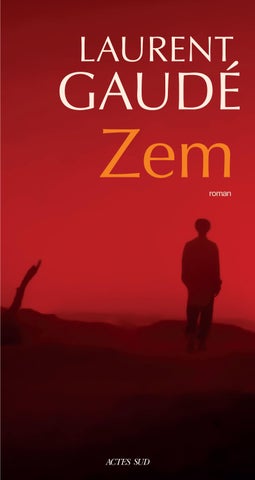LAURENT GAUDÉ
Zem
“Domaine français”
© ACTES SUD, 2025
ISBN 978‑2 330‑14094‑6
LAURENT GAUDÉ Zem
roman
La plupart des hommes veulent durer. Je l’ai vu mille fois. Ils s’accrochent, sont prêts à supplier pour obte‑ nir quelques jours de plus, quelques heures même, et pleurent lorsqu’ils finissent par comprendre qu’ils ne les auront pas. Moi, pas. Au moment de tout quit ter, je n’ai supplié personne. Je croyais que c’était la fin. Je l’avais appelée de mes vœux. Et pourtant, je suis encore là. Je n’arrive pas à mourir. La plupart des hommes pensent que c’est une chance. Moi, je dis que c’est une malédiction. Les voix tournent. Je les entends. Elles se relaient. “Monsieur Sparak ?” Des voix inconnues mais prévenantes. “Monsieur Sparak ? Vous m’entendez ?” Pourquoi ces gens se soucient‑ils tant de me faire revenir au monde ? “Zem ? Zem ?” La voix de Salia vient s’ajouter à celles des autres et m’enlève au cours de mes pen sées. Je ne sais pas où je suis. “Zem ?” Est‑ce qu’elle me gifle ? Est‑ce qu’elle tente de me faire cracher toutes les pilules d’Okios que j’ai ingérées ? Pour quoi fait‑elle cela ? Je veux juste rester dans mes visions, entouré des rues d’Athènes que j’ai quit tées il y a trente ans parce qu’on avait vendu mon pays, les rues d’Athènes en noir et blanc qui défilent
sous mes yeux, lentement, grâce à la drogue. Je veux qu’on me laisse. “Zem ?” Je suis dans les limbes et tout se mélange. Mes enquêtes, les meurtres, l’air triste et étonné qu’ont les cadavres. Je revois tout. Est‑ce que je suis encore au troisième étage de chez Miki, allongé au milieu d’autres corps qui, comme moi, ont pris des pilules et ne savent plus distin‑ guer le monde qui les entoure ? Il me semble sen tir Salia, penchée sur moi. Elle me secoue, me gifle, veut que je me réveille. “Zem ?” Elle est têtue. C’est ce qui fait sa qualité d’inspectrice. Je ne pensais pas qu’elle se battrait tant pour que je revienne à moi. Je m’imaginais qu’elle avait compris. Je veux tout quitter, que le monde s’efface. Je sens qu’on me gifle. Mais l’instant d’après, je me prends à dou‑ ter. Est‑ce moi qui reçois les coups ou suis‑je celui qui les donne ? Est‑ce que je suis en Grèce, dans une cave, à la merci de mes bourreaux ? Ou est‑ce moi qui tape ? Je l’ai fait. Ailleurs. Plus tard. Sou vent. Les interrogatoires musclés. Je l’ai fait. Briser les résistances. Voir la peur fissurer un être humain. Je l’ai vu. “Zem ?” Qui m’appelle ? Je reconnais cette voix. Ce n’est plus celle de Salia, c’est celle de Léna. On dirait que le temps est aboli. La voix n’a pas changé. Elle est en moi depuis si longtemps, dans un recoin de ma mémoire, intacte, sauvée du désastre. Léna. Est‑ce que tu m’as trahi ? J’essaie de te voir telle que tu étais, vive comme un cou teau, lorsque nous nous battions contre le rachat de notre pays, portés par notre jeunesse. “La vie plus forte que la politique”, disais‑tu. Je me sou‑ viens de tout. Et tout ressurgit. C’est le point fixe qui balaie tout le reste. Il m’en suffit d’un. Avec lui, je peux faire tourner le monde. Léna de ma
jeunesse. Nous nous sommes perdus parce qu’ils ont acheté la Grèce et l’ont vendue par bouts. Ils en ont fait une poubelle. Et nous sommes tous deve nus des apatrides. Ou plutôt des “cilariés”, comme ils disent. Citoyens salariés de GoldTex qui s’oc cupe de nous, s’occupe de tout. Chacun a vécu une vie loin de l’autre. Mais ils ne peuvent pas décider de ce qui a le plus d’importance. Si je dis que ce fut toi, Léna, alors je peux accrocher le monde à ton nom et le faire se balancer comme à un clou. C’est toi, l’horloge de tout. “Zem ?” J’entends des bruits d’hôpital. Je sais que ce sont les appareils qui mesurent mes constantes. Je suis fatigué. Laissez‑ moi mourir avec mes souvenirs. C’est ce qui fait une vie : un cortège de scènes, de visages, de sou‑ rires, dans un recoin de mon âme que personne ne peut atteindre. Je ne suis plus dans la salle de chez Miki. Il y a eu des secours, des gestes d’urgence pour tenter de me sauver de l’overdose. Je n’ai rien senti mais je sais très bien comment cela s’est passé.
La descente dans la rue sur un brancard. Le trajet à toute vitesse dans le quartier de RedQ. Et Salia qui exige que je sois transféré dans un hôpital de la zone 2, le meilleur même, et devant la tête étonnée des ambulanciers, elle montre sa carte de police, les injurie, les menace, les prévient qu’ils auront des soucis… Salia, comme une enragée. Je peux la voir. Les mains s’agitent sur moi. Les machines font de drôles de bruits. Tout le monde s’inquiète. Je flanche de nouveau. Massage cardiaque, défibril‑ lateur, laissez‑moi mourir, mais non, j’entends les constantes avec leur bip régulier, c’est ailleurs main‑ tenant, il y a un silence épais autour de moi, ce doit être une clinique, alors je sais, je ne peux plus en
douter, que je vais vivre, et la colère monte, je hurle contre Salia. Elle est là, devant moi, livide. Elle ne comprend pas. Je lui demande pourquoi elle m’a trahi. Je lui dis d’aller au diable, que c’est sa faute si je retourne à ma misérable vie parce qu’elle, plus que tout autre, aurait dû savoir qu’il fallait me lais‑ ser mourir. J’avais confiance. Je lui avais confié ce secret : que j’allais partir, que c’était bien, que c’était ce que je voulais, mais non, il a fallu qu’elle aille me chercher jusque dans la mort. Je crie. J’arrache mes perfusions. Je sais que c’est injuste… Salia, devant moi, s’est décomposée, fautive comme une enfant. C’est injuste, je le sais. Elle n’y est pour rien. C’est simplement la mort qui ne veut pas de moi. Je dois errer. Encore. Parce que je suis celui qui ne meurt pas. C’est mon châtiment. J’écoute les machines autour de moi. Elles font un bruit régulier. C’est leur façon à elles de me dire qu’il faut se résoudre. Alors, je capitule, je reprends ma vie, triste vie et j’ouvre les yeux.
ADDICTION
“Chienne… la pute… souillure… ça coule et glisse de merde…” Salia Malberg sort de la clinique Bol‑ tarex avec empressement, comme si elle allait vomir sur le trottoir. Les mots qu’elle vient de lâcher lui font du bien. Ils sont sortis d’elle comme un geyser de boue trop longtemps contenu. Elle connaît ça par cœur. Cela fait trois ans qu’elle vit avec ce volcan intérieur. Depuis la bastonnade qu’elle a subie trois heures de suite, ligotée à une chaise en étant bom bardée d’images d’horreur, viols, meurtres, salissure. Rien n’est parti. Ça s’est logé en elle. Elle le contient de mieux en mieux, parvient à retarder le moment où tout va jaillir, mais elle ne peut pas faire taire tota‑ lement le magma. Parfois, il faut tout laisser sortir. “Truie qui se bâfre… merde… merde… gueule de trou, pluie de sang…” Elle se sent mieux maintenant et respire avec un profond soulagement. Le psycho‑ logue qui la suit lui a dit qu’il faudrait des années pour faire disparaître les symptômes. Elle l’a écouté poli ment, avec un air concentré, mais au fond, elle s’en fout. Ce n’est pas elle qui a choisi de se faire suivre. C’était la condition sine qua non pour qu’elle puisse reprendre les enquêtes. “Te faire accompagner”, a dit
son supérieur. Accompagner où ? Dans le torrent de boue qu’elle a en elle ? Qu’est‑ce qu’ils y connaissent, les psychologues ? Ont‑ils seulement été bastonnés ? Est‑ce qu’elle peut leur parler de cette envie irrépres‑ sible, de ces mots qui lui montent aux lèvres et qu’elle ne peut réfréner ? Est‑ce qu’ils peuvent comprendre que les visions viennent d’un coup, toujours à des moments parfaitement imprévisibles et qu’alors il y a une sorte d’étrange jouissance à tout déverser hors d’elle ? Elle sait que cela ne la quittera plus jamais. Elle le sent. Malgré ce que disent les médecins qui prennent une voix douce et parlent de progrès, de trajectoire très encourageante et de perspectives d’avenir, comme si elle était un plan de développement d’entreprise… Aujourd’hui, il lui a demandé de par‑ ler de ce qu’elle avait enregistré sur son Aldilà. C’est lui qui a voulu qu’elle s’inscrive à ce programme de stèle funéraire numérique. Réfléchir à ce qu’elle veut laisser derrière elle peut avoir une vertu thé rapeutique, lui a‑t‑il dit. Elle a menti. Elle a expli‑ qué qu’elle avait commencé, que cela lui faisait du bien. La vérité, c’est qu’elle déteste ce qu’on l’oblige à faire. Elle voudrait ne partager son mal avec per‑ sonne. Mais elle essaie de se calmer en se répétant que c’est fini. Elle vient de sortir. Cette fois encore, elle a fait bonne figure. Il l’a trouvée bien, il le lui a dit. “Vous êtes en progrès. C’est très encourageant.” C’est tout ce qui compte. Parce que cela signifie qu’elle est tranquille pour un mois. Jusqu’au pro‑ chain rendez‑vous. C’est ce qu’elle se dit : un mois où elle est rendue à elle‑même. Alors, elle respire, se dirige vers sa voiture et démarre.
Zem Sparak arrive sur l’avenue des Bosquets au niveau du petit supermarché tenu par la vieille Miranda à qui il prend toujours au passage un café à emporter. Elle le salue comme tous les matins d’un retentissant : “Bonjour, capitaine”, sans qu’il ait jamais compris ce qui avait pu lui faire penser qu’il était doté d’un quelconque grade militaire. Une fois son café payé, il entre dans la rue des Sept‑Filtres.
Un peu plus loin, devant le siège officiel des Grands Travaux, il aperçoit deux voitures qui attendent, portières ouvertes, au pied du grand escalier.
“Pourquoi y a deux voitures ?” demande‑t‑il en s’approchant d’un des chauffeurs.
“Ordre de la Sécurité, lui répond le gars. Ça va être comme ça pendant toute la période des céré‑ monies officielles.”
Et il explique qu’avec la fête des Cinq Cents Jours qui arrive, le degré de sécurité a été monté. Les ten sions avec MolochFirst se multiplient.
“T’imagine si ces salauds s’en prenaient à Bar sok en pleine cérémonie…”
Zem répond d’une moue dont il est difficile de comprendre si elle est dubitative ou si elle est un signe d’acquiescement.
C’est à cet instant que Barsok sort du bâtiment. Il marche d’un bon pas, regarde devant lui. On dirait qu’il a envie de croquer le jour naissant. Un appétit d’ogre se dégage de son corps, de son visage. Comme si tout autour de lui devait être humé, goûté. Il descend l’escalier du parvis avec célérité, fait un petit signe de la tête à Zem pour le saluer et lorsqu’il s’engouffre dans la voiture de tête, il lui lance : “On va sentir l’air du large, Zem ?” puis
sans rien ajouter, il s’assoit, laissant son interlocu teur un peu surpris.
Zem ferme la portière, fait le tour du véhicule, et ce n’est que lorsqu’il s’assoit à son tour qu’il entend Barsok dire au chauffeur, avec un sourire de conspi rateur : “Au port.”
Ce sont toujours les mêmes circuits de vie. Depuis deux ans. Elle va de chez elle au commissariat. Du commissariat à la clinique. Et elle recommence. Quelque chose s’est arrêté dans son existence. Ils pensent tous que c’est à cause de la bastonnade, ce moment où son corps a été pilonné par des images insupportables, ravageant tout en elle, mais ils se trompent. C’est depuis que Sparak l’a chassée. Elle se souvient de la violence de cette scène. Elle était venue, comme si souvent auparavant, pour lui parler, l’encourager. Il était sur son lit d’hôpital. Elle était contente parce qu’il avait manifestement repris des forces, mais il l’avait chassée. Visage fermé. La haine dans les mâchoires. “Fous le camp.” Elle était restée interdite. “Dégage !” Il avait renversé son plateau‑ repas de rage, avait menacé de lui jeter son verre à la figure. Elle n’aime pas s’en souvenir mais cela la hante. Le visage tendu de Sparak, crispé. Les mots qu’il lui crachait à la figure. De plus en plus fort. Les infirmières avaient fini par venir. Elles avaient essayé de le calmer, mais sans y parvenir, alors on lui avait demandé de partir, de quitter les lieux, et elle l’avait fait. Elle était descendue en courant, comme un enfant humilié qui veut s’enfuir à l’autre bout du monde. “Fous le camp.” Elle était allée directe ment à RedQ. Au club Itami. Cela faisait longtemps
qu’elle tournait autour sans se résoudre à en pous ser la porte. Ce jour‑là, bouleversée par ce qu’elle venait de vivre, elle n’avait pas hésité. Et c’est là qu’elle va, de nouveau. Car depuis ce tout premier jour, c’est ce qu’elle fait après chaque séance à la clinique Boltarex. Elle est accro à la bastonnade. Il n’y a que cela qui lui fasse du bien. Elle coupe la connexion de la voiture. Ce n’est pas qu’elle veuille cacher à son DataGulper où elle va. Elle sait bien qu’il le saura. Il la voit entrer dans le club Itami. Il peut ensuite – s’il le souhaite – se connecter aux caméras intérieures et la voir descendre jusque dans la cave, cela lui est égal. Mais elle veut juste qu’il ne demande rien, ne pose aucune question. Être seule lorsque le gars au crâne à moitié rasé lui ouvre la porte. Être seule lorsqu’elle descend les marches qui la séparent de cet autre monde. Être seule. C’est la seule chose qui lui fasse du bien. Elle va retrou‑ ver la salle de traitement, s’asseoir sur le tabouret, se sangler elle‑même les pieds à la chaise. Elle sera bien. Elle a hâte. Elle sait que tout cela est absurde : aller à la clinique pour se faire soigner et descendre ensuite chez Itami pour se faire bastonner. Mais elle a renoncé à comprendre ce qui était en elle. Elle veut juste qu’on lui pose le casque sur les yeux et que la séance commence.
Barsok est de bonne humeur. Il a envie de parta‑ ger sa joie. Il n’arrête pas de parler. “On va y arriver, dit‑il. Les choses bougent.” Et il y a de la convic‑ tion dans sa voix. Il a toujours eu cette force de per‑ suasion, cette capacité à se saisir du réel et à vous donner envie d’y croire. Les Grands Travaux qu’il a
lancés sont populaires. Tout le monde aime le slogan qui l’a rendu célèbre : Une seule zone pour une seule ville ! GoldTex va mieux depuis que Kanaka et lui sont alliés. Une nouvelle dynamique est née et il en est le visage. L’époque où ils étaient rivaux semble loin. Kanaka l’avait neutralisé grâce aux résultats de l’enquête de Zem et Salia mais aujourd’hui, Barsok incarne le renouveau. Kanaka, lui, a mis la main sur la Commission directoire.
“On est à deux doigts d’y parvenir, Zem.” continue‑ t‑il. Et il explique qu’avec l’ouverture du deuxième port, GoldTex va franchir un cap. Qu’ils vont écra ser MolochFirst, SafeGlobe et toutes les Sociétés Monde. Il le dit et ses yeux brillent. Il ajoute qu’il faut simplement qu’ils y parviennent dans les délais impartis. C’est crucial. Et là aussi, il le répète, comme si Zem pouvait y faire quelque chose, comme si l’ouverture du port dépendait de sa bonne volonté à lui. “Ça va être énorme.” Et on sent qu’il voudrait en dire davantage mais ne peut pas. On sent qu’il a hâte que tout cela soit révélé parce qu’il sait qu’alors, on l’acclamera comme jamais et que c’est par cette action que son nom passera à la postérité. “Ce sera comme lorsque Yehu Rami a inauguré le dôme cli matique. Un moment d’histoire…” Et Zem déjà ne l’écoute plus tout à fait. Il ne peut s’empêcher de penser que cela aussi, il le verra disparaître. Un jour, il se souviendra de ces instants comme d’un monde si lointain qu’il finira par se demander quelle faute il a commise pour survivre ainsi à tout et rester seul. Barsok continue à parler. Mais l’esprit de Zem s’évade. Il pense à ce jour où l’homme politique était venu le voir à l’hôpital. Il pense à cette drôle de fata lité qui les unit l’un à l’autre. La voiture glisse dans
les rues vides de Magnapole. Il est encore trop tôt pour que les avenues soient engorgées de voitures et de camions. Ils roulent vite. Zem se souvient de ces moments où il était à peine conscient, dans un état de flottement qui rendait tout flou. Des voix l’appe laient. On lui soulevait un bras, un pied. Des gens s’agitaient autour de lui pour qu’il vive. Ce n’était pas le même endroit que là où Salia l’avait déposé après son overdose. Il y a eu deux chambres d’hôpi‑ tal, à deux moments différents de sa vie mais parfois, il a du mal à les distinguer. Il se souvient de ce jour où Barsok a surgi dans la première chambre. Il était venu lui rendre visite, à la sidération des infirmières qui le soignaient. Elles avaient cru si longtemps qu’il n’était qu’un pauvre diable que de voir arriver un haut membre de la Commission les avait sidérées. “C’est exactement ce dont j’ai besoin”, avait dit Bar sok avec la même voix qu’aujourd’hui. Gourmande. Facétieuse. “Je vous avais bien dit qu’on finirait par travailler ensemble, Sparak”, avait‑il ajouté. Le visage de Zem devait trahir de la perplexité parce que Bar sok avait expliqué : “Un homme qui veut mourir, c’est exactement ce que je cherche.” Et il avait parlé de sa volonté de l’avoir à ses côtés comme garde du corps. Il répétait en riant : “Un garde du corps sui‑ cidaire, c’est l’idéal. Il n’aura qu’une envie, c’est de prendre la balle à ma place !…” Zem n’avait pas eu la force de rire, ni même de parler. Il n’avait – de toute façon – plus d’idées sur ce que devait être sa vie, alors il avait acquiescé et fermé les yeux. Garde du corps. C’est ce qu’il avait effectivement fait lors‑ qu’il était sorti de ce premier hôpital. Pendant des mois. La voiture file. Ils passent devant le check‑ point de la Fosse ouest. Zem pense qu’il l’a connu
au moment des Grandes Émeutes, lorsqu’il avait été attaqué par les révoltés de la zone 3. Qui d’autre que lui s’en souvient ? Il est passé tant de fois devant. Il y a attendu des heures en voiture. Il y a montré ses papiers et il y avait toujours de la suspicion dans le regard des gardiens. Aujourd’hui, l’intérieur du check‑ point a été aménagé en café participatif. À l’endroit où les cocktails Molotov des manifestants éclataient, il y a maintenant une terrasse verte. Ils ne doivent plus être très nombreux à pouvoir se remémorer ce qui fut ici avant. Au fond, c’est peut‑être aussi cela qui le lie à Barsok. La voiture roule. Il a le sentiment d’avoir traversé les limbes tant de fois. Car il y avait eu le deuxième hôpital. Combien de temps après ? Un an ? Deux ans ? Il ne saurait le dire avec certi‑ tude. Il ne compte plus. Il se souvient juste de Bar‑ sok entrant dans cette nouvelle chambre. Cette fois, il avait le visage grave et Zem avait vu de la grati‑ tude dans ses yeux. Il voulait lui dire qu’il lui était redevable, qu’il lui avait sauvé la vie. Ils étaient tous les deux unis par ces images qui les hantaient : l’ex plosion, dans le stade, à quelques dizaines de mètres d’eux, le souffle qui balayait tout, le son qui les avait rendus sourds, les corps, les gravats, et cet homme, venant de l’autre côté du stade, habillé en policier, mais avec un fusil automatique, traversant la pelouse centrale et marchant droit sur Barsok. Zem revoit la scène. L’homme qui avance ainsi, fusil à la main, vers un tas de blessés. Il avait su tout de suite qu’il était là pour les tuer. Il avançait vite, ne se souciait de rien d’autre que de sa cible. Rien de ce qui l’entourait ne l’étonnait ni ne l’horrifiait. Il avançait. Zem se sou‑ vient de sa propre lenteur. Il était encore sonné par l’explosion. Il avait eu le temps de penser qu’il ne
serait peut‑être pas assez rapide. Il ne trouvait pas son arme, ou plutôt, il sentait la crosse de son pistolet sous les doigts mais n’arrivait pas à le sortir de son étui – et ce temps‑là était celui de la peur, car Barsok lui aussi voyait l’homme qui approchait et l’avait mis en joue. Il avait eu le temps de comprendre qu’il allait mourir. Il ne pouvait rien faire, ni fuir ni se cacher. Il allait mourir et lorsque, enfin, Zem avait tiré et que l’as saillant s’était effondré, le visage de Barsok était celui d’un enfant en pleurs. C’est pour cela qu’il ne disait rien dans la chambre d’hôpital. Il n’avait pas besoin de parler, Zem savait qu’il pouvait tout lui deman der, mais il savait aussi qu’il ne le ferait pas car cela faisait bien longtemps qu’il n’avait plus rien à deman der à personne. Il était une ombre qui ne voulait rien, n’aspirait à rien. Ce qu’il désirait – mourir – lui avait été refusé. D’une chambre d’hôpital à l’autre, le temps avait passé. Et cela allait continuer. Encore et encore. Peut‑être finirait‑il par prendre une balle en essayant de sauver de nouveau Barsok ? À moins qu’il ne dure éternellement ? C’est la seule idée qui lui fasse peur, la nuit, lorsqu’il marche dans les rues de Magnapole : la possibilité que tous ceux qu’il croise, tous ceux à qui il parle, meurent avant lui. Qu’il soit né pour enterrer les mondes les uns après les autres. Peut‑être, au fond, n’est‑il que cela : un fossoyeur ?
Le patron du club Itami a lancé le programme mais ce n’est pas assez fort. Des images lentes pour des esprits fragiles. Ce que veut Salia, c’est que ça cogne. Elle le dit : “Plus fort !” Elle sait qu’ils l’en tendent dans la cabine de contrôle. “Plus fort !” Et
ils accélèrent. C’est mieux. Les images sont plus rapides, plus violentes. Corps nus qui se mordent, animaux qui hurlent et montrent des mâchoires pleines de sang. C’est mieux. “Plus fort !” Elle veut que ça monte. Ce n’est rien par rapport à la baston nade qu’elle a connue. Il faut que ça tape davantage. Qu’est‑ce qu’ils peuvent y comprendre, les psycholo‑ gues aux bonnes mines ou les deux gars de la cabine de régie qui se marrent parce qu’ils la prennent pour une détraquée ? “Plus fort !” Ils n’ont aucune idée de ce qu’elle vient chercher ici. Elle est prise dans ce cercle‑là : se soigner, se bastonner, se soigner et recommencer. Elle ne peut plus vivre sans, et son DataGulper va lui demander pourquoi elle était hors circuit pendant quarante‑cinq minutes lorsqu’elle reviendra dans sa voiture et elle ne répondra rien parce qu’elle ne pourra pas parler, pas encore, il faut du temps quand elle sort d’une séance pour qu’elle revienne à elle. Elle titubera, aura soif, essaiera de reprendre vie. Peut‑être ne demandera‑t‑il rien car il s’est habitué, depuis ce jour, premier jour, où on les a mis en tandem. C’était il y a combien de temps ? Il lui parlait dans l’oreillette, lui indiquait tout ce qu’il pouvait lui procurer comme information, en temps réel : si la personne qu’elle avait devant elle était sous le coup d’un mandat, si elle avait payé ses factures, dans quelle école allaient ses enfants, si elle était à jour de ses cotisations, quels étaient les dix derniers numéros qu’elle avait appelés, à combien elle réglait son chauffage et de combien d’heures était son temps d’écran, et puis il y avait eu cette annonce qui avait grésillé dans la radio de la voiture. “Demande de renfort à tous les véhi cules. Attentat au stade. Présence possible parmi
les victimes de membres de la Commission. Alerte maximale.” Elle avait dû appuyer sur l’accélérateur. Son DataGulper lui proposa un parcours alternatif plus rapide en passant par le pont Kartage, et c’est là, une fois dessus, qu’elle avait freiné, sans savoir pourquoi. Elle s’était arrêtée sur la bande d’arrêt d’urgence de ce grand axe à trois voies. Elle avait marché jusqu’à la rambarde. Au loin, on voyait le stade. Une fumée noire en montait. On entendait des sirènes de police, d’ambulances. Tous les véhi cules de la ville semblaient converger vers le bâti‑ ment touché, et elle, elle était restée là. Elle avait laissé son oreillette sur le siège de la voiture pour ne pas entendre la voix du DataGulper lui demander ce qu’elle faisait et elle avait fumé une cigarette. Juste cela. Elle s’était soustraite à tout autour d’elle, l’ur‑ gence, la panique, les cris, les sirènes. Juste cela. Et à sa grande surprise, le DataGulper n’avait rien dit. Il n’avait pas fait de rapport, pas signalé son acte de sédition. Pourtant, à la seconde même où elle avait quitté son véhicule, il s’était branché sur les camé ras de la voie rapide et il l’avait vue, là, contem‑ plant la ville en fumant une cigarette, et cela lui avait semblé si étrange qu’il n’avait rien dit. Peut‑ être n’avait‑il pas de paramètres pour appréhender cette situation ? Toujours est‑il qu’il n’avait pas fait de rapport. Et chose plus étrange encore, il avait menti. Elle ne pensait même pas que ces Intelligence Ultra pouvaient le faire. Il avait déclaré le disposi‑ tif électronique de la voiture en mise à jour, légiti‑ mant ainsi qu’elle n’ait pas répondu à l’appel. Depuis ce jour, elle l’aimait bien, son DataGulper, et elle l’avait baptisé Motus bien qu’il passât son temps à lui murmurer des informations à l’oreille. Par quel
étrange cheminement algorithmique avait‑il décidé d’enfreindre le protocole et de ne pas la dénoncer ? Avait‑il compris que sa mission – au‑delà de toute autre chose – était de la servir, de la comprendre dans son entièreté, avec toute son ombre et son mystère ? Motus s’était tu, oui, et c’est ce qu’il fai‑ sait chaque fois qu’elle sortait de chez Itami, titu‑ bante, remontant avec difficulté dans sa voiture, pleine d’une violence qui semblait encore lui couler des yeux. Il ne disait rien. Attendait qu’elle revienne à elle. La vie n’était plus faite que de cela : se soi‑ gner puis se casser, dans un éternel recommence ment. Si quelqu’un lui avait demandé pourquoi elle se détruisait ainsi, elle aurait répondu qu’elle cherchait quelque chose et que l’objet de sa quête – elle en était certaine – se trouvait dans le magma immonde qu’elle avait en elle. “Plus fort !” C’est pour cela qu’elle crie. Parce qu’il faut que ça conti‑ nue, que ça croisse. La souillure. Les déjections. Les morsures. Elle reçoit tout. Le gars augmente encore la puissance, se demandant jusqu’où elle peut encais ser, et le corps de Salia se met à trembler comme celui d’une épileptique. À cet instant, quelque chose s’ouvre en elle. Un grand silence l’emplit soudain. Elle voit un arbre qui domine une montagne sèche, frappée de soleil. Au pied du tronc, il y a un banc en bois, un peu de guingois. Elle est à quelques mètres. Elle pourrait s’asseoir sur le banc mais elle reste debout, contemplant le paysage. C’est si beau. La montagne tombe en à‑pic dans la mer. Elle ne connaît pas cet endroit, n’est jamais venue ici, ne peut pas imaginer des terres si vastes sans habita‑ tions et aux couleurs si tranchées. Elle suffoque de beauté. Et lorsque, enfin, la machine s’arrête et que
sa tête retombe inerte, sur sa poitrine, elle pleure. Non pas de la violence qu’elle vient d’avaler, mais de cette vision pure, éphémère, qui lui a été offerte et sur laquelle elle voudrait pouvoir serrer le poing pour la garder toujours.
LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS
De retour dans les rues de Magnapole, Zem Sparak, l’ancien flic déclassé de la zone 3 – le “chien” au matricule 51 –, assure désormais la sécurité rapprochée de Barsok, l’homme qui a promis d’abolir les différences de classe et de réunifier la ville.
À l’approche du jour censé célébrer l’avancée des Grands Travaux, et alors que toutes les caméras sont tournées vers le port où arrive un cargo chasseur d’icebergs, un container livre une funeste découverte : assis côte à côte, cinq cadavres anonymes portent les traces d’atroces souffrances. L’occasion pour Zem de retrouver l’inspectrice chargée de l’enquête, Salia Malberg. Ensemble, ils vont tenter de comprendre ce que cache le consortium GoldTex : à Magnapole, comme ailleurs, le confort des uns semble bâti sur la vie de milliers d’autres…
Ce nouveau roman de Laurent Gaudé est un miroir tendu à nos sociétés consuméristes en proie à l’effondrement. Mais il abrite aussi l’idée d’un ailleurs, d’un refuge face au désastre, nommé résistance.
Né en 1972, Laurent Gaudé a reçu en 2004 le prix Goncourt pour Le Soleil des Scorta. Romancier, nouvelliste et dramaturge, il construit une œuvre protéiforme, d’ Eldorado (2006) au récit Terrasses ou Notre long baiser si longtemps retardé (2024), entièrement parue chez Actes Sud.
Photographie de couverture : dr
www.actes-sud.fr
DÉP. LÉG. : AOÛT 2025 / 22 € TTC France