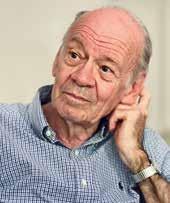Monnard




Jean-François Monnard

Monnard




Jean-François Monnard
Les textes de cette publication sont basés sur les préfaces des éditions Ravel éditées par Jean-François Monnard et ont été en partie révisés ou augmentés dans ce cadre
PB 5299 Bolero
PB 5374 La Valse
PB 5530 Rapsodie espagnole
PB 5539 Valses nobles et sentimentales
PB 5540 Le Tombeau de Couperin
PB 5532 Tableaux d’une exposition
PB 5650 Daphnis et Chloé
PB 5716 L’ Heure espagnole
PB 5753 L’Enfant et les Sortilèges
BV 516
ISBN 978-3-7651-0516-6
© 2025 by Breitkopf & Härtel KG
Walkmühlstraße 52
65195 Wiesbaden / Germany info@breitkopf.com www.breitkopf.com
Tous droits réservés
Photo de couverture : Portrait M. Ravel © picture alliance / Heritage Images / Lipnitzki Portrait J.-F. Monnard © Breitkopf & Härtel / Arthur Mildner
Conception de la couverture : Tankred Steinicke (Breitkopf & Härtel)
Composition et mise en page : Tankred Steinicke (Breitkopf & Härtel)
Impression : Plump Druck & Medien GmbH, Rheinbreitbach
Imprimé en Allemagne
L’éditeur des éditions « Urtext » de Maurice Ravel jusqu’à présent publiées chez Breitkopf & Härtel est le chef d’orchestre et musicologue Jean-François Monnard, d’origine suisse (Lausanne). Il est expert en matière de Ravel, et en 1997 déjà il a commencé à travailler sur une nouvelle édition critique de La Valse. Presque dix ans plus tard, le jour est arrivé : la première partition de Ravel sous l’égide de M. Monnard est parue chez Breitkopf & Härtel. Durant les années suivantes, il a complété le programme éditorial de nouvelles éditions supplémentaires d’œuvres pour orchestre et la scène de Ravel. À l’occasion du 150e anniversaire de Ravel en 2025, nous avons parlé avec JeanFrançois Monnard de son travail en tant qu’éditeur et de son rapport avec la musique de Ravel.
Breitkopf & Härtel : Monsieur Monnard, qu’est-ce qui fait de Maurice Ravel un compositeur aussi particulier ?
Jean-François Monnard : C’est surtout son œuvre, toujours au même haut niveau. C’est également sa personne qui fascine, sa manière de se glisser librement dans le rôle de magicien et illusionniste. Enfin la modernité qui fait de Ravel un précurseur de nos temps, bien qu’il reste en même temps un contemporain de son époque.
B&H : Comment vous êtes-vous rapproché de l’œuvre de Ravel dans votre rôle d’éditeur ?
JFM : L’aventure a commencé dans les années 90, lorsque Breitkopf & Härtel m’a contacté pour me proposer de publier une édition critique de La Valse, et ce « avec le regard d’un chef d’orchestre soucieux de la fiabilité du texte musical et des conséquences liées à la pratique de l’exécution »*. La première étape a été une visite à la Bibliothèque nationale de France à Paris pour faire une copie de la première impression de la partition, suivie par une démarche auprès de la Pierpont Morgan Library à New York pour obtenir la photocopie de la partition autographe, mise au net par Ravel. Une fois les documents explorés et passés au peigne fin, une recherche intensive de sources supplémentaires s’est ensuivie. Ces investigations n’ont pas toujours été encourageantes, mais heureusement j’avais à mes côtés des correcteurs expérimentés.
B&H : Le travail sur les éditions individuelles a pris plusieurs années. Votre objectif a-t-il changé pendant ce temps-là ?
JFM : Mon but n’était pas de mieux comprendre les œuvres de Ravel, mais de mieux ausculter le texte, s’y immerger et en percevoir toutes les subtilités, pour respecter l’intention de l’auteur et déceler la pensée qui s’organise. Cela demande d’y aller par étapes, avec une discipline empreinte d’objectivité et débarrassée d’états d’âme, et cette portion d’humilité indispensable pour approcher les chefs-d’œuvre.
Préface
Interroger les notes
Après avoir tenu le rôle de chef d’orchestre dans une première vie, je continue à interroger les notes. D’une autre manière, mais avec la même passion. L’examen des manuscrits de Ravel constitue une quête de la vérité. « Le manuscrit est la source originelle, à travers laquelle nous sommes placés à proximité directe de l’œuvre et de son caractère. »1 (András Schiff). Il s’agit de le déchiffrer avec une méticulosité quasiment maniaque. De le questionner sans relâche. En consultant le manuscrit, on a la chance d’avoir accès aux détails – des ratures, des corrections, des grattages, des taches – qui disparaissent lorsque le texte est édité. Cependant, dans la plupart des cas, le manuscrit ne saurait servir de référence absolue. En effet, la comparaison entre le manuscrit et la première version imprimée fait souvent apparaître de nombreuses différences. Il s’agit donc de chercher, à travers de minutieuses et patientes investigations, les véritables intentions du compositeur. Cela nécessite des allers-retours en permanence entre les sources, afin de récolter des faits bien assurés permettant ensuite de proposer une version de référence. C’est toujours un travail de longue haleine, qui fait que l’on tâtonne avant d’être capable de transformer une hypothèse en certitude. L’intuition oriente la recherche (même si on doit la récuser plus tard) et le mobile est celui de la rigueur.
Souvent, la notation de Ravel soulève des questions concernant des altérations manquantes, des liaisons escamotées ou des nuances qui mènent dans le vide, où le musicien à l’orchestre n’a pas connaissance de la dynamique requise. Parfois même, quand le doute vient paralyser la réflexion, on est soulagé et reconnaissant de pouvoir bénéficier des conseils de musiciens chevronnés, comme ceux de Charles Dutoit qui demeure un interprète incomparable de l’œuvre ravélienne.
L’étude des manuscrits de Ravel permet aussi d’apprécier l’excellence de la mise en œuvre, du travail artisanal, la beauté plastique et la précision de l’écriture – traits communs à la plupart des grands créateurs, ayant toujours valeur d’exemple aux yeux d’Henri Dutilleux. On sait que Ravel a réalisé des ébauches, fait des brouillons qu’il a corrigés, mais les mises au propre sont impeccables et nous offrent un grand plaisir esthétique. J’aime imaginer la main qui a tracé les signes sur le papier, déchiffrer les idées de sons, ausculter la promesse de résonance qui prend son bien dans l’immobilité, et décanter un peu d’âme entre les notes et les silences.
Bien que l’objet ne soit pas le même, la démarche du musicologue s’apparente à l’enquête de l’archéologue qui, après avoir dégagé le sable accumulé, découvre un trésor qu’il étudie attentivement avant de le restaurer et de libérer les ressources qui s’y cachent. N’y mettant rien de soi, surtout pas de subjectivité qui puisse voler l’œuvre à l’auteur. Comme on fait sortir l’eau de la terre, une vertu propre au sourcier qui, lui, sent les choses.
Jean-François Monnard
1 András Schiff, La musique naît du silence. Entretiens avec Martin Meyer, traduit de l’allemand par Maud Chignier, Paris 2018, p. 272.
1875 7 mars : naissance de Maurice Ravel à Ciboure.
1878 13 juin : naissance du frère Édouard à Paris.
1882 Premières leçons de piano avec Henry Ghys.
1888 Se lie avec Ricardo Viñes.
1891 Admis dans la classe de piano de Charles de Bériot au Conservatoire de Paris.
1893 Fait la connaissance d’Erik Satie.
1897 1er contrat avec l’éditeur Enoch (Menuet antique dédié à Ricardo Viñes).
1898 Admis dans la classe de composition de Gabriel Fauré.
5 mars : création des Sites auriculaires pour 2 pianos par Ricardo Viñes et Marthe Dron, salle Pleyel.
18 avril : création du Menuet antique pour piano solo par Ricardo Viñes, salle Érard.
1899 27 mai : création de Shéhérazade, Ouverture de féerie pour orchestre sous la direction du compositeur, Nouveau-Théâtre.
1902 5 avril : création de la Pavane pour une infante défunte et des Jeux d’eau pour piano solo par Ricardo Viñes, salle Pleyel.
1903 Fait la connaissance de Maurice Delage qui sera l’élève de Ravel et son ami le plus intime.
1904 5 mars : création du Quatuor dédié à Gabriel Fauré par le Quatuor Heymann, Schola Cantorum.
17 mai : création de Shéhérazade pour chant et orchestre par Jane Hatto sous la direction d’Alfred Cortot, Nouveau-Théâtre.
1905 Juin/juillet : croisière à bord du yacht Aimée d’Alfred et Misia Edwards. Novembre : parution de la Sonatine chez Durand qui deviendra l’éditeur exclusif des œuvres de Ravel.
* Sources comparatives
Marcel Marnat, Maurice Ravel, Paris 1986.
Maurice Ravel. Lettres, Ecrits, Entretiens, présentés et annotés par Arbie Orenstein, Paris 1989.
Roger Nichols, Ravel, New Haven 2011.
Maurice Ravel, L’intégrale. Correspondance (1895–1937), écrits et entretiens, éditée par Manuel Cornejo, Paris 2018.
« La danse, écrit André Suarès, gouverne toute la musique de Ravel... »1 Cette constatation convient parfaitement à la Rapsodie espagnole (sans h) qui n’est cependant pas un ballet. Contrairement au Bolero et à La Valse, la Rapsodie espagnole est une pièce symphonique de musique pure qui a été conçue à l’origine pour piano à quatre mains. Rhapsodique, elle l’est au sens large. Aux oreilles d’un Grec ancien, le mot rhapsodie se rattache à rhapsôdos qui définissait littéralement le fait de coudre (rhaptein) ensemble des éléments épars tout en chantant (ôdê). Dans l’Antiquité grecque, le rhapsode aède était donc une sorte de barde itinérant qui déclamait des poème antiques, spécialement des vers d’Homère. Au cours des temps, la rhapsodie s’affranchit de son support littéraire pour devenir une page musicale autonome et c’est à Franz Liszt que le genre doit sa transition à l’orchestre, s’inspirant du même coup des œuvres à thèmes populaires nationaux ou régionaux parfois réels, parfois imaginaires, le but étant de conserver à la rhapsodie sa couleur locale et son caractère épique. A ce titre, la Rapsodie espagnole mérite son nom : on peut la comparer à un patchwork de clichés andalous. C’est au cours d’un voyage d’un mois à bord du yacht l’Aimée de Misia et Alfred Edwards, en été 1907, que Ravel élabore les quatre mouvements de sa Rapsodie espagnole La Pierpont Morgan Library à New York conserve trois pages manuscrites de la main de Ravel (source K) constituant le premier jet du Prélude à la nuit dans son intégralité. Elles ne comportent aucune indication de mouvements, ni de nuances à l’exception d’un p expressif. Il y manque également de nombreux accidents. Ravel achèvera la version complète de la Rapsodie espagnole pour piano à quatre mains dans son appartement de Levallois en octobre de la même année, simultanément avec la version pour piano et chant de L’Heure espagnole. Quant à l’orchestration, il la termine en février 1908 alors qu’il dédie son œuvre à Charles de Bériot, dont il avait fréquenté la classe de piano au Conservatoire de Paris dès 1891. Une lettre à Ida Godebska 2 nous apprend qu’il ne corrigera les épreuves d’orchestre que fin mai / début juin, ce qui signifie clairement que les modifications apportées au manuscrit ont été faites au cours des répétitions ou même après la création qui fut donnée au Châtelet à Paris le 15 mars 1908 sous la direction d’ Édouard Colonne. Le programme assez hétérogène du concert débutait avec l’Ouverture du Roi d’Ys, se poursuivant avec l’« Inachevée » de Schubert, un fragment de La Nuit de Noël de Rimsky-Korsakov chanté par Mme de Wieniawski ainsi que la Ballade pour piano et orchestre de Fauré avec le concours d’Alfred Cortot. Puis ce fut le tour de la Rapsodie espagnole à laquelle succédaient des extraits de l’opéra La Fille de Neige de Rimsky-Korsakov, les Variations symphoniques de César Franck, de nouveau avec Cortot, et enfin la marche du deuxième acte de Tannhäuser. « Le public,
1 André Suarès, Pour Ravel, dans : La Revue musicale, avril 1925, p. 7.
2 Lettre de Ravel à Ida Godebska du 22 mai ou 5 juin 1908, voir Maurice Ravel, Lettres, Ecrits, Entretiens, présentés et annotés par Arbie Orenstein, Paris 1989, p. 96 s.
très spontanément quoi qu’on en puisse dire, accueillit chaleureusement l’œuvre ».3
Seule la Malagueña suscita un certain charivari et fut bissée sur une injonction venue du poulailler où la voix tonitruante de Florent Schmitt réclamait de jouer « encore une fois, pour ceux d’en bas qui n’ont rien compris ».
La Rapsodie espagnole se divise en quatre parties. Le Prélude à la nuit exprime « la lassitude d’une chaude fin de journée », écrit Vladimir Jankélévitch.4 Un motif de quatre notes – Fa–Mi–Ré–Dok – qui réapparaît dans Malagueña et Feria suggère en effet l’idée d’un lieu où la torpeur et la nonchalance provoquent une sensation d’alanguissement extrême que souligne le rythme binaire que Ravel a inséré dans une mesure à trois temps. L’intervention des clarinettes et des bassons sous la forme d’une cadence qui arrive à l’improviste atteste l’influence de Rimsky-Korsakov. Mais il ne fait aucun doute que Ravel privilégie l’économie de moyens.
La Malagueña est une sorte de Scherzo qui célèbre une danse ternaire de la Costa Brava. Le tempo de cette danse est d’ordinaire assez modéré. Ravel prescrit « Assez vif » et remplace le 3/8 par un 3/4. Les nuances qui ne dépassaient pas le mf dans le Prélude se font plus explosives et toute la gamme des percussions contraste résolument avec la suavité de la mélodie du cor anglais qui, par sa courbe mélodique, rappelle singulièrement le chant langoureux du basson solo dans l’Alborada. Et comment ne pas se souvenir que Ravel choisira la forme de malagueña pour l’ariette de Gonzalve dans L’Heure espagnole
C’est encore une danse qui occupe le troisième épisode, la Habanera, qui consacre la fascination du jeune Ravel pour une Espagne vulgarisée et idéalement pressentie à travers les récits de sa mère. « Quand il voulut caractériser musicalement l’Espagne, écrit Manuel de Falla, il se servit avec prédilection du rythme de habanera, la chanson la plus en vogue parmi celles que sa mère entendit dans les tertulias madrilènes de ces temps révolus... »5 Cette scène langoureuse n’est autre que l’orchestration d’une pièce pour deux pianos écrite en novembre 1895 et créée le 5 mars 1898 par Marthe Dron et Ricardo Viñes à la Société Nationale, ancienne salle Pleyel, en même temps que Entre Cloches sous le titre général de Sites auriculaires. « Les interprètes ayant peu ou pas répété, ce fut un cafouillis si fastueux qu’on en oublia la calme Habanera qui préludait. Seul, Debussy écouta de près cette Habanera, une géniale trouvaille pianistique en assurant la continuité […]. Cinq ans plus tard, le maître crut pouvoir s’emparer de cette astuce [Soirée dans Grenade]. »6 Ce fut l’origine de l’« affaire » Debussy-Ravel dont parle Manuel Rosenthal dans les Souvenirs qu’il a confiés à Marcel Marnat : « La Soirée dans Grenade des Estampes de Debussy (1903) semble calquer sa musique sur la Habanera de Ravel (1895), qui, mal accueillie, était tombée dans l’oubli lors de sa première publique, en mars 1898. Debussy avait demandé au jeune musicien une copie de cette pièce qui l’avait vivement intéressé. Devant les dithyrambes suscités par Soirée dans Grenade, Ravel dut faire remarquer publiquement l’antériorité de sa musique. Inévitablement, Debussy se brouilla définitivement avec son cadet. La légende veut qu’à
3 Jean d’Udine, dans : Le Courrier musical, 1er avril 1908.
4 Vladimir Jankélévitch, Ravel, Paris 1959, p. 44.
5 Manuel de Falla, dans : La Revue musicale, mars 1939.
6 Marcel Marnat, Faux-jours et pleine lumière : Ravel, dans : Cahiers Maurice Ravel n° 12, Séguier 2009, p. 10.
l’occasion d’un déménagement, peu après, on ait retrouvé la copie de la Habanera, tombée derrière le piano de Debussy. Ravel coupa court à tout rebondissement en orchestrant son œuvre et en la faisant figurer – avec sa date de composition – en troisième place de sa Rapsodie espagnole. » Et l’auteur d’ajouter : « Devant moi, il n’a jamais clairement accusé Debussy. Il esquivait en disant : ‹ Il l’a gardée plus longtemps que prévu. J’aurais dû la réclamer plusieurs fois. › »7 Il semble d’ailleurs que Debussy ait aussi « louché » sur Jeux d’Eau en composant, deux ans plus tard, Les Jardins sous la pluie. En 1913, il parlera de « phénomène d’autosuggestion » lorsqu’il apprend qu’exactement au même moment que lui Ravel avait mis en musique Soupirs et Placet futile
Dans ce contexte, on ne s’étonnera pas que le dernier mouvement de la Rapsodie espagnole, Feria, anticipe de très peu Iberia que Debussy achèvera à la fin de 1908. Comme son nom l’indique, Feria évoque une joyeuse foire musicale qui annonce la Bacchanale de Daphnis et Chloé, empruntant quelques thèmes à la Jota, populaire en Aragon. Les riches couleurs de cette danse endiablée et frénétique font encore penser au Capriccio espagnol de Rimsky-Korsakov, mais il ne s’agit en rien d’un chromo aussi rutilant. C’est surtout la science du crescendo ravélien qui se manifeste ici et qui laisse présager le déchaînement final de La Valse. D’aucuns soupçonneront Stravinsky en 1910 d’avoir « copié » les deux dernières mesures de la Rapsodie espagnole (traits des bois en un soufflet p –fff–p) à la fin de la Danse infernale de L’Oiseau de feu. Mais n’est-ce pas l’émulation qui suscite les chefs-d’œuvre ?
Outre le goût du rythme et du mouvement qui imprègne la partition où s’affirme déjà un sens prodigieux des progressions, on y trouve une inspiration et une palette de sonorités exceptionnelles. Il convient de relever certains détails d’instrumentation qui truffent ces pages séduisantes : la division des pupitres de cordes (dans le Prélude et la Habanera) qui crée une merveilleuse transparence, les arpèges en harmoniques du 1er violon solo (Prélude, mes. 54 → 1-01, p. 79) les coups d’archet qui se répètent au talon (Prélude, mes. 32–35), les effets sur la touche (Malagueña, mes. 40–45) ou avec le dos de l’archet (Feria, mes. 127–130 → 1-02, p. 79) sans oublier l’emploi du glissando. On notera celui de la contrebasse solo dans l’aigu (Feria, mes. 75 ss. → 1-03, p. 80) ainsi que l’injonction de « glisser en effleurant la corde du côté du chevalet » (Feria, mes. 6 → 1-04, p. 80). Ravel fait un usage savant du flageolet et ne craint pas de confier à la harpe un sol aigu (Feria mes. 1–6, 14–16) et des accords de cinq notes en harmoniques (Feria, mes. 88, 139 s. → 1-05, p. 80). On notera également l’alternance de sons avec sourdine et bouchés sans sourdine aux cors (Prélude mes. 56–60) et le défi que représente pour les trompettes le fait de mettre la sourdine tout en jouant (Habanera, mes. 57–60 → 1-06, p. 80). En outre, il est intéressant de remarquer dans la nomenclature des instruments la présence d’un sarrusophone ; avec son articulation souple et sa sonorité splendide dans le grave, il remplace avantageusement le contrebasson. Sur le plan harmonique, la mélodie ravélienne est résolument modale. Elle s’inscrit aussi naturellement dans les modes anciens que le chant populaire des provinces espagnoles (Malagueña, mes. 73–75 → 1-07, p. 80, Habanera, mes. 9–12 → 1-08,
7 Ravel. Souvenirs de Manuel Rosenthal, recueillis par Marcel Marnat, Paris 1995, p. 75.
G G G G G G NB 01-01 G G B B
1-03 (Feria, Cb. I solo, mes. 75–77)
1-06 (Habanera, Trp. I–III,
Nicht alle Seiten werden angezeigt.
This is an excerpt. Not all pages are displayed. Have we sparked your interest? We gladly accept orders via music and book stores or through our webshop at www.breitkopf.com. Dies ist eine Leseprobe.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bestellungen nehmen wir gern über den Musikalien- und Buchhandel oder unseren Webshop unter www.breitkopf.com entgegen.
Jean-François Monnard
né en 1941, a suivi une formation musicale et des études de droit dans sa ville natale de Lausanne. Il a étudié la direction d’orchestre avec Heinz Dressel et la théorie avec Krzysztof Penderecki à la Folkwang Hochschule d’Essen (1968 diplôme de maturité artistique, branche principale direction d’orchestre).
Le parcours théâtral de Monnard l’a conduit de Kaiserslautern à Osnabrück, où il a occupé la fonction de GMD, en passant par Graz, Trèves, Aix-laChapelle et Wuppertal. Il a été invité par de nombreuses maisons d’opéra et il a mené une importante activité symphonique. En 1998, il rejoint le Deutsche Oper Berlin, d’abord comme administrateur artistique, puis comme directeur d’opéra.
En 2007, retour en Suisse où de nouvelles tâches l’attendent : directeur adjoint du festival « Septembre Musical Montreux-Vevey », responsable du secteur Planning et Casting à l’Opéra de Genève et conseiller artistique auprès de l’Orchestre de la Suisse Romande.
Depuis 2013, activité musicologique croissante, notamment en tant qu’éditeur d’une édition critique de l’œuvre symphonique et lyrique de Ravel pour les éditions Breitkopf & Härtel (neuf volumes) et rédacteur en chef des « Cahiers Ravel », une publication de la Fondation Maurice Ravel à Paris. En outre, il a publié plusieurs ouvrages chez inFOLIO :
• Septembre Musical. 70 ans de festival, 2016
• L’Orchestre de la Suisse Romande. Un siècle en poche, 2018
• Markevitch. Musicien cosmopolite, 2021
• Magaloff. Prince des pianistes, 2023