LA REVUE DE PALAIS DES THÉS

Numéro 95 Été 2025


Clément Régis
Responsable RSE

LA REVUE DE PALAIS DES THÉS

Numéro 95 Été 2025


Clément Régis
Responsable RSE
Contribuer ensemble à partager le thé : voici ce qui anime au quotidien chaque collaborateur de notre maison. Cette philosophie du travail, vecteur d’épanouissement et favorisant le collectif, nous la partageons avec nos partenaires et fournisseurs de longue date, les Établissements et Service d’Aide par le Travail (ESAT). Depuis déjà trente ans, nous avons établi des partenariats avec quinze structures françaises ayant pour vocation de permettre aux personnes en situation de handicap d’exercer une activité professionnelle dans un milieu dit « protégé ».
Le matcha est un thé moulu entre deux meules de pierre.
ci-contr E
L’infusion à froid révèle et souligne des notes singulières, une façon de redécouvrir et de continuer à explorer ses thés préférés.
Au quotidien, les ESAT nous accompagnent sur des missions de conditionnement de nos thés et infusions : remplissage et pose d’étiquettes pour nos sachets fraîcheur et nos boîtes métal, montage des calendriers de l’Avent et de certains coffrets. En 2024, 68 000 calendriers de l’Avent ont ainsi été conditionnés par des travailleurs en situation de handicap et certains d’entre eux ont d’ailleurs été présents en boutiques pendant les fêtes pour partager avec les amateurs de thé leurs expériences et savoir-faire au quotidien. L’occasion d’échanger autour du plaisir du thé, et pour nous une volonté de mettre en avant l’évidence, la fluidité et la qualité de notre collaboration avec des ESAT ainsi que l’impact social bénéfique que peut avoir ce modèle de production. Notre démarche d’entreprise est aussi citoyenne, et participer à l’intégration et à l’autonomisation de ces travailleurs en fait naturellement partie. Au-delà d’un engagement social, le recours à ce travail adapté est vécu par notre maison comme une fierté et une force tant humaine que professionnelle. Une preuve de plus que le thé nous rassemble !

SOMMAIRE
CARNET DE VOYAGE
Par Elena Di Benedetto, Marie Laperrière et Kenza Benkhatar
Darjeeling, l’héritage et l’avenir
6
CULTURE THÉ
Par Elena Di Benedetto
La terre et le thé
20
RACONTEZ-MOI
Le tea time
30
CONTRIBUTEURS

Lola Sitruk
Master Tea Sommelière depuis 2024, Lola aime découvrir le même thé grâce à diverses méthodes d’infusion pour comparer l’impact de ces pratiques sur le goût.
PLANÈTE THÉ
Par Laetitia Portois
Comment le matcha est devenu un phénomène mondial ?
14
UN GRAND CRU, UN TEA SOMMELIER
Par Lola Sitruk
THÉ D’EXCEPTION
Le Darjeeling Mist Bari bio, un thé noir himalayen
32

Laetitia Portois
Laetitia a une préférence pour les thés verts japonais. Elle a plaisir à raconter des histoires et fait chaque jour de son métier une passion.
PLANÈTE THÉ Déguster le matcha 18
DU THÉ EN CUISINE Courgettes farcies au Mugicha
28
ÉBRUITÉ Toute l’actualité du Palais 34
Elena Di Benedetto

Master Tea Sommelière depuis 2024, Elena est adepte des oolong de Taïwan. Chaque tasse est pour elle une source de dépaysement et de découvertes.

Chaque année, François-Xavier Delmas, fondateur de Palais des Thés, invite la nouvelle promotion de Master Tea Sommeliers* à un voyage dans un pays de thé. Fin mars, nous voilà donc – Lola, Kenza, Marie, Lucie, Simon et moi – en route pour le « pays des orages »
C’est une chose que d’avoir lu les récits des aventures de Robert Fortune, l’espion qui a fait de l’Inde le nouveau champ de thé de l’empire britannique au xixe siècle, et une autre que de fouler pour la première fois ces plantations aux reliefs vertigineux !
Par Elena Di Benedetto, Marie Laperrière et Kenza Benkhatar
Darjeeling est la région théicole de cœur de François-Xavier Delmas. Il nous dit avoir cessé de compter ses voyages sur ces terres au soixantième Prenant à cœur son rôle de guide, dès l’aéroport, il nous confie quelques règles de politesse élémentaires, des subtilités du langage corporel aux coutumes incontournables. À peine arrivés à New Delhi, nous nous envolons vers Bagdogra, au nord-est de l’Inde et au sud de Darjeeling. Dès l’aéroport, les théiers sont omniprésents, à perte de vue dans les plaines. Leurs feuilles sont destinées à la production de thés en sachets, selon la méthode CTC (crush tear curl, « écraser, déchirer, rouler »).
Bien plus que nos chauffeurs, Pema et Muhammad seront nos compagnons de route, généreux en bonnes adresses et échangeant volontiers des petits bouts de vie pendant les longues heures passées ensemble au rythme des programmes radio : mantras le matin, variété internationale l’après-midi ! Nous partageons la voie avec le Toy Train, qui rallie la gare de New Jalpaiguri, près de Siliguri, à celle de Darjeeling. Ce train à vapeur, patrimonial, rase les flancs de montagne et perce les nuages sur une distance de 88,48 km exactement. À chaque détour, accrochés aux sièges, une seule question : « Passera ? Passera pas ? »
Il existe à Darjeeling une disparité de climats d’une plantation à une autre, pourtant distantes de quelques kilomètres à peine.
Une spécificité de la région !
*Un Master Tea Sommelier est un collaborateur de Palais des Thés ayant passé un examen exigeant validant une connaissance experte du thé et de son univers.
Premier arrêt avant d’entrer à la nuit tombante dans la bouillonnante Darjeeling et premiers momos – ces petits raviolis tibétains cuits à la vapeur – accompagnés d’un thé local et de graines de fenouil enrobées de sucre et légèrement mentholée. Elles sont idéales pour nettoyer nos palais peu habitués aux mets épicés. À plus de 2 000 mètres d’altitude, Darjeeling est une ville en suspension sur une colline tout en verticalité où sont accrochées des grappes de maisons multicolores. Le climat, moins chaud que dans la plaine, en a fait le lieu de villégiature des Anglais au xixe siècle, et aujourd’hui des touristes locaux et internationaux, en quête de fraîcheur. De la place principale, impossible de résister au spectacle époustouflant de la chaîne himalayenne et du mont Kanchenjunga, troisième sommet du monde (8 586 mètres) lorsque la brume chassée, il veut bien se dévoiler. Darjeeling sera notre hôte pendant trois jours. Nous aurons ainsi le temps de goûter à ses trésors culinaires aux influences tibétaines, népalaises et chinoises, mais aussi à sa succession de petites boutiques et marchands ambulants dans un niveau sonore auquel nous nous habituons peu à peu.
Des factories héritées du système britannique
Le lendemain matin, il nous faut près d’une heure pour laisser derrière nous Darjeeling et rejoindre les plantations de Risheehat et Liza Hill. Nous comprenons vite qu’il est inutile de compter en kilomètres chaque déplacement tant l’état des routes est précaire et aléatoire. Ces deux jardins aujourd’hui réunis sont très pentus, comme souvent dans cette région montagneuse, ce qui rend la cueillette acrobatique et nécessairement manuelle. Le responsable, Rajiv Kumar, nous accueille dans cette manufacture, qui témoigne d’un héritage colonial encore présent. À l’indépendance de l’Inde en 1947, les trois quarts des jardins appartenant à des compagnies anglaises ont été nationalisés. Les exploitants de thé, comme ici, sont donc aujourd’hui locataires de l’État et appartiennent souvent à de grands groupes, propriétaires de plusieurs plantations. Nous retrouvons des machines anglaises dans ces manufactures spacieuses, parfaitement entretenues. À notre arrivée en fin de matinée, les feuilles cueillies la veille ont déjà été flétries, puis roulées et séchées pendant la nuit. Nous assistons à la fin du triage manuel. À cause du froid et du manque de pluie, la récolte printanière est pour l’instant faible. Dans les 87 plantations agrippées à la montagne, l’un des défis de Darjeeling est de fabriquer des thés – de plus ou moins bonne qualité – en composant avec un climat changeant. Le tea maker répond à nos innombrables questions et nous explique les différences de manufacture d’un first flush, second ou third flush* et l’importance du flétrissage. Cette étape rend les feuilles plus malléables et permet de les manipuler sans les casser. Seule l’expérience permet la maîtrise du taux d’humidité et de la température dans la salle ainsi que le choix de la durée pendant laquelle les feuilles perdent jusqu’à 50 % de leur eau et entament le processus de transformation enzymatique nécessaire à l’oxydation. Toutes les connaissances théoriques acquises pour la préparation de notre examen de Master Tea Sommelier deviennent enfin plus concrètes ! Comme dans chacune des trois premières factories, notre visite est suivie d’une dégustation professionnelle, dans une salle dédiée, au set à déguster (un ensemble composé d'une tasse à infuser à bord dentelé et d'un couvercle). Ici, six thés de printemps ultra-frais, issus de variétés de théiers et de parcelles différents, récoltés deux jours avant notre arrivée. De jour en jour, nous sommes touchés par l’accueil des planteurs qui nous reçoivent en invités de marque dans leur bungalow et nous régalent de petits pains frits soufflés, d’une déclinaison de currys végétariens, de daals, jalebis (pâtisseries orange frites, imbibées d’un sirop parfumé), lassis…
« Light and bright »
Darjeeling doit composer avec un relief montagneux et un climat changeant.
S’il est une intention commune aux trois plantations visitées – Risheehat, Barnesbeg et Seeyok – c’est bien celle-ci : des thés de printemps « clairs et lumineux ». En effet, les thés « légers » que nous dégustons, bien que classés parmi les thés noirs, ont une liqueur très claire et des notes végétales dues à l’absence de l’étape de l’oxydation. Ils sont essentiellement destinés à l’export, le marché national ayant une préférence pour les thés d’été ou d’automne plus corsés et charpentés. Par exemple, les notes zestées du cultivar AV2 (variété de théier) que nous apprécions sont rarement la préférence des tea makers.
*En Inde, traces de l’Empire britannique, les récoltes sont communément nommées flush (« poussée végétative »). First flush, second flush et third flush désignent respectivement les récoltes de printemps, d’été et d’automne.


Chaque année, les thés de Darjeeling ouvrent le bal des nouvelles récoltes, avec les tant attendues Darjeeling de printemps.


Le jour suivant, à Barnesberg, nous sommes frappés par la propreté clinique de cette plantation qui mise beaucoup sur les services apportés aux travailleurs (crèches, aides aux soins ). « La qualité engendre la propreté », affichent-ils dans la manufacture !
Pour cette nouvelle journée, nous partons à la rencontre de Nikita, relais local de Karuna-Shechen, dans un village près de Dooteriah, un ancien jardin de thé aujourd’hui fermé. Depuis plusieurs années, Palais des Thés entretient des liens étroits avec cette ONG et soutient financièrement des projets dans les pays de thé. Les villageois que nous rencontrons ont, pour la plupart, perdu leur emploi à la suite de la fermeture des plantations. Plusieurs habitants continuent malgré tout à récolter et fabriquer, chez eux, des petites quantités de thé qu’ils vendent sur les marchés ou utilisent pour leur consommation personnelle. Des formations au maraîchage, à l’horticulture et à l’apiculture leur permettent de subvenir autrement à leurs besoins et de recréer des ressources. Dans l’esprit de Karuna-Shechen, les programmes encadrés par des responsables locaux, sur le terrain, sont très concrets : de la mise à disposition de semis et de filets pour protéger les cultures à la transmission de savoir-faire agricoles. Nous assistons au conseil du village, réunissant une trentaine de personnes, et aux échanges sur les solutions envisageables dans ce contexte économique et culturel. En discutant avec les plus jeunes, nous comprenons la volonté de certains de quitter la montagne pour la plaine, et donc la ville, quand d’autres expriment leur souhait de développer sur place des projets pérennes.
Dans l’après-midi, pour atteindre Seeyok, nous longeons la frontière népalaise. Seeyok est une leçon d’agroforesterie et de biodiversité appliquée ! Biches, oiseaux, ruisseaux la balade dans la plantation est un émerveillement. « On croise parfois des ours et des léopards ! » nous raconte JP Gurung,
Les thés dégustés sur place, et présélectionnés par François-Xavier Delmas, sont goûtés de nouveau à son retour. Le contexte émotionnel lié au cadre et aux liens affectifs mais aussi la manière de préparer le thé (plus dosé, à une température plus élevée que celle que nous préconisons) peuvent fausser notre appréciation.

le consultant pour la plantation – à la fois grand expert du thé et sage – qui mène la visite. Les thés fabriqués ici sont d’une qualité constante. Malgré les dangers d’un retour de nuit sur les chemins accidentés, nous ne pouvons décliner l’invitation à partager un délicieux buffet suivi d’une soirée autour du feu animée de chants népalis et de standards français et internationaux. La petite ville de Mirik sera notre point de chute pour une nuit.
En arrivant à Yanki Tea, nous découvrons un tout autre modèle de manufacture. Certes, minoritaire, mais réjouissant pour l’avenir de Darjeeling. Yanki Tea, c’est avant tout une famille, népalaise. Dans une logique de coopérative, Alan et sa mère, une femme de tête qui pratiquait un commerce de revente de thé avant même d’en fabriquer, achètent à un prix juste des feuilles à des petits propriétaires. Le jardin est un exemple de la faible part (25 %) de terres qui ne sont pas nationalisées. Les machines, pour partie de seconde main, sont ici plus petites. Les thés sont manufacturés selon un mode de fabrication moins conventionnel. Eusha, la femme d’Alan, tea maker à La Mandala, au Népal, n’est certainement pas étrangère à ce pas de côté. Parmi les curiosités dégustées sous la pergola construite par le père de famille, nous apprécions la créativité déployée dans un thé roulé à la main (ce qui lui donne une oxydation différente d’un thé noir « classique »), un thé torréfié ou encore des assemblages étonnants. Il est possible que vous retrouviez en boutiques, en toutes petites quantités, l’un des thés que nous avons tant aimés et que nous avons à cœur de vous faire découvrir. Ce n’est qu’en se rendant sur place, au contact des producteurs, que nous pouvons comprendre l’intention des tea makers et mesurer leur expertise pour manufacturer des thés d’excellence. Au bureau ou en boutiques, chacun de nous revit ces moments à la fois instructifs et chaleureux vécus à Darjeeling en les partageant entre amateurs, collègues et clients, autour d’une tasse d’un grand cru de printemps « clair et lumineux » ! •
Le matcha est une fine poudre de thé vert japonais moulu. Il est l’élément central de la cérémonie traditionnelle japonaise du cha no yu. Longtemps resté confidentiel, il connaît depuis le début des années 2000 un engouement mondial. De boisson traditionnelle à superaliment moderne, comment et pourquoi ce thé vert agite l’univers de la gastronomie ?
Par Laetitia Portois
Une boisson ancrée dans la tradition japonaise
L’histoire du matcha ne débute pas au Japon mais en Chine, sous la dynastie des Song (960-1279). À l’époque, les feuilles de thé sont réduites en poudre et battues dans l’eau chaude. C’est sous cette forme que le moine bouddhiste japonais Eisai rapporte à la fin du xiie siècle le thé de Chine au pays du Soleil Levant. Cette boisson est riche en théine, car toute la feuille est consommée. Son usage se diffuse rapidement dans les monastères au xiiie siècle, où il est apprécié car favorisant la concentration durant les longues heures de méditation. Au xvie siècle, le bonze zen Sen No Rikyu codifie les rapports entre thé et bouddhisme et donne à la cérémonie traditionnelle du cha no yu (littéralement « eau chaude pour le thé ») sa forme la plus accomplie. Ce rituel se déroule dans un pavillon au décor sobre, où après diverses purifications, le maître de thé prépare le matcha, toujours de grande qualité. Il propose d’abord un matcha épais (le koicha), puis léger (l’usucha). Pour ce dernier, les gestes sont précis : le maître de thé verse trois cuillerées de matcha dans un bol, puise une louche d’eau chaude et bat le thé avec un fouet en bambou. L’invité d’honneur reçoit le bol, boit une gorgée, puis donne son appréciation du goût du thé.
Synonyme de tradition, le matcha a depuis connu de nombreux bouleversements qui ont modifié son usage. La pratique des moines inspire les samouraïs, car sa préparation est proche de la philosophie des arts martiaux (les gestes doivent être précis, on savoure l’instant avant d’entrer en action). Il est dégusté avant de partir au combat, ultime moment de concentration. Les nobles guerriers participent ainsi à sa diffusion au sein de la cour impériale. Son usage se répand et, avec lui, l’utilisation du matcha dans les gâteaux qui accompagnent la cérémonie du thé, souvent associé à la pâte de haricots rouges. Au début du xxe siècle, le gouvernement japonais le remet en lumière et souhaite alors faire du cha

no yu une discipline artistique de haut niveau. Le matcha est un moyen d’affirmer l’identité culturelle de l’archipel face aux influences occidentales croissantes. Bien que les maîtres de thé s’y opposent, la cérémonie est enseignée aux jeunes filles de bonne famille et pratiquée par les geishas comme un art à part entière. Ce thé moulu perd ainsi sa dimension martiale pour s’ériger au rang d’art, inscrit dans la culture nippone. Au début du xxie siècle, la mondialisation aidant et le Japon s’ouvrant davantage sur l’extérieur, le pays devient une destination de voyage très prisée, notamment pour sa culture et sa gastronomie
Manufacturer le matcha : un procédé rigoureux et précis
Au Japon, on distingue les thés d’ombre et de lumière. Le matcha est un thé d’ombre, fabriqué en utilisant les feuilles de théiers privés partiellement et volontairement de lumière pendant plusieurs semaines. L’arbre puise alors les nutriments dans ses racines. Cela modifie les composés aromatiques de la feuille : les sucres, les acides aminés et la théine augmentent, ce qui confère au thé son profil umami 1. Les feuilles sont cueillies mécaniquement plusieurs fois dans l’année. Les machines retirent ensuite les nervures et les tiges pour ne garder que les feuilles (tencha). Ces dernières sont étuvées, puis une fois sèches, moulues entre deux meules en pierre. Du temps de passage entre les meules dépend la finesse de la poudre obtenue, qui doit être d’un beau vert jade vif. Le moment de récolte des feuilles influence la couleur : au printemps, les feuilles cueillies sont, par exemple, plus vertes qu’en été. Le matcha sera donc davantage vert vif. Cette poudre est ensuite conditionnée dans des boîtes métalliques hermétiques à la lumière, aux odeurs et à l’humidité pour en préserver les qualités.
L’ombrage du théier, l’étuvage des feuilles, le passage entre les meules de ses feuilles entières et la finesse de la mouture permettent de définir un matcha. À plus d’un titre, ce thé demeure une spécificité du Japon, son premier producteur et premier exportateur mondial. Loin de la cérémonie du thé, il est très apprécié pour ses usages culinaires, ses qualités aromatiques et gustatives exceptionnelles, sa couleur verte si caractéristique et ses bienfaits.
Une « révolution verte »
Depuis quelques années, le matcha est partout et sa consommation s’envole. Ce phénomène, observé depuis 2018, s’est très fortement intensifié entre 2023 et 2024. Selon le magazine britannique The Economist, les ventes quotidiennes de matcha au niveau mondial ont été multipliées par cinq entre l’été 2023 et l’été 2024. Pour le cabinet Indien The Business Research Company, le marché est aujourd’hui estimé à 4 milliards de dollars (le marché du thé à 52 milliards de dollars en 2023) et il est exponentiel avec un taux de croissance annuel évalué à 8 % d’ici 2030 (soit plus de 7 milliards d’euros d’ici 5 ans).
Ce thé moulu s’est avant tout popularisé en Occident sur les cartes des desserts des restaurants, salons de thé et pâtisseries, et en version « à emporter » sous forme de latte. Sa couleur intense le rend très photogénique : une esthétique prisée du monde de la gastronomie qui l’a fait connaître au plus grand nombre.
1 L’umami, généralement traduit par « savoureux », est la cinquième saveur de base avec le sucré, l’acide, l’amer et le salé.
Entre l’été 2023 et 2024, les ventes quotidiennes ont été multiplié par 5.
Source : The Economist
Le matcha est aujourd’hui dégusté comme une boisson saine du quotidien. Il s’invite à la table du petit-déjeuner, du goûter, ou à toute heure de la journée, en version latte. Il s’impose chez les plus jeunes en quête de tendances comme une alternative au café, apprécié pour ses bienfaits antioxydants et stimulants. Son importante teneur en théine apporte une énergie qui se déploie doucement, sur plusieurs heures, sans provoquer d’excitation. Sa forte concentration en L-théanine, un acide aminé permettant une diffusion lente de la théine dans le corps, favorise l’apaisement. Sa couleur verte évoque la nature et la fraîcheur. Son mode de préparation, fouetté, le rend singulier. Ces arguments séduisent les jeunes générations qui ont fait de ce thé vert moulu le symbole d’un mode de vie sain. Il s’intègre dans une quête du bien-être nourrie de rituels popularisés par une communauté digitale et un concept né aux États-Unis : les « clean girls » En s’entichant du matcha (toujours latte, au lait végétal), ces dernières ont provoqué l’émergence, puis l’explosion de cette tendance. Certaines créatrices de contenus ont même lancé leurs propres marques de matcha au succès fulgurant.
Un succès si soudain engendre quelques dérives. L’engouement rapide et massif pour le matcha à l’échelle planétaire crée une pression considérable pour les producteurs et une tension sur l’ensemble de la chaîne de fabrication du thé au Japon. Selon les données du ministère de l’agriculture, des forêts et de la pêche japonais (MAFF), l’archipel produit 4 176 tonnes de matcha en 2023, soit trois fois plus qu’en 2010 (1 471 tonnes). Pourquoi ne pas produire plus ? En raison d'un manque d'espace agricole et de la nécessité de revoir le type de théier utilisé. En effet, des cultivars comme le saemidori et le gokou sont idéaux pour manufacturer le matcha, car les feuilles offrent une saveur umami plus prononcée que le yabukita, le cultivar le plus répandu au Japon. Par ailleurs, la récolte n’a lieu que plusieurs fois par an à l'inverse de certains régions productrices qui cueillent en continu les feuilles du printemps à la fin de l'automne. Cela limite la quantité disponible. Pour faire face à la demande, les heures supplémentaires s’accumulent. À cela s’ajoute la diminution du nombre de producteurs de thé, passés de 53 000 en 2000 à 12 353 en 2020 (selon le MAFF). En 2024, le Japon a connu une pénurie de matcha sans précédent. Certaines marques comme Ippodo ont écoulé la plupart de leurs collections en un temps record et ont annoncé une hausse des prix et la limitation des achats à un article par personne. Chez Palais des Thés, nous rencontrons aussi certaines difficultés d’approvisionnement, que nous parvenons à surmonter grâce aux relations de confiance établies depuis plus de quinze ans avec nos partenaires et producteurs. Désormais, d’autres pays comme la Chine commencent à produire du matcha, la tendance semblant s’inscrire dans la durée. Ces thés sont fabriqués de manière industrielle, sans suivre le procédé établi par les producteurs japonais. Ils sont certes beaucoup moins chers mais de moins bonne qualité. Puisqu’il n’existe pas de contrôle, il est par conséquent possible d’appeler « matcha » toute sorte de dérivés. Ce phénomène mondial dépasse les frontières de la gastronomie. Le matcha inspire le monde de la parfumerie, devient une nuance de vert utilisée en design et dans la mode… Jusqu’où ira cette tendance ? •
Le matcha est aujourd’hui consommé et cuisiné de multiples façons. Ce thé aux notes végétales et à la saveur umami très prononcées, est apprécié pour ses propriétés culinaires, sa jolie couleur verte et ses caractéristiques aromatiques singulières. Apprendre à reconnaître un bon matcha et savoir le préparer en latte ou selon la technique traditionnelle implique de suivre un certain nombre d’étapes.
Comment reconnaître un bon matcha
C’est le mode de production du thé matcha qui définit ses propriétés gustatives. Pour s’assurer de sa qualité, il faut vérifier plusieurs points.
Sa provenance : nécessairement du Japon. Ses récoltes et méthodes de fabrication : récolte sur théiers ombragés, thé vert moulu entre deux meules de pierre.
L’aspect du thé : finesse de la poudre et couleur d’un vert jade vif.
Et bien sûr comme pour tout thé, les conditions de productions humaines et environnementales dans lesquelles il a été réalisé.
Un matcha bio : cela garantit qu’il n’y a pas d’utilisation de produits phytosanitaires, une notion essentielle car les abus sont nombreux. Chez Palais des Thés, certains de nos matcha sont bios, et sont a minima certifiés Safetea (voir Bruits de Palais n° 93, p. 36-37).
Chaque thé est contrôlé par un laboratoire indépendant qui s’assure du respect des seuils fixés en matière de résidus de pesticides par l’Union Européenne.

Comment préparer un matcha selon la méthode traditionnelle ?
Pour réaliser un matcha traditionnel, il est nécessaire de se munir d’un certain nombre d’ustensiles : un bol (chawan), un fouet en bambou (chasen) avec un repose-fouet qui lui permet de conserver sa forme et son efficacité, une spatule à thé.

Mettez 2 spatules (soit 1 cuillerée à café rase) de matcha dans le bol, en versant la poudre au travers d’un tamis. Versez sur la poudre 5 cl d’eau chauffée à 70 °C. Tenez fermement le bol d’une main et battez le thé à l’aide du fouet, en formant un W d’un geste saccadé. Dégustez une fois que le matcha est mousseux.


Le matcha offre une saveur umami intéressante qui vient renforcer le salé, le sucré, l’amère ou l’acide d’un plat. Pour les préparations salées, les notes d’oseille, de cresson et d’épinard du matcha permettent d’apporter du relief à un plat marin. On peut le mélanger au sel ou l’associer à une sauce pour accompagner un poisson, ou même à une mayonnaise pour la rehausser. Le matcha offre une bonne
Star des coffee shops, le matcha latte est très simple à réaliser soi-même.
Dans un bol ou un mug, versez une cuillerée à café de matcha ou trois spatules. Ajoutez 5 cl d’eau chauffée à 70 °C, puis mélangez avec un fouet électrique ou en bambou. Par ailleurs, faites mousser le lait tiède au fouet électrique, puis versez-le dans le matcha. Saupoudrez un peu de poudre de matcha sur la mousse avant de savourer ce délicieux latte !
longueur en bouche, qui accentuera le côté végétal d’une soupe de légumes.
Dans les pâtisseries, on l’ajoute aux crèmes, à une pâte à cookies, à des crêpes, à des gaufres, etc. Il s’associe autant à du chocolat qu’à des fruits rouges. Avec le matcha, les possibilités sont infinies. Laissez libre cours à votre créativité !


Du théier à la théière, la terre joue un rôle de l’ombre. Essentielle pour permettre au thé de grandir, elle le sublime au moment de le préparer, le servir, le déguster, le partager. Tour d’horizon des liens indéfectibles entre le thé et la terre.
Par Elena Di Benedetto

Terre, terroir, glaise… La terre suit le thé : si le Camellia sinensis s’enracine dans une terre fertile, le thé qui en est issu s’épanouit ensuite dans des objets en terre parfois millénaires. Partout, en Inde, au Japon comme en Chine, la terre est indissociable de la voie du thé.
Le thé est issu d’un arbuste persistant, le camélia. Si certaines variétés sont ornementales et privilégiées pour leurs fleurs, le Camellia sinensis est pour sa part apprécié pour ses feuilles en forme de paupières d’un vert profond. Une fois manufacturées, elles donneront toutes les couleurs de thé.
Terre, n. f. :
« Substance en tant qu’élément propre à la croissance des végétaux, aux cultures. »
Pour grandir et s’épanouir, le Camellia sinensis requiert des conditions environnementales particulières : ensoleillement, humidité, température, pente du sol et… qualité de la terre. Il est certes impressionnant que le thé pousse sous des latitudes aussi variées, en plaines comme en montagne, sur des sols faits de roches diverses comme le gneiss ou le granite, mais certaines caractéristiques géologiques sont particulièrement bénéfiques à la bonne santé de la plante.
Ainsi, le meilleur sol pour le thé est jeune et volcanique. La terre doit être plutôt acide, ni calcaire ni neutre, afin que la plante puisse absorber tous les nutriments dont elle a besoin ; son pH est idéal entre 4,4 et 5,5. Elle doit également être meuble, perméable, riche en humus et profonde afin que les racines du camélia puissent plonger jusqu’à 6 mètres. Par ailleurs, ce sol doit conserver l’eau en période de fortes chaleurs mais aussi favoriser un drainage optimal en cas de pluies, car la stagnation de l’eau dans la terre abîme durablement les racines. Enfin, c’est sa richesse en nutriments (potassium, magnésium, oligo-éléments…) qui permettra d’avoir des plantes vigoureuses.
Sans terre fertile donc, pas de théier sain, ni de thé. D’où l’intérêt de pratiques agricoles responsables, idéalement certifiées bio, respectueuses du sol comme de son environnement. Tout part de la terre, qui n’a pas fini de se muer pour offrir ce qu’elle a de meilleur à notre boisson préférée.

En Inde, le chaï est souvent dégusté dans de petites tasses en terre cuite fines que l’on jette ensuite au sol.

Terre, n. f. :
« Matière naturelle constituée par différentes argiles ; cette matière telle qu’elle résulte du travail du potier. »
Les arbres disséminés au milieu des plantations permettent d’apporter de l’ombre et de conserver l’humidité de la terre.
On trouve les premières traces de terres cuites (tao en chinois) dès 20 000 avant notre ère, en Chine. Si des matières animales pouvaient également être prisées pour réaliser des outres et autres poches hermétiques, rien n’égalait alors la robustesse de la terre. D’abord terre modelée, séchée, elle a ensuite été cuite, en une seule fois à basse température (600 à 800 °C). Au ive millénaire avant notre ère, puis dès l’Antiquité, la température de cuisson augmente pour obtenir des objets plus solides et moins poreux. Ainsi rendues étanches, ces céramiques sont de véritables alliées du transport de liquides. Mais avec un inconvénient notable : elles se fendillent et se déforment. Il y a plus de 3 000 ans arrive alors le grès (ci en chinois), une céramique plus résistante et tout à fait imperméable. Cuits en deux temps, ces modelages faits d’argile très riche en silice sont émaillés et ne laissent donc plus passer de liquide. C’est une innovation décisive ! Enfin, la porcelaine (aussi appelée ci en chinois) voit le jour vers le viie siècle, toujours en Chine. À l’époque, on parle même d’« or blanc » : la recette de la porcelaine était un secret d’État si précieux que quiconque en dévoilait le procédé de fabrication était menacé de mort… Si on en trouve les premiers exemples sous la dynastie Han (206 avant Jésus-Christ-220 après Jésus-Christ), c’est sous les Tang (618-907) et les Song (960-1279) que se développe cette pratique. La finesse de la glaçure et la blancheur de l’objet sont dues au kaolin, nouveau matériau qui transcende les possibilités de la céramique. Transparence et délicatesse caractérisent désormais cet artisanat.

Riches de toutes ces possibilités, les artisans potiers auraient pu se concentrer sur une seule sorte de céramique. Pour autant, la terre cuite, poreuse, parfois considérée comme imparfaite a continué d’habiter le monde du thé. Les divers usages qui en sont faits permettent de comprendre l’importance de la terre lors de nos dégustations.
Chine, Japon, Inde…
En voyageant au gré des terres de thé, il est frappant de constater combien chaque terroir, chaque tradition ont ajusté les pratiques selon les matières premières accessibles à proximité. Et toujours, la terre occupe une place de choix.
Les théières en argile de Yixing, en Chine. Fabriqués à partir d’argile locale du Jiangsu contenant du fer, du mica et de la silice, ces objets sont notamment prisés pour leur porosité qui absorbe les parfums du thé. Dites « à mémoire », ces petites théières, que l’on utilise pour le gong fu cha, se culottent au fil des infusions, ce qui signifie qu’un dépôt fait de tanins et de composés aromatiques se forme au fil du temps, révélant une véritable osmose entre le thé et son contenant à chaque dégustation.
Les kyusu en terre de Tokoname au Japon. Sur l’île de Honshu au Japon, l’argile de Tokoname se distingue par sa richesse en fer et surtout en silice. Les théières réalisées avec ce matériau sont ainsi idéales pour préparer des thés verts japonais. En effet, outre sa propension à bien diffuser la chaleur, le fer se mêle aux catéchines du thé et en tempère l’astringence. Alors

Fréquemment utilisée pour promouvoir les plus beaux objets du thé, l’appellation « Yixing » se confond pourtant aujourd’hui avec l’argile zisha (« terre violette ») qui semble la plus utilisée pour façonner ces objets d’exception, alors que d’autres argiles existent dans cette région ( zhuni et duanni).
Les tasses japonaises sont souvent le résultat d’un travail artisanal minutieux.
Une théière de petite contenance respecte mieux les parfums d’un thé, car celui-ci sera dégusté plus rapidement.

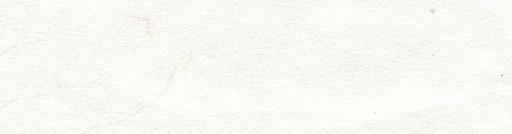
La silice est un composé naturel constitué principalement de dioxyde de silicium. On la trouve abondamment dans la nature sous différentes formes, notamment dans le sable et le quartz. Elle est responsable de la porosité ainsi que de l’étanchéité des matériaux. Ainsi, plus la terre est riche en silice, moins elle sera granuleuse à la cuisson.
en symbiose, le thé se retrouve sublimé grâce à cet objet tout en finesse. Façonnées par la main de l’homme, ces théières possèdent souvent un manche latéral et sont des incontournables de la cérémonie du senchado au Japon.
Les tasses en terre cuite pour le chaï en Inde. Si en Occident, la terre cuite rime aujourd’hui avec objet durable, en Inde, elle est encore souvent à usage unique. Ainsi les chaïwallahs, ces vendeurs ambulants de thé aux épices et au lait, proposent leur chaleureux breuvage dans des petites tasses en terre cuite ocre très simples, fines, que l’on brise au sol après la dernière gorgée. Cet usage vise à préserver la pureté rituelle entre les castes : chaque tasse étant à usage unique, il est certain qu’aucune personne d’une caste inférieure ne l’aura utilisée avant.
La mémoire de la terre
Mais les liens entre la terre et le thé ne s’arrêtent pas là. Certains thés poursuivent leur chemin dans des cuves en terre traditionnelles pour obtenir une patine caractéristique. Qu’il s’agisse des onggi coréennes ou des kvevri géorgiennes, la terre entre alors en synergie avec le thé. La manufacture du thé noir ou sombre se fait ici au gré de la matière. Enfin, on ne compte plus le nombre de tea pets conçus en terre poreuse. Ces petits animaux de compagnie sculptés très utilisés lors de préparations au gong fu cha sont arrosés de restes de thé et autres eaux de rinçage, comme pour être nourris. Ainsi hydratée, la terre évolue, alimentant chaque nouvelle expérience de thé de son histoire. •
Je vous emmène au sud-ouest de la Chine, dans la province du Yunnan située sur un plateau montagneux. La région que l’on nomme « au sud des Nuages » offre des paysages magnifiques mêlant montagnes, rizières, rivières et forêts tropicales. Dégustons ensemble un thé noir complexe et remarquable : les Bourgeons de Yunnan.
Par Lola Sitruk

Lola Sitruk est analyste de données et Master Tea Sommelière depuis 2024. Déjà amatrice de thé, sa curiosité n’a cessé de grandir au fil des années au sein de Palais des Thés. Elle aime découvrir le même thé grâce à différentes méthodes d’infusion pour en révéler toutes les notes et comparer l’impact de ces pratiques sur le goût du thé.
Berceau du thé, le Yunnan fait partie des régions productrices de thé emblématiques du pays. Le terroir est principalement réputé pour sa fabrication de pu erh, un thé sombre produit à partir de longues feuilles récoltées sur des théiers poussant au Yunnan, séchées au soleil et ayant subi une fermentation. Cette province vallonnée est peuplée de forêts de théiers sauvages. On trouve au sud, dans la région montagneuse de Jing Mai les plus anciens théiers de Chine. Parmi eux se cacherait même le Camellia sinensis réputé comme étant le plus vieux du monde. Chargé d’histoire, le Yunnan est le point de départ des premières routes du thé et des chevaux, d’anciennes voies commerciales reliant la Chine au Tibet, à l’Inde et à l’Asie du Sud-Est. On y échangeait du thé contre des chevaux, un commerce qui marque le début de la diffusion du thé tout en contribuant fortement à son expansion en Asie.
Le thé que nous dégustons est un Dian Hong Cha. Ce nom indique que ce thé noir est manufacturé dans la province du Yunnan. « Dian » fait en effet

1. Un thé uniquement composé de bourgeons.
référence à un royaume, établi entre le ive siècle et le iie siècle avant notre ère, correspondant à l’actuel Yunnan. Dian Hong Cha se traduit ainsi littéralement par « le thé rouge de Dian » (« Hong » signifiant « rouge » en chinois). Ce Grand Cru s’admire avant même d’être dégusté. Il est composé presque exclusivement de longs bourgeons duveteux [1] qui, en s’oxydant, ont pris une belle couleur fauve. Ce thé de
printemps est manufacturé à la main : un travail délicat et subtil, qui ne cesse de m’émerveiller. Les feuilles sèches dégagent une flaveur puissante aux arômes évoquant le cuir, l’animal, la terre et les fruits jaunes.
La révélation des notes au fil des eaux
J’aime préparer ce thé selon la méthode traditionnelle du gong fu cha , mais dans une petite théière en terre de Yixing [2] , j’aime admirer le mouvement des feuilles qui infusent [3]. Cette pratique consiste à réaliser des infusions successives courtes (de 30 à 40 secondes) mais très concentrées. J’aime cette technique de préparation, car chaque tasse est une nouvelle dégustation. La feuille nous livre son histoire et ses secrets au fur et à mesure des eaux. Avant de déguster, je réalise une infusion instantanée, que je ne boirai pas. Mon intention est de « rincer » le thé. Je prends un temps pour observer et humer ces feuilles humides. Les bourgeons se sont développés et assouplis, leur


aspect doré évolue vers une belle couleur cuivrée.
La liqueur ambrée est dense et brillante, annonciatrice des émotions à venir. Ce thé se révèle puissant en bouche tout en offrant une sensation de gourmandise. Sa texture est ronde avec une fine astringence. La saveur sucrée s’exprime grâce aux arômes de miel et de fruits compotés comme l’abricot. J’ai pour habitude de savourer ce thé dès le matin pour apprécier son intensité aromatique. La première infusion sera miellée et sucrée, puis suivront les touches animales et cuivrées dès la deuxième infusion.
Les Bourgeons de Yunnan s’accordent merveilleusement bien avec un magret de canard.
Une fois grillée, cette viande aux notes boisées et pyrogénées se mêlera parfaitement à celles cuivrées et animales du thé. Pour une pause sucrée, c’est le côté miellé de ce Grand Cru qui accompagnera avec harmonie un fondant au chocolat noir corsé. •
Origine Yunnan (Chine) COnseil de préparatiOn → au gong fu cha, infusions successives aCCOrds gOurmands un magret de canard ou un fondant au chocolat noir corsé
Sublimées par les notes torréfiées du Mugicha, les courgettes peuvent être accompagnées d’une salade fraîche à la sauce, elle aussi au Mugicha. Une recette savoureuse et saine !
Pour 5 personnes
35 g de Mugicha
25 g d’orge perlé cru 10 petites courgettes rondes
1 gousse d’ail
2 blancs de cébette
Huile d’olive
Beurre
Sel Poivre
250 g de ricotta
50 g de chapelure
Le saviez-vous ?
Nos Céréales à Infuser, tel que le Mugicha, sont également délicieuses préparées en latte ou glacées. Pour des infusions glacées : faites infuser 10 g de vrac dans 50 cl d’eau à température ambiante pendant une heure.
Ajoutez des glaçons et sirotez ! Pour des infusions en latte : faites infuser 10 g de vrac dans 30 cl de lait chaud de votre choix. Dégustez ainsi ou refroidi pour une délicieuse boisson estivale.
1. Préchauffez le four à 200 °C.
2. Faites infuser 20 g de Mugicha dans 50 cl d’eau à 90 °C pendant 10 minutes. Réservez.
3. Mixez finement les 15 g restants de Mugicha jusqu’à obtention d’une poudre. Tamisez et réservez.
4. Faites cuire l’orge perlé dans de l’eau salée. Égouttez et réservez.
5. Coupez le « chapeau » des courgettes et évidez-les à l’aide d’une cuillère.
6. Hachez la chair et les « chapeaux » avec l’ail et les blancs de cébette.
7. Faites-les revenir dans une poêle avec de l’huile d’olive et du beurre jusqu’à ce que l’eau se soit évaporée. Salez et poivrez.
8. Hors du feu, ajoutez la ricotta et l’orge perlé cuit. Assaisonnez avec quatre pincées de Mugicha en poudre.
9. Garnissez chaque courgette avec la farce à la ricotta.
10. Disposez-les au fond d’un plat à four. Recouvrez d’un mélange de chapelure et de poudre de Mugicha.
11. Versez l’infusion de Mugicha au fond du plat, jusqu’à environ 1 cm de hauteur. Enfournez à 200 °C pendant 30 minutes jusqu’à ce que la chapelure soit grillée et le jus réduit.
Conseil de dégustation
Accompagnez cette recette d’un mélange de pousses de mesclun, de vert de cébette et de persil haché très fins.
Assaisonnez d’une sauce au Mugicha réalisée à partir d’huile aux céréales et de 10 cl de Mugicha infusé.

Le tea time ou afternoon tea est une tradition anglaise emblématique. Ce temps du thé est associé à un ensemble de pratiques raffinées. La dégustation se déroule dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Instaurée au xix e siècle, cette coutume britannique a traversé les frontières pour s’inviter à la table de nombreux restaurants et salons de thé à travers le monde.
L’histoire d’amour entre les Anglais et le thé se noue au xviie siècle. À l’époque, les premières feuilles de thé arrivent de Chine en petites quantités, et la boisson n’est que peu consommée.
Le tea time, une histoire de femmes
En 1662, le roi Charles II épouse l’infante du Portugal, Catherine de Bragance. À peine arrivée, la princesse aurait demandé une tasse de thé pour se remettre d’une traversée longue et orageuse. Mais le breuvage restant introuvable, on lui offre finalement… un verre de bière. Déçue mais résignée, la jeune épouse du roi, qui a pour habitude de boire du thé à toute heure de la journée, se donne pour mission de diffuser cet usage au sein de la Cour. Elle apporte en dot un coffret rempli de précieux thés de Chine, qu’elle partage avec son entourage. La boisson, très appréciée, devient alors l’apanage des aristocrates. Elle est dégustée dans des cercles restreints. Denrée exotique, le thé est à cette époque dix fois plus cher que le café. L’époque est cependant marquée par l’ouverture de salons de thé. En 1706, Thomas Twining, de la famille de négociants de thé
britanniques, ouvre son premier salon à Londres. Le thé ne tarde pas à conquérir toutes les classes au fur et à mesure de l’expansion du commerce avec la Chine. Il rencontre un immense succès populaire et finit même par remplacer la bière au petit-déjeuner.
Cette pratique n’apparaît que plus tard, à l’époque victorienne. Son invention est associée à la duchesse de Bedford. Pour patienter avant le dîner servi tardivement à l’époque, elle a l’idée de se faire servir un thé dans l’après-midi, accompagné de pain et d’un peu de beurre. Elle convie ses amies à partager cette pause gourmande et la pratique ne tarde pas à se répandre dans toute la société anglaise. En pleine révolution industrielle, cette collation est d’ailleurs l’une des premières victoires sociales des syndicats anglais, inscrite dans le droit des travailleurs. Un moment indispensable pour les ouvriers, qui leur permettait de supporter le rythme des dures journées de labeur.

Aujourd’hui, le tea time est un moment de convivialité, une parenthèse pendant laquelle on se réunit en famille ou entre amis autour d’une
cuppa (abréviation de cup of tea, soit une tasse de thé). Le thé en Angleterre est souvent noir (earl grey, breakfast tea, darjeeling) et infusé dans une théière avant d’être servi avec une touche de lait, parfois une rondelle de citron. La pratique a évolué au fil des années, et l’on distingue aujourd’hui deux déclinaisons du tea time : le low tea et le high tea . Généralement pris vers 16 heures, le low tea est une collation composée de pâtisseries et autres scones, marmelades et gâteaux. Le high tea est un repas plus substantiel, presque

un dîner léger servi en fin de journée. On y retrouve des mets salés (tourtes, viandes froides, salades, etc.). Les noms de ces variantes sont dus à la hauteur des tables sur lesquelles on les déguste : le low tea est dressé au salon sur une table basse, tandis que le high tea prend place dans la salle à manger, sur une table qui est donc plus haute.
Le tea time est un temps du thé ancré dans l’histoire et la culture britannique, une pause bienvenue pour une fin de journée chaleureuse et conviviale. •
L’AFTERNOON TEA S’INVITE DANS LES PALACES PARISIENS
La tradition britannique a traversé la Manche pour prendre ses quartiers dans les plus beaux palaces parisiens qui, désormais, proposent tous leur version du tea time. Ce luxe « accessible » séduit les gastronomes curieux. L’afternoon tea à la française offre la part belle à la pâtisserie sophistiquée avec une quête d’originalité : intégration du thé directement dans les gourmandises sucrées pour Matthieu Carlin à l’Hôtel de Crillon, trompel’œil pour Cédric Grolet au Meurice, retour en enfance nostalgique avec les biscuits de François Perret au Ritz… Le guide digital et gastronomique La Liste remettra d’ailleurs en juin le Prix spécial du meilleur Afternoon Tea en partenariat avec Palais des Thés, afin de replacer le thé au centre de ce moment gastronomique !
Boisé, ciré, mystérieux, le Darjeeling Mist Bari rassemble plusieurs facettes de ces thés noirs qui font notre bonheur dès le petit-déjeuner. Récolté au nord de l’Inde, au cœur des brumes himalayennes (« mist » signifiant « brume » en anglais), il raconte l’histoire de Darjeeling en une seule tasse.
Du thé dans l’Himalaya ?
Si aujourd’hui, Darjeeling est un terroir emblématique, il faut pourtant attendre le xixe siècle pour que cette région enclavée entre le Népal et le Bhoutan devienne terre de thé. Une arrivée relativement récente dans l’histoire de cette boisson, là où le thé est par exemple cultivé en Chine depuis plusieurs millénaires !
Effectivement, si le thé était probablement présent en Inde à l’état sauvage dans l’Assam un peu plus à l’est (Camellia sinensis assamica), les théiers de Darjeeling sont pour leur part une variété chinoise (Camellia sinensis sinensis). Un mystère bien vite résolu lorsqu’on s’intéresse à l’histoire de Robert Fortune (lire Bruits de Palais n° 88, p. 30-31). Au xixe siècle, ce botaniste britannique est mandaté par la Couronne pour percer le secret de la culture du thé, extrêmement bien gardé par les Chinois pour qui la fameuse boisson est un marqueur culturel autant qu’une source de revenus considérable. Refusant de céder aux prix demandés
par les Britanniques, toujours plus friands de cette boisson, Robert Fortune s’introduit en Chine et commence sa mission d’espionnage. Grimé, le visage caché, il va observer la manière dont le thé est cultivé, puis manufacturé, dans le but d’importer illégalement des plants et des techniques en Inde afin d’y transplanter cette culture. Il y découvre notamment que thés verts et thés noirs sont en fait issus du même arbre…
Après un premier échec d’exfiltration de plants vers l’Inde colonisée, le second voyage en 1852 est le bon : les plants subtilisés survivent, et une fois plantés sur les pentes escarpées de l’Himalaya, ils réveillent le potentiel théicole de cette région nimbée de nuages.
À Darjeeling, le thé est récolté du printemps à l’automne, et chaque saison a sa signature gustative. Le Darjeeling Mist Bari possède toutes les caractéristiques des thés d’été : ses notes douces se font boisées, cirées,

Situées en altitude, les plantations de Darjeeling sont très souvent dans la brume.
cacaotées. Rond et faible en astringence à l’inverse des premiers Darjeeling de printemps, il offre une profondeur qui plaît au plus grand nombre.
Mais c’est également un thé surprenant qui révèle à la dégustation des notes de fruits cuits et de purée d’amande. Un éveil des sens tout en gourmandise pour ce thé noir d’altitude.

Des matins au rythme du thé
Ce Darjeeling accompagne aussi bien un petit-déjeuner rapide fait de tartines et d’un fruit qu’un généreux brunch. Il répand sa douce énergie en début de journée. On la doit autant aux quelques bourgeons présents qu’aux propriétés
stimulantes pour le cœur des thés noirs. Il est aussi possible de l’associer avec du lait pour un tea time à l’anglaise riche de scones, de cakes aux fruits et de petits sandwiches… L’occasion de goûter aux origines multiculturelles de cette terre de thé devenue incontournable. •

L’héritage gastronomique français infuse et oriente notre pratique du thé. Création d’accords mets et thés, intégration du thé comme ingrédient de plats salés et de douceurs sucrées, mixologie, etc. : ces dernières années, le thé entre de plus en plus dans notre patrimoine gastronomique aussi bien dans les restaurants que dans les cafés ou les bistrots, dans les salons de thé ou les pâtisseries. Depuis des années, Palais des Thés accompagne ces établissements pour leur proposer les thés et les infusions les plus adaptés et les aider à constituer leurs cartes. Cette année, la maison va encore plus loin en apportant son soutien à La Liste, un classement gastronomique international.
Lors du gala de remise des prix en novembre dernier, nos thés ont été servis en accompagnement d’un cocktail réparti en plusieurs buffets rendant hommage au Japon, à la Chine, à la Corée et à la France. Ils ont été choisis en accord avec le dessert de la cheffe pâtissière Nina Métayer réalisé pour l’occasion. Notre ambition commune : promouvoir le thé comme une boisson gastronomique et apporter nos connaissances et notre savoir pour accompagner les chefs qui souhaitent mettre le thé à leur table. Au mois de juin, François-Xavier Delmas aura l’honneur de remettre le prix du Meilleur tea time de l’année lors de la Garden Party organisée par La Liste.


Soutenir la biodiversité avec le Muséum national d’Histoire naturelle
Depuis 2023, Palais des Thés accompagne le Muséum en soutenant ses actions avec un partenariat de mécénat. Ce soutien financier a ainsi permis de créer un poste de botaniste au sein du programme « Vigie-Nature ». Lancé en 2006, ce programme de sciences participatives

rassemble une vingtaine de protocoles de suivi de la biodiversité, mêlant chercheurs et scientifiques, responsables d’exploitation et d’espaces verts, citoyens concernés, groupes scolaires, etc. L’objectif est de récolter collectivement un ensemble de données relatives à la biodiversité (observation de la faune et de la flore dans toute la France) sur le long terme afin de nourrir la recherche et d’accompagner la prise de décision des pouvoirs publics. Cette démarche nécessite une mobilisation citoyenne. Aujourd’hui, près de 40 000 personnes ont déjà contribué à envoyer leurs données et constats aux chercheurs du Muséum. Au sein de cette organisation, le poste de botaniste en charge de la coordination des observatoires flore a été confié à Ania Schleicher. Son travail porte sur les
programmes d’observation et de suivi de la flore sauvage en France (« Florilèges », « Vigie Flore » et « Sauvages de ma rue »). Formation du grand public pour devenir des observateurs éclairés, accompagnement des gestionnaires d’espaces verts citadins, présentation des résultats des collectes et organisation de rencontres nationales et régionales, ateliers pour améliorer le protocole d’observation, sont autant de missions menées au quotidien pour faire vivre ces trois projets. Ces initiatives nous tiennent à cœur. Nous sommes heureux de les soutenir, dans un contexte où l’éducation à la préservation de l’environnement est un enjeu majeur.
→ Pour plus d’informations : vigienature.fr
Composez en boutique votre coffret* sur mesure ! Suivez vos envies et vos intuitions et remplissez ces trois boîtes de 40 g environ du Grand Cru de votre choix.

Tasse Harou (28 cl)
→ Réf. N344 – 18 €
Coffret Grands Crus
→ Réf. DGC1 – 42 €
Tasse Yakushima (16 cl)
→ Réf. N345 – 15 €
Tasse mosaïque (16 cl)
→ Réf. N343 – 26 €
*Uniquement disponible en boutiques. Sur le web, retrouvez deux coffrets découvertes.
La collection glacée se teinte de nouvelles couleurs pour rafraîchir vos journées ensoleillées. À emporter partout avec soi grâce aux berlingots, à déguster jusqu’en soirée ! L’été s’annonce fruité et glacé !

Carafe thés glacés
→ Réf. M208 – 38 €
Boîte thés glacés*
Une boîte à remplir avec le thé glacé de votre choix
→ Réf. V423 – 6 €
Berlingots
6,90 € le berlingot
1. Pêche Glaciale BIO
→ Réf. DTG8370N
2. Summer Fizz BIO
→ Réf. DTG832N
3.Tropicolada BIO
→ Réf. DTG8430N
4. Exotic Party
→ Réf. DTG814N
5. Bahia BIO
→ Réf. DTG8460N

Bruits de Palais est une publication de Palais des Thés
Rédaction en chef
Lucile Block de Friberg, Bénédicte Bortoli, Mathias Minet
Direction artistique et mise en page
Prototype.paris
Stylisme
Sarah Vasseghi
Illustrations
Sabine Forget
Photogravure
Key Graphic
Impression Achevé d’imprimer en mai 2025 sur les presses du groupe Prenant (France)
Palais des Thés
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction sous quelque forme que ce soit, réservés pour tous pays.
Crédits photographiques
François-Xavier Delmas : 10-11, 12, 20-21, 22, 23, 24, 33 • Guillaume Czerw : couverture, 2, 4, 15, 26, 27, 29, 36, 37, 38, 39 • Karuna –Shechen : 6 • Kenza Benkhatar : 13 • Anna Miyoshi : 25 • Kenyon Manchego : 33 • MNHN - Jérôme Munier : 34-35.
Service clients
01 43 56 90 90
Coût d’un appel local, du lundi au samedi de 9 h à 18 h
Service Cadeaux d’affaires
01 73 72 51 47
Coût d’un appel local, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
Retrouveznous sur palaisdesthes

Ajoutez-la en quelques clics dans votre téléphone, en scannant ce QR code. Votre carte de fidélité dématérialisée !

« Buvez votre thé lentement et avec révérence, comme s’il s’agissait de l’axe sur lequel tourne la Terre − lentement, uniformément, sans se précipiter vers l’avenir. »
Thích Nh T ha N h moine bouddhiste vietnamien palaisdesthes.com
