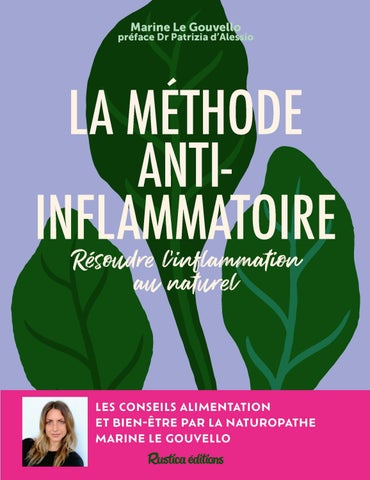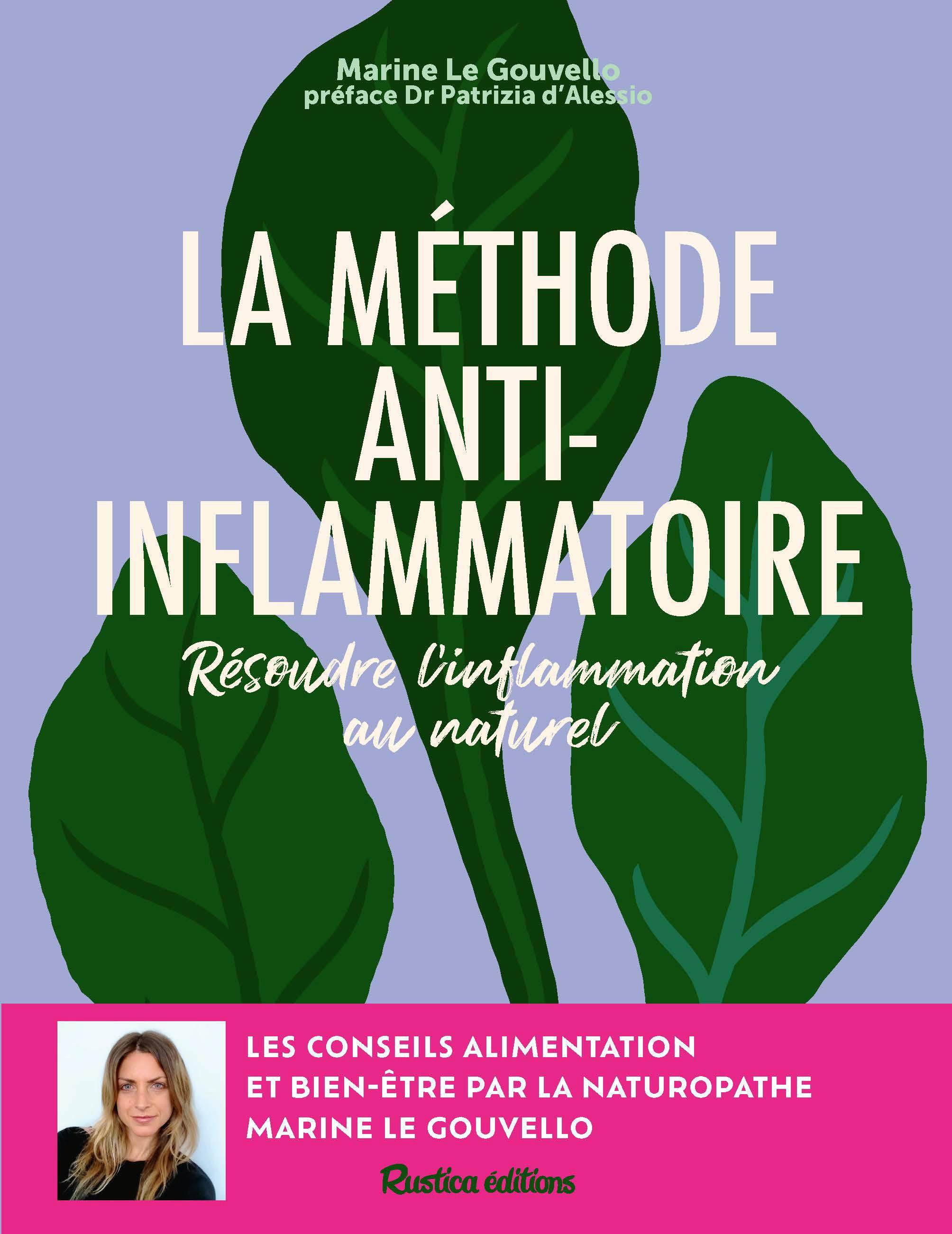
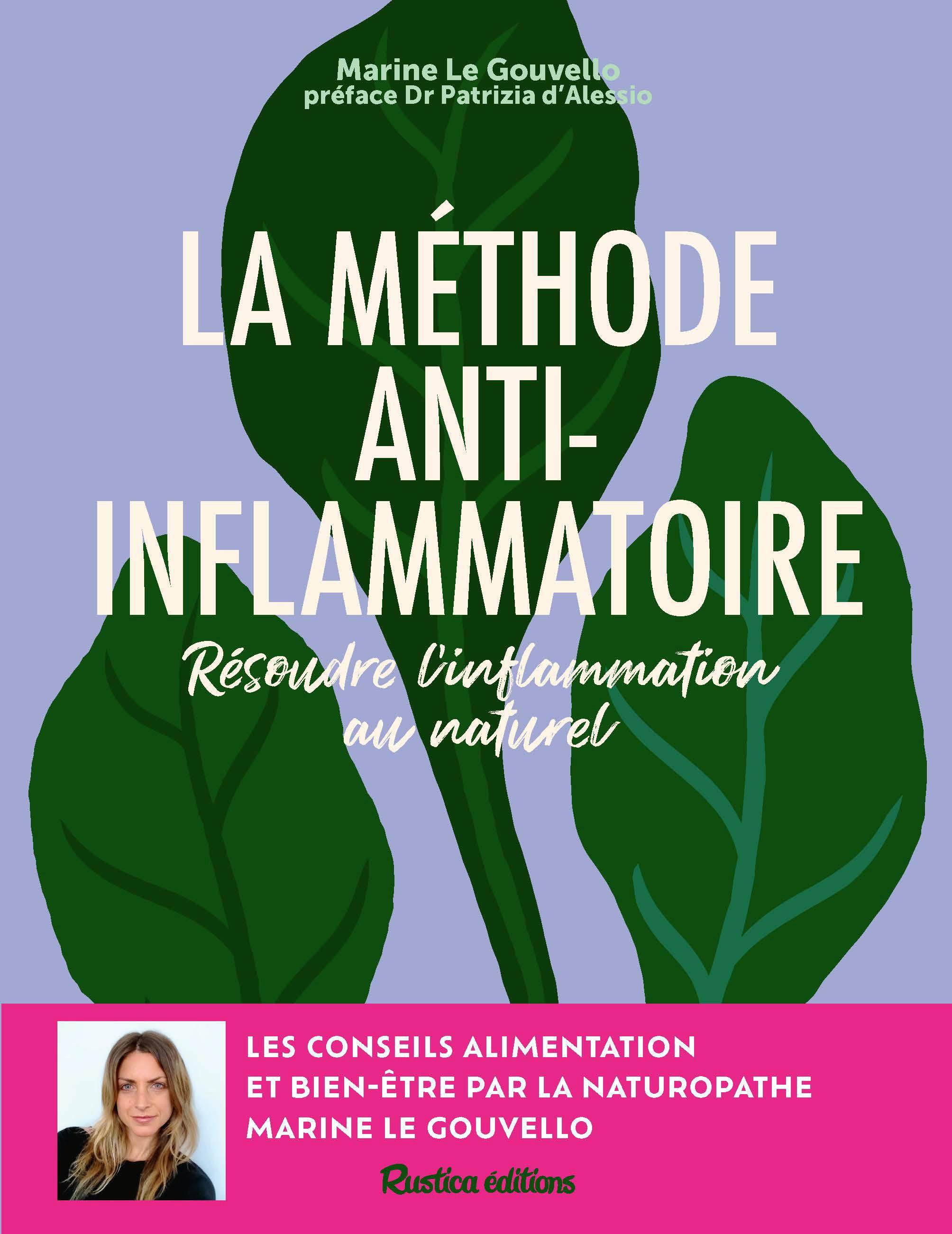
La bascule vers l’inflammation
Deuxième partie
MODE D’EMPLOI POUR RÉSOUDRE
L’INFLAMMATION CHRONIQUE
CHAPITRE 1
Adopter une alimentation anti-inflammatoire
L’alimentation anti-inflammatoire, à la croisée des régimes méditerranéen et Seignalet
L’alimentation
pour réguler l’insuline et perdre du poids
Que manger en cas d’inflammation systémique importante ?
Les plantes et nutriments anti-inflammatoires
Casser le cercle des médiateurs pro-inflammatoires : que penser des compléments anti-inflammatoires naturels
CHAPITRE 1
Les différentes inflammations
Nous allons étudier dans cette première partie les différentes formes d’inflammation afin de comprendre à quoi elle sert et comment elle est générée par l’organisme.
L’idée ici est de prendre conscience du déroulement parfois très silencieux de la mécanique inflammatoire.
À notre insu, alors que nous n’avons aucun symptôme ou presque, nous pouvons avoir une inflammation qui s’étend dans notre organisme et prépare le terrain pour l’apparition de pathologies plus graves. Nous pouvons parfois ignorer sciemment et durant des années des symptômes digestifs ou de stress, des petites douleurs chroniques, des infections récidivantes, une prise de poids progressive, de l’insomnie qui s’installe…
C’est en écoutant davantage ces signes évocateurs de l’inflammation, et en la traitant directement que nous pourrons prévenir efficacement un grand nombre de maladies.
QU’EST-CE QUE L’INFLAMMATION ?
Une réponse immunitaire de notre homéostasie
Le corps possède sa propre intelligence de régulation. Il recherche par nature l’équilibre, que ce soit entre les systèmes, les organes, les échanges cellulaires, la régulation des cycles, les sécrétions d’enzymes et d’hormones, le maintien des constantes vitales, la température… Toute cette formidable intelligence biologique se nomme l’homéostasie. C’est grâce à elle que votre sang est stabilisé à un certain pH, quel que soit le degré d’acidité ou d’alcalinité de l’aliment que vous avez mangé au petit-déjeuner.
L’homéostasie reflète notre capacité adaptative. Lorsqu’un évènement survient et perturbe notre équilibre interne, alors le corps va déclencher toute une série de réactions en cascade afin de retrouver l’équilibre de base.
L’homéostasie est assurée par différentes glandes du système nerveux central, principalement l’hypothalamus, l’hypophyse et la glande pinéale.
L’inflammation est une réponse immunitaire de votre homéostasie pour vous adapter à votre environnement. Elle fait suite à un évènement que l’on pourrait qualifier de traumatisant, car induisant une lésion ou une infection. Cette lésion, cette blessure, cette intrusion ou cette agression agit comme un facteur de stress et déclenche une réponse adaptative de votre organisme qui cherche à retrouver l’équilibre, la fameuse homéostasie. Plus spécifiquement, le système
immunitaire va répondre à l’évènement traumatisant sur ordre du système nerveux. Il est d’ores et déjà intéressant de remarquer que la blessure ou l’intrusion peuvent être d’ordre physique ou psychique. En effet, qu’il s’agisse d’une écharde, d’une entorse, d’un virus ou d’un traumatisme psychique, la cascade inflammatoire déclenchée sera exactement la même biologiquement. Les réponses cellulaires de coagulation et de cicatrisation seront exactement les mêmes, que l’agression soit physique, pathogène ou émotionnelle. Cette similitude implique une prise en charge globale de l’inflammation chronique moderne si nous souhaitons réellement la résoudre.
La cascade de l’inflammation
* L’alerte
Un évènement traumatisant survient : vous vous plantez une écharde dans le doigt. L’évènement est détecté par votre branche orthosympathique du système nerveux autonome (celle qui commande la vigilance). Elle est donc responsable a fortiori de donner l’alerte d’une vulnérabilité potentielle. Lorsque nous détectons un stress, le système nerveux central déclenche l’alarme en sécrétant massivement de l’adrénaline pour activer toutes nos fonctions de survie. Le cœur accélère, nous libérons du glucose pour nos muscles si nous devons nous battre ou courir pour fuir, les pupilles se dilatent pour voir plus loin… Toute une chaîne de réactions mobilise l’organisme pour sa défense.
Endothélium
La réaction inflammatoire
A. HOMÉOSTASIE

Lumière du vaisseau sanguin
Endothélium






B. INFLAMMATION










Médiateurs de l’inflammation
Tissu
Tissu
Cette alerte du système nerveux libère la sécrétion des kinines, les molécules principales de la douleur. Elles donnent la sensation de douleur aiguë et déclenchent quasi instantanément la variation de la mobilité du sang : une courte phase de vasoconstriction suivie d’une phase de vasodilatation. Le but de l’organisme est d’activer les plaquettes sanguines pour qu’elles coagulent au niveau de la brèche et empêchent l’hémorragie. Ce phénomène de l’hémodynamique (variations de la vitesse de la circulation du sang) est responsable de la rougeur et de la chaleur ressentie sur le lieu de la lésion, deux autres caractéristiques principales de l’inflammation.
L’organisme cherche également à attirer un maximum de cellules immunitaires compétentes sur place pour détruire les éventuels pathogènes microbiens qui se seraient infiltrés. Les polynucléaires neutrophiles (globules blancs) sont les premiers à arriver sur place, alertés par des messagers chimiques que l’on nomme les cytokines (par exemple le TNF-alpha). Leur arrivée massive provoque l’œdème, le gonflement typique de la réaction inflammatoire, car ils vont déverser des enzymes pour « nettoyer » les débris microbiens. L’action d’autres globules blancs (les mastocytes et basophiles) va également produire de l’histamine en grande quantité, cette molécule vasodilatatrice activant les cellules inflammatoires. Combinée à l’action des kinines, elle va accentuer la rougeur, l’œdème et la douleur.
Les molécules chimiques faisant circuler l’information inflammatoire comme les cytokines ou l’histamine sont aussi celles qui entrent en action dans l’inflammation chronique (⟶ P. 54).
Les globules blancs sont donc appelés sur place grâce à ces messagers et se déplacent par adhésion aux tuniques vasculaires (paroi des vaisseaux sanguins). Ce phénomène, nommé diapédèse, est une forme de déplacement spécifique des globules blancs, rendue possible par les molécules d’adhésion placées le long des parois internes des vaisseaux sanguins.
Les 5 caractéristiques de l’inflammation
Aulus Cornelius Celsus, à Rome, au ier siècle, avait déjà décrit quatre caractéristiques de l’inflammation (d’où l’étymologie latine des mots) : – rubor, la rougeur ; – calor, la chaleur ; – dolore, la douleur ; – tumore, l’œdème.
Il existe aussi un cinquième paramètre typique de l’inflammation : la perte de fonction, ou functio laesa. Nous sommes immobilisés, soit de façon très brève, car sous le choc de la douleur et gêné par le gonflement, soit de façon temporaire le temps nécessaire à la cicatrisation.
Et le plus souvent, l’immobilisation prolongée entraîne une perte d’élasticité, une rigidification et un raccourcissement des tissus. En plus de provoquer de la raideur et des pertes de mobilité, cette immobilisation nous amène à adopter des compensations qui peuvent elles aussi engendrer des douleurs.
Cette notion de diapédèse est au cœur des recherches actuelles de prévention des métastases cancéreuses. À l’heure actuelle, des molécules de plantes ont montré une efficacité de 80 % sur l’inhibition de ces déplacements et donc la prévention d’une métastase (dissémination des cellules cancéreuses utilisant la diapédèse pour se déplacer) (⟶ P. 40).
* La cicatrisation
Une fois que l’alerte du système nerveux sympathique a été déclenchée, c’est au tour du système nerveux parasympathique de prendre le relais.
La branche parasympathique du système nerveux autonome préside à la récupération et à la réparation en général : digestion, sommeil, récupération musculaire, activation du système immunitaire et ce qui nous intéresse ici, la cicatrisation. Lors de ce processus, certaines cellules vont activer la fabrication de molécules matricielles (fondatrices de la structure) comme le collagène et l’élastine afin de reconstruire du tissu conjonctif.
Les différents types de collagène de l’organisme ont pour but de donner de la structure, de la force et du soutien aux tissus et organes. C’est grâce au collagène que votre peau est tendue sur votre visage, que votre tendon se maintient en place.
Le collagène est composé principalement de trois acides aminés (des morceaux de protéines ; ici la proline, la glycine et l’hydroxyproline) ainsi que de vitamine C, de zinc, de cuivre et de manganèse.
L’élastine a pour but, comme son nom l’indique, de donner de l’élasticité aux tissus. Approximativement mille fois plus extensible que le collagène, elle est composée d’acides aminés (la proline, la glycine, la desmosine et l’isodesmosine).
La combinaison du collagène et de l’élastine va permettre la cicatrisation du tissu endommagé sur une durée plus ou moins longue selon la gravité du traumatisme subi.
Les durées moyennes de cicatrisation
En moyenne, la durée de cicatrisation d’un ligament est de 6 semaines, sous réserve qu’il ait été mis au repos. La cicatrisation osseuse d’une fracture dépend de la vascularisation de l’os. Par exemple elle prend en moyenne 6 semaines pour la diaphyse tibiale ou humérale, alors qu’elle peut mettre 3 à 6 mois pour le scaphoïde, un petit os très peu vascularisé. Une plaie cutanée peu profonde met en général une à deux semaines avant de se résorber. La muqueuse intestinale met, elle, en moyenne 3 mois avant de se restaurer, et sous condition que les agresseurs pathogènes et alimentaires aient été retirés.
Il est intéressant de noter à ce stade que notre cicatrisation est dépendante de la sécrétion de l’hormone de croissance, la growth hormone ou GH. Nous sécrétons principalement cette hormone pendant les premières heures de sommeil profond, au début de la nuit, et plus particulièrement si nous nous endormons avant 23 heures. En effet, les hormones obéissent toutes à des cycles de sécrétion avec des pics et des creux, et la GH ne fait pas exception.
Système nerveux autonome
Système sympathique
Dilatation de la pupille
Diminution de la sécrétion de salive
Dilatation des bronches
Augmentation de la fréquence cardiaque
Diminution de la glycogénogenèse
Diminution de la digestion
Sécrétion de la norépinéphrine
Ganglion cœliaque
Système parasympathique
Contraction de la pupille
Augmentation de la sécrétion de salive
Constriction des bronches
Diminution de la fréquence cardiaque
Diminution de la mobilité intestinale
Stockage de l'urine
Ganglion mésentérique supérieur
Chaîne sympathique
Ganglion mésentérique inférieur
Augmentation de la sécrétion de bile
Stimulation de la digestion
Augmentation de la mobilité intestinale
Contraction de la vessie
Ces cycles de sécrétion appartiennent au phénomène homéostasique dont nous avons déjà parlé (⟶ P. 27) et sont gouvernés principalement par l’hypothalamus, l’hypophyse et la pinéale.
Le processus de cicatrisation se poursuit jusqu’à ce que la blessure soit complètement résorbée. S’il y a des traumatismes répétés au même endroit, les cicatrisations successives peuvent engendrer un processus de fibrose cicatricielle, c’est-à-dire de rigidification progressive de la structure. Sur le long terme, cela cause une sclérose, autrement dit une perte de mobilité dont la réversibilité est parfois un grand défi.
La sclérose engendre un raccourcissement de la structure (comme un muscle ou un tendon) et modifie donc la géométrie d’équilibre originelle (la tenségrité). La sclérose entraîne inévitablement un phénomène compensatoire : la silhouette se modifie (on devient courbé du haut du dos, par exemple), le muscle perd sa capacité à se relâcher, on développe des tensions intestinales chroniques, on fait de l’arthrose… Toute une cascade de réactions inflammatoires liées à la perte d’élasticité et de mobilité d’une structure.
C’est pourquoi nous attacherons tant d’importance dans cet ouvrage à l’étude des causes de l’inflammation chronique et à leur résolution. Vous l’avez compris, notre santé physique et psychique sur le long terme dépend profondément de notre élasticité.


L’INFLAMMATION AIGUË
OU LA « BONNE INFLAMMATION »
Le processus inflammatoire que nous venons de décrire (alerte avec les cinq caractéristiques de l’inflammation, puis la cicatrisation) relève de l’inflammation dite aiguë.
Celle-ci se produit à un moment bien déterminé et pour une durée relativement courte. Physiologiquement, la réaction inflammatoire n’est pas censée durer plus de 48 heures.
Inflammation subaiguë ou intermédiaire
On parle d’inflammation subaiguë ou intermédiaire pour des troubles d’une durée variant entre 3 à 12 semaines, ce qui peut arriver dans le cas de traumatismes plus graves (fractures multiples, brûlures, persistance microbienne avec surinfections successives…).
C’est dans cette catégorie que l’on retrouve toutes les maladies en -ite : tendinite pour l’inflammation du tendon, sinusite pour l’infection des sinus, arthrite pour l’inflammation articulaire, capsulite pour l’inflammation de l’épaule, cystite pour l’infection urinaire…
Les causes de l’inflammation
L’inflammation peut arriver pour trois raisons :
Une lésion traumatique : écharde, entorse, fracture, chute ou toute autre blessure portant atteinte à l’intégrité physique.
Une infection par un agent pathogène : un virus ou une bactérie a réussi à pénétrer vos défenses immunitaires et enflamme la structure ou l’organe atteint (sinus, bronche, vessie, estomac, foie…). Cette inflammation aiguë s’accompagne souvent de fièvre, qui est également un mécanisme de régulation homéostasique. L’élévation de la température corporelle vise à détruire le pathogène. C’est pourquoi il peut être judicieux, jusqu’à un certain point, d’accompagner cette fièvre afin d’aider le corps dans son objectif immunitaire plutôt que de chercher absolument à la faire baisser avec du paracétamol ou de l’ibuprofène. Bien entendu, la fièvre doit rester dans des normes raisonnables, surtout chez les enfants où une élévation trop importante de la température corporelle peut être dangereuse et provoquer des convulsions.
Un traumatisme psycho-émotionnel : il génère l’inflammation en engendrant du stress psychique. En effet, comme nous l’avons déjà évoqué, un évènement traumatique déclenche exactement la même cascade de réactions en chaîne que l’inflammation physique (sécrétion de cytokines pro-inflammatoires et tout particulièrement élévation du cortisol).

Nous activons notre système d’alerte sympathique de la même manière qu’avec un gros hématome après une chute à vélo même si l’évènement ne touche en rien le corps physique.
La résolution de l’inflammation
La cascade inflammatoire déclenchée par l’alerte du système nerveux sympathique est ensuite suivie d’une phase de cicatrisation comme nous l’avons vu précédemment. Cette phase de cicatrisation est possible lorsque nous sommes en état nerveux parasympathique, c’est-à-dire sous la conduite de l’autre branche du système nerveux autonome. C’est l’état relaxé du système nerveux qui permet la cicatrisation, la réparation
cellulaire, la digestion du traumatisme et le retour vers l’état d’équilibre.
La résolution de l’inflammation, c’est-à-dire la cicatrisation et le retour à l’état d’élasticité, dépend donc de notre capacité à nous relaxer.
Or nous vivons presque toutes et tous dans des états de stress intérieurs quasi permanents, avec de hauts niveaux d’hormones de stress circulant dans notre sang. Ces neurohormones de la famille des catécholamines (comme l’adrénaline ou la noradrénaline) participent activement à l’absorption du choc causé par un stress (physique comme émotionnel) et au processus inflammatoire aigu dans l’organisme (⟶ P. 36). Le cortisol est également un acteur majeur de cette
réponse hormonale. Cette hormone est la clé de l’adaptation anti-inflammatoire à court terme de l’organisme lors d’un traumatisme aigu.
Ce même cortisol est aussi un des responsables principaux de la bascule vers l’état inflammatoire chronique.
Le rôle des neurohormones et du cortisol
L’inflammation est un système de réponse adaptative de l’organisme lorsqu’il est confronté à un stress. Ce stress est détecté par notre système nerveux qui déclenche l’alarme et active toute une chaîne de messagers chimiques afin d’attirer sur place les agents immunitaires nécessaires à la défense de la zone impactée et les plaquettes sanguines pour colmater la brèche.
Nous reparlerons plus loin des messagers chimiques pro-inflammatoires. Ce qui nous intéresse ici est le rôle des messagers nerveux qui activent les fonctions liées à l’alerte et à la relaxation, les deux pôles nécessaires du déclenchement de l’inflammation et de sa résolution. On les nomme neurohormones, neurotransmetteurs ou encore neuromédiateurs.
L’alerte est donnée par les catécholamines : l’adrénaline en premier, rapidement suivie de la noradrénaline et de la dopamine. Cette dernière est surnommée l’hormone du plaisir, car elle est notamment impliquée dans toutes les sensations de plaisir, de motivation et de récompense intérieure. La poussée inflammatoire aiguë va donc déclencher une sécrétion de dopamine afin de générer une impulsion interne nécessaire à la fuite ou au combat.
Dans un même temps, le système nerveux central active la cascade de sécrétion du cortisol par les glandes surrénales afin de juguler l’inflammation. Le cortisol est la molécule anti-inflammatoire la plus puissante que le corps produit naturellement. Son action anti-inflammatoire et immunosuppressive (qui réduit les réactions du système immunitaire) majeure a donné naissance à tous les traitements médicamenteux à base de cortisone et de corticoïdes de synthèse.
Les fonctions du cortisol
Le cortisol est un élément incontournable de la réponse antiinflammatoire de l’organisme. Il a plusieurs fonctions, toutes cruciales dans l’adaptation de l’organisme au stress et en corrélation directe avec l’inflammation. En voici quelques exemples : – il inhibe la douleur ; – il inhibe les cytokines proinflammatoires, ainsi que le NF-κB (un facteur de transcription majeur de la réaction inflammatoire dont nous reparlerons plus loin, ⟶ P. 45), mais également d’autres molécules de l’inflammation comme l’histamine, les leucotriènes et les prostaglandines ; – il permet de mobiliser du glucose pour répondre à l’inflammation ; – il module à la baisse le recrutement des cellules immunitaires en favorisant le retour des lymphocytes vers les organes de réserve d’agents immunitaires (comme les ganglions lymphatiques, par exemple).
Son utilisation est aussi très courante dans les thérapies anti-inflammatoires allopathiques, qu’il s’agisse de cortisone en comprimés, de sprays nasaux pour les troubles ORL ou encore de piqûres locales pour soulager les inflammations articulaires. Mais les médecins et les patients savent bien que cette démarche axée sur les symptômes ne peut être efficace que sur le court terme, en raison des problèmes liés à une utilisation trop prolongée de la cortisone.
En effet, nombreux sont les effets négatifs liés à un traitement de cortisone ou de corticoïdes : prise de poids, ventre qui gonfle et fabrique de la graisse, insulino-résistance, œdème du visage, gaz et ballonnements digestifs, caries, perte de cheveux, irritabilité, instabilité d’humeur, tendance dépressive… Et un des effets les plus problématiques du cortisol administré sur le long terme est la déficience immunitaire qu’il génère,
ouvrant ainsi la porte aux infections pathogènes répétées.
Tous ces effets secondaires se retrouvent dans les symptômes des patients souffrant d’inflammation chronique systémique. C’est « normal » : l’installation de l’inflammation chronique est directement liée à une cortisolémie élevée prolongée.
Nous verrons en détail plus loin dans cette première partie les conditions qui sous-tendent l’installation de l’inflammation chronique (⟶ P. 54).
En résumé, l’excès de cortisol entraîne des troubles digestifs, une tendance à la dépression nerveuse et diminue l’efficacité du système immunitaire. Ensemble, ces éléments préparent le terrain pour l’installation de maladies inflammatoires chroniques plus graves.
Les effets du cortisol
Active la vigilance
Engendre brouillard mental, dépression, insomnie
Inflammation aiguë à court terme
Augmente la glycémie
Inhibe la réponse immunitaire et la douleur
CORTISOL
Augmente l’insuline et la prise de poids
Sécrétion chronique à cause du stress
Diminue l’efficacité immunitaire et augmente les infections
Cause des troubles digestifs
Déminéralise (perte de cheveux, caries, troubles articulaires...)