SURF Culture


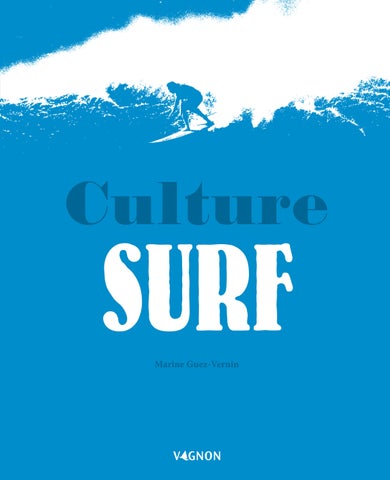



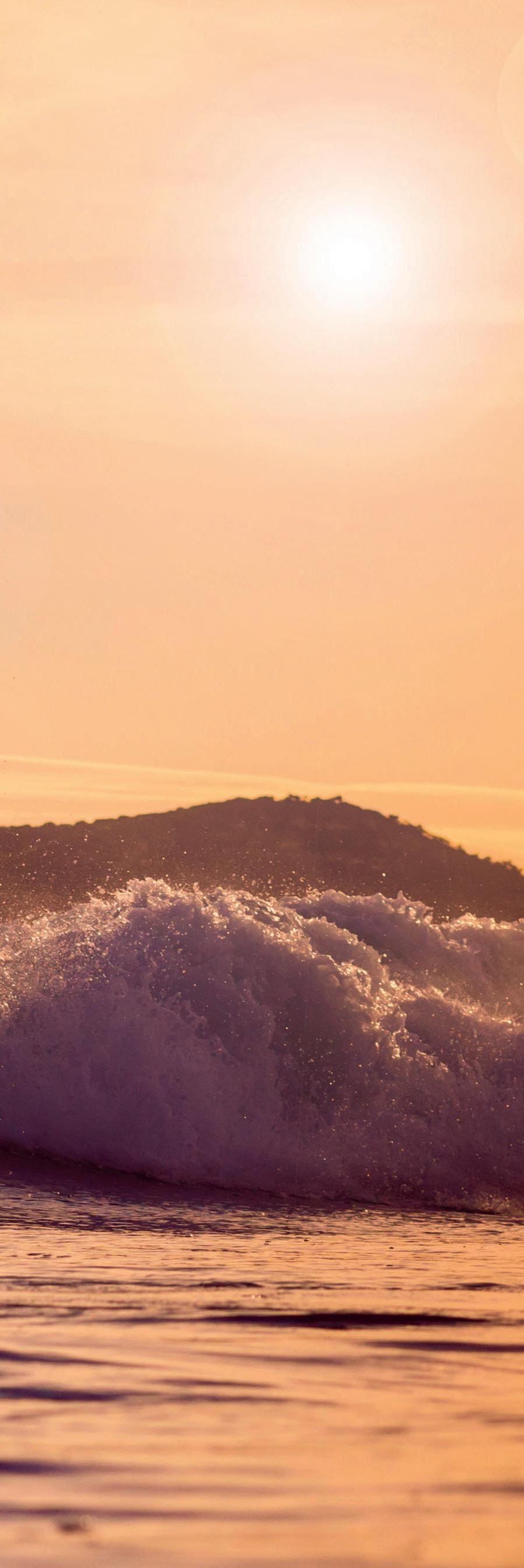
Surf et danse : deux arts du mouvement, plein de similitudes. Le surfeur se laisse guider par la vague, le danseur par la musique. Chacun, de la même façon, doit s’ajuster sans cesse, improviser pour garder l’équilibre, rester fluide, éviter la chute. Après tant d’entraînements et de répétitions, le geste semble si facile à regarder, si naturel pour ceux qui s’émerveillent. Le surf ?
On dirait du sport. Mais à mieux le regarder, c’est avant tout une danse, et pour sûr une danse de la joie.
Ils glissent, virevoltent, se plient et se déplient, dans un équilibre toujours fragile. Le surf partage avec la danse le même langage du corps, il va chercher les mêmes ressources, jusque dans ses origines polynésiennes. Bien avant la colonisation, à Hawaï, la danse hula tout comme le heʻe nalu – nom originel du surf – honoraient la nature sacrée par le mouvement. Ensemble, ils ont failli disparaître sous l’interdiction des missionnaires qui ne supportaient pas cette liberté d’être, mais tous deux ont survécu.
L’évocation de la danse revient chez de nombreux champions : pour la surfeuse Stephanie Gilmore, « la puissance, la grâce, l’improvisation et le rythme » se rejoignent dans les deux pratiques. Le Guadeloupéen Gatien Delahaye cherche, pour sa part, à mettre en valeur la dimension artistique de ses figures, cet instant où, « quand tout s’aligne, on ne pense plus, on danse avec la vague ». Danser ? Comment faire autrement ! Car l’instabilité de la vague oblige à s’adapter en permanence par le geste pour garder l’équilibre. Il faut accepter, encore et toujours, cette part d’incertitude si caractéristique du surf. Cela va sans dire, c’est bien l’eau qui mène la danse et décide si le pas d’après sera périlleux ou tranquille, sans jamais prévenir.
Festivités
Lancé en 2022 à la Chambre d’Amour d’Anglet, face à l’océan, le festival Surf N Dance offre chaque été une terre de rencontre entre danse, surf et yoga. Créé par le danseur et chorégraphe Brice Larrieu, alias Skorpion, il illustre à quel point ces disciplines sont transversales. Le longboard dancing, long skateboard hérité du surf, y a fait son entrée. Cette discipline dit à elle seule qu’on peut, sur mer comme sur terre, glisser et danser en même temps, et pourquoi pas chanter.
De la terre ferme, quand on regarde les surfeurs qui avancent ou reculent sur leur planche en pas croisés (cross-steps), on a l’impression d’assister à une chorégraphie savamment apprise, qui pourrait tout autant être exécutée au sol, sur une scène. Pourtant, leurs pieds et leurs bras, hésitants, ne font que s’adapter, seconde après seconde, au rythme de la vague. Quand les Occidentaux ont découvert le surf en débarquant à Hawaï, c’est peut-être ainsi qu’ils ont cru voir les rois sur l’eau : d’étranges êtres qui dansaient sur des planches, sans craindre les éléments.
De la plage, on pourrait les admirer des heures évoluer sur les vagues. Sur son longboard, un surfeur avance et recule délicatement. De plus près, on remarque qu’il vient poser cinq ou dix orteils (hang five ou hang ten) sur le nose, l’avant de la planche. Suspendu à cette extrémité, tout en élégance, il a l’air de flotter en balancier. Ailleurs, cette fois sur des shortboards, des surfeurs s’attaquent à la verticalité de la vague ; la danse est plus saccadée, syncopée. Les corps s’élancent, se compressent avant de remonter la paroi (bottom turn), se retournent brutalement (roller) et donnent un coup de reins sec lors d’un snap pour faire pivoter la planche d’un coup d’un seul. Quant à l’aerial, c’est le saut vers le ciel, planche collée aux pieds, le corps qui pivote à 360°, mélange de danse aérienne et d’acrobatie. Pour sûr, ces esprits-là n’ont que deux mots à la bouche : « Having fun ! »


Le surf tandem, entre surf, danse et art du cirque
Au début du XXe siècle, les beach boys de Waikiki portaient les touristes sur leurs épaules pour leur faire découvrir les sensations uniques de la glisse. Une photo de cette époque reste célèbre : la jeune nageuse Viola Hartman debout sur les épaules du champion Duke Kahanamoku lors d’une démonstration de surf à Corona del Mar, en Californie, en 1922. Ce n’est que dans les années 30 que le surf tandem quitte sa nature d’attraction pour devenir une discipline à part entière. Un couple de surfeurs conquis par ce qu’ils ont découvert à Hawaï, Pete Peterson et Lorien Harrison, continuent la pratique en Californie et la font connaître. La discipline se professionnalise. Les prouesses de Steve et Barrie Boehne, plusieurs fois champions du monde, leur ouvrent les portes de l’international dans les années 70. Aujourd’hui, en France, Rico Leroy et Sarah Burel émerveillent par leur grâce aquatique et leur complicité. Deux humains, une planche et l’océan comme piste de danse.



À la fin du XIXe siècle, malgré la pression des missions calvinistes pour faire disparaître cette pratique accusée de paresse et d’impudeur, le surf est toujours vivant. Les bateaux à vapeur et les lignes de chemin de fer facilitant les échanges, on vient goûter à la douceur exotique d’Hawaï, tandis qu’en Californie se développent de nouvelles cités balnéaires. Sous l’impulsion de trois hommes d’exception – Jack London, George Freeth et Alexander Hume Ford –, le heʻe nalu, surf des origines, s’apprête à devenir un sport. Mais un sport de roi.
En 1898, Hawaï est annexé par les États-Unis. Si la colonisation a fait des ravages irréparables, le surf, autrefois condamné, est envisagé comme un vestige que l’élite américaine veut garder, comme l’explique Jérémy Lemarié dans son ouvrage Surf, Histoire d’une conquête (éditions Arkhê, 2021). Sur la plage de la divine Waikiki, près du port d’Honolulu, les nouveaux touristes peuvent compter sur la protection des beach boys, des hommes à tout faire, sauveteurs et nageurs d’exception, qui apprennent à surfer aux plus téméraires. Surfer ! Quelques décennies plus tôt, Mark Twain affirmait : « Seuls les indigènes sont maîtres dans l’art du surf. » Les temps ont bien changé. On vante les vertus de l’océan pour la santé, le train et le bateau facilitent les échanges entre Hawaï et la Californie, où
Santa Cruz et Santa Monica deviennent des cités balnéaires prisées. À Santa Cruz, justement, depuis que trois princes hawaïens ont montré leurs talents sur les vagues en 1885, certains se demandent si cette pratique exotique ne pourrait pas devenir un sport de blancs.
Trois hommes, une passion
En 1907, Jack London, au sommet de sa carrière et en plein tour du monde avec son épouse et son fils, fait escale à Waikiki. Émerveillé devant quelques surfeurs qui dansent sur les vagues, il tente cette expérience pour le moins périlleuse. Il peut compter sur la bienveillance du journaliste américain et surfeur passionné, Alexander

Hume Ford, installé à Hawaï. Intervient alors George Freeth, beach boy de son état, né de parents irlandais et hawaïen, qui apprend à l’écrivain à « négocier des rouleaux démesurés ». London tombe amoureux du surf. Les trois hommes ne se quittent plus. Ensemble, chacun avec ce qu’il sait faire de mieux, ils mettent tout en œuvre pour faire connaître la discipline en Californie. Pour le Comité de promotion d’Hawaï, créé par des élites souhaitant donner une image idéalisée de la
culture hawaïenne – en décalage avec la réalité vécue par le peuple hawaïen –, les démonstrations de surf, exotiques et joyeuses, sont un moyen idéal pour attirer les touristes et développer l’économie locale. George Freeth se prête au jeu. London et Ford se mobilisent pour le faire inviter à Los Angeles et surfer sur les vagues de Venice Beach. La presse locale parle alors d’un « champion de surf venu d’Honolulu ».

Jack London et son épouse
Charmian Kittredge lors d’une croisière à bord du yacht Snark à Hawaï et en Australie en 1907
Avec London, « un sport de roi » célébré
« Un sport de roi pour les rois naturels de la terre, voilà ce qu’est le surf. » C’est ainsi qu’à l’automne 1908 Jack London ouvre l’article publié dans le magazine féminin à grand tirage, Woman’s Home Companion. Il y célèbre « un art de la non-résistance », la « physique du surf » nécessitant d’apprendre à connaître les vagues, un sport pratiqué par des corps sculptés et tannés par le soleil. Beauté et volupté. L’article, intégré plus tard dans son récit La Croisière du Snark, devient un best-seller et contribue à faire découvrir le surf au grand public.
Ford, le premier club de sports
nautiques au monde
De son côté, le journaliste Alexander Hume Ford fonde le premier Outrigger Canoe Club d’Hawaï, où l’on se retrouve pour le sport mais aussi pour les affaires. Majoritairement fréquenté par des « haole » – des blancs – il rivalise bientôt avec le Hui Nalu Club, créé la même année par des Hawaïens autochtones, dont un certain Duke Kahanamoku… Ford ne s’arrête pas là. Il part en Australie, où il promeut encore le surf et prépare (sans le savoir) le passage décisif du Duke, quelques années plus tard.
Freeth, les prémices du surf-sauvetage
George Freeth, quant à lui, marque l’histoire, ce que sa mort prématurée fait trop souvent oublier. En 1908, il devient un héros après avoir sauvé sept pêcheurs japonais de la noyade. Son exploit illustre une évidence : savoir bien nager est plus efficace que se déplacer en barque pour aller porter secours. Grâce à lui, l’idée d’intégrer le surf aux techniques de sauvetage commence à émerger. Engagé par le Los Angeles Athletic Club de 1913 à 1915, Freeth devient l’entraîneur de Duke Kahanamoku après sa première médaille d’or olympique. Après sa mort en 1919, The Duke poursuit sa voie et popularise le surf dans le monde entier.
L’Outrigger Canoe Club, toujours en vie
Tombé en ruine pendant quelques années, l’Outrigger Canoe Club fondé par Ford continue de promouvoir les sports nautiques hawaïens. Reconstruit en 1941, aujourd’hui déplacé à Diamond Head, ce club célèbre l’aloha (voir p. 92) mais attention, members only !
« Là où ne régnait un instant plus tôt que l’immense désolation et l’invincible rugissement de l’océan se trouve un homme qui, debout, dressé, ne bataille pas frénétiquement contre cette force sauvage, n’est pas englouti ni broyé ni ballotté par ces monstres tout-puissants, mais qui les domine tous, superbe et serein, en équilibre au sommet de cette vertigineuse crête, les pieds enfouis dans ses remous, les genoux fouettés par le sel des embruns, et tout le reste du corps à l’air libre, sous le soleil aveuglant, et le voilà qui fend l’air, volant vers le rivage, volant à la vitesse effrénée du flot qui le porte. C’est un nouveau Mercure, un Mercure noir. »
Jack London, Les Joies du surf (éditions Rivages poche, 2024)

Dans les années 50, bien avant que la côte basque ne devienne la « Californie française », c’est sur ses plages que le surf naît sur le continent européen. Pas de clubs, pas de règles, juste une bande de copains fascinés par les photos de silhouettes glissant sur l’eau à l’autre bout du monde. Ils bricolent, tentent, s’unissent autour de cette passion naissante et, sans le savoir, donnent à leur terre une place unique sur la carte du surf mondial.

Le fil à la patte
En 1958, après avoir failli se noyer, Georges Hennebutte conçoit une chevillère à Velcro qu’il attache à sa planche par une ligne élastique pour ne plus risquer de la perdre. Il vient d’inventer le leash, qu’il appelle « fil à la patte » et ne brevette pas. Dans les années 70, l’Américain Pat O’Neill le commercialise à grande échelle, sans aucun lien avec son créateur originel.
1952. Jacky Rott, ébéniste à Dax, aperçoit des silhouettes debout sur l’eau dans une séquence au cinéma. Glisser, il sait bien que c’est possible avec les planky, ces petites planches appréciées des jeunes pour filer à plat ventre dans les vagues. Mais se mettre debout ? Jamais de la vie. Pourtant, il tente de fabriquer une planche comme il l’a vue, en vain. Appelé à ses obligations militaires, il en reste là. En 1956, Joël de Rosnay, jeune étudiant, découvre le documentaire Hawaï, îles de rêve, comme il le raconte dans son livre Petit Éloge du surf (éditions Les Pérégrines, 2020) L’ingénieur bayonnais Michel Barland, lui, est frappé par une photo dans le livre du même titre de Jacques Chegaray. Et si, ici aussi, on pouvait surfer comme là-bas ?
En août 1956, une planche de surf arrive à Biarritz avec le matériel d’un film en tournage, Le soleil se lève aussi, adapté du roman d’Ernest Hemingway. Le scénariste Peter Viertel s’essaye sur les vagues de la côte des Basques, devant l’écrivain et des témoins ébahis. La planche finit par se briser, mais Georges Hennebutte, artisan biarrot et voyageur connaisseur de ces grands modèles en bois, la répare. Des liens d’amitié se tissent. Jacky Rott, de retour au pays, tente de reproduire la planche réparée. Au printemps 1957, son modèle lui permet de garder l’équilibre sur les vagues de Hossegor quelques instants. L’Américain Peter Viertel revient, une nouvelle planche dans ses bagages. La bande s’agrandit. L’été 1957 est le premier été du surf sur la côte des Basques de Biarritz. Leurs noms mis bout à bout forment les « tontons surfeurs » – comme les a nommés le journaliste Alain Gardinier –, et ce sont eux qui ont donné vie au surf en France : Michel Barland, Robert Bergeruc, Jean Brana, Joël de Rosnay, Claude Durcudoy, Henri Etcheparé, Georges Hennebutte, Pierre Laharrague, Jo Moraiz, André Plumcoq, Paul Pondepeyre, Bruno Reinhardt et Jacky Rott.
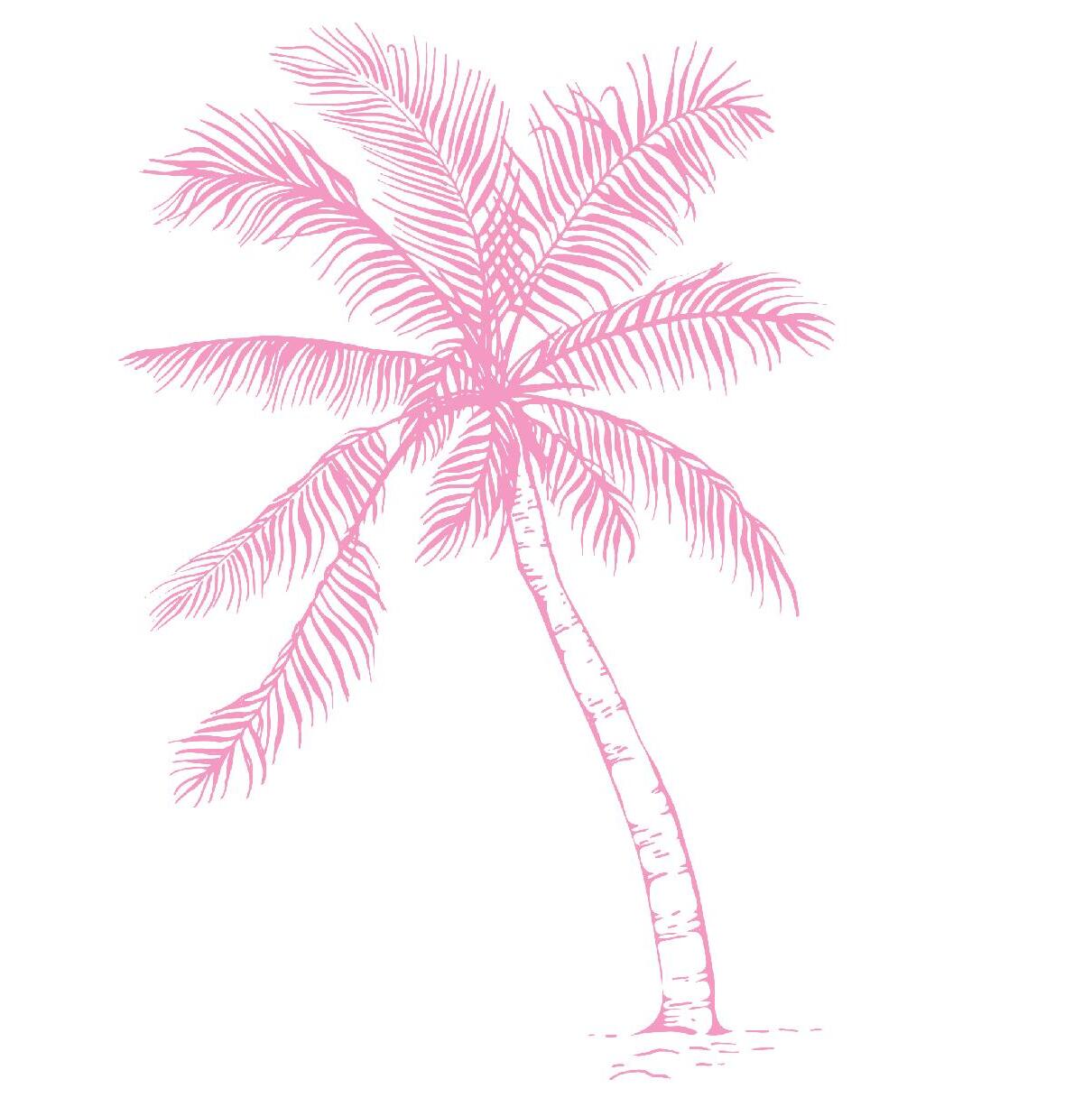
Les uns et les autres apprennent le surf sur le tas, sans savoir qu’il faut aller side way – de travers plutôt que face à la plage –, avant que des surfeurs étrangers ne révèlent le tuyau qui change tout. Barland et Rott cherchent comment optimiser les planches. Quand Viertel revient encore, avec des planches en balsa, ils s’en servent comme modèles et fondent la première entreprise de fabrication de planches, bientôt en mousse polyuréthane. Les maires des localités côtières craignent les dérives d’une contre-culture associée au surf, aux USA, que la jeunesse enfourche. Pourtant, la bande de la côte n’a que le plaisir de la glisse en tête, et rien d’autre.
Au fil du temps, la pratique commence à s’institutionnaliser : en 1959, le milliardaire péruvien Carlos Dogny rejoint l’équipe pour fonder le tout premier club, le Waikiki. L’année suivante, à la Grande Plage de Biarritz, le public découvre les premiers championnats de France, dont Joël de Rosnay sort vainqueur. Puis vient le premier championnat d’Europe, gagné par Jacky Rott. La presse locale parle d’un « sport new-look ». Outre-Atlantique, le magazine Surfer incite à aller tester les vagues du côté de la ville basque.
Les nouveautés s’enchaînent. Joël de Rosnay crée le Surf Club de la plage de la Chambre d’Amour d’Anglet : chacun son club, chacun son identité, dans une saine rivalité. Pour Jo Moraiz, incontournable de la bande, il est temps de passer à la vitesse supérieure. En 1963, il ouvre le Biarritz Surf Club. L’année suivante, la Fédération française de surf commence à structurer l’aventure. Puis viennent le premier surf shop de la côte basque et la première école de surf. Personne n’y croit encore vraiment, pourtant les décennies à venir vont consacrer mondialement le surf sur la côte basque, qui va s’étendre à la côte landaise et la côte girondine, avec leurs deux pôles incontournables, Hossegor et Lacanau. Tout ceci n’aurait jamais existé sans ces amis que ces souvenirs uniront à jamais. Depuis 2023, la place des Tontons Surfeurs leur est dédiée sur la côte des Basques de Biarritz.

Joël de Rosnay
La Fédération
française de surf
En 1964, le maire de Biarritz, Guy Petit, fonde la Fédération française de surf pour réunir les clubs du littoral et officialiser le surf comme discipline sportive. Aujourd’hui, la Fédération, installée à Hossegor, organise, développe et réglemente la pratique sous toutes ses formes. Elle encadre la formation des éducateurs, labellise les écoles, organise les compétitions nationales, promeut l’accès du surf pour tous et veille même à la préservation du littoral.
La passion du surf ne se vit pas que dans les vagues. Une fois hors de l’eau, délestées de leur fonction première, certaines planches commencent une seconde vie chez des collectionneurs passionnés. Si l’on rassemblait tous les objets, œuvres d’art et accessoires qui ont façonné la culture surf, il faudrait sans doute un musée haut comme une vague hivernale à Nazaré.
À l’abri des rayons du soleil et des embruns marins, la planche collectionnée n’attend plus qu’une chose : être admirée, commentée et restaurée si besoin, tâche difficile qui oblige à toucher à sa patine, tout en conservant l’âme de son époque. L’esthétique, la signature du shaper qui l’a fabriquée, la beauté de ses finitions, sa palette de couleurs, son logo emblématique et son état de conservation sont bien sûr essentiels, mais son histoire l’est tout autant : a-t-elle appartenu à un grand nom du surf ? A-t-elle chevauché des vagues mythiques ? Quelle époque a-t-elle connue ? Le coup de foudre entre l’objet et le collectionneur fait le reste. Cette passion prend parfois des proportions impressionnantes, étant donné la taille de l’objet. Certains transforment des garages entiers en véritables musées privés, avec système de contrôle de température et d’humidité, et protection des rayons UV dignes des plus grandes institutions.
À les entendre, c’est comme dans une histoire d’amour. Beaucoup sillonnent le monde pour la trouver, quand ils n’ont pas les yeux rivés sur les ventes sur Internet. Les collectionneurs partent en quête de


trésors qui leur ressemblent. À Hawaï, Luis Real vibre surtout pour les planches des champions, Randy Rarick, pour la restauration des modèles vintage, Wayne Babcock, pour les pièces anciennes. En Nouvelle-Zélande, Dusty Waddell s’attache à préserver la mémoire du surf de son pays. Cette passion s’étend d’ailleurs à toutes sortes d’objets liés à la culture surf : magazines, photographies, combinaisons, accessoires d’époque, enseignes… Du côté de l’Europe, le Biarrot Pierre-Bernard Gascogne, cofondateur du magazine Surf Session, possède une des plus belles collections du continent, dont un modèle de planche dessiné par Tom Blake. Robert Rabagny, « l’homme du Biarritz Surf Festival » – dans les trois cents pièces à son actif –, pourrait parler des heures de la planche de

Southern Surf Festival, en Australie
Hotdogger Surf Swap Festival, la joie de l’échange
Au phare de Biarritz, chaque année, le Hotdogger Surf Swap Festival fait l’évènement pour les amoureux de belles pièces. Le savoir-faire du shaper est à l’honneur : ici, une exposition de planches de collection, là, un espace d’achat-vente et d’échange, le tout dans l’atmosphère joyeuse et musicale d’un festival. Autant d’occasions de rencontrer collectionneurs, surfeurs et shapers du monde entier. Certaines planches sont même choisies pour rejoindre le line up – ce sont de beaux moments en perspective !
Greg Noll. Dans son monde à part, Gérard Decoster possède quelque deux mille pièces, qu’il expose via son association Histoire, art et culture surf (HACS). Adepte de la « confusion des genres », il se passionne pour la diversité de la culture surf, d’une planche de skate ayant appartenu à Duke Kahanamoku, à une œuvre d’art contemporain en passant par un objet chiné dans une boutique pour touristes. S’il était possible de collectionner les vagues…
Les ventes aux enchères font monter l’adrénaline des collectionneurs à l’instant crucial du « qui dit mieux ». À Honolulu, en 2011, dernière année de la Hawaiian Islands Vintage Surf Auction (HIVSA), une planche en séquoia surfée par John Kelly part à 42 000 dollars. En Europe, à Saint-Jean-de-Luz, lors de la première session de la Vintage Surf Auction en 2023, un modèle californien appartenant au collectionneur Éric Gros part, quant à lui, à 8 600 euros. Quand il s’agit d’innovation technologique sur des modèles rares, on peut vite partir dans les hautes sphères. En 2009, une des dix planches en nickel conçues par le designer Marc Newson et le shaper Dick Brewer pour le surfeur de gros Garrett McNamara est vendue à 220 000 dollars à New York ! La palme d’or revient aux 1 300 000 dollars déboursés en Nouvelle-Zélande en 2014 par un inconnu pour un modèle unique, une pièce de musée avant l’heure. Cette œuvre, jamais mise à l’eau, nommée The Rampant, a été conçue par le shaper Roy Stuart dans le but, dit-il, de « créer la meilleure planche de surf au monde si nous n’avions aucune limite ». Coque creuse en bois de paulownia, aileron en forme de tunnel, dérive inspirée d’une baleine à bosse, lion en or peint sur la surface… Tout laisse à penser que ce sont des considérations uniquement esthétiques. Il n’en est rien. C’est la fonction qui crée la beauté. Et visiblement, elle n’a pas de prix. Si l’ambiance d’une salle des ventes reste unique en son genre, les collectionneurs du XXIe siècle font de plus en plus monter les enchères à partir de leur application mobile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
C’est ce que permet la California Gold Surfboard Auction, une des plus importantes plateformes de vente en ligne de planches de surf et d’objets de collection. Cette ouverture facilitée change la donne. Plus besoin des voyages et des rencontres pour trouver son bonheur. Mais le bonheur de trouver la planche n’est-il pas aussi celui des rencontres qu’elle provoque ? Peut-être faut-il juste le bon équilibre pour que les deux mondes continuent de faire des heureux.
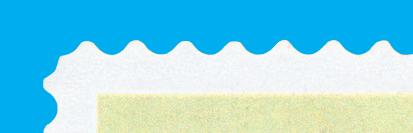

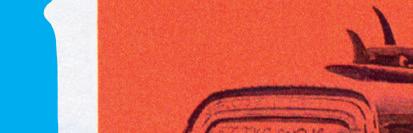
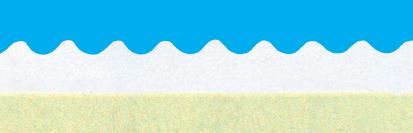
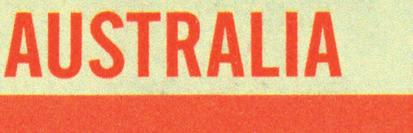







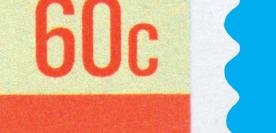

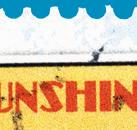























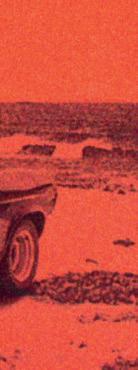





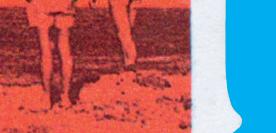
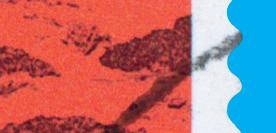


















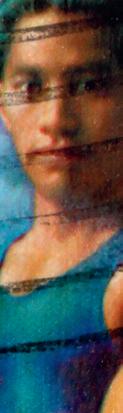






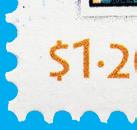


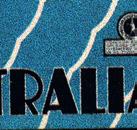






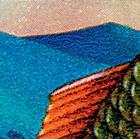














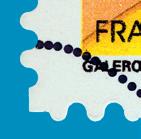




































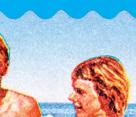



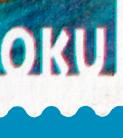








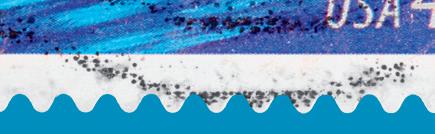


















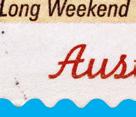
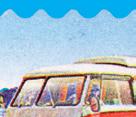

























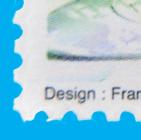









































De l’anglais shaper, « façonneur ».
Le shape d’une planche exige un travail de haute précision, la moindre variation peut affecter sa stabilité ou sa réactivité. Être shaper, c’est être artisan et artiste, mais aussi connaître le langage des vagues et la biomécanique sur le bout des doigts, être surfeur ou l’avoir été, savoir écouter, inventer. Une fabrique de bonheur.
L’atelier, d’abord un lieu de rencontres
Pour se procurer une planche, il y a les grandes enseignes et leurs séries standardisées, et puis il y a les ateliers des shapers, qui respirent la culture surf et la passion de la glisse. Si la qualité fait la différence avec la production industrielle, c’est aussi parce que l’échange fait partie du processus de fabrication. Avant le premier coup de ponceuse, entre shaper et surfeur, on discute, on réfléchit ensemble, on précise… Le shaper prend le temps de consigner toutes les informations utiles qui lui permettront de définir son modèle : quel est le poids du surfeur, sa taille,
son niveau ? Quelles sont ses habitudes de glisse, ses vagues préférées, ses attentes particulières ? Souhaite-t-il plus de stabilité ou de maniabilité ?
Plus le surfeur est familier avec le vocabulaire de la planche, plus le dialogue est fluide. Le shaper, lui-même surfeur, connaît le langage des vagues sur le bout des doigts et la façon dont le corps réagit à leur contact. Derrière la minutie du travail, le but est sensoriel : du plaisir, de la fluidité et, qui sait, que la vague fusionne avec les planches qui la traversent.
Au commencement était la forme
Tout commence par une matière brute posée sur l’établi, le plus souvent un pain de mousse en polyuréthane ou en polystyrène, bien que des matières écoresponsables voient le jour. Le shaper à l’ancienne, l’œil affûté, trace l’outline (le contour) à l’aide de gabarits en contreplaqué et d’un mètre ruban. Vient ensuite le façonnage, au rabot, à la ponceuse. Il s’attaque à la longueur, à la largeur, à l’épaisseur, aux bords (rails), à la courbure (rocker). D’autres utilisent un logiciel de modélisation 3D pour dessiner la planche et générer un fichier numérique qui sera utilisé pour la découpe à la machine.
À mesure que les jours passent, la poussière blanche envahit la surface du sol, les chutes s’accumulent, la silhouette de la planche s’affine, traversée par le stringer (latte de bois au centre), qui lui sert de colonne vertébrale.




Une immersion dans l’univers et l’esprit du surf, des origines à nos jours
Quelle autre pratique consiste à glisser sur une surface mouvante et imprévisible ? Cette question révèle les multiples facettes du surf, sport de compétition pour les uns, moyen d’accès à la plénitude et étendard de liberté pour les autres, source de bienfaits pour le corps et l’esprit dans tous les cas.
À travers une diversité de sujets et une riche iconographie, explorez le monde du surf : ses vagues et ses spots emblématiques, l’histoire de ses origines, les grands noms qui l’ont fait évoluer, les ateliers des shapers, son art de vivre, combien il a inspiré les artistes et les penseurs…
Un sport de roi, de Waikiki à la Californie · Pionniers du surf de gros · Surf music, le son de la glisse · Le wipeout, le calme pendant la tempête · Kelly Slater, le GOAT · Jet-skieur, héros de l’ombre · Mavericks, un début d’inclusion · L’esprit d’aloha…