








































































































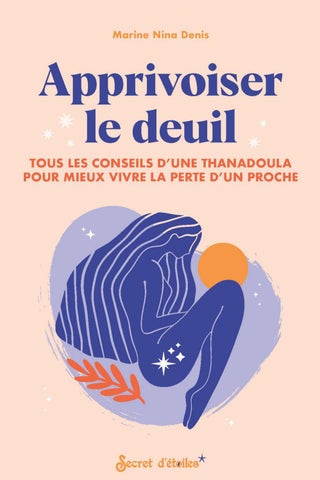









































































































1. C’est quoi le deuil, concrètement ?
5. Le deuil, un processus (et pas une ligne droite)
5. Ce qui se passe dans le mental
5. Ce qui se passe dans les émotions
5. Ce qui se passe dans le corps
5. Le deuil n’est pas une faiblesse
2. Ce que personne ne nous dit sur le deuil .
5. Mythe n° 1 : « Le deuil suit des étapes »
.23 Mythe n° 2 : « Le temps guérit toutes les blessures » 24
5. Mythe n° 3 : « Il faut tourner la page »
5. Mythe n° 4 : « Il faut être fort·e »
3. Pourquoi le deuil fait-il si peur (et pourquoi c’est normal) ?
5. La peur de la mort . . . . . .
5. La peur d’être changé·e à jamais
5. La peur de ne plus être compris·e .
5. La peur de souffrir encore .
4. Le deuil invisible et les autres pertes .
5. Faire le deuil de l’enfant que l’on n’aura pas . . . .35
Le deuil d’un animal : une perte souvent
5. Apprendre la maladie d’un·e proche : quand le diagnostic tombe
5. Maladies neurodégénératives : le deuil blanc
5. Le deuil après une rupture amoureuse : une souffrance souvent éclipsée .
5. La fin d’une amitié : une perte rarement reconnue
5. Un déménagement : une
39
5. La fin d’un projet : un deuil discret mais profond . . 41
5. Apprendre qu’on est malade : un deuil intérieur, souvent silencieux
41
5. Légitimité de toutes les formes de deuil . . . . . . . 42
CHAPITRE II : RESSENTIR
1. Colère, culpabilité, injustice : quand les émotions débordent
.45
5. La colère : contre qui, contre quoi ? . . . . . . . . . . . . 48
5. La culpabilité : ce poison silencieux .
5. L’injustice : quand le monde semble absurde . . 50
2. Quand le corps parle : deuil et sensations physiques
5. Le corps en état de choc
5. Le poids du chagrin
5. Quand le corps garde la trace
3. Quand la tête s’emballe : comprendre le deuil mental
5. L’esprit en boucle
5. La mémoire perturbée
5. L’identité bousculée
4. Les émotions en tempête : accueillir sans se noyer
5. Les montagnes russes émotionnelles
5. La peur d’être débordé·e
5. Culpabilité, soulagement, amour : les émotions taboues
1. Les outils du quotidien : apprivoiser le deuil au fil des jours
5. Ralentir, respirer, s’ancrer
5. Écouter le corps, prendre soin de soi
5. S’exprimer avec créativité
5. Trouver des appuis extérieurs
2. Redéfinir le lien avec la personne décédée
5. L’amour ne meurt pas
5. Créer des espaces de mémoire vivante
5. Porter l’héritage
3. Reconstruire, petit à petit . . .
5. Accepter de revivre . . . . . . . .
5. Faire de la place à l’imprévu . .
5. Accueillir la joie sans culpabilité . . . .
4. Une spiritualité qui apaise . . .
5. La spiritualité comme fil de sens . . . . . . .
.79
80
81
81
.83
84
5. Les signes, les présences, les intuitions . . . . . . . . .85
5. Consulter un·e médium : une aide possible ? . . . .85
5. Créer ses propres rituels .
CHAPITRE IV : TRANSMETTRE ET PARTAGER
1. Le deuil dans la société : parler, transmettre, transformer . .
5. Rompre le silence
5. Éduquer à la mort dès le plus jeune âge .
5. Réinventer une culture du deuil . .
2. Créer un espace pour son ou sa proche décédé·e
5. Le lien continue autrement .
5. Un autel, un coin, un geste
5. Vivre avec et non contre
3. Revenir à la vie .
5. Reconnaître le vivant en soi
5. Explorer le renouveau .
5. Habiter une autre forme de paix .
4. Offrir et transmettre .
5. Quand le chagrin devient fertile
86
91
94
.97
98
100
101
102
103
104
105
5. Créer des espaces d’écoute et de lien . .
106 Faire trace, transmettre, relier .
5. Quand demander de l’aide (et à qui) ? .
5. Les thérapeutes : des guides .
5. Les thanadoulas : un accompagnement spécialisé et humain . .
5. Les sophrologues et les kinésiologues : les approches corporelles douces . .
5. Les art-thérapeutes (musicothérapie, bibliothérapie…) : s’exprimer par l’art
5. Les groupes de parole : partager pour se sentir plus léger
5. Cercles laïcs ou religieux : se tourner vers la spiritualité .
CHAPITRE V :
1. Revenir à soi, à son corps, à l’instant
2. Créer des rituels symboliques
5. Rituels d’ancrage
5. Rituels d’hommage
3. S’exprimer autrement
5. À travers les arts créatifs
5. À travers l’écriture
Conclusion
Annexes
Foire aux questions
109
112
112
126
| Témoignage |
Hugo, quarante-cinq ans, deuil de sa mère
Quand ma mère est morte d’un AVC, tout s’est figé, sauf moi. Je suis resté en mouvement. J’ai organisé l’enterrement, trié ses affaires, repris le travail comme si de rien n’était. J’avais cette phrase dans la tête : « Elle aurait voulu que je sois fort. » Alors j’ai serré les dents.
Mais trois mois plus tard, c’est mon corps qui a lâché. Vertiges. Nausées. Crise d’angoisse à la boulangerie. Moi qui avais toujours été solide ! Moi qui pensais que le deuil, c’était un moment à traverser vite…
Une psychologue m’a alors dit une phrase qui m’a marqué : « Le deuil se vit, ou il se venge. » Elle m’a expliqué que le chagrin n’est pas un ennemi ; que c’est un processus naturel, comme une convalescence. J’ai commencé à lire sur le deuil. À comprendre les vagues, les étapes, les allers-retours.
Ce n’était pas du relâchement, c’était un réapprentissage. J’ai compris que j’avais le droit de m’effondrer. Le droit de pleurer ; même si j’étais un homme de quarante-cinq ans ; même si j’étais « le grand de la famille ». Le droit d’avoir mal.
On entend souvent parler de « faire son deuil ». Comme si c’était une tâche à accomplir. Un objectif à atteindre : « Tu coches ça, et après tu vas mieux. » Mais ça n’a rien à voir avec tout ça.
Quand un·e de nos proches décède, c’est un tremblement de terre. Notre monde s’effondre, mais les autres autour continuent à vivre comme si de rien n’était. On se sent souvent seul·e et isolé·e, même si les personnes autour de nous sont également en deuil.
Et surtout, ce n’est pas un problème à résoudre, mais un passage à traverser. Intime, brutal parfois, silencieux souvent. Un passage qui secoue tout : le corps, le mental, les émotions, et même l’âme. Un moment de vie qui vient nous confronter à l’essence même de ce que signifie être humain·e : aimer, perdre, survivre, transformer. Le deuil, c’est la trace de l’amour qui a été partagé. Il est là pour nous rappeler que l’absence n’efface pas la présence, mais la redéfinit.
On aimerait bien que ce soit clair, que ce soit simple, mais en vérité, le deuil, c’est un sentier sinueux, avec des bosses, des creux, des détours imprévus.
Il ne ressemble pas à une ligne droite. Plutôt à une spirale. Parfois, tu crois que tu vas mieux, puis une chanson, une date, une odeur, une photo te font à nouveau t’effondrer. Alors tu te dis : « J’y étais presque… et je repars de zéro. » Mais non, tu ne repars jamais de zéro : tu continues. Tu fais un pas de côté. Tu revisites une émotion. Tu n’es pas en retard. Tu es en train de traverser.
C’est une expérience de transformation. Le deuil n’a pas de règle fixe ni de déroulé prévisible. Nous sommes tous·tes différent·e·s. Chacun·e le vit à sa manière, à son rythme, selon son histoire, son lien avec la personne décédée et selon ses ressources intérieures. Il y a ceux ou celles qui plongent tout
de suite dans le chagrin et ceux ou celles qui restent longtemps figé·e·s dans une forme de sidération. Il y a ceux ou celles qui rient beaucoup, même au cœur de la peine, et ceux ou celles qui se sentent vides, sans larmes. Chaque réaction est tout à fait normale et aucune n’est meilleure qu’une autre.
Chaque jour, ou quand tu en ressens le besoin, écris librement les sensations, les idées, les envies qui te traversent. Pas besoin que ce soit beau ni logique : il faut juste faire sortir ce qui pèse. Tu peux commencer par : « Aujourd’hui, je me sens… » ou « Je ne comprends pas pourquoi… ».
Tu peux écrire dans un carnet, sur une feuille volante ou dans ton téléphone. L’important, c’est de laisser une trace à l’extérieur.
Quand une personne que l’on aime décède, notre cerveau se retrouve en terrain inconnu. Il essaie de comprendre ce qui vient de se passer, de donner un sens à l’absence, de s’adapter. Mais il se heurte à une réalité brutale : cette personne n’est plus là. Et pourtant, notre cerveau continue à la chercher. On croit l’apercevoir au coin d’une rue. On entend son rire dans une conversation. On se surprend à vouloir lui envoyer un message.
Cela s’appelle la présence fantôme. C’est bouleversant. Et c’est normal. Le cerveau cherche à recoller les morceaux de réalité.
Il est aussi possible de traverser des états de sidération, de confusion ou de flou mental. Des oublis surgissent, les mots se perdent, la sensation d’être « ailleurs » s’installe.
Le cerveau se met alors en mode protection. Il ralentit pour survivre au choc.
Et dans cette brume mentale, il est possible de se sentir incapable de se concentrer, de lire ou de faire une simple tâche administrative. On peut se retrouver à fixer un mur pendant de longues minutes ou à relire la même phrase dix fois sans en comprendre le sens. Ce n’est ni de la paresse ni de l’incompétence : c’est une surcharge émotionnelle que le cerveau tente de contenir. Le mental cherche à garder le cap alors que tout tangue autour de lui.
Note sur un morceau de papier chaque pensée obsédante ou culpabilisante. Plie-le et dépose-le dans un bocal ou dans une boîte fermée. Tu pourras y revenir plus tard ou jamais. Ce geste symbolique te permet de poser ce poids quelque part.
Le deuil, ce n’est pas que de la tristesse. C’est tout un nuancier : la colère, la peur, la culpabilité, le soulagement parfois, le vide, l’angoisse, la nostalgie.
Ces émotions arrivent souvent de manière imprévisible. Elles peuvent coexister. Tu peux pleurer et rire en même temps. Tu peux ressentir un mélange d’amour et de rage. Et c’est normal. Tu n’es pas instable. Tu essaie de composer avec l’absence. Avec le manque et l’incompréhension.
Les émotions peuvent surgir comme des vagues. Parfois douces, parfois dévastatrices. Elles peuvent s’exprimer dans des contextes inattendus : un supermarché, un embouteillage, un repas de famille. Un mot, une odeur, un son peuvent suffire
à faire tout remonter. Et il n’est pas toujours possible de les contenir. Ce n’est pas grave. Laisser sortir ces vagues. Les reconnaître, c’est aussi leur permettre de repartir. Les émotions ont besoin d’être traversées pour être intégrées.
Prends un moment pour te demander : « Aujourd’hui, sur 10, à combien est ma tristesse ? ma colère ? ma peur ? ma joie ? »
Juste pour sentir, sans chercher à changer. Tu peux noter ces chiffres chaque jour pour voir comment ils évoluent.
Voici la liste non exhaustive des émotions que tu peux y noter : Tristesse – Solitude – Colère – Confusion – Peur – Désespoir –Nostalgie – Choc – Manque – Anxiété – Amour – Culpabilité – Soulagement – Espoir – Acceptation – Joie
Le deuil touche le corps. Fortement. Il peut se manifester par des tensions, des douleurs, de la fatigue chronique, des palpitations, des troubles digestifs. Tu peux te sentir épuisé·e sans avoir rien fait. Avoir l’impression de porter un poids. D’être engourdi·e.
Ton corps tente de compenser l’énormité de la perte par des signaux d’alarme. Il exprime ce que les mots ne parviennent pas encore à dire. C’est une forme de langage du chagrin. Ton corps garde la mémoire du lien, de la douleur, de l’attachement. Et il a besoin, lui aussi, d’être écouté, soutenu, accompagné.
| Le scan corporel express | Assieds-toi. Ferme les yeux si tu veux. Balaye mentalement ton corps, de la tête aux pieds. Ressens : est-ce tendu, chaud, douloureux ? Si tu peux, relâche un peu chaque zone. Même quelques secondes, c’est utile. Ce moment de reconnexion te permet de sortir de ta tête et de retrouver un peu d’ancrage. Cet outil peut être également très utile lorsqu’une vague d’émotion te submerge à un moment qui n’est pas idéal. Il te permet de la faire redescendre.
Le deuil est parfois perçu comme une faiblesse. Comme une défaillance. Les larmes peuvent surgir. Le fonctionnement habituel se dérègle. Les repères vacillent. Les mots et les gestes se dérobent.
Mais vivre un deuil, ce n’est pas être cassé·e. C’est être humain·e. Tu n’as rien à prouver. Tu n’as pas besoin d’aller vite. Tu n’as pas besoin de « gérer ». Tu as besoin d’espace, de temps, d’écoute et d’indulgence envers toi-même.
Le deuil n’est pas un symptôme. Il n’est pas une pathologie. Il est la trace d’un lien profond, la réaction à une perte inestimable. Ce n’est pas une maladie à soigner, mais une expérience à traverser. Il peut affaiblir, oui, mais il peut aussi ouvrir, transformer, approfondir notre regard sur la vie. Il peut nous rendre plus sensibles à l’essentiel, plus réceptif·ve·s aux liens, plus attentif·ve·s à l’instant. Et cela, c’est une force.
Choisis une phrase qui te rassure et te fait du bien. Par exemple : « Je fais du mieux que je peux. »
« Je suis vivant·e, même dans la peine. »
« J’ai le droit d’avoir mal. »
Écris-la sur ton miroir, ton carnet, ton téléphone. Affiche-la.
Répète-la dès que tu en as besoin.
Ce chapitre n’a pas pour but de tout expliquer, mais de te dire : ce que tu vis est normal. Ton chagrin est légitime. Tu n’es pas seul·e. Les ressources que je te propose te permettent d’avancer un peu plus sûrement. Tu peux les utiliser ou non. Les essayer, les adapter, les ignorer. Fais comme tu peux. Fais comme tu veux. Tu es déjà en train d’avancer.






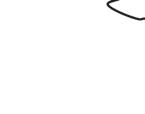

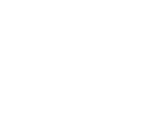
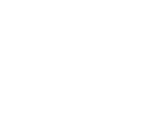

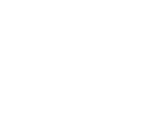


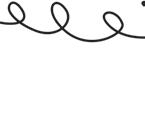

Traverser un deuil, c’est souvent se retrouver plus seul·e qu’on ne l’avait imaginé. Pas seulement parce que l’autre n’est plus là, mais aussi parce que la société, les proches, parfois même les professionnel·le·s, ne savent pas toujours comment réagir. Il existe autour du deuil une multitude d’idées reçues, de phrases automatiques, de croyances erronées qui peuvent faire plus de mal que de bien.
Et si on défaisait les mythes autour du deuil ? Pas pour les accuser, mais pour les nommer, les comprendre et redonner au deuil toute sa complexité humaine. Parce que parfois, ce qui fait le plus souffrir, ce n’est pas seulement la perte, mais le regard des autres, les injonctions, le décalage entre ce qu’on vit et ce qu’on pense devoir ressentir. Déconstruire ces idées toutes faites, c’est se donner l’autorisation de vivre son deuil autrement. De se faire confiance. D’oser être dans sa vérité.
Le deuil est souvent présenté en cinq étapes : le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l’acceptation. C’est le modèle de la psychiatre Elisabeth Kübler-Ross, présenté dans son livre Les Derniers Instants de la vie, publié en 19691. À l’origine, ce livre décrivait les réactions des personnes en fin de vie face à l’annonce de leur propre mort, avant d’être progressivement appliqué au processus de deuil en général. Il a été largement diffusé et a aidé à ouvrir la parole sur la mort. Il a donné une structure à l’indicible. Et pour certaines personnes, cela peut faire sens et permet d’avoir le sentiment d’avancer.
Dans la réalité du deuil, il n’y a pas de ligne droite. Pas de parcours balisé. Pas de médailles pour l’étape suivante. Ce n’est pas un jeu vidéo avec un niveau final appelé « acceptation ». Le chagrin ne se programme pas ; il vit sa propre logique, souvent déconcertante. Tu peux ressentir plusieurs émotions en même temps, ou aucune. Tu peux
1. Elisabeth Kübler-Ross, On Death and Dying, Macmillan Hungry Minds, 1969. Traduction française : Les Derniers Instants de la vie, Labor et Fides, 1975.
avoir l’impression d’avoir trouvé une certaine paix, puis retomber dans la peine sans comprendre pourquoi.
Les « étapes » peuvent rassurer, mais elles ne doivent pas devenir une norme à atteindre, parce que ne pas ressentir ce qui est attendu peut faire croire à une anomalie, à un blocage ou à une forme de défaillance, alors qu’en vérité, tu vis simplement ton propre deuil, à ta manière.
MYTHE N° 2 :
Cette phrase revient souvent : « Avec le temps, ça ira mieux. » Et c’est vrai que le temps joue un rôle. Il étire. Il adoucit parfois. Il permet de respirer différemment. Mais le temps, seul, ne suffit pas. Le temps peut aussi figer, si on ne trouve pas de lieu pour exprimer, pour pleurer, pour partager.
Certaines personnes vivent avec une blessure ouverte pendant des années, non parce que le deuil est trop long, mais parce qu’il n’a jamais eu d’espace pour être entendu. Le deuil non reconnu, non exprimé, peut devenir silencieux, mais aussi pesant.
Dire que le temps guérit, c’est parfois une manière de dire à l’autre : « Attends, tais-toi, ça va finir par passer. » Mais on n’a pas besoin de silence. On a besoin de présence. De vécu partagé. De reconnaissance.
Comme si le deuil était un livre qu’on pouvait refermer. Comme si notre proche décédé·e devait être relégué·e dans le passé pour que nous puissions enfin « avancer ». Mais
nous ne sommes pas des livres. Nous sommes fait·e·s de liens, de mémoires et de filiations invisibles.
Tourner la page, ce serait nier que cette personne a existé, qu’elle compte encore, qu’elle vibre dans nos gestes, dans nos choix, dans nos silences. Il ne s’agit pas de rester figé·e·s dans le souvenir, mais de le faire évoluer avec nous.
D’inventer une nouvelle manière d’être en lien. Pour beaucoup, le véritable apaisement vient quand on peut dire : « Je continue à vivre, et il·elle fait toujours partie de moi. » Le lien ne s’efface pas. Il se transforme.
Écris une lettre à ton ou ta proche décédé·e. Pas une lettre d’adieu ; une lettre de lien. Dis-lui où tu en es. Ce que tu ressens. Ce que tu fais aujourd’hui. Pose-lui une question. Garde-la, relis-la ou détruis-la, peu importe. Ce qui compte, c’est l’acte de renouer.
L’injonction au courage est partout. « Sois fort·e », « Tiens le coup », « Fais-le pour les autres ». Comme si le courage était de se taire, de continuer comme si de rien n’était. Comme si pleurer était une faiblesse. Comme si exprimer sa peine était un échec.
Mais le courage peut prendre de nombreuses formes. C’est oser dire : « Je ne vais pas bien. » C’est réussir à demander : « Tu peux rester près de moi ? » C’est accepter d’être vu·e dans sa vulnérabilité. Oser lâcher prise, même si c’est juste pour un instant.
