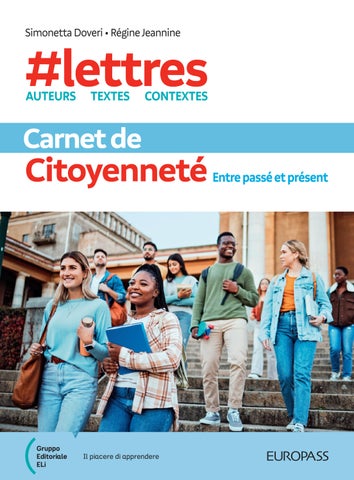Simonetta Doveri • Régine Jeannine
#lettres
AUTEURS TEXTES CONTEXTES
Carnet de Citoyenneté
Entre passé et présent

Simonetta Doveri • Régine Jeannine
#lettres
Carnet de Citoyenneté
Entre passé et présent
Gruppo
Editoriale ELi Il piacere di apprendere
1 Égalité entre les sexes 4
Hier Une femme écrivaine
Christine de Pizan, Livre de la Cité des dames, Enfin, vous toutes, mesdames… 4
Critique du pouvoir masculin
Aujourd’hui La vexation de la femme, pas de droit à la parole, pas de liberté
Rachid Boudjedra, La répudiation, La femme répudiée 6
Aujourd’hui Écriture féminine pour une revendication identitaire
Annie Leclerc, Parole de femme, Les hommes ont la parole 8
2 Droits et protection des enfants 9
Hier Un éducateur novateur Rousseau, Émile ou de l’éducation, Leçon des choses 10
Hier Le comique, perspective réaliste sur le monde
Charles Sorel, L’Histoire comique de Francion, Les malheurs des écolier 12
Aujourd’hui De l’enfance heureuse à la fuite Joseph Joffo, Un sac de billes, Une rencontre 13
Aujourd’hui L’élève, partie d’une Collectivité Interview avec Daniel Pennac 15
3 La laïcité 16
• « Un roi, une fois, une loi » 16
• La laïcité aujourd’hui demeure le point d’aboutissement d’un long processus 16
• La question religieuse se déplace sur le terrain de l’école 17
• 27 novembre 1883 : la lettre aux instituteurs de Jules Ferry 17
• Charte de la laïcité à l’école 18
4 Droits pour tous pour un développement durable 20
• L’évolution des droits 20
• Les textes ‘sacrées’ 21
• Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 22
• Les articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 23
Lire les images La Révolution française expliquée en images 24
• La DUDH, source généreuse du droit international 26
• Eleanor Roosevelt : défenseure des droits de l’homme 27
Hier Un écologiste avant l’heure
Jules Verne, Voyages et aventures du Capitaine Hatteras 29
Hier Une activiste pré-écologiste
George Sand, La forêt de Fontainebleau, Chercher l’oracle de la forêt sacrée 30
Hier Un manifeste de la cause écologiste
Jean Giono, L’Homme qui plantait des arbres, Dix-milles chênes 31
Aujourd’hui Décrire la crise écologique sans en parler
Antoine Desjardins, Indice des feux, À boire debout 32
• Pauvreté et exclusion sociale : les victimes de la crise et de l’indifférence
L’éloge de la pauvreté Victor Hugo, Les Contemplations, Le
L’anonymat
Jean-Marie Gustave Le Clézio, Désert, La gare, lieu d’exil 37
• La loi française contre le racisme
• Le massacre des Italiens
Gérard Noiriel, Aigues-Mortes, 17 aout 1893, les plus sanglant pogrom de l’histoire contemporaine de la France, Une société impossible 41
• La xénophobie
Tahar Ben Jelloun, Le racisme expliqué à ma fille, La peur de l’étranger 42
• La migration clandestine
Mahi Binebine, Cannibales, Espoirs et désespoirs 43
• La numérique, facteur d’accroissement de la participation 46
• Les citoyens impliqués dans l’élaboration des décisions publiques 46
• Une citoyenneté plus active 47
• Les nouvelles formes de participation citoyenne 47
• La citoyenneté est aussi un parcours dans la vie de la cité 48
• La citoyenneté à l’école


Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.
Égalité entre les sexes Un droit fondamental
L’égalité des sexes n’est pas seulement un droit fondamental à la personne, mais aussi un fondement nécessaire pour l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable
Les femmes et les filles représentent la moitié de la population mondiale. Cependant, de nos jours, les inégalités entre les sexes persistent partout et entravent le progrès social : les lois et les normes sociales discriminatoires restent omniprésentes ; les femmes restent sous-représentées à tous les niveaux du pouvoir politique ; en moyenne, dans le monde, les femmes sur le marché du travail gagnent toujours 24 % de moins que les hommes ; et 20 % des femmes et des filles âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part d’un partenaire intime.
Hier
Une femme écrivaine
Au début du XVe siècle une figure particulièrement remarquable émerge dans la littérature médiévale, Christine de Pizan Historienne, poétesse et moraliste d’origine italienne, elle est la première femme ayant vécu de sa plume. Dans ses œuvres lyriques, elle défend la cause des femmes trop honorées dans l’amour courtois et trop bafouées dans les fabliaux.
Dans le Livre de la Cité des dames (1405), elle décrit une société allégorique où la dame est une femme dont la noblesse est celle de l’esprit plutôt que de la naissance. L’ouvrage cite une série de figures féminines du passé qui sont pour Christine de Pizan des exemples de la façon dont les femmes peuvent mener une existence pleine de noblesse tout en apportant leur contribution à la société. Ce livre contient également des dialogues didactiques entre trois figures allégoriques, les déesses de la Raison, de la Droiture et de la Justice. Cette dernière demande à Christine de construire une cité métaphorique où pourront résider les Dames.
Christine de Pizan demande si les femmes doivent recevoir la même éducation que les hommes et pourquoi cette idée déplaît aux hommes. Elle évoque également des questions comme l’illégalité du viol, l’affinité des femmes pour l’étude et leur capacité à gouverner.
1 Les plus grands défauts.
2 Charmeurs.
3 Astuces.
4 Veuillez.
COMPRENDRE
Son livre est considéré par certains auteurs contemporains comme un des premiers ouvrages féministes de la littérature, en ce sens qu’il ne reprend pas les tropes usés du débat rhétorique utilisés par les auteurs masculins pour attaquer ou défendre les femmes, mais qu’il se place délibérément dans une perspective nouvelle : la narratrice prend conscience de ce que sa vision d’elle-même est en fait déterminée par les clichés qui circulent sur les femmes et véhiculent à l’époque un sentiment de leur infériorité « naturelle ».

Enfin, vous toutes, mesdames…
Livre de la Cité des dames
Ici finit le Livre de la Cité des dames. Christine s’adresse aux femmes.
Enfin, vous toutes, mesdames, femmes de grande, de moyenne ou d’humble condition, avant toute chose restez sur vos gardes et soyez vigilantes pour vous défendre contre les ennemis de votre honneur et de votre vertu. Voyez, chères amies, comme de toutes parts ces hommes vous accusent des pires défauts1! Démasquez leur imposture par l’éclat de votre vertu ; en faisant le bien, convainquez de mensonge tous ceux qui vous calomnient. Ainsi pourriez-vous dire avec le Psalmiste : « L’iniquité du méchant retombera sur sa tête ». Repoussez ces hypocrites enjôleurs2 qui cherchent à vous prendre par leurs beaux discours et par toutes les ruses3 imaginables votre bien le plus précieux, c’est-à-dire votre honneur et l’excellence de votre réputation ! Oh ! fuyez, mesdames, fuyez cette folle passion qu’ils exaltent auprès de vous ! Fuyez-la ! Pour l’amour de Dieu, fuyez ! Rien de bon ne peut vous en arriver ; soyez certaines, au contraire, que même si le jeu en paraît plaisant, cela se terminera toujours à votre préjudice. Ne vous laissez jamais persuader du contraire, car c’est la stricte vérité. Souvenez-vous, chères amies, comment ces hommes vous accusent de fragilité, de légèreté et d’inconstance, ce qui ne les empêche point de déployer les ruses les plus sophistiquées et de s’évertuer par mille manières à vous séduire et à vous prendre, comme autant de bêtes dans leurs filets ! Fuyez, mesdames, fuyez ! Évitez ces liaisons, car sous la gaieté se cachent les poisons les plus amers, ce qui entraînent la mort. Daignez4, mes très vénérées dames, accroître et multiplier les habitantes de notre Cité en recherchant la vertu et en fuyant le vice, et réjouissez-vous dans le bien.
1 Quel est le thème de l’extrait ?
2 À quoi les femmes sont-elles invitées ?
3 Quels sont les stéréotypes masculins ?
COMPÉTENCE CRITIQUE
4 Christine de Pizan n’aurait jamais imaginé que, au XXIe siècle, on est encore en pleine querelle des femmes.
Imaginez d’écrire une lettre à Christine sur l’actualité de la querelle et sur son rôle dans l’histoire du féminisme.
MÉDIATION
5 Christine de Pizan apparaît comme une visionnaire, une femme en avance sur son temps. Y a-t-il des femmes comme elle dans notre littérature du Moyen Âge ?
Aujourd’hui

Critique du pouvoir masculin
Depuis très longtemps, des romanciers mais aussi des poètes et des dramaturges, en intervenant ou en dénonçant les abus de la société dans leurs écrits, les utilisent pour des buts sociaux. Simone de Beauvoir, par exemple, accuse les femmes de passivité et les hommes de sexisme. Des millions de femmes dans le monde ne sont que des objets sexuels et appartiennent aux hommes qui les possèdent comme un bien. Les États concernés ont fini par mettre en place des mesures législatives pour faire face à ce problème, sans toutefois réussir à s’attaquer vraiment aux causes profondes des féminicides, dernier acte d’une longue série d’humiliations et de violences physiques. En tête de la domination masculine, se trouvent l’Afghanistan des talibans et l’Arabie Saoudite. Et là où l’Islam est « doux », comme en Afrique musulmane, la polygamie et la répudiation demeurent et augmentent chaque année. Ne bénéficiant pas d’un niveau scolaire élevé, l’homme n’a pas les capacités théoriques et intellectuelles lui permettant de concevoir le principe de l’égalité des sexes comme un principe rationnel et raisonnable, comme un futur inévitable : il considère ainsi la domination masculine comme une donnée bio-naturelle et religieuse sacrée.
La vexation de la femme, pas de droit à la parole, pas de liberté
Issu d’une famille bourgeoise, Rachid Boudjedra, écrivain et poète algérien, est né en 1941. Il serait l’aîné de trente-six enfants. Sa mère était la première épouse de son père qui, polygame marié quatre fois, était tyrannique et féodal.
La répudiation a été pendant longtemps interdite en Algérie et ce roman n’a pas laissé indifférente la critique, tant littéraire que politique. D’abord, parce qu’il a été publié sept ans seulement après la fin de la guerre d’Algérie, événement qui avait traumatisé les Français ; ensuite, il s’agit d’un auteur algérien qui dénonce la situation de la femme algérienne quelques années après l’indépendance acquise et reconnue à la suite de dures épreuves. Le roman est constitué de séquences de réminiscence sans lien chronologique : fêtes religieuses, présence autoritaire des mâles, légitimation d’une société machiste. Les malheurs de la femme, particulièrement ceux de la mère répudiée du narrateur, ont profondément marqué son enfance. Cette injustice, que les femmes subissent au nom de la religion et au nom de la tradition et que personne n’ose remettre en question, doit être dénoncée afin que les hommes et les femmes d’Algérie qui ont eu la chance de lire ce roman prennent conscience du drame qui se déroule parfois sous leurs yeux. La répudiation (1969) est le premier roman écrit par un homme et consacré entièrement à la femme et à ses relations avec le monde masculin qui l’entoure.
T2
La femme répudiée
La répudiation
Dans cet extrait de La répudiation, l’écrivain raconte la cérémonie de la répudiation et condamne le pouvoir arbitraire de l’homme.
Cérémonie. Rite. Ma mère avait participé à la cérémonie rituelle. Elle n’avait plus peur. Les mots lui arrivaient au ras du cortex, puis s’échappaient comme ils étaient venus : des bulles. Aucune révolte ! Aucune réflexion ! Le barricadement était nécessaire, inévitable, et durerait le restant de sa vie. Claustration que l’on donnera
1 Enceintes.
2 Lent.
3 Discours confus de blessures.
4 Triste.
5 Étonnés.
6 Bruissants.
7 Pierre précieuse.

Égalité entre les sexes
en exemples aux veuves engrossées1 et aux répudiées indisciplinées. Ma savait qu’il y allait de l’honneur de la famille. Trente ans. Elle allait en finir avec sa vie de femme visitée conjugalement et dignement par le mâle effréné qui contentait aussi deux ou trois maîtresses, dont l’une, française, était venue au pays dans le seul but de vérifier l’ardeur génitale des hommes chauds. Solitude, ma mère ! Fermeture ! Pire qu’une huître : un vagin inculte. à trente ans, la vie allait s’arrêter comme un tramway poussif 2 qui veut jouer à l’âne. Ultime recours : Dieu devait faire revenir Si Zoubir sur sa décision, sinon les sorciers entreraient en transe et les charlatans envahiraient la maison. Après la consternation, la première décision. Pour répudier Ma, Si Zoubir se fondait sur son bon droit et sur la religion : sa femme, elle, comptait sur l’abstraction des formules magiques.
Enfant, elle l’était, et elle ne pouvait dominer les choses que par l’intermédiaire d’une autre transcendance : l’amulette. Solitude, ma mère ! À l’ombre du cœur refroidi par l’annonciation radicale, elle continuait à s’occuper de nous. Galimatias de meurtrissures3 ridées. Sexe refrogné4. Cependant, douceur ! Les sillons que creusaient les larmes devenaient plus profonds. Abasourdis5, nous assistions à une atteinte définitive. […]
Ma était donc répudiée. Longues déambulations agressives à travers la maison. Lourde métamorphose. Elle rêvait peut-être de papillons chuintants6 et de phosphorescence pénétrante. La rupture avec le père était totale : il ne venait plus à la maison. Mutations intégrales. Transformations inadéquates. Le sang lui battait dans le bout des doigts. L’ovulation, chaque mois, se dégonflait lamentablement, comme une bulle crapaudine7 sur ces nénuphars en papier que nous rapportions des kermesses des écoles françaises. Si Zoubir, lui, pensait déjà à prendre une deuxième femme ! Halètements vertigineux des sourdes résonances. Toutes les nuits à franchir, et la solitude ! Mes tantes épiaient ma mère ; et profondément visitées, elles soupiraient d’aise, en se retournant dans leurs lits, pour mieux suggérer les jouissances abondantes. Les vaches ! Je voyais Ma se mordre les lèvres et se tordre le corps. Elle se taisait. Dans le noir, je faisais semblant de dormir. Depuis le départ du père, j’avais pris sa place dans l’énorme alcôve. J’avais dix ans et comprenais beaucoup de choses.
COMPRENDRE
1 Relevez tous les mots qui soulignent la solitude et l’isolement de la femme répudiée.
2 Retrouvez la phrase qui atteste la toute puissance du père et la légitimité de son despotisme.
3 Les autres femmes de la famille manifestent-elles de la solidarité féminine ? En quoi cette société est-elle hypocrite ?
4 À la fin du passage, que semble avoir compris le narrateur ?
COMPÉTENCE CRITIQUE
5 L’auteur décrit une société impitoyable pour tous ceux qui sont marginalisés, une société dans laquelle la condition de la femme est soumise à l’arbitraire de l’homme. Est-ce condamnable ? Justifiez votre réponse.
MÉDIATION
6 Cette situation de la femme algérienne est-elle unique au Maghreb et dans l’espace sud-méditerranéen ? Dans la société européenne, quelles injustices subissent les femmes ?

Écriture féminine pour une revendication identitaire
Annie Leclerc (1940-2006) a grandi dans le Limousin au sein d’une famille aux traditions humanistes. Elle s’est illustrée par son militantisme féministe et son engagement pour la cause des prisonniers.
Parole de femme (1974) est un texte philosophique et poétique, presque un chant, porté par un souhait : libérer la parole des femmes, l’inventer, la faire naître pour sortir de l’impérialisme culturel masculin. Les femmes ont leur mot à dire, leurs forces propres à apporter dans un monde d’hommes régi par le profit et l’esprit de conquête.
Les hommes ont la parole
Parole de femme
Cet extrait est traversé par la problématique fondamentale de l’appropriation par les femmes du savoir et la mise en évidence de l’écriture féminine, valorisant à la fois la conscience de soi en tant que femme et une nouvelle approche des rapports de pouvoir. Prendre la parole, c’est ainsi trouver sa place dans ce qui détermine l’énonciation en affirmant son moi, et c’est assumer ce que la parole impose.
Rien n’existe qui ne soit le fait de l’homme, ni pensée, ni parole, ni mot. Rien n’existe encore qui ne soit le fait de l’homme ; pas même moi, surtout pas moi. Tout est à inventer. Les choses de l’homme ne sont pas seulement bêtes, mensongères et oppressives. Elles sont tristes surtout, tristes à en mourir d’ennui et de désespoir. Inventer une parole de femme. Mais pas de femme comme il est dit dans la parole de l’homme ; car celle-là peut bien se fâcher, elle répète. Toute femme qui veut tenir un discours qui lui soit propre ne peut se dérober1 à cette urgence extraordinaire : inventer la femme. C’est une folie, j’en conviens. Mais c’est la seule raison qui me reste.
Qui parle ici ? Qui a jamais parlé ? Assourdissant tumulte des grandes voix ; pas une n’est de femme. Je n’ai pas oublié le nom des grands parleurs. Platon et Aristote et Montaigne, et Marx et Freud et Nietzsche… Je les connais pour avoir vécu parmi eux et seulement parmi eux. Ces plus fortes voix sont aussi celles qui m’ont le plus réduite au silence. Ce sont ces superbes parleurs qui mieux que tout autre m’ont forcée à me taire.
1 Se soustraire.
COMPRENDRE
Qui parle dans les gros livres sages des bibliothèques ? Qui parle au Capitole ? Qui parle au temple ? Qui parle à la tribune et qui parle dans les lois ? Les hommes ont la parole. Le monde est la parole de l’homme. Les paroles des hommes ont l’air de se faire la guerre. C’est pour faire oublier qu’elles disent toutes la même chose : notre parole d’homme décide. Le monde est la parole de l’homme. L’homme est la parole du monde.
1 Quel est le thème de l’extrait ? Que revendique Annie Leclerc pour les femmes ?
2 Que reproche-t-elle aux hommes ? Quelles ont été sur elle les conséquences de ces reproches ?
COMPÉTENCE CRITIQUE
3 Expliquez la phrase Inventer une parole de femme (l. 5).
4 Justifiez-vous le féminisme d’Annie Leclerc ? Avez-vous trouvé exagérée sa critique aux hommes ? Discutez-en en classe et exprimez votre opinion.


Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promuovoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie
Droits et protection des enfants
Les enfants ne sont pas des êtres humains en développement, mais des êtres humains à part entière. Ils bénéficient donc de l’ensemble des droits humains définis dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948. Pourtant, parce qu’ils sont plus vulnérables, les mineurs ont besoin de plus de protection et de la garantie de droits spécifiques pour assurer leur accès à l’éducation, à une justice qui leur soit adaptée, à une protection contre les violences. Depuis 1989, les droits des enfants sont consacrés par un texte de droit international majeur, la Convention internationale des droits de l’enfant – la CIDE.
Mais depuis près de quarante ans après son adoption, le bilan reste sombre. Si les situations varient d’un pays et d’un continent à l’autre, nulle part les droits des enfants ne sont correctement respectés. Partout les filles subissent des discriminations ; certaines n’iront pas à l’école ou seront mariées de force et précocement. En cas de conflits, les enfants qui devraient particulièrement être protégés sont souvent en première ligne, quand ils ne sont tout simplement pas enrôlés de force. Partout les tribunaux traitent des mineurs comme des adultes et les placent en détention avec des adultes. Trop souvent se faire soigner ou aller à l’école est de l’ordre de l’inaccessible. Partout, le droit de vivre avec sa famille et sous un toit sont foulés au pied... La liste des violences subies tous les jours par des mineurs tout simplement privés d’une vie d’enfant est longue et leur avenir est alors sérieusement compromis.


COMPRENDRE
1 Pourquoi définir les droits de l’enfant ?
COMPÉTENCE CRITIQUE
2 La maltraitance infantile a des effets dévastateurs à court et à long terme sur le développement de l’enfant. Réfléchissez sur les conséquences et sur les causes et mettez par écrit vos pensées.
Hier Un éducateur novateur

Rousseau (1712-1778) s’est très vite aperçu de la nécessité de refonder l’éducation des enfants. D’en faire une des bases de l’égalité sociale. Pour lui, l’horreur de voir souffrir les autres est un sentiment spontané chez l’homme. Il suffit de l’encourager chez l’enfant pour qu’il se développe. Il propose un système d’éducation basé sur les intérêts spontanés de l’enfant, et non pas le contraindre à réciter des réponses à des questions qu’il ne se pose pas. Le philosophe-pédagogue réfute le par cœur, l’ingurgitation du savoir. L’enfant doit apprendre à apprendre ; c’est la base des méthodes modernes d’enseignement (Montessori, Freynet, etc).
Émile ou de l’éducation (1762) est un traité pédagogique. Émile a un précepteur (professeur privé) et vit dans la nature, sans contact avec la famille ou la société. Les principes de l’éducation d’Émile sont :
• Pas d’enseignement théorique, où l’enfant reste passif. Le professeur ne doit même pas répondre aux questions. Il faut que l’enfant cherche par lui-même les réponses. L’enfant doit inventer la science.
• Rousseau préconise l’observation de la réalité. Il faut montrer les choses elles-mêmes et non pas des représentations. La théorie, c’est pour plus tard.
• L’enseignement doit être à la portée de l’enfant (idée relativement nouvelle à l’époque).
• Le rôle du professeur est de susciter la curiosité et d’éveiller l’intérêt de l’enfant.
• Rousseau situe l’éducation dans la nature, loin de la société.
T4
Leçon de choses
Émile ou de l’éducation
La théorie essentielle de Rousseau pédagogue est contenue dans ce passage du troisième livre de l’Émile. C’est la méthode directe, le contact avec les choses ; le précepteur n’enseigne pas, il prépare, il avertit, il insinue. Mais il sera bon de lire avec indépendance tout ce morceau. Les idées justes y voisinent avec le paradoxe.
Rendez votre élève attentif aux phénomènes de la nature, bientôt vous le rendrez curieux : mais, pour nourrir sa curiosité, ne vous pressez1 jamais de la satisfaire. Mettez les questions a sa portée, et laissez-les-lui résoudre. Qu’il ne sache rien parce que vous le lui avez dit, mais parce qu’il l’a compris lui-même ; qu’il n’apprenne pas la science, qu’il l’invente. Si jamais vous substituez dans son esprit l’autorité à la raison, il ne raisonnera plus ; il ne sera plus que le jouet2 de l’opinion des autres. Vous voulez apprendre la géographie à cet enfant, et vous lui allez chercher des globes, des sphères, des cartes : que de machines ! Pourquoi toutes ces représentations ? Que ne commencez-vous par lui montrer l’objet même, afin qu’il sache de quoi vous lui parlez !
Une belle soirée on va se promener dans un lieu favorable, où l’horizon bien découvert laisse voir à plein le soleil couchant, et l’on observe les objets qui rendent reconnaissable le lieu de son coucher. Le lendemain, pour respirer le frais, on retourne au même lieu avant que le soleil se lève. On le voit s’annoncer de loin par les traits de feu qu’il lance au-devant de lui. L’incendie augmente, l’orient paraît tout en flammes : à leurs éclats on attend l’astre longtemps avant qu’il se montre : à chaque instant on croit le voir paraître ; on le voit enfin. Un point brillant part comme un éclair et remplit aussitôt tout l’espace; le voile des ténèbres s’efface et tombe.
Droits et protection des enfants
L’homme reconnaît son séjour et le trouve embelli .La verdure a pris durant la nuit une vigueur nouvelle; le jour naissant qui l’éclaire, les premiers rayons qui la dorent, la montrent couverte d’un brillant réseau de rosée qui réfléchit à l’œil la lumière et les couleurs. Les oiseaux en chœur se réunissent et saluent de concert le Père de la vie; en ce moment pas un seul ne se tait; leur gazouillement, faible encore, est plus lent et plus doux que dans le reste de la journée, il se sent de la langueur d’un paisible réveil. Le concours de tous ses objets porte aux sens une impression de fraîcheur qui semble pénétrer jusqu’à l’âme. Il y a là une demi-heure d’enchantement auquel nul homme ne résiste : un spectacle si grand, si beau, si délicieux, n’en laisse aucun de sang froid. [...]
Ne tenez point à l’enfant des discours qu’il ne peut entendre. Point de descriptions, point d’éloquence, point de figures, point de poésie. Il n’est pas maintenant questions de sentiment ni de goût. Continuez d’être clair, simple et froid; le temps ne viendra pas trop tôt de prendre un autre langage.(..)Dans cette occasion, après avoir contemplé avec lui le soleil levant, après lui avoir fait remarquer du même côté les montagnes et les autres objets voisins, après l’avoir laissé causer là-dessus à son aise, gardez quelques moment le silence comme un homme qui rêve, et puis vous lui direz: Je songe que hier au soir le soleil s’est couché là, et qu’il s’est levé là se matin, comment cela peut-il se faire? N’ajoutez rien de plus ; S’il vous fait des questions, n’y répondez point ; parlez d’autre chose. Laissez-le à lui-même. Et soyez sûr qu’il y pensera.
COMPRENDRE
1 Quel est le principe pédagogique à la base de chaque paragraphe ?
2 Le maître doit-il transmettre ce qu’il sait ? Pour apprendre, l’élève doit-il imiter le maître ? Justifiez pourquoi le professeur ne doit pas répondre aux questions que pose l’enfant.
3 Qui est le meilleur précepteur ?
4 Pourquoi Rousseau défend-il une pédagogie négative ?
COMPÉTENCE CRITIQUE
5 Pour Rousseau l’éducation de l’enfant par le progrès qui le corrompt, est mauvaise, c’est pourquoi il doit être éduqué dans la nature et par l’expérience, jamais de livres. La réalisation de ce type d’enseignement vous parait-elle possible ? Exprimez votre opinion et justifiez-la.
6 Commentez la phrase de Rousseau dans ses Confessions après son apprentissage chez un maître mauvais et méchant : « Depuis lors, je fus un enfant perdu ».
MÉDIATION
7 Quel est pour vous l’objectif de l’enseignement de votre maître idéal ?

Hier Le comique, perspective réaliste sur le monde

T5
Charles Sorel (né à Paris à une date inconnue, mort dans la même ville le 7 mars 1674), est un romancier et écrivain français du XVIIe siècle. L’ensemble de son œuvre romanesque comique et satirique a été publiée anonymement ou sous des pseudonymes. 1623 est l’année de publication de son œuvre romanesque la plus connue et la plus reconnue : L’Histoire comique de Francion, publiée d’abord en sept livres, revue et allongée en onze livres en 1626, puis en douze livres en 1633. Cette œuvre constitue l’une des premières histoires comiques à la française et restera l’un des chefs-d’œuvre du genre.
L’éducation occupe une place de choix dans la satire. Le collège est un passage obligé des romans satiriques. Il apparaît comme un monde clos où Francion subit un enseignement mécanique et sans intérêt centré sur la grammaire latine. Les élèves sont battus et souffrent de la faim au point que Francion ira jusqu’à voler pour se nourrir. Enfin, le professeur, pédant, est tourné en ridicule.
Les malheurs des écolier
L’Histoire comique de Francion
Le jeune écolier se rend compte que l’école qu’il fréquente le prive de toutes les libertés et qu’elle est faite aussi de punitions corporelles.
COMPRENDRE
1 Comment Sorel présente-t-il la vie scolaire ?
2 Que regrette-t-il d’avoir perdu ?
3 L’auteur fait des allusions à l’histoire antique : pourquoi ? Quel message veut-il transmettre ?
COMPÉTENCE CRITIQUE
4 Commentez la partie finale et à la manière de Sorel, dressez une liste des malheurs qui vous arrivent à l’école.
5 Le texte n’est pas écrit en français moderne. Quelles différences remarquez-vous avec le français d’aujourd’hui ? Donnez quelques exemples.
1 Gardes champêtres.
2 Réglées.
3 Professeur.
Ô quel changement je remarquay, et que je fus bien loing de mon compte ; je ne jouyssois pas de toutes les délices que je m’estois promises ; qu’il m’estoit estrange d’avoir perdu la douce liberté que j’avois chez nous, courant parmy les champs d’un costé et d’autre, allant abattre des noix, cueillir du raisin aux vignes sans craindre les Messiers1, et suivant quelque fois mon père à la chasse. J’estois alors plus enfermé qu’un Religieux dans son cloistre, et estois obligé de me treuver au service divin, au repas, et à la leçon à de certaines heures, car toutes choses estoient là compassées2 . Au lieu de mon livre qui ne me disoit pas un mot plus haut que l’autre, j’avois un Regent3 à l’aspect terrible, qui se promenoit tousjours avec un fouet à la main, dont il se scavoit aussi bien escrimer qu’un homme de sa sorte. Je ne pense pas que Denis le Tyran4, après le misérable revers de sa fortune, s’estant fait Maistre d’école afin de commander tousjouts, gardast une gravité de Monarque beaucoup plus grande. La loy qui m’estois la plus fascheuse à observer sous son Empire, estoit qu’il ne faloit jamais parler autrement que latin, et je ne me pouvois desaccoustumer de lascher tousjours quelques mots de ma langue maternelle : de sorte qu’on me donnoit tousjours ce que l’on appelle le signe5, qui me fasoit encourir une punition. Pour moy, je pensay qu’il falloit que je fisse comme les disciples de Pythagoras6, dont j’entendois assez discourir, et que je fusse sept ans à garder le silence comme eux, puisque sitost que j’ouvrois la bouche l’on m’accusoit avec des paroles aussi atroces que si j’eusse esté le plus grand scélérat du monde. (….) J’appris alors à mon grand regret, que toutes les paroles qui expriment les malheurs qui arrivent aux escoliers, se commencent par un P, avec une fatalité très remarquable : car il y a Pédant, peine, peur, punition, prison, pauvreté, petite portion, poux, puces, et punaises, avec encore bien d’autres, pour chercher lesquelles il faudroit avoir un Dictionnaire, et bien du loisir.
4 Tyran de Syracuse (430-367 av. J.-C.).
5 Pièce de cuivre, marque
d’infamie, que l’on donnait à l’élève surpris en train de parler français.
6 Philosophe du VIe siècle av. J.-C., il imposait le silence à ses élèves.
Aujourd’hui

T6
1 Calèche.
2 Nous sommes foutus.
3 Cheval vieux et maigre.
4 Boite parce qu’il a mal au talon.
5 Épaisses.
6 Collaborateur des Allemands.
Droits et protection des enfants
De l’enfance heureuse à la fuite
Joseph Joffo (1931-2018) est un écrivain, scénariste et acteur français. Sous l’Occupation allemande, sa famille d’origine juive est persécutée. Il doit fuir Paris en 1942 avec son frère plus âgé, Maurice, pour se réfugier en zone libre. Il rentre à Paris à la fin de la guerre et retrouve le reste de sa famille, sauf son père qui a été déporté.
Dans le roman Un sac de billes (1973), Joffo raconte ses souvenirs de jeune Juif durant l’Occupation allemande. La force de son récit réside en la candeur et le pragmatisme du regard d’enfant, qu’il porte, à l’époque, sur les faits quotidiens de cette étrange et terrible période. Septembre 1941, Jo a 10 ans. C’est un gamin parisien, un joyeux poulbot farceur et dégourdi du 18e arrondissement. Il est le dernier d’une fratrie de six enfants, et est très proche de Maurice, son aîné de deux ans à peine. Mais les Allemands occupent Paris. Les parents de Joseph décident donc que leurs deux cadets doivent fuir pour gagner la zone libre et rejoindre leurs frères aînés à Menton. Avec alors pour tout bagage, une consigne de survie martelée violemment à leurs oreilles : « Ne dis jamais que tu es juif ! », quelque 5 000 francs de l’époque, leur intrépidité, bon sens et innocence, Maurice et Joseph prennent la route de la liberté, celle de tous les dangers.
Une rencontre
Un sac de billes
Paris est occupé et l’étoile jaune est obligatoire. Les parents de Joseph organisent la fuite de leurs deux enfants cadets. Joseph et Maurice, dans leur tentative de rejoindre Menton, affrontent une série de péripéties et quelque fois ils rencontrent de bonnes âmes comme ce Monsieur avec une calèche.
Un bruit de roue derrière moi. Dans un sentier perpendiculaire à la route que nous suivons, une carriole avance, traînée par un cheval. Je regarde mieux : ce n’est pas une carriole, c’est beaucoup plus élégant ; on dirait un fiacre1 découvert comme dans les films de l’ancien temps.
Maurice dort toujours.
Si la voiture va vers la ville, il faut en profiter. Dix-huit kilomètres à faire encore, et dix-huit kilomètres, non seulement ça use les souliers mais aussi les jambes des petits garçons même s’ils sont grands.
Je ne perds pas le fiacre de vue. Il va tourner. Gauche ou droite ? Si c’est à gauche, c’est fichu2. Si c’est à droite, on a une chance.
C’est à droite. Je me lève et vais à sa rencontre. Le cocher a un fouet près de lui, mais il ne s’en sert pas. Avec la haridelle3 qui traîne sa charrette, il faut dire que ça ne servirait pas à grand-chose. Chaque pas semble être le dernier, et, à le voir, on a envie de regarder si la famille suit derrière le corps du défunt.
À quelques mètres de moi, l’homme tire sur les rênes. Je m’avance en boitillant4 .
– Pardon, monsieur, vous n’allez pas à Aire-sur-l’Adour, par hasard ?
– Si, en effet, je m’y rends. Je m’arrête à deux kilomètres avant, pour être plus exact. Ce monsieur a une distinction d’un autre âge, si je savais faire la révérence, je m’y essaierais.
– Et vous ... enfin, est-ce que vous pourriez nous emmener mon frère et moi dans votre fiacre ? L’homme fronce des sourcils broussailleux5. Là, j’ai dû dire quelque chose qu’il ne fallait pas. Ou alors ce type est de la police, ou c’est un collabo6 et je prévois des tas d’ennuis par ma faute.
7 Boitant.
8 Dort profondément.
9 Sans cérémonie.
10 Sacoche.
11 Stupéfait.
12 Nous montons.
– Mon jeune ami, ce véhicule n’est pas un fiacre, c’est une calèche
Je le regarde, bouche ouverte.
– Ah bon, excusez-moi.
Cette politesse semble le toucher.
– Ceci n’a pas d’importance, mais il est bon, mon garçon, d’apprendre, dès le plus jeune âge, à nommer les choses par leur nom. Je trouve ridicule de dire «un fiacre» lorsque l’on se trouve en présence d’une calèche authentique. Mais tout ceci n’a qu’une importance relative et vous pourrez, votre frère et vous, partager cette voiture.
– Merci, monsieur.
À cloche-pied7, je cours vers mon frère qui en écrase dur8, bouche ouverte. Je le réveille sans trop de ménagement9
– Qu’est-ce que c’est ?
– Dépêche-toi, ta calèche t’attend.
– Ma quoi ?
– Ta calèche. Tu ne sais pas ce que c’est ? Tu confonds avec un fiacre peut-être ?
Il frotte ses yeux, ramasse sa musette10 et, toujours ébahi11, contemple le véhicule qui attend.
– Mon Dieu, murmure-t-il, où as-tu trouvé ça ?
Je ne réponds pas. Maurice salue respectueusement notre conducteur qui nous regarde en souriant et nous grimpons12. Et c’est ainsi que Maurice et moi, nés à la porte de Clignancourt, Paris XVIIIe, arrivâmes sur la place de la gare d’Aire-surl’Adour dans une calèche du siècle dernier.
COMPRENDRE
1 Entre les deux frères, qui a plus d’initiative ?
2 Dans le texte, on parle d’un véhicule tiré par un cheval. Relevez tous les noms qui désignent ce véhicule.
3 La scène décrite dans ce texte se déroule-t-elle au temps où les fiacres, les calèches étaient nombreux dans les rues ? Relevez une phrase du texte justifiant votre réponse.
4 Relisez d’abord les dix premières lignes du texte puis et dites pourquoi le narrateur dit : « on a une chance » (l. 10).
5 Que signifie la phrase : « Ce monsieur a une distinction d’un autre âge » (l. 18) ?
COMPÉTENCE CRITIQUE
6 À votre avis que dénonce ce roman ? Sauriez-vous expliquer le titre ?
COMPÉTENCE NUMÉRIQUE
7 Justifiez : pourquoi il vaut mieux laisser Paris pour aller à Menton ? La ville de Menton est-elle en zone libre ? Faites une recherche historique sur le web.

Enfants d’origine juive persécutés et déportés pendant l’occupation allemande.
Droits et protection des enfants
Aujourd’hui

L’élève, partie d’une Collectivité
Daniel Pennac, auteur de Chagrin d’école, plus d’un million d’exemplaires vendus, prend parti pour la première fois dans le débat sur la réforme du collège et s’adresse aux professeurs.
D’après Marie-Laure Delorme – Le Journal du Dimanche, 20/06/2017
Que diriez-vous, aujourd’hui, à quelqu’un qui veut devenir professeur ?
Je lui dirais que les enfants et les adolescents ont avant tout besoin d’adultes sérieux et bienveillants. [...] Des adultes qui savent encore ce qu’être adolescent veut dire, des adultes patients, attentifs, méthodiques, honnêtes et fermes dans leur enseignement.
Je lui dirais de s’attaquer d’entrée de jeu à la peur de certains élèves : peur de ne pas comprendre, peur de ne pas répondre juste, peur d’avoir une mauvaise note, peur de passer pour un crétin… Voilà l’ennemi principal ! La peur de l’élève gangrène tout. Elle engendre la honte, qui produit le retrait sur soi ou la violence sur l’autre – sur le bon élève ou sur le professeur, par exemple. Elle devient très vite la peur du professeur lui-même [...], la peur des parents [...]. Je lui dirais de dédramatiser l’ignorance pour ouvrir grandes les portes à la connaissance. Je lui dirais d’instaurer en classe des rituels et de ne pas en changer. Les rituels apaisent les élèves, la régularité les rassure. Je lui dirais d’être réglo, d’une honnêteté pédagogique irréprochable, un adulte exemplaire, en somme, ça changera ses élèves des images d’adultes corrompus qui encombrent l’actualité. Je lui dirais de faire en sorte que, dans ses classes, chaque élève se sente partie prenante d’une collectivité [...]
Dans Chagrin d’école, vous vous décrivez comme un cancre mais sans jamais vous trouver de circonstances atténuantes, « enfant de la bourgeoisie d’État, issu d’une famille aimante ».
L’échec scolaire est une affaire d’inhibition et de fantasmes. L’élève en échec se raconte à lui-même l’histoire de sa nullité, soit en exagérant sa faute soit en accusant la terre entière ; bref, en se réfugiant dans une fiction. Enfant, j’ai opté très tôt pour la fiction de mon indignité. Devenu professeur, j’ai vite compris que ce genre de problème ne se résout ni par l’empathie, ni par la psychologie, ni par la sociologie, ni par la morale, mais que notre meilleure arme est la matière que nous enseignons [...]. Analyser les pronoms impersonnels « y » ou « en » dans les phrases « je n’y arriverai jamais » ou « je m’en fous » est une bonne façon d’initier un cancre à la grammaire. [...] Il y a tout à coup enchantement. Peu à peu l’élève n’affabule plus, il parle avec vous. [...]
Vous insistez sur le rôle de la parole dans l’enseignement. Qu’on le veuille ou non, la parole en classe se distingue de la parole extérieure à la classe. Entre ces murs, il faut se libérer du langage de connivence. [...] À propos du rôle de la parole, je suis absolument sidéré par la question du téléphone portable. En autorisant le portable à l’école, on a laissé entrer en classe l’objet même qui permet à l’élève d’en sortir à la seconde où il s’assied sur sa chaise. Que je sache, cette aberration pédagogique n’a suscité aucune réaction forte des différents ministères de l’Éducation. [...]
COMPRENDRE
1 Comment doivent être les enseignants ?
2 Que fait la peur ?
3 Comment peut-on réduire l’échec scolaire ?
4 Que pense-t-il du portable en classe ?
COMPÉTENCE CRITIQUE
5 À travers les documents présentés et votre propre expérience, quel est le rôle de l’école dans la formation des jeunes ?

La laïcité
« Un roi, une fois, une loi »
La jeunesse de Louis XIV (qui rit quand les dévots le décrient violemment dans Tartuffe de Molière) donne l’image d’un souverain modérément pieux mais il affichera davantage sa piété par la suite. Louis XIV a compris l’importance de la gloire chrétienne et de l’obéissance religieuse pour son métier de roi car il occupe une place unique dans le domaine religieux, celle de médiateur entre Dieu et les sujets qu’il lui a confiés. Une conception chrétienne du pouvoir politique et une alliance avec la religion scellée par la cérémonie du sacre est l’aspect le plus inédit de sa personnalité. Louis XIV considère qu’il ne peut y avoir que « un Roi, une foi, une loi » et cette union, se prolongera en France jusqu’à la séparation de l’Église et de l’État en 1905.
La laïcité aujourd’hui demeure le point d’aboutissement d’un long processus
La signature de l’Édit de Nantes opère une distinction entre le sujet politique, qui doit obéir à la loi du roi dans la sphère publique, et le croyant, libre de ses choix religieux dorénavant cantonnés à la sphère privée. Toutefois, l’Édit de Nantes réaffirme que la seule religion reste le catholicisme. L’idée philosophique et politique de laïcité apparaît en Europe au XVIIIe siècle avec la Philosophie des Lumières. Voltaire écrivait que chacun peut « aller au ciel par le chemin qui plaît ». En 1787, l’édit de tolérance permet aux protestants de retrouver un état civil et en 1789 la liberté religieuse est proclamée. C’est bien la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui pose les principes de la laïcité « à la française ». L’article 10 de la Déclaration consacre la liberté d’opinion en affirmant que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». La liberté religieuse, croire ou de ne pas croire, est acquise et la liberté du culte est inscrite dans la première Constitution (3 septembre 1791) que se donne la France. Le 21 février 1795, on décrète la séparation des Églises et de l’État, qui assure la liberté religieuse, mais avec le Concordat de Napoléon (1801) qui redéfinit les rapports entre l’Église et l’État, les cultes sont organisés plus librement. Les clercs sont payés par l’État qui reconnaît quatre cultes : protestant réformé, luthérien, israélite et catholique. Désormais, le catholicisme n’est plus la religion d’État, mais celle de « la majorité des Français » et le protestantisme est finalement à côté du catholicisme. C’est une valeur essentielle dans la redéfinition du rapport entre l’Église et l’État qui s’amorce et qui continuera tout au long du XIXe siècle.

Signature du Concordat de Napoléon (1801).
La question religieuse
se déplace sur le terrain de l’école
En 1850, sous la IIe République, l’école est gérée à la fois par l’État… et par l’Église ! Le ministre de l’instruction publique Alfred de Falloux autorise les congrégations religieuses à ouvrir des établissements secondaires, en plus des établissements primaires qu’elles géraient jusque-là. La IIIe République poursuit la sécularisation de la société, créant de nombreux services publics, l’éducation entre autres. Champ privilégié de la laïcité, l’école primaire publique devient le pilier de la République, avec pour mission d’instruire les futurs citoyens. Dans une perspective de neutralité et de lutte contre l’Église dans l’enseignement, Jules Ferry dote l’école d’un cadre laïque solide. C’est l’objet des lois de 1881-1882 qui créent l’école primaire gratuite et laïque et rendent l’instruction obligatoire pour tous les élèves de 6 à 13 ans. En 1905, une loi de séparation des Églises et de l’État sécularise la société : l’État cesse de subventionner l’Église. La laïcité ne posait plus de problème d’application en France. À ce sujet le conflit entre l’Église catholique et l’État laïque est apaisé. À l’affrontement idéologique, violent et tenace, qui durait siècle pour le contrôle de l’enseignement, succède une longue période de réconciliation de 1945 à 2003 : la laïcité allait de soi. Cependant, l’arrivée d’une importante population immigrée d’origine musulmane, la revendication rudement affirmée du port du voile dit « islamique » et le refus de suivre les cours d’éducation physique et de biologie par quelques centaines d’élèves a remis à jour le terme de « laïcité ». L’adoption de la loi du 15 mars 2004 relative à l’application du principe de laïcité et à l’interdiction du port de signes religieux ostensibles dans l’enseignement public, a suscité de nombreuses controverses au sein de la société française entre partisans et opposants à l’élaboration de ce texte. Outre les manifestations d’hostilité dans le monde musulman, ces débats ont montré la nécessité de retrouver les sources de ce concept français et de comprendre son ancrage historique dans la France d’aujourd’hui.

ACTIVITÉS
1 Quelles sont les datesclés de la laïcité en France ?
2 Quelle est la loi de Jules Ferry ?
3 Pourquoi Jules Ferry a-t-il voulu l’école laïque ?
4 Quelle est l’importance de la loi 15 mars 2004 ?
27 novembre 1883 :
la lettre aux instituteurs de Jules Ferry
L’instruction religieuse appartient aux familles et à l’Église ; l’instruction morale, à l’école. Le législateur n’a donc pas entendu faire une œuvre purement négative. Sans doute il a eu pour premier objet de séparer l’école de l’Église, d’assurer la liberté de conscience et des maîtres et des élèves, de distinguer enfin deux domaines trop longtemps confondus : celui des croyances, qui sont personnelles, libres et variables, et celui des connaissances, qui sont communes et indispensables à tous, de l’aveu de tous. (...) En vous dispensant de l’enseignement religieux, on n’a pas songé à vous décharger de l’enseignement moral ; c’eût été vous enlever ce qui fait la dignité de votre profession. Au contraire, il a paru tout naturel que l’instituteur, en même temps qu’il apprend aux enfants à lire et à écrire, leur enseigne aussi ces règles élémentaires de la vie morale qui ne sont pas moins universellement acceptées que celles du langage ou du calcul. (…) Au moment de proposer aux élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s’il se trouve à votre connaissance un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu’il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire ; sinon, parlez hardiment : car ce que vous allez communiquer à l’enfant, ce n’est pas votre propre sagesse ; c’est la sagesse du genre humain, c’est une de ces idées d’ordre universel que plusieurs siècles de civilisation ont fait entrer dans le patrimoine de l’humanité.
Charte de la laïcité à l’École (2013)
La Nation confie à l’école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République.
Une charte de la laïcité est un document du gouvernement pour éclaircir les valeurs à respecter dans certains lieux publics (établissements scolaires, services publics) pour ne pas en heurter le caractère laïc. En France, une telle charte a été publiée le 9 septembre 2013 par le ministre
de l’Éducation nationale, Vincent Peillon. Cette charte par laquelle, dans son introduction, « La Nation confie à l’École la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République », doit être apposée dans toutes les écoles et établissements du second degré.
La République est laïque
1 La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.
3 La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression de ses convictions, dans le respect de celles d’autrui et dans les limites de l’ordre public.
2 La République laïque organise la séparation des religions et de l’État. L’État est neutre à l’égard des convictions religieuses ou spirituelles. Il n’y a pas de religion d’État.
4 La laïcité permet l’exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun avec l’égalité et la fraternité de tous dans le souci de l’intérêt général.
• • L’École est laïque • •
5 La République assure dans les établissements scolaires le respect de chacun de ces principes.
6 La laïcité de l’École offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l’apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcheraient de faire leurs propres choix.
9 La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l’égalité entre les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et de la compréhension de l’autre.
7 La laïcité assure aux élèves l’accès à une culture commune et partagée.
8 La laïcité permet l’exercice de la liberté d’expression des élèves dans la limite du bon fonctionnement de l’École comme du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions.
10 Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que des autres principes fondamentaux de la République. Ils veillent à leur application dans le cadre scolaire. Il leur revient de porter la présente charte à la connaissance des parents d’élèves.
11 Les personnels ont un devoir de stricte neutralité : ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses dans l’exercice de leurs fonctions.

12 Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde ainsi qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique
Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme.
14 Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur, sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
ACTIVITÉS
1 Quels sont les piliers de la laïcité ?
2 L’Italie est un état laïque ? Et l’école ? Exprimez votre opinion en apportant des exemples
3 Allez sur le site :https://www.solidarite-laique.org/informe/desressources-pedagogiques-sur-la-laicite/9 décembre 2023 Quiz sur les valeurs de la République, pour tester vos connaissances et réviser les points essentiels en vidéos.
13 Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l’École de la République.
15 Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement.



Promouvoir
l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous
Droits pour tous pour un développement durable
Discrimination, racisme, immigration, marginalisation, intolérance. Ce sont des thèmes de grande actualité aujourd’hui aussi : le manque de liberté, l’intégration difficile, le problème de l’émancipation, les injustices persistantes, notamment celles dont surtout la femme est encore victime. Le but est de favoriser la connaissance et l’intégration en offrant un approfondissement sur certains débats pour vivre ensemble sur un pied d’égalité dans des sociétés démocratiques, durables et culturellement diverses
L’évolution des droits
Les libertés et les droits fondamentaux du citoyen sont des piliers importants de la démocratie. Ils peuvent être divisés en 4 catégories.
1 Les droits inhérents à la personne humaine (« droits de ») : ces droits, qui sont pour la plupart établis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789 et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sont pour l’essentiel des droits civils et politiques, individuels, dont l’État a pour obligation de permettre l’exercice. Il s’agit, entre autres, de l’égalité, de la liberté, de la sûreté et de la résistance à l’oppression.
2 Les droits qui sont des aspects ou des conséquences des précédents : ainsi du principe d’égalité découlent, par exemple, le suffrage universel, l’égalité des sexes, mais aussi l’égalité devant la loi, l’emploi, l’impôt, la justice, l’accès à la culture... Le principe de liberté induit l’existence de la liberté d’opinion, d’expression, de réunion, de culte, de la liberté syndicale ainsi que du droit de grève. Le droit de propriété (art. 17 DDHC) a pour corollaire la liberté de disposer de ses biens et d’entreprendre (art. 4).
3 Les droits sociaux et économiques sont énoncés plus particulièrement par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : droit à l’emploi, à la protection de la santé, à la gratuité de l’enseignement public...
4 Les droits dits « de troisième génération » (« droits pour ») sont par exemple énoncés dans la Charte de l’environnement, qui affirme le droit de chacun de « vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » (art. 1) et qui consacre la notion de développement durable (art. 6) et le principe de précaution (art. 7).

Les textes ‘sacrés’
Les textes qui consacrent les droits fondamentaux sont au nombre de deux : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789 et la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) de 1948 (ONU). À ceux-ci s’ajoutent la Convention internationale des droits de l’enfant (1989), la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000), le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (2015) ou encore la Charte de l’environnement, un texte de valeur constitutionnelle intégrée en 2005 dans le droit français, reconnaissant les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement.

COMPRENDRE
1 Reliez chaque droit (1-4) a sa définition (a-d).
Le citoyen possède quatre différents types de droits :
1 droits civils et libertés essentielles
2 droits politiques
3 droits sociaux
4 droits de troisième génération
a droit à un développement durable b droit de voter, de se présenter à une élection, droit de concourir à la formation de la loi par la voie des représentants qu’il élit

c droit au travail, droit de grève, droit à l’éducation, à la sécurité sociale d droit à la sûreté, à l’égalité devant la loi, liberté de pensée, d’opinion et d’expression, de religion, de circulation, de réunion, d’association ou de manifestation
COMPÉTENCE CRITIQUE
2 Donnez votre définition de citoyen et dites comment s’engager dans la vie citoyenne.
3 Les libertés et les droits fondamentaux sont des piliers importants de la démocratie. Comment sont-ils protégés ?
COMPÉTENCE NUMÉRIQUE
4 Regardez la vidéo « Les libertés fondamentales », Ferdinand Mélin-Soucramanien professeur à Bordeaux. Quels sont les quatre sujets que le professeur affronte ? Choisissez un sujet pour en faire une courte relation.
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
Une semaine de débats suffit pour rédiger ce code universel qui en inspirera beaucoup d’autres.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est adoptée en août 1789 par l’Assemblée nationale. Ce texte fondateur affirme que tous les individus disposent de droits, et pose les bases de la République et de la démocratie. Ses rédacteurs s’inspirent en partie de la Déclaration d’indépendance des États-Unis (1776).

« Tous les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », affirme l’article 1. Le texte présente ensuite les grands principes s’appliquant aux individus, aux citoyens ou à la Nation tout entière : l’égalité des droits entre les citoyens, la reconnaissance des libertés de chacun (liberté d’aller et venir, liberté de pensée, liberté d’expression, etc.), la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), le droit à la propriété etc. C’est un texte juridique majeur, que tous les gouvernements français ont l’obligation de respecter.
Préambule
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits suivants de l’homme et du
COMPRENDRE
Quel est le thème abordé dans le premier article de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?
2 Quels sont les droits de l’individu ?
3 Lisez les articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Inscrivez les numéros des articles correspondant aux thèmes suivants :
a La liberté et la sûreté
b L’égalité
c La propriété
d Les droits de la nation
e La force publique
DÉBAT
4 La révolution française est-elle source de toutes les libertés fondamentales ? Cette révolution est-elle encore actuelle ? Les progrès qu’elle a apportés ont-ils été réalisés à notre époque ?
Confrontez-vous avec vos camarades et faites un court résumé oral de ce débat.
Article 1er
Les articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article 2
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Article 3
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 4
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5
La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article 6
La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
Article 8
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Article 11
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12
La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article 13
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14
Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 16
Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Article 17
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Lire les images
La Révolution française expliquée en images
La fin de l’absolutisme et des privilèges laisse espérer en 1789 une ère nouvelle, placée sous le signe de la liberté et de l’égalité des droits.
Mais l’impossible conciliation des principes de l’Ancien Régime avec la fuite en avant du mouvement révolutionnaire plonge le pays dans une guerre civile continue. Après une ascension fulgurante, Bonaparte prend le pouvoir en 1799, confisquant une révolution qui ne parvient pas à s’achever. Mais nombre de révolutionnaires des XXe et XXIe siècles ont encore dans leur imaginaire cette exemplarité pour leur donner du courage et pour réfléchir.