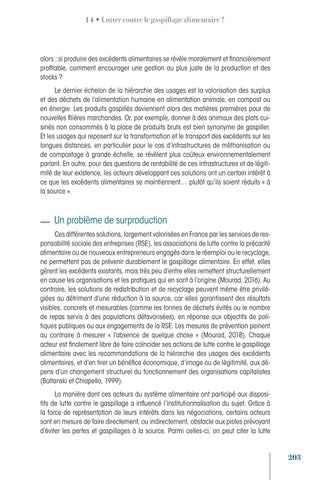14 • Lutter contre le gaspillage alimentaire ?
alors : si produire des excédents alimentaires se révèle moralement et financièrement profitable, comment encourager une gestion au plus juste de la production et des stocks ? Le dernier échelon de la hiérarchie des usages est la valorisation des surplus et des déchets de l’alimentation humaine en alimentation animale, en compost ou en énergie. Les produits gaspillés deviennent alors des matières premières pour de nouvelles filières marchandes. Or, par exemple, donner à des animaux des plats cuisinés non consommés à la place de produits bruts est bien synonyme de gaspiller. Et les usages qui reposent sur la transformation et le transport des excédents sur les longues distances, en particulier pour le cas d’infrastructures de méthanisation ou de compostage à grande échelle, se révèlent plus coûteux environnementalement parlant. En outre, pour des questions de rentabilité de ces infrastructures et de légitimité de leur existence, les acteurs développant ces solutions ont un certain intérêt à ce que les excédents alimentaires se maintiennent… plutôt qu’ils soient réduits « à la source ».
— Un problème de surproduction Ces différentes solutions, largement valorisées en France par les services de responsabilité sociale des entreprises (RSE), les associations de lutte contre la précarité alimentaire ou de nouveaux entrepreneurs engagés dans le réemploi ou le recyclage, ne permettent pas de prévenir durablement le gaspillage alimentaire. En effet, elles gèrent les excédents existants, mais très peu d’entre elles remettent structurellement en cause les organisations et les pratiques qui en sont à l’origine (Mourad, 2016). Au contraire, les solutions de redistribution et de recyclage peuvent même être privilégiées au détriment d’une réduction à la source, car elles garantissent des résultats visibles, concrets et mesurables (comme les tonnes de déchets évités ou le nombre de repas servis à des populations défavorisées), en réponse aux objectifs de politiques publiques ou aux engagements de la RSE. Les mesures de prévention peinent au contraire à mesurer « l’absence de quelque chose » (Mourad, 2018). Chaque acteur est finalement libre de faire coïncider ses actions de lutte contre le gaspillage alimentaire avec les recommandations de la hiérarchie des usages des excédents alimentaires, et d’en tirer un bénéfice économique, d’image ou de légitimité, aux dépens d’un changement structurel du fonctionnement des organisations capitalistes (Boltanski et Chiapello, 1999). La manière dont ces acteurs du système alimentaire ont participé aux dispositifs de lutte contre le gaspillage a influencé l’institutionnalisation du sujet. Grâce à la force de représentation de leurs intérêts dans les négociations, certains acteurs sont en mesure de faire directement, ou indirectement, obstacle aux pistes prévoyant d’éviter les pertes et gaspillages à la source. Parmi celles-ci, on peut citer la lutte
203