Ethnomathématiques









Directrice des rédactions : Cécile Lestienne
MENSUEL POUR LA SCIENCE
Rédacteur en chef : François Lassagne
Rédacteurs en chef adjoints : Loïc Mangin, Marie-Neige Cordonnier
Rédacteurs : François Savatier, Sean Bailly
HORS-SÉRIE POUR LA SCIENCE
Rédacteur en chef adjoint : Loïc Mangin

Développement numérique : Philippe Ribeau-Gésippe
Community manager et partenariats : Aëla Keryhuel aela.keryhuel@pourlascience.fr
Directrice artistique : Céline Lapert
Maquette : Pauline Bilbault, Raphaël Queruel, Ingrid Leroy, Ingrid Lhande
Réviseuses : Anne-Rozenn Jouble, Maud Bruguière et Isabelle Bouchery
Assistant administratif : Bilal El Bohtori
Responsable marketing : Frédéric-Alexandre Talec
Direction du personnel : Olivia Le Prévost
Fabrication : Marianne Sigogne et Stéphanie Ho
Directeur de la publication et gérant : Nicolas Bréon
Ont également participé à ce numéro : Laure Bonnaud-Ponticelli, Etienne Dumur, Mathieu Lihoreau, Antoine Petiteau, Gabriel Tobie
PUBLICITÉ France
stephanie.jullien@pourlascience.fr
ABONNEMENTS
www.boutique.groupepourlascience.fr
Courriel : serviceclients@groupepourlascience.fr
Tél. : 01 86 70 01 76
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Adresse postale :
Service abonnement groupe Pour la Science
20 rue Rouget-de-Lisle
92130 Issy-les-Moulineaux.
Tarifs d’abonnement 1 an (12 numéros)
France métropolitaine : 59 euros – Europe : 71 euros
Reste du monde : 85,25 euros
DIFFUSION
Contact kiosques : À Juste Titres ; Alicia Abadie
Tél. 04 88 15 12 47
Information/modification de service/réassort : www.direct-editeurs.fr
DISTRIBUTION
MLP
ISSN 0 153-4092
Commission paritaire n° 0927K82079
Dépôt légal : 5636 – Août 2023
N° d’édition : M0770550-01
www.pourlascience.fr
170 bis boulevard du Montparnasse – 75 014 Paris
Tél. 01 55 42 84 00
SCIENTIFIC AMERICAN
Editor in chief : Laura Helmuth
President : Kimberly Lau
2023. Scientific American, une division de Springer Nature America, Inc. Soumis aux lois et traités nationaux et internationaux sur la propriété intellectuelle. Tous droits réservés. Utilisé sous licence. Aucune partie de ce numéro ne peut être reproduite par un procédé mécanique, photographique ou électronique, ou sous la forme d’un enregistrement audio, ni stockée dans un système d’extraction, transmise ou copiée d’une autre manière pour un usage public ou privé sans l’autorisation écrite de l’éditeur. La marque et le nom commercial «Scientific American» sont la propriété de Scientific American, Inc. Licence accordée à «Pour la Science SARL».
© Pour la Science SARL, 170 bis bd du Montparnasse, 75014 Paris. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente revue sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français de l’exploitation du droit de copie (20 rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).
Origine du papier : Autriche Taux de fibres recyclées : 30 %

« Eutrophisation » ou « Impact sur l’eau » : Ptot 0,007 kg/tonne
Imprimé en France
Maury Imprimeur SA Malesherbes
N° d’imprimeur : 271 672
Dessiner sur le sable passe pour un jeu d’enfant. Dans l’archipel du Vanuatu, l’exercice est réservé aux praticiens d’une tradition ancienne. L’œil naïf s’émerveillera des entrelacs délicats, figurant ici une tortue, là un papillon. Les populations pratiquant cet art enregistrent, elles, dans leurs réalisations leur mythologie et les épisodes de la vie collective.
L’ethnomathématicien Alban Da Silva y a vu la trace du concept mathématique de graphe eulérien, qui consiste à dessiner une figure imposée d’un seul trait sans repasser deux fois sur une même ligne. Il apporte la preuve, par une modélisation rigoureuse des pratiques observées, que certaines populations du Vanuatu ont littéralement la théorie des graphes au bout des doigts. Coexistent ainsi, dans ces fragiles et éphémères tracés, des règles empiriques transmises au fil des générations et celles d’une théorie très importante pour les mathématiciens, ravivant la fascinante question des fondements anthropologiques de la pensée mathématique.
À quelque 11 000 kilomètres à l’ouest du Vanuatu se joue une forme de coexistence autrement concrète : celle des humains et des léopards. La densité humaine dans les environs de Mumbai est telle que les rencontres avec les grands félins sont singulièrement fréquentes. L’éthologue indienne Vidya Athreya nous fait découvrir les conditions qui depuis des siècles rendent possible une cohabitation pacifique entre notre espèce et les grands félins. Et qu’il s’agit de remettre à jour dans un monde urbanisé.
Il n’aura pas échappé aux amateurs de science, ces dernières semaines, une autre forme de coexistence inattendue : celle d’annonces contradictoires accompagnant les dernières observations du télescope spatial James-Webb. Quel âge ont vraiment les premières galaxies de l’Univers ? Une équipe répond 320 millions d’années, une autre 200 millions, une autre encore abaisse la limite à 100 millions d’années. Ces annonces, présentées à quelques jours d’intervalle parfois, signent la dérive de la course à la publication, juge l’astrophysicien Nicolas Laporte. Il faudra attendre l’examen patient par les pairs pour obtenir une réponse consistante.
La science est une entreprise de clarification et de distinction, qui exige du temps. Elle sait faire le tri entre ce qui mérite crédit et ce qui doit être abandonné. Elle crée des liens éclairants entre des concepts et des domaines apparemment distants. Elle peut aussi, dans le champ de l’écologie, faciliter la découverte de terrains d’entente entre parties prenantes. Toutes œuvres utiles en temps de confusion informationnelle et de tensions environnementales. n

P. 6
ÉCHOS DES LABOS
• Le cerveau, un acteur régulateur de l’inflammation
• Les racines multiples de notre espèce
• Le son grave de l’Univers
• Un pouls peut en cacher un autre
• Ces appeaux préhistoriques chantent encore
• Une particule de son « coupée en deux »
• On pompe et la Terre bascule
P. 16
LES LIVRES DU MOIS
P. 18
DISPUTES ENVIRONNEMENTALES
Sortir la tête de la bassine
Catherine Aubertin
P. 20
LES SCIENCES À LA LOUPE

Le culte de l’innovation
Yves Gingras
BIOPHYSIQUE VERS UNE INGÉNIERIE DES FORMES VIVANTES ?
Philip Ball
Le champ émergent de la morphologie synthétique floute les frontières entre vie naturelle et artificielle.
BIOPHYSIQUE
« LA MATIÈRE BIOLOGIQUE EST À LA FOIS PHYSIQUE, ACTIVE ET RÉACTIVE »
Entretien avec Emmanuel Farge
Pour appréhender le vivant il faut tenir compte des interactions de ses propriétés physiques et des processus biochimiques qui lui donnent vie
ASTROPHYSIQUE
SUR LES TRACES DE L’AUBE COSMIQUE
ÉTHOLOGIE
VIVRE AVEC LES LÉOPARDS

LETTRE D’INFORMATION
NE MANQUEZ PAS
LA PARUTION DE VOTRE MAGAZINE GRÂCE À LA NEWSLETTER
• Notre sélection d’articles

• Des offres préférentielles
• Nos autres magazines en kiosque
Inscrivez-vous www.pourlascience.fr
En couverture :
© Eric Lafforgue
Les portraits des contributeurs sont de Seb Jarnot

Ce numéro comporte un courrier de réabonnement posé sur le magazine sur une sélection d’abonnés.
Nicolas Laporte
Quand les premières étoiles et galaxies sont-elles nées ? Depuis un an, le télescope spatial JWST est parti à leur recherche.

Et déjà un florilège de découvertes surprenantes surgit de ses observations
Vidya Athreya
Réapprendre à cohabiter avec les fauves : tel est le défi que la population indienne tente de relever pour préserver ses grands carnivores
P. 80
LOGIQUE & CALCUL RUINER LE CASINO OU SE RUINER ?
Jean-Paul Delahaye
NEUROPHYSIOLOGIE

CE QUE LA CHALEUR INFLIGE AU CERVEAU

Pieter Vancamp
Jour de canicule : on transpire, on rougit et on se sent groggy, voire confus, jusqu’à être incapable de travailler De fortes chaleurs nuisent à nos performances physiques et mentales. Pourquoi ? Et comment s’en prémunir ?
HISTOIRE DES SCIENCES
« UBU COCU » OU L’ARCHÉOPTÉRYX

SELON ALFRED JARRY
Eric Buffetaut
Qu’est venu faire le plus ancien oiseau identifié jusqu’à présent dans une pièce inconnue du père de la pataphysique ?
Contre toute attente, l’auteur de la saga du « Père Ubu » n’est pas le seul lettré à s’être intéressé de près à certains fossiles illustres.
Classés patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco, les dessins que tracent sur le sable certains habitants du Vanuatu suivent des règles qui leur confèrent des propriétés... de graphes mathématiques ! Enquête sur le terrain.

Les mathématiques des jeux de casino indiquent comment jouer pour perdre le moins possible.

P. 86
ART & SCIENCE
« La Cène », vue de l’intérieur Loïc Mangin
P. 88
IDÉES DE PHYSIQUE
L’ombre de l’invisible Jean-Michel Courty et Édouard Kierlik
P. 92
CHRONIQUES DE L’ÉVOLUTION
Les éléphants se sont-ils domestiqués ?
Hervé Le Guyader
P. 96
SCIENCE & GASTRONOMIE
Connaissez-vous bien la mayonnaise ?
Hervé This
P. 98
À PICORER

Dans le noyau parabrachial du cerveau, les neurones marqués en rouge se projettent à travers tout le cerveau et contrôlent la libération de cortisone après la détection d’un signal inflammatoire dans le sang.
En centralisant de nombreux signaux d’alerte, une région du cerveau, le noyau parabrachial, modulerait la réponse anti-inflammatoire.
En cas de blessure ou d’infection, les cellules immunitaires, présentes dans les tissus ou circulant dans l’organisme, s’activent et déclenchent, notamment, la réponse inflammatoire. Dans les premières étapes de ce processus, elles libèrent diverses molécules ou « médiateurs de l’inflammation », par exemple des cytokines, des histamines, etc. Le rôle de ces molécules est de recruter des cellules circulantes du système immunitaire, d’éliminer les agents pathogènes ou encore d’engager la réparation des tissus lésés. Dans cette cascade de mécanismes complexes, le cerveau n’est pas en reste. En détectant la présence de médiateurs de l’inflammation dans le sang, il induit une réponse nommée « état de maladie », qui consiste à
réa ff ecter l’énergie au sein de l’organisme pour mieux lutter contre la perturbation. Cette réaction se traduit par des ajustements du métabolisme (fièvre, perte d’appétit, altération de la production d’hormones, etc.) ou du comportement (évitement social, sommeil, etc.).
La modulation du système immunitaire est réalisée notamment par la synthèse dans la glande surrénale de cortisone, une hormone produite sous le contrôle du noyau paraventriculaire de l’hypothalamus La libération de cette hormone est induite par différents signaux : psychologiques, sensoriels (liés à la douleur) ou immunitaires (avec les médiateurs de l’inflammation). En 1999, Andrew Turnbull et Catherine Rivier, de l’institut Salk , en Californie , avaient démontré que certaines cytokines médiatrices de l’inflammation déclenchaient une activation de l’hypothalamus conduisant à la production de cortisone dans la glande surrénale.
Certaines observations suggèrent que le cerveau a aussi une action régulatrice sur la réponse inflammatoire.
Cependant, l’activité du noyau paraventriculaire est connue pour être régulée par de nombreuses autres régions du cerveau Dès lors, il était possible que d’autres
Le cerveau détecte l’inflammation et, en retour, contribue à la réguler
circuits établissent une connexion entre les signaux du système immunitaire et l’hypothalamus. En étudiant les interactions du cerveau et du système immunitaire chez la souris , les équipes de l’immunologiste Gérard Eberl et des neuroscientifiques Pierre-Marie Lledo et Gabriel Lepousez, de l’institut Pasteur, de l’Inserm et du CNRS , ont justement découvert un tel circuit par lequel le cerveau détecte l’inflammation et, en retour, contribue à réguler cette dernière
Pour l’identifier, les chercheurs ont d’abord administré différents médiateurs de l’inflammation à des souris Ils ont alors constaté une production de cortisone importante pour seulement certaines cytokines , notamment l’interleukine 1 bêta (IL-1β). Ils ont remarqué qu’une dose croissante d’IL -1 β n’augmentait pas la concentration de cortisone émise , mais prolongeait sa réponse dans la durée
Les scientifiques de l’institut Pasteur ont constaté que cette interleukine active dans un premier temps des neurones d’une région du tronc cérébral ( situé sous le cerveau et directement relié à la moelle épinière ), le complexe vagal Après cette première étape, les informations sont transmises du complexe vagal vers une autre région du tronc cérébral, le noyau parabrachial Cette zone est connue pour traiter divers signaux provenant d’autres régions du cerveau, en lien avec la douleur et certaines mémoires aversives ou traumatiques De là , les signaux de l’inflammation conduisent à l’activation de neurones de l’hypothalamus, qui se traduit par une production et libération de cortisone dans le sang. Cette hormone réduit alors le développement de cellules immunitaires dans la moelle osseuse et le thymus, afin d’éviter un emballement immunitaire qui pourrait être fatal , comme c’est le cas lors d’un choc septique.
En collectant de nombreux signaux provenant de l’extérieur ou de l’intérieur de l’organisme, le noyau parabrachial permet au cerveau de coordonner la meilleure réponse possible – immunitaire , métabolique et comportementale – en cas d’inflammation et a ainsi un rôle central dans le processus de retour à l’équilibre de l’organisme n
Sean Bailly
Les analyses génomiques des quelque 5 000 échantillons collectés par la mission « Tara Pacific » sur les récifs coralliens du Pacifique révèlent un microbiome aussi riche que toute la biodiversité terrestre. Le microbiologiste Pierre Galand présente ces résultats étonnants.
intra-espèce de corail, nous avons prélevé les bactéries sur dix colonies par espèce. Pour le plancton, nous avons utilisé trois tailles de filtres pour séparer les bactéries libres (moins de 3 micromètres) du zooplancton et du phytoplancton, à proximité du corail, à la surface et à distance.
Quels étaient vos objectifs lors de cette expédition de plus de deux ans avec la goélette Tara ?
Nous voulions cartographier la diversité de ces précieux écosystèmes, découvrir des zones écologiques aussi riches que le « triangle de corail » entre la Malaisie, l’Indonésie et les Philippines, qui concentre la plus grande biodiversité marine du monde. Et voir si la biodiversité des récifs coralliens est en lien avec la diversité bactérienne.
Que savait-on de ce microbiome ?
La vision était parcellaire. Les récifs côtiers, situés entre 2 et 15 mètres de profondeur, sont la fabrique de la biodiversité marine : avec seulement 0,2 % de la surface du globe, ils abritent 32 % des espèces animales. On sait aussi que le corail est en symbiose avec des bactéries sans que l’on comprenne pourquoi. Avec le projet Tara Pacific, notre analyse, à l’échelle du Pacifique, avec un même protocole de séquençage de l’ADN, a établi un état des lieux précis des bactéries associées aux coraux, aux poissons qui y vivent et au plancton.
Quelle a été votre méthodologie ?
Tara a sillonné le Pacifique de mai 2016 à octobre 2018 et récolté 5 392 échantillons de microbiome dans 99 récifs coralliens de 32 îles de l’Amérique à l’Asie. Congelés à bord à – 80 °C, ces échantillons ont été envoyés par avion au génoscope du CEA. Dans un but de comparaison, nous avons ciblé les rares espèces présentes dans tout le Pacifique : trois coraux (Millepora platyphylla, Porites lobata et Pocillopora meandrina) qui di èrent par leur mode de vie et leur résilience ainsi que deux poissons (le chirurgien bagnard, Acanthurus triostegus, et l’idole mauve, Zanclus cornutus), l’un herbivore, l’autre carnivore. Pour vérifier la variabilité
Votre analyse microbiologique est d’une ampleur inédite…
Oui ! Impensable il y a dix ans… Nous avons séquencé l’équivalent de 50 000 génomes humains. Plus de 800 métagénomes et environ 540 000 portions d’ADN préalablement identifiées comme de bons marqueurs taxonomiques de bactéries. C’est beaucoup plus qu’on ne le pensait ! En extrapolant nos résultats à toutes les espèces connues de corail et de poissons du Pacifique, nous estimons que la biodiversité bactérienne de ces récifs coralliens du Pacifique est du même ordre que toute la biodiversité terrestre estimée. Quelles conclusions tirez-vous ?
Le plancton contient le plus grand nombre d’espèces bactériennes. La plupart des bactéries sont uniques à leur hôte que ce soit le plancton, les poissons ou le corail. Et le microbiome dépend du site. Mais ceux du Pacifique occidental, qui abrite une plus grande variété d’espèces de coraux que le Pacifique oriental, ne sont pas plus diversifiés. Nous n’avons pas trouvé de corrélation significative entre la température de l’eau de mer et la diversité des microbiomes. Ni de lien établi avec la biodiversité des récifs. Mais nous avons identifié trois nouvelles bactéries, abondantes partout, signe d’une coévolution pérenne, associées chacune à une espèce de corail. Et elles produisent l’indispensable vitamine B, ce qui pourrait être un des éléments de cette symbiose corail-bactérie. Plus largement, nous espérons identifier des bactéries indicatrices de l’état de santé des récifs pour certains déjà très dégradés, ou de l’environnement (température, salinité). n
, 2023.
L’encornet de Californie est doté d’un mécanisme d’édition de ses molécules d’ARN qui reconfigure la structure de certaines de ses protéines, les rendant plus e caces à basse température.
Les céphalopodes n’en finissent pas de surprendre par leur comportement, leurs capacités d’apprentissage, mais aussi et surtout par leur étonnante biologie. Des abysses glacials et obscurs aux eaux chaudes et peu profondes des tropiques, cette large famille d’animaux marins qui comprend les pieuvres, les seiches et les calmars occupe un grand éventail d’environnements océaniques. Pour mieux comprendre cette adaptabilité aux différentes températures de l’eau, Kavita Rangan et Samara Reck-Peterson, de l’université de Californie à San Diego, se sont intéressées à l’encornet de Californie (Doryteuthis opalescens), qui habite dans les eaux du Pacifique sud-ouest américain, connues pour leurs variations saisonnières de température. Elles ont découvert chez ces animaux un mécanisme d’édition de leur ARN messager, qui améliore la fonctionnalité de certaines protéines à basse température.

Habituellement, des enzymes lisent l’ADN et produisent des ARN messagers, à partir desquels sont synthétisées toutes les protéines d’un organisme. Mais certains processus d’édition de l’ARN permettent aux organismes de recoder ces molécules messagères afin qu’elles engendrent des protéines modifiées Il s’agit d’un processus très rare chez l’humain, mais relativement commun chez les céphalopodes à corps mou, comme l’encornet de Californie Dans leur étude, les deux biologistes ont scruté à l’échelle moléculaire ce mécanisme appliqué à deux protéines, la dynéine et la kinésine. Ces protéines jouent un rôle important de moteur moléculaire, transportant diverses cargaisons – des vésicules contenant des protéines, entre autres – le long d’autoroutes cellulaires qu’on appelle « microtubules », sortes de filaments qui constituent une partie du « squelette interne » des cellules.
Or il est fréquent que des baisses drastiques de température affectent l’efficacité de certaines fonctions physiologiques La kinésine, par exemple, se déplace plus lentement.
Travaillant sur des paralarves vivantes d’encornet, Kavita Rangan et Samara Reck-Peterson ont montré que, pour pallier cela, ces animaux avaient la capacité – par l’édition de leur propre ARN messager – de reconfigurer la structure en acides aminés de leur kinésine
L’encornet de Californie (Doryteuthis opalescens) est ectotherme : il ne produit pas sa propre chaleur interne. Malgré cela, il est capable de vivre dans une large variété de températures océaniques.
Cette reconfiguration survient en particulier lorsque les paralarves sont immergées dans des eaux froides Les chercheuses ont alors reconstitué ces kinésines modifiées en laboratoire , à l’aide d’une technique d’ADN recombinant , afin de mesurer leurs mouvements par microscopie optique. Résultat : la motilité des variants était en effet plus élevée à des températures basses.
Ce constat met en lumière l’étonnante plasticité phénotypique de ces animaux ; ils sont capables de moduler leur protéome (l’ensemble de protéines de leur organisme) en réponse à un stimulus environnemental comme une variation de température. Or Doryteuthis opalescens est un ectotherme, c’est-à-dire un animal qui ne produit pas sa propre chaleur interne . Kavita Rangan et Samara Reck- Peterson pensent que ce mécanisme expliquerait en partie comment, malgré cela, ces animaux sont capables de s’épanouir dans une si large variété de températures océaniques n
William Rowe-PirraLa fourmi Atta sexdens, une espèce coupeuse de feuilles présente au Brésil, est capable de transporter un fragment de végétal pesant jusqu’à six fois sa masse. Mais comment fait-elle pour ne pas couper de morceaux trop lourds ou, à l’inverse, trop petits, qui l’obligeraient à faire davantage d’allers-retours ?
Daniela Römer et ses collègues, de l’université de Würzburg, en Allemagne, ont réalisé une série d’expériences et ont montré que la fourmi ancre ses pattes arrière sur le bord de la feuille ce qui lui donne un point de référence pour définir la trajectoire de ses mandibules lors du découpage. Elle utilise aussi, dans une moindre mesure, les poils sensoriels situés au niveau de son cou. Ces derniers sont connus pour leur rôle dans le positionnement de la tête. n
Caroline BarathonLe cancer de la vessie est plus fréquent et agressif chez les hommes que chez les femmes. En outre, même si l’on prend en compte certains biais comme la surconsommation d’alcool et de tabac par les premiers, cette asymétrie persiste. Quelle est son origine ?
L’équipe de Dan Theodorescu, du centre médical de Cedars-Sinaï, à Los Angeles, avance une nouvelle explication qui est liée au chromosome Y. Chez les hommes âgés, le chromosome Y est parfois perdu lors de la division cellulaire. Cette perte, déjà connue pour provoquer d’autres maladies, notamment cardiaques, rendrait les cellules tumorales plus agressives et induirait un « épuisement » du système immunitaire. Cependant, l’équipe a aussi constaté que, chez la souris, certains anticorps qui réactivent le système immunitaire étaient plus efficaces quand les tumeurs étaient sans chromosome Y. Une piste pour améliorer l’immunothérapie de ce cancer. n
S. B.Le vent solaire souffle usuellement à des vitesses de 300 à 400 kilomètres par seconde, mais certaines pointes atteignent 800 kilomètres par seconde ! La pression thermique ne suffit pas à expliquer ces rafales extrêmes. Les spécialistes pensaient que le champ magnétique de l’étoile en était à l’origine, mais le mécanisme en cause faisait débat. Jusqu’à présent, les observations étaient réalisées de trop loin pour percer les détails du processus. Or la sonde Parker Solar Probe a été conçue pour pénétrer le plus loin possible dans la couronne solaire. En étudiant des données enregistrées lors de survols effectués à seulement 8 millions de kilomètres du Soleil, Stuart Bale, de l’université de Californie à Berkeley, et ses collègues ont montré que le vent solaire rapide serait lié au mécanisme de création de certaines structures magnétiques dans des régions nommées « trous coronaux ».

La surface du Soleil est constituée des cellules de convection de différentes tailles. Dans les trous coronaux, des zones relativement froides, les cellules atteignent parfois des tailles gigantesques affichant un diamètre d’environ 30 000 kilomètres – on parle alors de « supergranules ». Dans ces régions, les lignes de champ magnétique sont ouvertes, c’est-à-dire qu’elles se dirigent vers l’espace Mais près des bords des supergranules, ces lignes ouvertes interagissent avec des lignes de champ fermées (qui font des boucles à la surface du Soleil) : elles se reconnectent et produisent des structures magnétiques en forme de S, les switchbacks. « La reconnexion rapide induit une tension sur les lignes de champs qui est relâchée sous forme d’énergie », décrit Jean-Baptiste Dakeyo, de l’université Toulouse III. Cette énergie accélérerait les particules présentes, la source du vent rapide n
Évrard-Ouicem Eljaouhari
Grâce à un dispositif s’inspirant du principe des miroirs semi-réfléchissants, il est possible de manipuler quantiquement les ondes acoustiques comme on le fait pour les photons.
Lorsque Alice a traversé le miroir, elle n’imaginait par découvrir un monde merveilleux dont les règles défient en permanence l’intuition. D’une certaine manière, les physiciens sont les explorateurs d’un monde tout aussi fascinant que celui de Lewis Carroll, où la mécanique quantique mène à des phénomènes étonnants et contre-intuitifs. Ses lois expliquent par exemple comment une particule peut passer par deux chemins différents en même temps, un peu comme si elle avait été « coupée en deux » ! De tels tours de passe-passe sont maîtrisés depuis bien longtemps pour les photons, les particules de lumière. Mais peuton en faire autant avec les phonons, les « particules de son » ? L’équipe d’Andrew Cleland vient de développer un élément clé pour réaliser ce genre d’expérience.
L’idée de manipuler un phonon comme un photon est surprenante, car, contrairement à ce dernier, le phonon n’est pas une particule élémentaire. On parle plutôt de quasi-particule, car un phonon décrit en réalité un comportement collectif de typiquement 1015 particules, qui vibrent dans la matière et forment, par exemple, une onde acoustique Cependant, une quasiparticule se comporte par bien des aspects comme une particule unique et indivisible Et il est possible de mener des expériences quantiques avec de tels objets
Mais comment couper une particule en deux ? Une façon d’y parvenir consiste, dans le cas des photons, à utiliser un miroir semi-réfléchissant La particule de lumière a une certaine probabilité de traverser le miroir ou d’être réfléchie Si aucune mesure n’est réalisée, le photon se retrouve dans une superposition d’états quantiques, il est décrit par une fonction mathématique composée de l’état où il est réfléchi et de l’état où il est transmis Avec un jeu de miroirs, le photon passe alors par deux chemins en même temps et interfère avec luimême. C’est le principe de l’interféromètre de Michelson ou de celui de Mach-Zehnder
Ces manipulations menées sur les photons sont a priori applicables à tout type d’objets quantiques , même à des phonons. Mais un élément manquait dans la boîte à outils des physiciens manipulant les phonons :
1015
C’EST LE NOMBRE DE PARTICULES QUI PARTICIPENT TYPIQUEMENT AU MOUVEMENT COLLECTIF
D’UNE ONDE SE PROPAGEANT DANS LA MATIÈRE. CE PHÉNOMÈNE EST DÉCRIT PLUS SIMPLEMENT PAR UN PHONON, UNE QUASI-PARTICULE, QUI PRÉSENTE DE NOMBREUSES PROPRIÉTÉS DES PARTICULES.
l’équivalent du miroir semi-réfléchissant Or c’est exactement ce que vient de développer l’équipe d’Andrew Cleland
Le dispositif expérimental est composé de deux qubits supraconducteurs, qui servent de sources de photons uniques Chaque source est ensuite associée à un transducteur capable de convertir le photon en phonon unique , ou inversement de convertir un phonon en photon Entre les deux transducteurs, les chercheurs ont placé un « peigne » constitué de 16 dents métalliques que les phonons traversent. Chaque dent réfléchit environ 3 % de l’énergie acoustique Un phonon émis depuis l’un des deux supraconducteurs a donc environ 50 % de chances d’atteindre le second supraconducteur et les 50 % restantes de revenir à son point de départ Les chercheurs sont ensuite parvenus à montrer que le phonon se trouvait bien dans un état superposé

Avec ce « miroir semi-réfléchissant » pour phonons, les physiciens réfléchissent déjà à des dispositifs hybrides de calcul quantique ou le développement de réseaux de communication phononiques. Au pays des merveilles, l’imagination n’a pas de limite ! n
S. B.






3€ * 99

Scanner ce QR Code avec votre téléphone pour commander votre numéro, ou rendez-vous sur boutique.groupepourlascience.fr






> Au Vanuatu, un art traditionnel consiste à tracer avec le doigt des dessins sur le sable selon des règles précises.
> Il est possible de modéliser cette pratique pas à pas à l’aide d’outils mathématiques.
> Une telle modélisation révèle que les experts du dessin
sur le sable du Vanuatu ont une démarche qui relève d’une branche des mathématiques, la théorie des graphes.
> Elle fournit aussi des clés pour mieux comprendre cette pratique et les récits qui l’accompagnent, reflets des cosmogonies des sociétés vanuataises et de leurs traditions.
ALBAN DA SILVA ethnomathématicien, agrégé de mathématiques, docteur en histoire et philosophie des sciences, professeur en classe préparatoire en NouvelleCalédonie, chercheur associé au laboratoire Sphere de l’université Paris Cité

Classés patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco, les dessins que tracent sur le sable certains habitants du Vanuatu suivent des règles qui leur confèrent des propriétés… de graphes mathématiques ! Enquête sur le terrain.
Octobre 2015, Port-Vila Ma mission de formation d’enseignants en mathématiques du lycée français de la capitale du Vanuatu touche à sa fin Le proviseur me convie à partager un kava, la boisson traditionnelle de l’archipel Je m’en rendrai compte un peu plus tard , mais pour tout chercheur en sciences sociales qui travaille sur les sociétés de ce pays, le partage du kava est un moment très fructueux pour la collecte d’informations Fabriquée à partir des racines de l’arbre du même nom , cette boisson induit un effet relaxant propice à la libération de la parole. Cette première rencontre avec le kava l’a été aussi avec le « dessin sur le sable ». Au cours de la soirée , l’un des stagiaires a sorti une grande planche recouverte d’un sable très fin. Après avoir soigneusement aplani la surface, il s’est mis à dessiner avec un doigt une « grille » faite de lignes horizontales et verticales, sur laquelle il s’est appuyé pour tracer un sillon sans jamais lever le doigt À la fin, l’artiste a fait le commentaire suivant en
bislama (ou bichlamar, un pidgin anglomélanésien utilisé au Vanuatu) : « Hemia hem i wan fis i ronwe i stap unda stone from i kat wan sak » ( « C’est un poisson qui se cache sous une pierre pour échapper au requin »).
La fluidité du tracé, mêlée aux effets du kava, m’a plongé dans un état de fascination et d’émerveillement La technique employée m’a immédiatement évoqué le défi intellectuel consistant à dessiner une figure imposée d’un seul trait sans repasser deux fois sur une même ligne Ce principe, utilisé dans certains cassetête, met en jeu le concept mathématique de « graphe eulérien »
Alors que je tentais de rassembler mes idées, un stagiaire s’est approché de moi et m’a glissé à l’oreille : « Alors Monsieur le professeur, où sont les mathématiques dans ce dessin ? » Sans le savoir, par cette remarque, il allait faire basculer les six années suivantes de ma vie dans un travail doctoral sur le dessin sur le sable. Une question m’a tout particulièrement animé : « Comment de tels dessins ont été créés ? » Mon enquête m’a mené bien plus loin que je ne l’imaginais En observant les experts dessiner
Avant de réaliser un dessin sur le sable, le praticien trace une grille, le plus souvent rectangulaire, mais parfois circulaire, comme celle-ci, qui servira de support au dessin Skul blo fis, « l’école des poissons », où seize poissons mangent autour d’un corail.

sur le sable, en les interrogeant sur leur manière de procéder, en collectant sur le terrain de nombreux dessins et leur histoire, et aussi en explorant les travaux d’ethnologues du XXe siècle déjà intrigués par ces représentations, j’ai mis au point un modèle mathématique de la pratique du dessin sur le sable qui suit fidèlement la réalisation des œuvres. Ce modèle fournit un cadre rigoureux qui m’a permis de montrer que la création de ces dessins et leur exécution s’apparentent à une approche mathématique : elles sont le fruit d’algorithmes et d’opérations de nature algébrique Le langage mathématique est donc approprié pour décrire les démarches des experts du dessin sur le sable Et même plus : il aide à comprendre comment ces démarches reflètent les relations que les sociétés du Vanuatu entretiennent avec leur environnement.

Le Vanuatu est un archipel où vit une population d’environ 315 000 personnes réparties sur 83 îles Ce pays possède la plus haute densité linguistique au monde, puisqu’on y dénombre

L’archipel du Vanuatu (nommé Nouvelles-Hébrides jusqu’en 1980) est le pays qui possède la plus grande densité linguistique du monde. Il existe souvent plusieurs langues sur une même île (ci-dessus une plage de l’île Espiritu Santo) et on en dénombre plus d’une centaine au total. Le dessin sur le sable se pratique sur les îles du centre (pointillé vert). L’auteur s’est concentré sur la province de Penama, plus particulièrement sur les îles Maewo et Pentecôte.

138 langues vernaculaires. Les deux langues officielles d’éducation sont le français et l’anglais, le bislama faisant office de langue véhiculaire Ce constat se traduit par des réalités culturelles très différentes du nord au sud du pays, voire au sein d’une même île, même si des traits sont communs à toutes les sociétés Ainsi, la pratique du dessin sur le sable n’est répandue que dans certaines îles du centre Elle n’est pas sans rappeler une autre manière de dessiner à même le sol existant dans le Tamil Nadu, en Inde Mais elle possède des caractéristiques uniques au monde qui ont amené l’Unesco à la classer au patrimoine immatériel de l’humanité en 2008.
Zone de pratique de dessins sur sable
Province de Penama
drawing en anglais , sandroing en bislama . Traditionnellement, elle consiste à réaliser avec le doigt – sur la terre battue des villages, le sable des plages ou la cendre – des figures formées le plus souvent d’une ligne continue refermée sur elle-même et contrainte par une grille composée de lignes ou de points Les mots « continue » et « fermée » ont ici le même sens qu’en mathématiques : un dessin sur le sable s’apparente à une courbe continue fermée du plan.
Ce dessin sur le sable évoque un poisson caché sous une pierre pour échapper à un prédateur.
Ma thèse repose sur deux enquêtes de terrain, menées sur les îles Maewo en 2018 et Pentecôte en 2019, notamment dans le nord de cette dernière, dans la société Raga (prononcer [Ra-ra]). Avec Ambae, ces deux îles constituent la province de Penama et sont liées par des mythes communs, ce qui a grandement facilité mes recherches.
L’activité « dessin sur le sable » est probablement millénaire Au Vanuatu, on la nomme sand

Il est difficile d’avoir une idée précise du nombre de dessins toujours pratiqués de nos jours , mais il est acquis que de nouveaux apparaissent alors que certains disparaissent çà et là Un système très proche de la propriété intellectuelle existe dans les sociétés du Vanuatu , rendant l’accès à ce savoir traditionnel parfois sensible et difficile .
L’objet se révèle pluridimensionnel S’il existe des dessins iconiques d’animaux, d’insectes ou de plantes, certains sandroing nourrissent des liens étroits avec les mythes, les cosmogonies, l’organisation sociale ou encore les traditions de ces sociétés, regroupées sous
le nom générique de kastom Ils servent aussi de support à des narrations révélant les dimensions éthiques ou politiques des sociétés du centre du Vanuatu. Dans de nombreux cas, chaque dessin porte un nom vernaculaire lié à ces différents aspects. Aujourd’hui, dans ces sociétés, cette pratique est reconnue comme un art graphique traditionnel comportant une dimension mnémotechnique impliquée dans la remémoration de connaissances rituelles, mythologiques et environnementales. Néanmoins, les mots de Jief Todali, un chef coutumier que j’ai côtoyé dans la région Raga, dans le nord de Pentecôte, sont éclairants pour comprendre quelle place occupe cette activité pour la population locale, les Raga Selon lui, les dessinateurs ne sont que les porte-parole : « Avant l’arrivée des tuturani (les étrangers blancs), les gens du nord de Pentecôte ne savaient pas parler Ils s’exprimaient à l’aide de dessins qu’ils traçaient sur le sol avec leurs doigts À la place des gens, les rochers, les pierres, le sol des collines et des vallées, le vent, la pluie, l’eau de la mer parlaient. Mais maintenant la situation est inversée, ce sont les gens qui parlent et la terre, le vent, la pluie et la mer se sont tus. Maintenant les gens Sia Raga disent parfois : “Nous devons parler pour la terre, car elle ne peut plus parler pour elle-même ” »
Ajoutons enfin que cet art éphémère – le dessin est effacé une fois terminé – stimule la narration. Les praticiens accompagnent généralement leurs dessins par le récit d’un mythe ou d’un conte, les plus doués étant capables de le faire tout en dessinant Il n’est pas rare qu’ils fassent alors appel à l’imagination des spectateurs, suggérant au sein du dessin des détails en lien avec leur histoire : des lieux, des personnages, des animaux, des légumes…
Il existe différents niveaux de pratique. Certaines personnes ne pratiquent pas du tout, d’autres connaissent quelques dessins plutôt simples, tandis que des « experts » – désignés comme tels par le reste des membres de chaque société – disposent d’un impressionnant répertoire (jusqu’à quatre cents dessins de l’aveu de certains). Si les premières ethnographies mentionnaient que cet art était réservé aux hommes, il semble que ce ne soit plus le cas de nos jours. Plusieurs femmes que j’ai rencontrées avaient un haut niveau d’expertise
Du débutant à l’expert, tous respectent un ensemble de « règles » Les sociétés du Vanuatu étant de tradition orale, il n’en existe aucune trace écrite, mais durant mon enquête de terrain j’ai établi une liste de principes suivis dans la majorité des cas Les dessins commencent tous par le tracé d’une grille qui constituera
Ce dessin a été réalisé en 2018 par Donia sur une plage du village de Naoné, dans le nord de l’île Maewo. Nommé Mat, il fait référence à la technique de tressage de nattes. Les nattes ont une grande importance rituelle et symbolique au Vanuatu. L’île Pentecôte est par exemple connue pour ses « nattes rouges », dont la technique de coloration les rend uniques dans l’archipel.

leur support et qui définit un ensemble de nœuds et d’arêtes (voir l’encadré page 28) Sept règles indiquent ensuite les mouvements autorisés : aller de nœud en nœud sans repasser par le même chemin, ne pas couper la grille autrement qu’en ses nœuds, revenir au point de départ sans lever le doigt… Tout cela s’apparentait étrangement à des mathématiques, mais quel était le lien exact entre ces deux pratiques ? Je n’étais pas le premier à me poser cette question. Mon sujet de thèse s’inscrit en fait dans la continuité des travaux menés par la mathématicienne américaine Marcia Ascher, une des pionnières de l’ethnomathématique
Depuis une quarantaine d’années, ce champ disciplinaire s’est structuré et institutionnalisé autour d’une communauté d’anthropologues et de mathématiciens qui questionnent les variations culturelles des concepts et savoirs mathématiques, notamment ceux élaborés en dehors du champ académique Auparavant, il était tenu pour acquis – notamment en raison de la prégnance des théories évolutionnistes en anthropologie – que le recours à l’écriture était une condition nécessaire à la pratique des mathématiques. Le plus souvent , les chercheurs n’avaient donc évalué les savoirs mathématiques développés dans les différentes sociétés du monde qu’à l’aune des sources textuelles qu’elles avaient produites. Ce faisant, ils avaient réduit ceux des sociétés dites « de tradition orale » aux pratiques de numération et aux aspects géométriques et procéduraux impliqués dans la création de divers artéfacts (tissage, vannerie, ornementation…). Certaines activités, que des ethnographes avaient pourtant documentées, s’étaient ainsi retrouvées négligées pendant fort longtemps
3 FORMULES AU CHOIX
Le magazine papier 12 numéros par an
Le magazine en version numérique 12 numéros par an
Le hors-série papier 4 numéros par an
Le hors-série en version numérique 4 numéros par an
Accès à pourlascience.fr actus, dossiers, archives depuis 1996
VOTRE
Commandez plus simplement ! Pour découvrir toutes nos o res d’abonnement et e ectuer un paiement en ligne, scannez le QR code ci-contre
4,90 € PAR MOIS
6,50 € PAR MOIS
30 % de réduction * 36 % de réduction *
8,20 € PAR MOIS
46 % de réduction *
À renvoyer accompagné de votre règlement à : Abonn’escient – TBS Group – Service abonnement Groupe Pour la Science 20 rue Rouget de Lisle - 92130 Issy les Moulineaux Courriel : serviceclients@groupepourlascience.fr


Je choisis ma formule (merci de cocher)
FORMULE
PAPIER
• 12 n° du magazine papier
FORMULE
PAPIER + HORS SÉRIE
• 12 n° du magazine papier
• 4 n° des hors-séries papier
1 2 3
Nom :
FORMULE
INTÉGRALE
• 12 n° du magazine (papier et numérique)
• 4 n° des hors-séries (papier et numérique)
• Accès illimité aux contenus en ligne
Mes coordonnées Mandat de prélèvement SEPA
Prénom :
Adresse :
Code postal Ville :
Tél. :
Courriel : (indispensable pour la formule intégrale)
J'accepte de recevoir les o res de Pour la Science ☐ OUI ☐ NON
* Réduction par rapport au prix de vente en kiosque et l’accès aux archives numériques. Délai de livraison : dans le mois suivant l’enregistrement de votre règlement. O re valable jusqu’au 31/03/2024 en France métropolitaine uniquement. Pour un abonnement à l’étranger, merci de consulter notre site boutique.groupepourlascience.fr. Photos non contractuelles. Vous pouvez acheter séparément les numéros de Pour la Science pour 7 € et les hors-séries pour 9,90 €. En souscrivant à cette o re, vous acceptez nos conditions générales de vente disponibles à l’adresse suivante : https://rebrand.ly/CGV-PLS.
Les informations que nous collectons dans ce bulletin d’abonnement nous aident à personnaliser et à améliorer les services que nous vous proposons. Nous les utiliserons pour gérer votre accès à l’intégralité de nos services, traiter vos commandes et paiements, et vous faire part notamment par newsletters de nos o res commerciales moyennant le respect de vos choix en la matière. Le responsable du traitement est la société Pour la Science. Vos données personnelles ne seront pas conservées au-delà de la durée nécessaire à la finalité de leur traitement. Pour la Science ne commercialise ni ne loue vos données à caractère personnel à des tiers. Les données collectées sont exclusivement destinées à Pour la Science Nous vous invitons à prendre connaissance de notre charte de protection des données personnelles à l’adresse suivante : https://rebrand.ly/charte-donnees-pls. Conformément à la réglementation applicable (et notamment au Règlement 2016/679/UE dit « RGPD ») vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’e acement, à la portabilité et à la limitation de vos données personnelles. Pour exercer ces droits (ou nous poser toute question concernant le traitement de vos données personnelles), vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse protection-donnees@pourlascience.fr.
En signant ce mandat SEPA, j’autorise Pour la Science à transmettre des instructions à ma banque pour le prélèvement de mon abonnement dès réception de mon bulletin. Je bénéficie d’un droit de rétractation dans la limite de 8 semaines suivant le premier prélèvement. Plus d’informations auprès de mon établissement bancaire.
TYPE DE PAIEMENT : RÉCURRENT



Titulaire du compte
Nom : Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :
Désignation du compte à débiter
BIC (Identification internationale de la banque) :
IBAN : (Numéro d’identification international du compte bancaire)

Établissement teneur du compte
Nom :
Adresse :
Code postal : Ville :
Date
EMMANUEL FARGE est directeur de recherche Inserm à l’institut Curie, à Paris, où il est responsable de l’équipe Mécanique et génétique du développement embryonnaire et tumoral, au sein de l’unité mixte 168 du CNRS.

Depuis quelques années, on s’aperçoit qu’il est impossible d’appréhender le vivant sans prendre en compte ses propriétés physiques, les processus biochimiques en jeu, et leurs interactions.
Vous êtes physicien de formation et, depuis de nombreuses années, vous vous intéressez aux interactions de la biologie et de la physique durant le développement embryonnaire et la tumorigenèse. D’où est venu votre intérêt pour ce sujet ?
Cela s’est fait un peu par hasard Durant ma thèse, au début des années 1990, j’étais dans un laboratoire de l’Institut de biologie physicochimique, à Paris , où les chercheurs étudiaient une « pompe à phospholipide » appelée « flippase ». La membrane des cellules vivantes est constituée de deux couches de lipides couplées et la flippase pompe les lipides
de la couche externe vers la couche interne À l’époque , on ne connaissait pas la fonction physiologique de ce pompage et j’explorais la réponse physique de la membrane à la différence de surface induite par cette activité biochimique de pompage. La membrane est très facilement déformable, ses propriétés d’élasticité relèvent de la physique de la matière molle Par conséquent, le pompage la courbe nécessairement vers l’intérieur de la cellule.
J’examinais donc si la flippase était une force motrice de l’endocytose, le processus d’invagination de la membrane par lequel les cellules ingèrent des substances extérieures
J’avais commencé par travailler sur des systèmes mimétiques, des liposomes, puis, à l’institut Pasteur, sur des cellules vivantes en stimulant l’activité de la flippase, ce qui avait en effet stimulé l’endocytose J’ai donc eu rapidement confiance dans l’idée que le couplage biochimique - biomécanique engendrait des processus physiologiques importants pour la cellule C’est alors que j’ai appris l’existence de groupes, comme celui d’Eric Wieschaus à l’université Princeton, aux États-Unis, qui étudiaient le contrôle génétique de la morphogenèse biomécanique chez la drosophile Ces groupes étudiaient des mutants qui ne développaient
pas certains mouvements morphogénétiques et leur influence sur la forme de l’embryon. Je me suis alors demandé si l’inverse existait aussi
l’influence des déformations mécaniques de l’embryon sur l’expression des gènes –, et je me suis lancé.
Étiez-vous le premier à vous intéresser au rôle de la mécanique dans le contrôle des processus biologiques ?
Il y avait déjà eu des expériences , par exemple en cancérologie (dans le laboratoire de Mina Bissell, aux États-Unis), qui avaient montré que les cellules tumorales étaient plus rigides que les cellules saines en réponse à la rigidité de leur substrat – due à la fibrose qui se développe avec la tumeur –, ce qui stimulait leurs propriétés d’invasivité tumorale D’autres expériences sur les cellules endothéliales qui forment les parois des vaisseaux sanguins avaient aussi révélé qu’en réponse à des flux sanguins trop importants, les jonctions entre les cellules se renforçaient. Mais les e ff ets observés des stimulations mécaniques étaient plutôt de nature physique (renforcement de la structure, de la rigidité, motilité des cellules…). On ne trouvait pas d’expérience démontrant un contrôle mécanique de la différenciation des cellules, c’est-à-dire de leur destin, y compris dans le cadre du développement embryonnaire, le stade par excellence où les cellules se spécifient , certaines devenant par exemple l’endoderme – le tube gastrique primitif de
l’embryon –, d’autres l’ectoderme, qui donnera l’épiderme et le système nerveux.
Ne réfléchissait-on pas déjà de longue date à l’effet possible de la forme sur la biologie ?
Au début du XXe siècle, notamment, le biologiste écossais D’Arcy Thompson défendait l’idée que la physique et la mécanique intervenaient dans la structuration des organismes vivants…
Il y avait en effet une longue tradition d’approches physiques et mathématiques en embryologie, qui s’attachait à comprendre le développement des formes des organismes et en particulier de l’embryon. Ces approches ont été majoritaires tant que le seul observable en embryogenèse était la morphologie , avant l’avènement de la biologie moléculaire et de la génétique On voyait bien que différents organes possédaient différents types de formes liées à leurs fonctions Jusqu’à la fin du XXe siècle, des chercheurs ont ainsi essayé de comprendre le développement et l’évolution des formes soit via l’hydrodynamique – la mécanique newtonienne de l’écoulement des fluides –, soit via des démarches plus mathématiques comme celle de D’Arcy Thompson, qui recherchait si des transformations mathématiques simples suffisaient pour décrire les différences de morphologie entre deux espèces parentes Mais ces chercheurs ne pouvaient pas, évidemment, penser la différenciation cellulaire puisqu’à l’époque on ne connaissait pas l’existence des gènes.
Cette approche a disparu avec l’avènement de la biologie moléculaire ?
En fait, après la découverte du génome, dans les années 1950, et des gènes du développement, l’intérêt s’est focalisé sur le rôle de la morphogenèse biochimique dans le développement embryonnaire, c’est-à-dire sur le fait que certains tissus sont le produit de cellules qui ne sont pas différenciées de la même façon que les autres Pendant quarante ans, de façon naturelle, l’effort s’est majoritairement porté sur les aspects biochimiques du développement. Et finalement, les approches physicomathématique et biochimique ont avancé chacune de leur côté.
Les travaux de nature physique n’ont pas pris en compte l’existence du génome ?
Pas tous au début, semble-t-il. Cela faisait 2 400 ans (depuis les travaux d’Aristote) que l’observable était plutôt de nature physique, il était alors naturel que les recherches s’attachant à comprendre le développement de la morphologie biomécanique des structures multicellulaires du vivant à l’aide de la physique seule se poursuivent Les premiers couplages avec la génétique sont venus justement au début des années 1990 d’équipes qui se sont intéressées au contrôle génétique du développement des
forces induisant la morphogenèse biomécanique au cours de l’embryogenèse. L’un des premiers groupes qui a travaillé sur ce sujet est celui de Dan Kiehart , alors à l’université Harvard . En 1991, il a montré que durant le développement embryonnaire de la drosophile, un moteur moléculaire – une myosine – se concentre et se stabilise sur la surface apicale des cellules (vers l’extérieur de l’embryon) au pôle postérieur de l’embryon. Quand la myosine est stabilisée, une contraction se produit sous l’action de ce moteur, qui déclenche l’invagination et la formation du tube gastrique

À peu près au même moment , l’équipe d’Eric Wieschaus et d’autres identifiaient les gènes responsables de ces mouvements morphogénétiques C’est ainsi que quelques groupes de généticiens ont commencé à étudier le contrôle génétique du développement des formes physiques de l’embryon, et donc le contrôle de la morphogenèse biomécanique par des processus biochimiques Et c’est alors, à ma connaissance, que sont apparues les premières recherches ayant mené à coupler processus biomécaniques et biochimiques dans le développement embryonnaire
Mais le regard ne se portait alors que sur l’influence du génome sur la morphologie… Oui, mais c’est allé assez vite finalement puisque j’ai appris l’existence de ces recherches en 1996. C’est à ce moment-là que m’est venue l’idée de poser la question inverse. Il me paraissait naturel qu’il y ait un contrôle biomécanique de l’expression des gènes du développement embryonnaire, ne serait-ce que pour une question de « contrôle qualité ». Dans une vision alors encore très centrée sur le génome, vu comme l’organisateur du développement embryonnaire, il paraissait difficile d’imaginer qu’il ne soit pas en mesure de contrôler l’état d’élaboration de la forme qu’il « a la charge » de produire Si le produit est une différenciation biochimique, c’est assez direct, parce que le profil biochimique d’expression des gènes d’une étape donnée induit la différenciation de l’étape suivante via des signaux biochimiques : le profil d’expression des gènes change, ce qui informe le système sur l’étape du développement Mais si le produit est morphologique – mécanique –, comment cela fonctionne-t-il ? L’hypothèse la plus simple était que le génome détecte le champ de contraintes mécaniques lié à la morphologie qu’il façonne
Chez la drosophile, lors de la gastrulation – une déformation de l’embryon qui conduit à la différenciation de ses cellules en trois feuillets, le mésoderme, l’endoderme et l’ectoderme –, le gène snail contrôle des pulsations cellulaires qui induisent la contraction de l’embryon en stabilisant un moteur, la myosine-II, sur la surface externe des cellules, ce qui conduit à l’invagination de l’embryon et à la spécification
du mésoderme, caractérisée par l’expression du gène twist (à gauche) Quand on mute le gène snail, on bloque la gastrulation (au centre), mais si on stimule mécaniquement l’embryon muté pour remplacer les pulsations manquantes dans le mutant de snail par une simple déformation mécanique, on rétablit l’induction de la stabilisation de la myosine et l’expression de twist (à droite).
Et pour qu’il y ait un retour efficace, le plus simple était que certains gènes du développement embryonnaire soient mécanosensibles D’où l’hypothèse que j’ai été amené à formuler.
Comment cette hypothèse de gène mécanosensible a-t-elle été accueillie ?
D’abord, il a fallu la tester. On a commencé par des choses simples : déformer un embryon de drosophile suivant un axe, à l’aide d’un petit montage piézoélectrique, avant qu’il ne développe ses propres mouvements morphogénétiques et regarder si les cellules changeaient de destin. Pouvait-on induire une différenciation cellulaire en réponse à ces déformations ? La réponse a été « oui » : les cellules dorsales se sont mises à exprimer les gènes qui les transforment en cellules ventrales Les embryons n’avaient plus de polarité dorsoventrale. On obtenait un ventre tout autour de l’embryon, juste en le déformant ! On a appelé ce mécanisme « induction mécanique de la différenciation » C’est un processus de « reprogrammation génétique » mécaniquement induit Une grande partie des biologistes du développement ont bien reçu ces travaux, car cela ouvrait une nouvelle voie dans la compréhension des processus de développement embryonnaire Depuis, d’autres expériences, menées sur d’autres types d’embryons et d’autres systèmes, sont venues corroborer cette hypothèse. Récemment encore, en 2019, Ardon Shorr et ses collègues, à l’université Carnegie Mellon, aux États-Unis, ont obtenu le résultat que nous avions observé sur l’embryon de drosophile en déformant cette fois des centaines d’embryons par circulation dans des tuyaux dont ils contrôlaient le diamètre.
Mais c’est une chose de voir qu’on peut influer mécaniquement sur l’expression de gènes du développement embryonnaire, c’en est une autre de savoir si le système se développe en utilisant cette propriété . C’est ce qu’on a fait en bloquant la compression de certaines cellules de l’embryon de drosophile par ablation de tissus bien choisis et en rétablissant cette compression à l’aide de particules magnétiques On a montré qu’effectivement, dans certains domaines de l’embryon, les contraintes mécaniques internes de l’embryogenèse induisent l’expression massive d’un gène impliqué dans la différenciation cellulaire, twist Sans l’activation mécanique de son expression, le tube gastrique antérieur se forme, mais ses cellules ne sont pas différenciées. La moitié du tube est alors incapable de digérer, et la larve meurt de ne pas pouvoir se nourrir, signe que ce mécanisme est fonctionnel et vital
Donc, aujourd’hui, cette induction mécanique de la différenciation est intégrée dans la compréhension des processus de morphogenèse dans le monde vivant ?
?
En 2022, l’équipe d’Emmanuel Farge a montré qu’un choanoflagellé, un organisme proche des métazoaires (les animaux pluricellulaires) formé d’une colonie de cellules, inverse activement sa courbure sous l’effet de la houle, selon un processus qui implique l’activation du moteur myosine II, comme la gastrulation de l’anémone étoilée et celle de l’embryon de drosophile, déclenchée par une contrainte mécanique interne (voir la figure page 45). Ses travaux et les similitudes observées chez le poisson-zèbre et l’éponge suggèrent que la houle serait à l’origine de la gastrulation chez l’ancêtre de tous les métazoaires.

Oui , d’autant plus que maintenant on connaît le processus moléculaire à l’œuvre : le capteur – la β-caténine, une protéine des jonctions entre les cellules – et le mécanisme qui conduit de la contrainte mécanique à la différenciation cellulaire. Et d’autres équipes ont trouvé, par exemple, que ce mécanisme est impliqué dans la différenciation menant à la formation des follicules qui donneront les plumes dans l’embryon de poulet. Un mécanisme similaire faisant intervenir d’autres molécules mécanosensibles interviendrait aussi lors de la toute première différenciation cellulaire à l’origine du développement de la souris.
L’a-t-on observé chez d’autres espèces encore ?
Oui, et même très éloignées dans l’arbre du vivant. On s’est en effet aperçu que chez le poisson-zèbre comme chez la drosophile, les tout premiers mouvements morphogénétiques de l’embryogenèse induisent la différenciation du mésoderme, le premier tube à se former dans l’embryon et qui donnera les organes internes hormis le tube gastrique. Dans les deux cas, les
gènes activés diffèrent mais ont la même fonction de différenciation du mésoderme, et le mécanisme est le même, ainsi que le capteur mécanosensible, toujours la β-caténine On s’est donc demandé si un site de cette protéine crucial pour le mécanisme (une tyrosine qui devient accessible et activable quand la protéine se déforme) était conservé chez tous les métazoaires, c’est-à-dire non seulement les vertébrés (dont le poisson-zèbre) et les arthropodes (dont la drosophile), ou plus généralement les bilatériens (animaux présentant une symétrie bilatérale), mais aussi les cnidaires comme l’anémone de mer, ou même les éponges. Nous l’avons trouvé présent dans tous les animaux testés ! Cela ouvrait la possibilité que l’induction mécanique dépendante de la β-caténine qui conduit à la spécification des premiers feuillets embryonnaires soit partagée par les embryons d’un très grand nombre d’espèces ayant divergé d’un ancêtre commun il y a très longtemps, peut-être le premier métazoaire.
Est-ce
On l’a fait chez Nematostella, une anémone de mer constituée, pour simplifier, d’un tube digestif avec quelques systèmes protomusculaires qui lui permettent de se mouvoir et de capturer ses proies On a stimulé les embryons avec des flux hydrodynamiques marins – son environnement naturel Cela a suffi pour déclencher l’invagination du premier tube
BIBLIOGRAPHIE
N. M. Nguyen et al., Mechano-biochemical marine stimulation of inversion, gastrulation, and endomesoderm specification in multicellular Eukaryota, Frontiers in Cell and Developmental Biology, 2022.
P.-A. Pouille et al., Mechanical signals trigger myosin II redistribution and mesoderm invagination in Drosophila embryos, Sci. Signal., 2009.
N. Desprat et al., Tissue deformation modulates twist expression to determine anterior midgut di erentiation in Drosophila embryos, Developmental Cell, 2008.
embryonnaire de cet animal (l’endomésoderme) et sa différenciation à un stade où, normalement, elle ne se produit pas Et ce mécanisme est dépendant de ce même processus impliquant la β - caténine ! Donc l’ancêtre commun de Nematostella, du poisson-zèbre et de la drosophile, qui vivait il y a 600 à 700 millions d’années, présentait probablement déjà ce mécanisme. Le fait qu’il soit lié à la conservation d’une même tyrosine dans toutes les espèces suggère que ce mécanisme existe depuis l’ancêtre commun de toutes les espèces animales, y compris les éponges Mais il faudrait un laboratoire en bord de mer pour tester cette hypothèse sur ces dernières, car elles se cultivent difficilement
Ce mécanisme existe-t-il aussi chez l’humain ?
Oui, l’équipe de Valérie Weaver, à l’université de Californie à San Francisco, a réussi à stimuler mécaniquement la différenciation de cellules embryonnaires humaines en mésoderme par exactement le même mécanisme dépendant de la β - caténine . On le retrouve aussi dans la progression tumorale Notre équipe a montré que les pressions de croissance tumorale induisent l’activation de la voie β - caténine selon exactement le même processus dans les cellules saines comprimées avoisinant les tumeurs , participant à leur reprogrammation tumorale Celle de Valérie Weaver a trouvé les mêmes processus activés en réponse à la rigidité fibrotique tumorale
Finalement, le couplage biomécanique est partout, peut-être même à l’échelle cellulaire ?
Il est probablement présent dans de nombreux cas. Si on regarde toutes les protéines associées à des structures déformables dans une cellule – elles sont nombreuses –, elles ont toutes des sites actifs susceptibles d’être cachés par une conformation et ouverts par des déformations, et donc d’être activés mécaniquement Une fois que l’on a compris cela , la question devient plutôt : comment le système fait pour filtrer les signaux mécaniques fonctionnels ? Comment les systèmes ont évolué pour garder certaines voies mécanosensibles fonctionnelles, par exemple au cours du développement embryonnaire, et pour se protéger des déformations hasardeuses appliquées à d’autres voies ?

Donc oui, aujourd’hui, il est difficile de penser l’aspect physique sans penser l’aspect génétique du vivant et inversement. Les deux sont très fortement intriqués La matière biologique est à la fois physique – déformable – et, à travers les mêmes objets, active et réactive biochimiquement. De fait, il est probable que l’on ne puisse pas, dans de nombreux cas, échapper à ce couplage. n
Propos recueillis par Marie-Neige Cordonnier
Licence 1
Niveau Suivi
Licence 1 à Master 1


Formation en présentiel ou à distance Cours magistraux filmés et retransmis en direct ou en différé
Objectifs
Formation en ligne
Tutorat personnel et individualisé Cours thématiques avec de nombreux exercices
Acquérir un panorama des connaissances actuelles en astronomie et astrophysique auprès d’astronomes professionnel·le·s



Acquérir des bases solides en astrophysique à travers les parcours thématiques proposés

Se spécialiser grâce aux exercices suivis et corrigés à distance par un·e astronome professionnel·le
Contenu


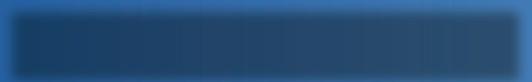
Cours et TD (Mécanique Céleste, Ondes et Instruments, Soleil, Cosmologie, Galaxies etc.)






Stage pratique d’une semaine à l’Observatoire de Meudon (optionnel et sous conditions)
Stage d’observation à l’Observatoire de Haute Provence (optionnel et sous conditions)
Des parcours thématiques adaptés à tous :

• Des étoiles aux planètes (L1-L2)

• Cosmologie et Galaxies (L2)









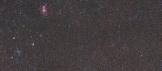

• Mécanique céleste (L3)
• Sciences planétaires (L3)

• Fondamentaux pour l’astrophysique (L3)
• Fenêtres sur L’Univers (M1)
• Instrumentation (M1)
Plusieurs centaines d’exercices corrigés individuellement
Pages Web
http://ufe.obspm.fr/DU/DU-en-presentiel/ DU-Explorer-et-Comprendre-l-Univers/ contact.duecu@obspm.fr




Contact
http://ufe.obspm.fr/Formations-en-ligne/ LUMIERES-SUR-L-UNIVERS/ contact.dulu@obspm.fr
Date limite d’inscription 3 septembre 2023
https://espacecandidature.psl.eu

Ce texte est une adaptation de l’article Living with leopards, publié par Scientific American en avril 2023.

Réapprendre à cohabiter avec les fauves : tel est le défi que la population indienne tente de relever pour préserver ses grands carnivores.
> Panthera pardus fusca, le léopard indien, vit au sein de nombreuses régions indiennes densément peuplées.
> Pour réduire les conflits avec les humains, la Fonction publique forestière indienne déporte des panthères dans les réserves naturelles, ce qui
les stresse et multiplie les accidents.
> L’étude du comportement des léopards montre que là où les habitants acceptent traditionnellement leur présence et savent se comporter avec eux, les conflits sont rarissimes.
Où vivent les animaux sauvages ? Notre réponse à cette question dépend de la culture dont nous sommes issus, de l’éducation que nous avons reçue et de ce que nous voyons sur les écrans La réponse de l’éthologue que je suis est plutôt conditionnée par un certain conflit entre ma formation scientifique et mes constatations de terrain. Quand, dans les années 1990, j’ai commencé ma carrière en étudiant le lion d’Asie et la panthère nébuleuse dans des réserves naturelles indiennes, je prenais encore très à cœur le principe de base de la biologie de la conservation : les animaux sauvages dans la nature sauvage ! Et cela s’appliquait d’abord aux grands carnivores… Puis dans les années 2000, j’ai été confrontée à une réalité : Panthera pardus fusca, c’est-à-dire le léopard indien, vit au voisinage, voire à l’intérieur même, de certaines agglomérations urbaines « Il ne devrait pas ! », a protesté l’éthologue en moi, mais il y vivait bien, franchissant les clôtures des réserves aussi nonchalamment que les murs mentaux érigés par les scientifiques entre la nature et l’humanité Voyons par exemple le cas de la première panthère – léopards et panthères sont une seule et même espèce ! – que j’ai équipé d’une balise GPS. Il s’agissait d’un grand mâle, qui, au cours de l’été 2009, était tombé dans un puits proche de Junnar, une ville située en arrière de Bombay, dans le Maharashtra, l’un des vingt-huit États indiens. Pour lui faire quitter le rebord dominant l’eau, où il s’était réfugié, les gardes forestiers installèrent une cage-piège au sommet d’une échelle , qu’ils descendirent dans le puits Manifestement fatigué par la chaleur de la journée, le vieux léopard resta imperturbable, même une fois en cage. Notre équipe était composée du vétérinaire Karabi Deka, d’Ashok Ghule, un agriculteur me servant de traducteur et de guide dans la région, et de moi-même, alors doctorante. Nous vérifiâmes d’abord que le vieil animal n’était pas blessé, puis nous l’anesthésiâmes
Il ne grogna même pas quand il reçut la fléchette Son calme et sa douceur nous incitèrent à le nommer Ajoba, ce qui en marathi, la langue officielle du Maharashtra parlée par 72 millions de locuteurs, signifie « grand-père »
Le soir même, à quelque 50 kilomètres de là, nous avons relâché Ajoba dans une forêt, avant, dans les semaines suivantes, d’observer ses étonnants déplacements grâce aux positions envoyées de proche en proche par son collier. Ajoba nous inquiéta, car, quittant la forêt que nous avions choisie pour lui servir de refuge, il franchit successivement des étendues agricoles, une réserve naturelle, la forêt d’usines fumantes d’une zone industrielle , une autoroute à quatre voies et une gare ferroviaire intensément fréquentée… Ayant parcouru 125 kilomètres en un mois, il s’installa à la lisière de la jungle du parc national Sanjay Gandhi , qui jouxte cette agglomération de plus de 20 millions d’habitants qu’est Bombay !
Traditionnellement , l’IFS – l’Indian Forest Service , c’est - à - dire la Fonction publique forestière indienne – gère la peur des panthères en capturant les félins découverts dans des zones habitées pour les relâcher en forêt. Et voilà que nous découvrions que la première chose que faisait le vieil Ajoba , sans doute tombé dans un puits du côté de Junnar parce que l’IFS avait cherché à l’éloigner des banlieues de Bombay, était de rentrer à la maison !
Nous autres , humains , pensons être les seuls à agir de notre propre chef. Toutefois, comme les dizaines de millions d’Indiens ruraux qui subissent actuellement la transformation de leurs forêts et de leurs champs en mines , usines , barrages et autres autoroutes, les animaux sauvages s’adaptent pour survivre dans ce monde de plus en plus difficile La biologie des grands félins implique qu’ils doivent être capables de franchir des dizaines, voire des centaines, de kilomètres pour trouver un partenaire et avoir des petits ; sans cette dispersion, la consanguinité serait rampante et l’extinction de leurs espèces imminente C’est bien parce que les grands chats indiens ne se laissent pas confiner aux 5 % de la surface du pays ayant le statut de réserves naturelles que l’Inde continue d’abriter, en plus de ses 1,4 milliard d’habitants , 23 % des espèces de carnivores de la planète,

dont la moitié de ses tigres, la seule population survivante de lions d’Asie , et près de 13 000 léopards…
Toutefois, la survie de ces grands carnivores implique qu’ils ne causent pas de dégâts susceptibles d’inciter les humains à se venger Dans le monde entier, la principale menace pesant sur les grands félins est l’homme (lire l’encadré page 65). En Inde, les braconniers à la recherche de peaux, de griffes ou d’os, qui font l’objet d’un trafic illicite, ou encore les paysans furieux d’avoir perdu du bétail, ont, selon les chiffres de la Société indienne de protection de la faune , tué entre 1994 et 2021 près de 5 200 panthères. Pour autant , la façon dont beaucoup de ruraux indiens considèrent les animaux sauvages rend possible la survie de milliers d’entre elles, même dans des zones où vivent 400 habitants par kilomètre carré. L’observation de ces fauves m’a convaincue : pour que les grands carnivores aient une chance de survie à l’avenir, il faut changer notre façon de les percevoir. Voici donc l’histoire commune de deux espèces hautement capables d’adaptation, et partageant le même espace. En ces temps sombres pour la vie sauvage, il s’agit d’une histoire pleine d’espoir, dans laquelle l’image des
redoutables grands félins assoiffés de sang est remplacée par celle d’animaux sauvages qui, comme les humains, tentent de survivre, d’élever leurs petits et de vivre dans leur propre société, une société qui s’entremêle à la nôtre
Petite fille, j’ai découvert l’histoire du dieu hindou Ayyappa. C’est depuis ce temps-là que les grands félins me fascinent Quand il était enfant, Ayyappa reçut l’ordre d’aller chercher du lait de tigresse Il y parvint, et revint à califourchon sur le dos de l’animal. Les images de mon livre étaient pacifiques, pleines d’empathie et de compréhension, et elles sont restées imprimées dans ma tête En 2001, après un master en écologie et en biologie évolutive, je me suis retrouvée dans le canton de Junnar, une zone rurale couverte de champs de canne à sucre Mère d’un enfant en bas âge, j’y avais suivi mon mari, physicien au Radiotélescope géant à ondes métriques , et je prévoyais de consacrer mon temps à ma fille. Toutefois, des reportages faisant état d’un grand nombre d’attaques de léopards dans la région m’intriguèrent : entre 2001 et 2003, près de Junnar, pas moins de 44 personnes furent attaquées
Bombay, une agglomération de plus de 20 millions d’habitants, borde le parc national Sanjay Gandhi et d’autres zones naturelles qui abritent une cinquantaine de léopards.

Si certaines de ces attaques étaient peut-être accidentelles, d’autres étaient clairement préméditées, comme celles de ces nuits chaudes pendant lesquelles une panthère vint saisir un petit enfant dormant dehors entre ses parents, le tuant si vite et si silencieusement qu’aucun des deux adultes ne se réveilla…
Cela n’avait aucun sens ! Comment autant de panthères pouvaient-elles vivre dans ce paysage agricole sans herbivores et autres proies sauvages ? Pourquoi étaient-elles si agressives ?
L’administration forestière du Maharashtra ne cessait d’en capturer dans les zones rurales de l’État et de les relâcher en forêt : intelligents, les léopards sont néanmoins des chats, de sorte qu’ils tendent à se laisser prendre dans les cages-pièges Dans la littérature scientifique, je n’ai trouvé aucun article sur la préservation de grands carnivores en dehors de réserves naturelles. Après m’être procuré une petite subvention, j’ai monté une équipe capable d’installer à leur encolure des puces électroniques non émettrices, mais identifiables à l’aide d’un lecteur portatif. J’ai alors commencé à noter où chaque léopard était capturé et pourquoi, et vite compris que si on les déplaçait dans les jungles, ce n’était pas parce qu’ils avaient attaqué quelqu’un, mais seulement parce qu’on les avait aperçus près d’un village

En 1972, le gouvernement indien a promulgué une loi – le Wild life (protection) act, c’està - dire la « Loi sur la protection de la vie sauvage » – selon laquelle il est interdit de chasser les espèces en danger, même si l’élimination occasionnelle d’un tigre ou d’un léopard « mangeur d’hommes » peut être accordée. Depuis les années 1980, l’IFS, qui a la responsabilité de gérer les gros animaux sauvages d’Inde, retranche
systématiquement les panthères errant dans les zones habitées afin de réduire les conflits avec les humains Pour autant, ce qui s’est révélé à Junnar dans les années 2000, c’est que le déplacement de ces superbes félins tachetés augmentait les conflits…
Pendant longtemps, les habitants du canton signalaient quatre attaques par an en moyenne. En réponse, l’administration des forêts lança en février 2001 un vaste programme de transfert, de sorte qu’en une année, les gardes forestiers déplacèrent quarante léopards vers deux réserves situées à des dizaines de kilomètres Les attaques triplèrent alors près des réserves, atteignant une moyenne de quinze par an ; la proportion d’attaques mortelles doubla, atteignant 36 % Elles devinrent aussi plus nombreuses à proximité des sites où l’on relâchait les fauves Une panthère capturée et marquée à Junnar, puis transférée dans une réserve située dans le nord-ouest de l’État du Maharashtra, attaqua plusieurs personnes près du lieu de son relâchement Une fois qu’elle fut recapturée, nous pûmes montrer grâce à la puce que nous lui avions implantée qu’il s’agissait bien du même individu . Même si depuis toujours des léopards vivent dans la région, c’était bien la première fois que les attaques se multipliaient à ce point Panthera pardus est extrêmement furtif, de sorte qu’observer comment une capture suivie d’une remise en liberté en forêt affecte un membre de cette espèce est difficile Ce que nous savons, c’est que le stress amplifie l’agressivité des grands félins On constate par exemple que le déplacement de grands chats de zoo en zoo augmente leurs taux d’hormones de stress Chez les chats, avoir un foyer est un impératif biologique ! Dans les rares zones où les léopards sauvages se montrent occasionnellement , comme au Sri Lanka et en Afrique, leur vie sociale est centrée sur les femelles ; il est logique que la perturbation de ces relations aggrave le stress dû au déplacement Des études menées en Russie sur des tigres équipés de colliers suggèrent qu’ils attaquent surtout après avoir été provoqués ou blessés. En 1988, pour la première fois depuis 1904, des lions d’Asie ont attaqué des humains : l’événement s’est produit après le déplacement de 57 lions, capturés dans des zones habitées, vers le parc national de Gir, la réserve qui leur est consacrée
Les félins que l’on déporte se mettent-ils à considérer les humains comme des menaces ? Quelle qu’en soit la raison, force est de constater que le déplacement de léopards hors de leur milieu habituel, suivi par leur relâchement en terrain inconnu, a eu des conséquences désastreuses pour les paysans qui les ont rencontrés par hasard Au début des années 2000, alors que je parcourais l’État du Maharashtra pour
Leopard (Panthera pardus) Status, Distribution, and the Research Efforts across Its Range, PeerJ, 2016 (statut par sous-espèces) ; Kontur (densité démographique)
L’insaisissable léopard (Panthera pardus) est le plus adaptable des grands félins. Puissant coureur, nageur et grimpeur, il parcourt les forêts tropicales, les zones arides et les champs cultivés d’Afrique et d’Asie du Sud jusqu’à l’extrême-orient gelé de la Russie. Chasseur invétéré, il se nourrit de tout ce qui lui tombe sous la patte : cerfs, singes, bovins, chèvres, chiens, voire rats ou poissons. Trois sous-espèces, les léopards de l’Amour (P. p. orientalis), d’Arabie (P. p. nimr) et de Java (P. p. melas), sont en danger critique d’extinction ; les autres sont en danger ou menacées.
HIMACHAL PRADESH Statut du léopard Présent Présence non prouvée Disparu

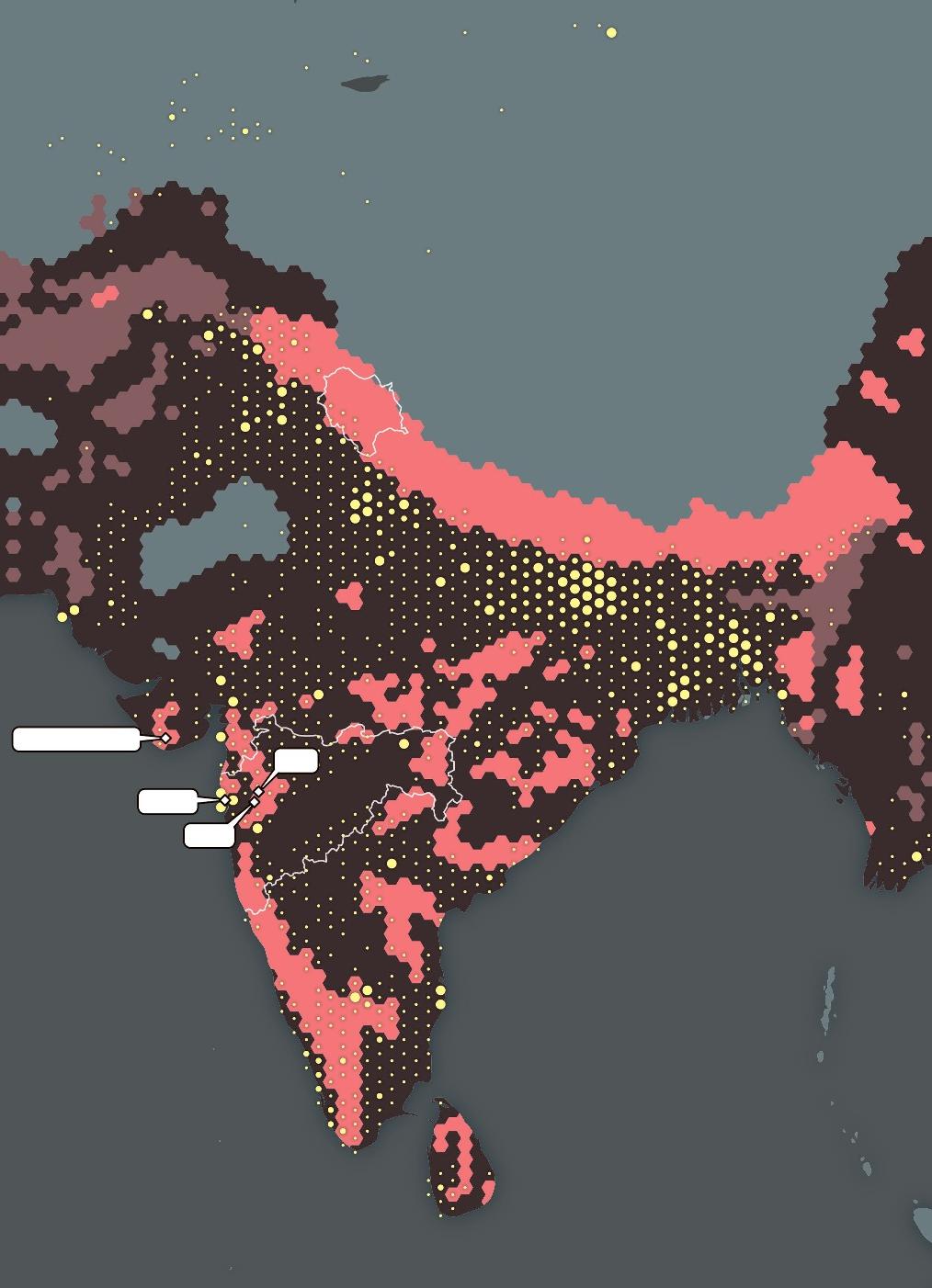
Habitants par kilomètre carré
250-1 000
1 000-1 500
Plus de 1 500
QUAND HUMAINS ET LÉOPARDS SE RENCONTRENT
Le léopard indien (Panthera pardus usca) vit dans des territoires très peuplés, et même aux abords de Mumbai. Le lien immémorial qu’entretiennent les populations rurales et surtout indigènes du sous-continent avec ce grand félin pousse de nombreux paysans à tolérer la perte occasionnelle d’une chèvre ou d’un chien. Les léopards s’attaquent rarement aux humains, et lorsqu’ils le font, l’attaque semble souvent liée à une violence précédemment infligée par ces derniers.
Densité humaine moyenne dans les zones d’habitat des léopards (personnes par kilomètre carré)
Sous-espèce de léopard
Panthera pardus orientalis
P. p. nimr
P. p. melas
P. p. kotiya
P. p. japonesis
P. p. delacouri
P. p. saxicolor
P. p. fusca
P. p. pardus
0 500 1 000
Statut selon la densité humaine Présent Disparu
Les maisons des Warlis sont souvent ornées de peintures traditionnelles de léopards ou d’autres animaux sauvages, illustrant leur tradition de coexistence avec les autres êtres vivants. Pour autant, eux aussi préfèrent ne pas avoir ce genre de visiteur nocturne dans leur maison !

équiper les panthères de puces identificatrices, je fus intriguée par un territoire de collines et de vallées magnifiques situé au nord de Junnar De nombreux léopards y étaient capturés, telle cette femelle piégée avec ses petits au milieu d’un champ de blé. Manifestement, l’espèce Panthera pardus fusca était très représentée dans cette zone très peuplée, mais sans que des attaques ne s’y produisent Naturellement, j’ai voulu comprendre.
Cela faisait alors déjà quatre ans qu’en collaboration avec l’administration des forêts, je travaillais sur les léopards Cette collaboration et mon dossier persuadèrent deux biologistes chevronnés, spécialistes de la faune sauvage
Ullas Karanth, ancien directeur de la Société indienne de préservation de la vie sauvage, et Raman Sukumar, de l’Institut indien des sciences –, de soutenir mon projet de thèse sur l’écologie de Panthera pardus fusca Je commençai mon travail autour de la ville d’Akole. Je n’étais alors même pas sûre qu’il y aurait autour de cette agglomération de 20 000 habitants assez de léopards pour apprendre quelque chose de significatif à l’aide d’outils comme les pièges photographiques Aucun biologiste n’avait jamais signalé la présence d’une panthère dans la région, mais les gardes forestiers m’en apportèrent les preuves : des empreintes fraîches en bord de champ, devant des maisons, voire dans une cour de récréation ; des chiens disparus ou mordus ; ici et là, un cochon mort ; certaines de ces proies hissées dans des arbres, manière typique des léopards de les mettre à l’abri des autres prédateurs. Clairement, j’entamais mes recherches au bon endroit !

Toutefois, quelle idée n’avais-je pas eu de fonder mon étude sur l’usage de pièges photographiques dans une zone où les humains grouillaient ? J’étais alors l’une des dernières biologistes à employer des appareils photos analogiques : leurs pellicules coûtaient cher et se volaient… En outre, la période était difficile pour ma fille de 6 ans, qui protestait chaque fois que je partais pour une semaine à Akole Quoi qu’il en soit, je commençai par présenter mon projet à 200 paysans, que j’interrogeai aussi sur leurs rencontres avec les léopards et leurs pertes de bétail. Ils se montrèrent tout d’abord surpris de voir une éthologue, a fortiori une femme, parcourir leurs champs sur des kilomètres à la recherche de signes du passage de panthères, afin de déterminer où installer des caméras dans les champs de canne. Heureusement, ils s’accoutumèrent vite à ma présence, et m’offrirent souvent petit déjeuner, déjeuner ou thé…
Au début, ce ne fut pas sans peur que je marchais seule dans des champs de canne à sucre et autres cultures de deux mètres de haut, où les grands félins pouvaient se cacher, ou encore dans le lit de rivières à sec bordées d’arbres, où ils aiment à se reposer Il me fallait éviter de
surprendre un léopard, de sorte que j’ai pris l’habitude de parler tout haut même si je marchais seule ; si quelqu’un m’accompagnait, nous bavardions constamment. Mais à force de discuter avec les habitants de la région, ma peur s’est envolée, car ils interagissaient souvent avec les panthères Un jour, dans un café de village, un client m’a raconté en riant comment sa femme, qui jetait de l’eau sale sur le champ situé en contrebas de leur maison , fut terrifiée lorsqu’elle entendit le grognement d’indignation du grand chat qu’elle avait mouillé sans le vouloir ; en dépit de cette vexation, le fauve avait simplement continué son chemin Un paysan m’a aussi raconté comment une nuit, alerté par les beuglements de son bétail, il était sorti en courant de chez lui, pour tomber nez à nez avec le voleur, qui, au lieu de l’attaquer, s’est enfui Une vieille paysanne m’a aussi raconté comment elle a sauvé sa chèvre en la retenant par les pattes de derrière tandis qu’un léopard la tirait par les pattes de devant… Même si elle était seule, le grand chat préféra s’en aller. En été, les gens dormaient habituellement dehors pour profiter de l’air frais de la nuit, et le faisaient sans crainte Les quelques attaques sur des humains dont j’ai entendu parler étaient accidentelles, comme lorsqu’un léopard, en essayant de sauter sur un chien, rentra dans un couple à moto, le faisant tomber dans un champ, avant de s’enfuir. De mémoire d’homme, aucun léopard n’avait tué personne dans les villages entourant Akole.
Il m’a fallu un an pour installer les premiers appareils photos déclenchés par le mouvement dans ma zone d’étude de 179 kilomètres carrés Je les ai positionnés le long des chemins, là où j’avais trouvé des empreintes et des excréments Les premières prises de vue révélèrent des chiens et des villageois, tel ce vieux paysan farceur qui, se mettant à quatre pattes, passait devant la caméra en feulant… Très vite cependant, de vraies panthères apparurent, que nous apprîmes à identifier d’après leur pelage. Dans le même temps, nous construisions des modèles statistiques afin d’évaluer le nombre des animaux non détectés. Les résultats de nos observations étaient fascinants : nous comptions cinq fauves par kilomètre carré, ce qui était considérable Il s’agissait de panthères, mais aussi de hyènes, des carnivores tout aussi gros ! Et tous ces animaux vivaient au milieu d’une campagne agricole où, selon mon décompte, demeuraient pas moins de 357 humains par kilomètre carré… À titre de comparaison, en Namibie, la densité de léopards varie de un à quatre par 100 kilomètres carrés, tandis que la densité humaine moyenne n’est que de trois par kilomètre carré : moins d’un centième de celle d’Akole Dans les terres cultivées entourant les villages vivaient aussi
des chats de jungle (Felis chaus) – des petits félins volant souvent des poules –, sans parler des chacals et des renards Même le très rare chat rubigineux (Prionailurus rubiginosus) ou « chat léopard d’Inde » se reproduisait dans la région
Pour comprendre de quoi se nourrissaient les léopards, des bénévoles et des amis m’ont aidée à ramasser des excréments et à les examiner afin d’y déceler des restes de poils, de griffes et de sabots non digérés. À ma grande surprise, les animaux domestiques constituaient 87 % des proies des grands chats. À eux seuls, les chiens représentaient 39 % de la biomasse consommée, presque quatre fois plus que les chèvres, pourtant sept fois plus nombreuses dans la région
Les éleveurs m’ont confirmé perdre bien moins de cheptel à cause des prédateurs qu’à cause des maladies ou des accidents, ce qui, peut-être, leur rendait plus acceptable la perte occasionnelle d’une tête de bétail Jamais auparavant on n’avait signalé d’aussi fortes densités de grands carnivores dans une région indienne aussi peuplée ! Pour les gardes forestiers, ce n’était guère une surprise, mais la plupart de mes collègues chercheurs refusèrent d’y croire.
Après de telles constatations, équiper certains félins d’un collier émetteur de signaux GPS s’imposait, afin d’y voir plus clair sur cette ahurissante cohabitation entre léopards et humains. Au départ, j’étais réticente, car j’ignorais si le stress induit n’allait pas s’avérer désastreux à la fois pour les panthères et pour les si accueillants villageois d’Akole. Toutefois, le vif intérêt du chef des gardes forestiers m’a incitée à laisser libre cours à ma curiosité scientifique, et ce que nous avons découvert fut spectaculaire
Les signaux radio indiquaient que les félins passaient leurs journées à l’intérieur de petits buissons ou au sein des champs des hautes cannes à sucre, donc à proximité immédiate des gens, qui vaquaient à leurs occupations sans réaliser leur proximité. Ce n’est qu’une fois la nuit venue et la campagne vidée de ses humains que s’ouvrait pour eux un espace sauvage, de leur point de vue, pareil à tout autre Le suivi par GPS nous a montré qu’une fois leur heure arrivée , les léopards rôdaient à la recherche de chèvres et d’animaux, ou, près des décharges, en quête de chiens et de cochons venus fouiller les ordures.
Une femelle et un mâle sur qui nous avions posé des colliers se sont avérés être une mère et son fils subadulte (adolescent). Émis toutes les trois heures, leurs signaux nous ont montré qu’ils se rencontraient parfois, se nourrissaient ensemble de la même carcasse avant de repartir chacun de leur côté Lorsque cette mère léopard eut une nouvelle portée, elle dut s’absenter deux nuits d’affilée pendant lesquelles son adolescent garda les petits : il faisait du baby-sitting !
Un soir, un des bébés léopards tomba dans un puits Les signaux GPS nous révélèrent que sa mère était restée à proximité toute la nuit, avant d’aller se réfugier pendant la journée dans un champ de canne à sucre voisin. Les gardes forestiers secoururent le bébé le lendemain et le relâchèrent près du puits à la nuit tombée. Après une demi-heure la mère revint, et quelques heures plus tard, nous pûmes relever les traces de trois félins avançant ensemble : la mère, son fils subadulte et son bébé s’étaient retrouvés. Dans le paysage agricole d’Akole, les panthères ne font pas que survivre : elles forment aussi des familles Quelque chose m’intriguait dans la façon dont les habitants de la région géraient cette situation Ma formation me poussait à considérer que la juxtaposition de grands carnivores et d’êtres humains ne pouvait que créer des conflits Un jour, au début de mes recherches à Akole, le paysan Ghule kaka – kaka est une formulation de respect signifiant « oncle » – m’emmena rendre visite à une femme dont la chèvre venait d’être tuée par une panthère. Quand je lui demandais quels problèmes elle rencontrait avec ce grand félin, elle s’énerva et m’expliqua avec brusquerie qu’un léopard venait régulièrement par un chemin dans les collines, et passait devant sa maison avant de s’en aller « par là » Plus tard, intriguée par sa réaction, je demandais à Ghule kaka de m’expliquer pourquoi elle était agacée « Vous venez de lui demander quel problème lui pose son dieu, me révéla-t-il Par ici, les gens vénèrent les léopards. » De fait, une statue de Waghoba, la grande divinité féline vénérée dans la région depuis au moins un demi-siècle, se dressait non loin de là Autre cas : cette réaction d’un paysan dont un mouton venait d’être enlevé par un léopard « Le pauvre n’avait plus de proie dans la forêt, commentait-il. Il a donc pris mon mouton, mais Dieu m’en donnera d’autres »
La jeune biologiste quelque peu arrogante que j’avais été était convaincue que l’on ne pouvait résoudre les « conflits » entre les humains


Près de Nairobi, et de ses 4 millions d’habitants, se trouve un parc national, qui, comme celui du parc national Sanjay Gandhi, qui jouxte Bombay, est un peu plus grand que Paris intra-muros. Bordé de la même façon par des bidonvilles, il abrite des lions, des hyènes, des hippopotames… et une population assez dense de léopards. Pour autant, ici, de mémoire d’homme, aucun animal sauvage n’a tué d’humains. D’où vient cette di érence entre Bombay et Nairobi ?
En Afrique, la faune sauvage est pour ainsi dire plus explicite. Les éleveurs maasais qui vivent dans le parc protègent leurs enclos comme ils le peuvent, par exemple à l’aide de lampes flash qui e raient les fauves, mais ne les tuent qu’en dernière extrémité. « C’est ici, dans cette partie de la cage, que nous mettons l’appât – une chèvre en général. C’est là que la panthère ou le lion peut entrer », m’a décrit un jour le caporal Kereto du Kenya Wildlife Service – l’agence gouvernementale qui s’occupe de conserver la nature kenyane. Après m’avoir ainsi expliqué la capture des animaux dangereux, il a posé pour une photo. J’ai souri intérieurement, tant la situation contrastait avec celle de Bombay, où lors de ma dernière visite de son parc, j’avais aussi eu le privilège de voir où on gardait les « léopards errants ». En revanche, pas question de prendre des photos : l’administration des forêts étant accusée de ne pas assurer la sécurité des citoyens, le sujet était trop sensible !
Il est vrai qu’au Kenya, les grands carnivores sont moins attirés par Nairobi, car la frontière sud du parc s’ouvre sur de vastes savanes, où zèbres, antilopes ou gnous migrent de façon saisonnière. Une situation qui contraste avec celle du parc national de Bombay désormais entièrement encerclé par l’étalement urbain. En Inde, les léopards ont pour ainsi dire moins le choix. En outre, le parc national de Nairobi et ses savanes environnantes forment un écosystème dont la préservation représente de forts enjeux économiques et politiques. À lui seul, le commerce des safaris pour touristes correspond à environ 15 % du PIB kényan ! Or cette savane est le domaine des Maasai, une ethnie dont les savoirs en matière de faune sauvage sont mondialement connus. Malgré la poussée urbaine, les Maasai sont, bon an, mal an, parvenus à garder des droits sur le vaste espace du parc. Les touristes les photographient autant que les girafes et les gnous, car ils font partie du paysage, ce qui leur donne un certain pouvoir de négociation.
En revanche, qui parmi les touristes visitant l’Inde ou même les habitants de Bombay sait qu’environ 9 000 Adivasis – littéralement, des « aborigènes » –vivent dans la jungle du parc national Sanjay Gandhi ? Leur présence est rendue invisible par les pouvoirs publics, qui la considèrent comme illégale. L’expansion du parc – sa surface a été multipliée par quatre en trente ans –a entraîné la destruction de nombre de leurs hameaux forestiers. Nullement dangereux pour la biodiversité, ces autochtones savent vivre avec les léopards, au contraire des habitants des bidonvilles.
Alors que les Maasai représentent moins de 3 % de la population kényane, les Adivasis constituent le quart des aborigènes de la planète ! Pour autant, ils sont loin d’avoir le soft power des Maasai, ce que je nomme
l’« éco-ethnicité ». Celle des Maasai et de leur célèbre robe rouge est très grande. Les pouvoirs publics leur laissent donc des droits, ce qui permet en retour une meilleure gestion de la savane, notamment par des gardes forestiers maasai, prêts à veiller sur les animaux convoités par les braconneurs, tels les rhinocéros blancs. Les Adivasis, au contraire, ne comptent pas : pour la plupart des Indiens, il s’agit de primitifs, dont les brûlis et la chasse nuisent à l’environnement. Jusqu’à récemment, le parc national évitait même de les employer pour protéger la jungle, puisqu’on voulait les en chasser ! Pourtant, par là, on se prive de gardiens capables d’alerter en cas d’incendie, de survenue de braconniers… ou de léopards en goguette.
et une espèce animale qu’en étudiant cette dernière. Toutefois, ce que je vivais à Akole me suggérait que la solution était à rechercher plutôt du côté des humains, intuition dont j’ai très vite pu vérifier la justesse
En 2011, Sunil Limaye prit la direction du parc national Sanjay Gandhi, dont la taille excède de peu celle de Paris intra-muros (105 kilomètres carrés) et dut immédiatement affronter un grave problème : les attaques de léopards au sein de la réserve et dans ses alentours se multipliaient. En juin 2004, des panthères attaquèrent pas moins de douze personnes, dont la plupart faisaient partie des quelque 500 000 habitants de bidonvilles établis aux bordures de la réserve Le nouveau directeur avait entendu parler de mon travail à Junnar, de sorte qu’il avait une idée quant à la nature du problème Des années durant, l’administration des forêts avait relâché dans le parc de nombreux léopards capturés autour de la grande réserve naturelle ou ailleurs : quinze en 2003, par exemple. La relocalisation de ces fauves n’avait cependant servi à rien, car ils avaient été vite remplacés par des congénères dans les territoires laissés vacants, tandis que leur concentration dans le parc avait augmenté les risques d’attaques aux environs L’administration des forêts avait compris quelle dynamique était en cours, mais énorme était la pression des politiques et des médias pour continuer les transferts d’animaux

Sunil Limaye décida de lancer un projet impliquant des scientifiques, des citoyens et des institutions de Bombay afin de réduire le conflit humains-léopards, et il désira m’impliquer J’étais alors bien occupée à rédiger ma thèse de doctorat sur le travail effectué à Akole, mais je ne pus m’empêcher de contribuer à résoudre une situation aussi terrible pour les grands félins que pour les hommes En outre, ma sœur vivant à Bombay à l’époque, ma fille pouvait jouer avec son cousin pendant que je travaillais. Sunil Limaye constitua donc une équipe associant plusieurs gardes forestiers, Vidya Venkatesh, le directeur de la Fondation pour la dernière nature sauvage (Last Wilderness Foundation) et moi-même. Notre équipe s’est rassemblée autour de l’idée qu’il fallait faire changer les mentalités, étant donné que de nombreux habitants de Bombay ne voyaient dans la forêt qu’une source de problèmes. Le moyen le plus sûr pour y parvenir était d’impliquer les Mumbaikars , c’est- à - dire les habitants de Bombay(Mumbai, en marathi) !
Nous avons donc recruté des passionnés de nature qui souhaitaient depuis longtemps contribuer à la protection d’une réserve qu’ils aimaient Ils ont formé l’association Mumbaikars for SGNP (Les habitants de Bombay pour le
parc national Sanjay Gandhi ), et ont lancé une campagne de sensibilisation à la valeur du parc national en tant que réservoir d’espaces verts , d’eau douce et d’oxygène . Des étudiants ont installé des pièges photographiques afin de compter les panthères. Sur les 117 kilomètres carrés du parc national Sanjay Gandhi et dans la colonie d’Aarey Milk , un espace de prés et de bois consacré à l’élevage de bufflesses, les appareils photographièrent 21 panthères, ce qui trahissait une très forte densité Le parc national abritait des proies sauvages, principalement des daims, mais les léopards étaient aussi attirés vers les bidonvilles par les chiens errants s’y nourrissant des ordures jonchant le sol
Nous avons aussi interrogé les riverains afin de mieux comprendre quelles interactions ils avaient avec les léopards. Comme le géographe Frédéric Landy, de l’université de Paris Nanterre, l’a noté dans ses travaux, ce n’était pas tant les habitants des bidonvilles – les personnes les plus souvent attaquées – qui demandaient l’élimination des panthères Il s’agissait plutôt de personnes dotées d’un pouvoir politique, et vivant dans les immeubles situés à proximité de la réserve. Ces membres de la couche sociale supérieure appréciaient la vue sur la verdure, mais paniquaient si un léopard apparaissait sur une caméra de sécurité Par ailleurs, les Warlis et les Kohlis, des aborigènes vénérant Waghoba et qui avaient vécu dans la forêt pendant des siècles avant que Bombay ne les englobe , n’avaient pour leur part pas peur des léopards et n’en subissaient que rarement les attaques (lire l’encadré page 65) Eux souhaitaient la présence des carnivores pour repousser les promoteurs et les installations illégales
À mesure que progressaient nos recherches et le programme de sensibilisation, l’administration des forêts a pu améliorer sa gestion des situations, par exemple lorsqu’un léopard était découvert en ville Elle s’est aussi rapprochée de la police afin d’accroître sa capacité à contrôler les foules susceptibles de chercher à attaquer ces animaux et, sans doute le plus important, de la municipalité afin d’améliorer le ramassage des ordures dans les zones autour du parc fréquentées par Panthera pardus fusca Après la publication de notre rapport, nous avons collaboré avec le Club de la presse de Bombay et d’autres organisations des médias afin de conseiller les gens sur les moyens de rester en sécurité : garder des alentours propres, ne pas laisser les enfants jouer dehors après la tombée de la nuit, éclairer les zones sans lumière, et plutôt que crier et vouloir effrayer un léopard de rencontre , prendre du champ…
Mumbaikars for SGNP a aussi organisé des ateliers réguliers avec des membres de la presse, afin de convertir leur couverture trop racoleuse du problème en véritable information
– pour certains journalistes, léopard était synonyme de « mangeur d’hommes ». Après un article évoquant les dangers encourus par les enfants scolarisés à l’orée du parc, le gouvernement a mis en place un service de bus scolaire
Résultat : la presse et la population, beaucoup mieux informées sur les léopards, les ont aussi acceptés, de sorte que des bénéfices tangibles sont apparus Depuis notre campagne, il n’y a pratiquement pas eu d’incidents : des panthères ont bien attaqué des personnes en 2017, 2021 et 2022, mais grâce aux pièges photographiques des naturalistes amateurs, elles ont pu être très vite identifiées, piégées, puis placées en captivité permanente Notre travail à Bombay a démontré l’importance de sensibiliser les médias et la population, et de les mobiliser afin de réduire les conflits entre humains et carnivores

Je n’aurais pas dû être aussi surprise par la relation profonde et complexe que les Indiens entretiennent avec les grands félins, puisqu’ils partagent leur espace avec eux depuis la préhistoire. Toutefois, j’avais été éduquée dans l’idée d’une stricte séparation entre la nature et l’humanité , idée née en Europe et qui a atteint son apothéose en Amérique du Nord Débarrassant la nature de tout ce qu’ils trouvaient menaçant , les colons européens du Nouveau Monde ont pratiquement éradiqué les loups et les couguars De même, lorsque les Britanniques sont arrivés en Inde, ils ont abattu des dizaines de milliers de tigres et de léopards et exterminé le guépard
A. Schnitler et L. Hermann, Quand le tigre et le lion cohabitaient en Asie, Pour la Science, n° 527, 2021.
C. Pittman, World’s largest wildlife bridge could save mountain lions, Scientific American, 2021.
R. Leakey, « Si l’on ne réduit pas la pauvreté, il n’y aura pas d’avenir pour la vie sauvage » , Pour la Science, n° 472, 2017.
C. Mounet, Comment gérer la grande faune sauvage ?, Pour la Science, n° 402, 2011.
P. Clergeau, Les villes, terres d’accueil, Dossier Pour la Science, n° 65, 2009.
Dans le discours dominant en matière de conservation, les grands carnivores sont seulement présentés comme des prédateurs, qui attaquent inévitablement humains et bétail. Dans de nombreux documentaires , l’histoire racontée est celle d’une nature aux dents et aux griffes sanglantes Cette vision présuppose un conflit et suggère que la seule façon de traiter les grands carnivores est de les tuer ou de les éliminer. Je pense le contraire : la plupart des conflits entre léopards et humains trouvent leur origine dans la présupposition d’un conflit. Chez les humains, l’agression entraîne une agression en représailles, et il pourrait en être de même chez les grands félins Dans les rares cas où ils attaquent délibérément les humains, nous devons nous demander pourquoi La réaction normale d’un léopard lorsqu’il entend ou voit des personnes est de s’enfuir ; comment surmonte-t-il cette peur au point de tuer, dans les rares cas où cela se passe ? Est-ce à cause de quelque chose que nous lui avons fait ?
Impossible de le savoir. Toutefois, dans la plupart des endroits où je fais des enquêtes, le récit dominant est celui de la paix plutôt que du conflit Dans les zones rurales de l’Himachal Pradesh, les habitants nomment les léopards mrig, ce qui signifie « animal sauvage », soit un terme neutre . Nous avons constaté que les humains et les léopards partageaient l’espace, tous s’efforçant de survivre dans des conditions difficiles
De nombreux écologues indiens s’orientent désormais vers l’idée d’une coexistence dans des territoires partagés. Compte tenu de la relation culturelle profonde entre les humains et les grands félins dans le sous - continent indien, il est concevable que , si les animaux reviennent un jour dans les régions où ils ont disparu, les gens les accepteront
En décembre 2011, alors que je commençais mon travail à Bombay, un véhicule a heurté un léopard sur une autoroute Un défenseur des animaux, passant par-là, constata que le fauve était gravement blessé, mais vivait encore, et le mit dans le coffre de sa voiture – il pesait 75 kilogrammes –, où était assise sa famille Il l’emmena ensuite jusqu’au parc national dans l’espoir que ses vétérinaires pourraient le sauver Lorsqu’il arriva, une heure plus tard, l’animal était mort. Comme prévu, son collier GPS s’était déjà détaché automatiquement, mais la puce introduite sous sa peau pouvait être lue Il s’agissait d’Ajoba Apprenant sa mort, des gens ont pleuré, m’at-on rapporté Un réalisateur marathi – c’est-àdire issu de la région de Bombay – fut tellement inspiré par la saga d’Ajoba qu’il en a tiré un long métrage. Le film contribua à apprendre à des millions d’Indiens à apprécier les léopards C’est cette empathie qui me donne l’espoir que ma fille et ses enfants vivront dans un monde encore riche en espèces sauvages n
HERVÉ THIS
physicochimiste, directeur du Centre international de gastronomie moléculaire AgroParisTech-Inrae, à Palaiseau

On croit tout savoir de sujets culinaires aussi reba us que la sauce mayonnaise. Erreur : les progrès de la physicochimie montrent que la structure de ce grand classique culinaire s’apparente plus à une « émulsion de Ramsden », stabilisée par des particules, qu’à la classique émulsion stabilisée par des molécules.
Au début était la « rémoulade » : dès le XIVe siècle, Le Viandier de Guillaume Tirel proposait de confectionner des sauces en « rémoulant » de l’huile dans un mélange d’un liquide, froid ou chaud, additionné de moutarde Puis des cuisiniers introduisirent du jaune d’œuf, au goût flatteur, avant que, au tournant du XIXe siècle, l’omission de la moutarde ne conduise à cette sauce qui fut nommée « magnonnaise » , « mahonnaise » , « manionnaise », et finalement « mayonnaise » : du jaune d’œuf, du vinaigre, du sel, du poivre et de l’huile
Reste que, pour les cuisiniers des siècles passés, la confection de la sauce surprenait : mêlant ces solutions aqueuses que sont le jaune d’œuf (50 % d’eau) et le vinaigre (90 % d’eau) avec l’huile, on obtient – dans les bons cas – une « émulsion » si ferme que la cuiller y tient debout ! Comment expliquer ce mystère ? On a
« tout » entendu à ce propos : la mayonnaise serait un « gel », les molécules du jaune d’œuf seraient « désarticulées », l’huile et l’eau seraient mélangées de façon « intime », « amalgamées ». Mais un simple microscope montre bien que, en première approximation, l’huile est divisée par le fouet ou la fourchette en gouttelettes, qui sont dispersées dans l’eau ; la viscosité augmente, parce que, plus on ajoute d’huile et plus on fouette, plus les gouttelettes d’huile sont nombreuses et tassées dans la phase aqueuse, finissant par ne plus pouvoir bouger individuellement. Comment parvient-on à disperser l’huile dans l’eau, alors que si l’on fouette de la simple huile avec de l’eau pure, on n’obtient pas la viscosité de la mayonnaise ? C’est la partie non aqueuse du jaune d’œuf qui renferme la clé du mystère.

Comment l’huile et l’eau contenue dans l’œuf et le vinaigre s’associent-elles en une consistance ferme ? La physicochimie de l’œuf fournit trois explications complémentaires.
On a initialement prétendu que les « lécithines » ou les « phospholipides » (des catégories souvent confondues, à tort) se disposaient à la surface des gouttelettes d’huile, prévenant la coalescence de ces dernières. Oui, mais c’était compter sans les protéines du jaune d’œuf. On a amélioré la description de l’émulsion quand on a compris que ces protéines étaient « dénaturées » par le travail de la sauce, venant se disperser à l’interface : non seulement ces molécules préviennent mieux la rencontre des gouttelettes d’huile, mais, de surcroît, leurs charges électriques assurent une répulsion efficace.
Pour compléter le tableau on explore, depuis quelques années, les émulsions dites « de Ramsden » (du nom du chimiste britannique Walter Ramsden), fautivement dites «émulsions de Pickering » (Percival Pickering arriva un an après Ramsden) : dans ces systèmes, ce sont des particules qui, disposées à la surface des gouttelettes d’huile, assurent l’émulsification. En effet, le jaune d’œuf est fait de « granules » dispersés dans un plasma : ces granules sont constitués de protéines et de divers lipides, tandis que le plasma est une solution aqueuse qui contient de nombreuses protéines. Depuis deux ans environ, la question de savoir si les mayonnaises sont ou non
des émulsions de Ramsden est posée, et les expérimentations convergent pour établir l’importance de ce mécanisme d’émulsification. À ce jour, il semble judicieux de considérer que les trois types de mécanismes – par des phospholipides, par des protéines, par des particules – contribuent à la constitution de ce joyau culinaire qu’est la mayonnaise, dite par l’humoriste américain Ambrose Bierce « sauce qui sert de religion d’État aux Français ». n
➊ Dans un grand bol, mettre un jaune d’œuf et deux cuillerées à soupe de bon vinaigre, sel, poivre (surtout pas de moutarde, sans quoi l’on produit une rémoulade).
➋ En fouettant, ajouter un demi-verre d’huile goutte à goutte pour obtenir une émulsion un peu molle : c’est au début de l’émulsification que l’ajout lent d’huile est essentiel, parce qu’il s’agit de disperser l’huile dans l’eau, et non l’eau dans l’huile.
➌ Utiliser un mixeur plongeant pour a ermir la sauce, qui devient alors plus blanche.
➍ Terminer avec un peu de piment de Cayenne, de paprika, du cerfeuil haché, une perle d’ail broyé, une échalote émincée, et quelques gouttes de jus de citron.
p. 80
Retrouvez tous nos articles sur www.pourlascience.fr
Au casino, la maison gagne toujours ! Dans ces conditions défavorables, la meilleure stratégie à adopter est celle du « jeu hardi », qui consiste à miser systématiquement le maximum possible jusqu’à être ruiné ou atteindre exactement le but fixé.
p. 20
p. 34
En prélevant quelques cellules d’un embryon de grenouille, des chercheurs ont constaté que celles-ci s’organisent en une structure comparable à un microorganisme pluricellulaire. Ces xénobots (du nom de la grenouille d’origine Xenopus laevis) développent même des cils qui leur donnent un moyen de propulsion. De curieuses créatures très différentes des batraciens !
On remplacerait plus utilement l’ivresse de l’innovation par une exigence de la sobriété, qui servirait à évaluer la nécessité d’adopter sans réfléchir toute solution présentée comme innovante
YVES GINGRAS sociologue des sciences à l’université du Québec
Environ 60 % des surfaces irriguées en France sont consacrées à la culture du maïs, une plante qui demande beaucoup d’eau (et de façon critique en été). Sa production répond surtout aux besoins de la méthanisation et du bétail. Une stratégie de gestion de l’eau à repenser ?
p. 92
Ces cellules sont aussi nommées « neurones en fuseau » à cause de leur structure. On ne les trouve que chez les animaux qui ont une encéphalisation importante comme les hominidés, les cétacés et les éléphants. Des études psychiatriques ont montré qu’elles sont associées au « cerveau social », car les cas pathologiques présentent une baisse d’empathie et de conscience sociale.
En cas de grosse chaleur, le corps est soumis à rude épreuve. Mais l’humidité est aussi un problème, car elle perturbe le mécanisme thermorégulateur de la sueur. Des chercheurs ont défini l’humidex, qui détermine le risque relatif pour la santé. Par exemple, à 100 % d’humidité, 33 °C est aussi mortel que 42 °C à 40 % d’humidité.
13 000
Près de 13 000 léopards vivent en Inde. Mais parce que ces félins parcourent des dizaines, voire des centaines, de kilomètres pour trouver des partenaires, ils ne se limitent pas aux réserves naturelles du pays qui représentent 5 % de sa superficie. Alors, avec 1,4 milliard d’humains, la cohabitation est inévitable.
AcademiaNet offre un service unique aux instituts de recherche, aux journalistes et aux organisateurs de conférences qui recherchent des femmes d’exception dont l’expérience et les capacités de management complètent les compétences et la culture scientifque.
La base de données qui rassemble toutes les femmes scientifques de renommée internationale
AcademiaNet, base de données regroupant toutes les femmes scientifques d’exception, offre:

• Le profl de plus des 2.300 femmes scientifques les plus qualifées dans chaque discipline – et distinguées par des organisations de scientifques ou des associations d’industriels renommées
• Des moteurs de recherche adaptés à des requêtes par discipline ou par domaine d’expertise
• Des reportages réguliers sur le thème »Women in Science«





