Trouble bipolaire
Pourquoi les émotions alternent
Comment aider un proche bipolaire

L’émerveillement,
NEUROSCIENCES
Boire
PSYCHOLOGIE
Accepter ses métaémotions pour se reconnecter à soi-même
SOCIÉTÉ
Comment développer son sens de la repartie en

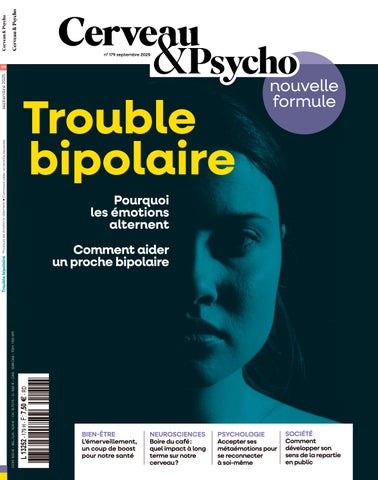
Pourquoi les émotions alternent
Comment aider un proche bipolaire

L’émerveillement,
NEUROSCIENCES
Boire
PSYCHOLOGIE
Accepter ses métaémotions pour se reconnecter à soi-même
SOCIÉTÉ
Comment développer son sens de la repartie en

à partir de 6,90 € / mois sans engagement





• Tout cerveauetpsycho.fr
• Le téléchargement PDF
• Les archives depuis 2003

• Le magazine (11 numéros / an)

















Pour s’abonner et découvrir toutes nos o res, flashez ici.





C’estBipolaires, votre moment est venu
SÉBASTIEN
BOHLER rédacteur en chef
un changement majeur dans notre société. Le livre du journaliste Nicolas Demorand est un phénomène d’édition, un succès national qui change le regard porté sur le trouble bipolaire et sur la maladie mentale en général « Je suis un malade mental », la phrase choc de l’auteur, a secoué les consciences et amené des millions de personnes à se demander : mais qu’est-ce que c’est que d’être bipolaire ?
En écoutant son intervention sur France Inter, j’ai été frappé par ces mots : « À certains moments, j’ai le cerveau grillé. »
Nous avons donc voulu savoir ce qu’il en était, ce qui se passait précisément dans le cerveau à ce moment-là , et pourquoi le paysage émotionnel des patients oscille ainsi entre le jour et la nuit, l’ombre et la lumière, l’énergie débordante et le vide d’envie.
Vous découvrirez le résultat dans notre dossier de une. Mais la santé mentale, c’est aussi le résultat d’une société qui pousse les cerveaux à bout. Dans ce numéro vous ferez la connaissance de Marc, qui ne justifie plus son existence que par le travail, de Misha, qui n’a pas supporté de ne pas atteindre 1 million d’abonnés sur Instagram et a mis fin à ses jours Pour échapper à ces injonctions permanentes, nous vous proposons de reprendre contact avec vous-même grâce au pouvoir de l'émerveillement, que vous découvrirez dans la chronique de Nathalie Rapoport, directrice de l'Institut de médecine corps-esprit, ou en renouant avec vos « métaémotions », sur les pas de Christophe André Pour mieux vous connaître et retrouver, finalement, une forme d’équilibre. £
Ils ont contribué à ce numéro

p. 16
Bruno Dubois professeur de neurologie à Sorbonne Université, il est spécialiste de la maladie d’Alzheimer et de son diagnostic.

p. 28
Hana Lévy-Soussan psychologue et responsable des programmes d’activités à La Maison perchée, elle accompagne notamment les personnes souffrant de trouble bipolaire grâce à la pair-aidance.

p. 62
Sébastien Goudeau professeur de psychologie sociale à l’université de Poitiers, il analyse comment l’école creuse les inégalités sociales.

p. 78
Claire de March
chargée de recherche CNRS en chimie du vivant, elle a contribué à identifier pour la première fois la structure 3D d’un récepteur neuronal de l’odorat.

p. 6
p. 7
cerveau & société
P. 34 DERRIÈRE L’INFO, LA PSYCHO
Morte par désabonnements
Nicolas Gauvrit
P. 38 LES CLÉS DE L’HISTOIRE
Quand la peur de Satan pétrifiait l’Amérique
Sebastian Dieguez
P. 42 UN PSY AU CINÉMA
Black Mirror : quand votre cerveau ne vous appartient plus Laurent Bègue-Shankland
P. 48 À MÉDITER
Connaissez-vous vos « métaémotions » ?
Christophe André
Pourquoi le bâillement est-il contagieux ?
Autisme : la flexibilité cognitive retrouvée !
p. 9 Nostalgie, quand tu nous fais danser…
p. 10 Des cellules souches contre Parkinson
p. 12 Militaires ou civils : qui se soumet à l’autorité ?
P. 14 L’IMAGE DU MOIS
Voyage aux confins du cerveau
Albane Clavere
P. 16 FOCUS
Alzheimer : un premier test sanguin approuvé !
Bruno Dubois l’actualité des sciences cognitives

Ce numéro comporte un encart d’abonnement Cerveau & Psycho, broché en cahier intérieur, sur toute la diffusion kiosque en France métropolitaine Il comporte également un courrier de réabonnement, posé sur le magazine, sur une sélection d’abonnés
Ce numéro comporte un encart « FIRST VOYAGE - Pure Pepper » posé sur le magazine et diffusé sur l’ensemble des abonnés ainsi qu’un courrier de réabonnement posé sur le magazine, sur une sélection d’abonnés En couverture : © Iconaru Cristi/Shutterstock


Pourquoi les émotions alternent
Comment aider un proche bipolaire
On commence à mieux comprendre pourquoi les personnes bipolaires alternent entre phases dépressives et maniaques. Ce qui peut aider les proches à mieux les accompagner au quotidien.
P. 50 NEUROPHYSIOLOGIE
p. 20 Quand le cerveau perd l’équilibre
Raoul Belzeaux et Albane Clavere
p. 28 « Les proches ont aussi le droit de souffler »
Entretien avec Hana Lévy-Soussan
neurosciences & psychiatrie
P. 72 NEUROSCIENCES
Le paradoxe des souvenirs enfin résolu
Hajdina Halilovic
P. 78 INTERVIEW DES LABOS « L’homme a marché sur la Lune avant de comprendre son odorat »
Entretien avec Claire de March
P. 82 LE CAS CLINIQUE
Marc, esclave volontaire de son travail
Grégory Michel
santé & bien-être 68
Ce que le café fait à votre cerveau
Tessa Biscarrat
P. 58 L’ENVERS DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Faut-il suivre
les conseils d’experts ?
Yves-Alexandre Thalmann
P. 60 CORPS & ESPRIT
L’émerveillement, une bouffée d’air pour l’esprit
Nathalie Rapoport-Hubschman


P. 62 APPRENTISSAGE
Pour des devoirs enfin utiles à tous
Sébastien Goudeau
P. 68 MON CERVEAU & MOI
Comment avoir le sens de la repartie ?
Jean-Philippe Lachaux psycho

PSYCHOLOGIE
Des chercheurs ont peut-être découvert la raison de ce mimétisme : il conduirait les membres d’une même communauté à synchroniser leurs rythmes de veille et de sommeil, conférant de multiples avantages sociaux.
ous voyez bâiller quelqu’un en soirée, et ça y est… vous ne pouvez vous empêcher de l’imiter Bien que ce comportement soit présent chez de très nombreux animaux, on ne sait toujours pas très bien à quoi il sert, ni pourquoi il se propage si facilement. Les travaux de Ramiro Joly-Mascheroni et ses collègues de l’université de Londres, récemment publiés dans la revue Nature, pourraient lever un coin du voile sur ce mystère. Ils suggèrent en effet un rôle possible de la transmission du bâillement : en se propageant au sein d’un groupe d’individus, il ferait passer le message qu’il est temps de se coucher
Il permettrait ainsi une synchronisation du sommeil – et donc des activités diurnes – qui pourrait profiter aux espèces sociales comme les primates, dont nous faisons partie. Dans leurs travaux, les scientifiques britanniques ont cherché à savoir si le bâillement remontait loin dans l’évolution de notre espèce, et s’il présente des points communs entre les humains et les primates. Car s’il joue probablement un rôle pour stimuler la vigilance lorsque la fatigue devient di fficilement supportable, il ne se révèle contagieux que chez certaines espèces, notamment les grands singes Les chercheurs ont donc placé des chimpanzés face
à un visage humanoïde de synthèse qui bâillait. Les singes s’y sont mis aussi ! Mais ce n’est pas tout : après avoir bâillé, ils s’apprêtaient au sommeil Ils se confectionnaient notamment des matelas de fortune, comme si c’était le moment de se coucher, certains allant jusqu’à s’allonger pour s’assoupir. Voilà qui laisse entrevoir un rôle nouveau pour le bâillement contagieux : en se transmettant d’un individu à l’autre, il aurait pour effet d’amener un grand nombre d’entre eux à se préparer à dormir. Or, pour un groupe de primates, aller se coucher en même temps revêt plusieurs avantages. D’abord, le repos collectif évite de rendre les individus endormis
vulnérables : si certains restaient éveillés, ils risqueraient de faire du bruit et d’attirer de potentiels prédateurs qui s’en prendraient aux assoupis Et si tout le monde dort en même temps, tout le monde est disponible pour des activités diurnes collectives, au même moment, comme la chasse ou la cueillette, ou lorsqu’il faut lever le camp
Chez l’humain, la contagiosité du bâillement débute vers 4 ans, période de maturation des capacités sociales Au niveau cérébral, il engage notamment les lobes frontaux, impliqués dans l’empathie Son imitation fait d’ailleurs intervenir les neurones miroirs, essentiels aux interactions sociales « Des travaux ont montré que les bonobos bâillent davantage en réponse à la femelle dominante, et les chimpanzés au mâle dominant », fait remarquer Olivier Walusinski, médecin généraliste spécialiste de ce phénomène Ce serait donc même un moyen pour le chef d’asseoir son statut et d’imposer son rythme au groupe
Ces recherches laissent entrevoir un scénario possible : le bâillement aurait déjà existé chez les ancêtres communs des grands singes et des humains, il y a environ 8 millions d’années. Au fil des âges, il aurait renforcé la cohésion des groupes et augmenté nos chances de survie Pour ces ancêtres, il fallait trouver le moment opportun pour dormir, quand aucun danger n’était à l’horizon C’est pourquoi notre cerveau a tendance à enclencher le bâillement quand aucun événement dans notre environnement ne vient éveiller notre attention Par exemple, lors d’une réunion ennuyeuse… £
Margot Brunet
R. Joly-Mascheroni et al., Chimpanzees yawn when observing an android yawn, Scientific Reports, 2025.
Retrouvez toutes les actualités sur
Un des écueils auxquels se heurtent les personnes autistes est la difficulté de passer d’une tâche ou d’une stratégie à une autre, et à ajuster ses réponses quand l’environnement change. Cette flexibilité cognitive suppose que le cerveau bascule littéralement d’un état neuronal A à une configuration B , di fférente Pour effectuer cette bascule, il faut apporter de l’énergie. C’est un peu comme lorsque nous convertissons notre canapé en lit quand des invités viennent nous rendre visite : il faut passer de la configuration canapé à la version lit, et pour cela investir de l’énergie musculaire Cette énergie neuronale ferait défaut aux personnes autistes, se traduisant par ce qu’on appelle une « inflexibilité cognitive », qui les bloque souvent dans une activité répétitive. Récemment, des chercheurs japonais ont réussi à surmonter cette barrière énergétique par une technique de stimulation cérébrale non invasive, la stimulation magnétique transcrânienne Ce qui a pour
effet d’améliorer la flexibilité cognitive En activant une région bien précise du cerveau – le lobule pariétal supérieur droit – ils ont rehaussé l’activité d’un réseau de neurones (le réseau frontopariétal), lequel facilite la transition d’un état cérébral vers un autre. Ils ont alors favorisé ce basculement à un moment où le cerveau semblait s’attarder dans un état cérébral particulier. L’inflexibilité cognitive, mesurée par le temps pris pour alterner entre deux tâches proposées simultanément, a alors diminué après une seule session de stimulation Il restera à optimiser les protocoles, car les effets obtenus à ce jour disparaissent au bout de deux mois. Et il faudra reproduire ces expériences sur des groupes de personnes plus larges et plus diversifiés. £
Ilona Bouvard
T. Watanabe et al., Noninvasive reduction of neural rigidity alters autistic behaviors in humans, Nature Neuroscience, 2025.
p. 20
Quand le cerveau perd l’équilibre
p. 28
Interview
« Les proches ont aussi le droit de sou ffler »
Vivre avec un trouble bipolaire, c’est souvent naviguer entre tristesse sans bornes et excès d’euphorie Ces épisodes ne sont pas de simples sautes d’humeur : ils durent parfois plusieurs semaines, voire des mois, entrecoupés de phases de stabilité plus ou moins longues
Ce dossier invite à mieux comprendre cette a ffection psychiatrique complexe, en explorant ce qui se passe dans le cerveau C’est au cœur même de notre système émotionnel, dans une petite structure appelée « amygdale », que des déséquilibres auraient été observés. Une piste prometteuse qui ouvre la voie à de nouvelles approches thérapeutiques. Car si le lithium reste le traitement de référence, tous les patients n’y répondent pas. Alors, d’autres leviers existent, comme certaines thérapies, ou la psychoéducation, qui vise à mieux comprendre sa maladie.
Enfin, la bipolarité est une épreuve pour les proches des malades. Comment les soutenir sans s’épuiser ou se décourager ? La psychologue Hana Lévy-Soussan, elle-même atteinte de trouble bipolaire et engagée dans un lieu d’entraide des patients – on parle de « pair-aidance » –y partage ses conseils et de nombreuses ressources. Elles seront précieuses à tous ceux qui vivent cette situation au quotidien.
Albane Clavere
Hana Lévy-Soussan psychologue et responsable des programmes d’activités à La Maison perchée.

Entre incompréhension, épuisement et solitude, les aidants se retrouvent souvent démunis face à un proche atteint d’un trouble bipolaire. Comment être en soutien sans se perdre soi-même ?
Autour d’une personne touchée par un trouble bipolaire, il y a souvent des proches, des familles, des conjoints qui l’aident et l’accompagnent. De façon générale, qui appellet-on les « aidants » ?
Tous ceux qui choisissent d’apporter leur soutien : amis, frères, sœurs, parents, conjoint... Mais tous les proches ne sont pas forcément des aidants Ce rôle suppose de s’impliquer activement pour accompagner et soutenir. Il existe aussi ce qu’on appelle les « pairs-aidants » – notre lieu d’accueil et de rencontre, La Maison perchée , repose sur leur action –, qui sont des gens eux-mêmes confrontés au trouble et qui mettent à profit leur vécu pour aider celles et ceux qui traversent des difficultés similaires Étant moi-même psychologue et concernée par le trouble bipolaire, cela me permet d’avoir une double casquette – une compréhension à la fois théorique et expérientielle. On rencontre donc une diversité d’aidants, et il est essentiel que les personnes vivant avec un trouble sachent qu’elles peuvent s’appuyer sur un réseau diversifié
Comment préserver son équilibre quand on soutient un proche bipolaire ?
Accompagner quelqu’un demande de donner beaucoup de soi. Parfois trop. D’où l’importance de savoir s’imposer des limites, reconnaître quand il faut se
mettre en retrait pour prendre soin de soi. Être aidant exige parfois de savoir lâcher prise. Comme les individus bipolaires, les proches ont eux aussi besoin d’écoute et de soutien. Cela peut passer par des échanges avec l’entourage, mais aussi en rejoignant des groupes de proches aidants, tels ceux que propose La Sentinelle des aidants, par exemple, une association qui accompagne les proches des individus affectés par des troubles psychiques Ces espaces permettent de se décharger, de se livrer sur son épuisement, sa colère, son désarroi…
Justement, quelles ressources peut-on mobiliser pour ne pas se décourager ?
Le trouble bipolaire ne se vit pas seul. Il touche la famille, le couple, les amis L’entourage y est forcément confronté. Or, lorsqu’on ne connaît pas bien la maladie, on peut prendre beaucoup de choses de manière personnelle : les accès d’agressivité, les épisodes suicidaires, ou même certains jours où son proche reste prostré au fond du lit. C’est pourquoi il est très utile de s’informer C’est le rôle de la psychoéducation, qui aide à déchiffrer
ces comportements, à comprendre qu’ils ne sont pas dirigés contre nous et que ce n’est pas à proprement parler l’individu qui s’exprime à travers eux, mais bien le trouble. Une telle distinction est essentielle. Elle permet de moins en vouloir à la personne, de prendre de la distance, et surtout de ne pas culpabiliser.
Quelles sont, selon vous, les principales difficultés auxquelles sont confrontés les aidants ?
Aider quelqu’un qui n’est pas prêt à recevoir de l’aide représente, à mon sens, l’un des plus grands défis auxquels font face les proches de sujets en souffrance psychique. Car même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas porter secours à quelqu’un contre son gré Et il y
a souvent, chez l’individu concerné, une forme de déni qui rend toute démarche d’accompagnement très complexe À La Maison perchée, on reçoit régulièrement des parents profondément investis pour aider leur enfant, mais aussi complètement désemparés. Ils racontent avoir tout tenté pour le convaincre de consulter, sans succès. Et c’est parfois difficile à entendre, mais on ne peut pas forcer quelqu’un à aller mieux Le désir de soin doit venir de la personne elle - même . Cela crée un vrai décalage : d’un côté, un proche qui veut sincèrement apporter son soutien ; de l’autre, quelqu’un qui le refuse ou semble indifférent. Cette dissonance fragilise la relation L’aidant pense bien faire, mais son comportement peut être perçu comme une intrusion, voire une tentative de contrôle Et chacun avance alors dans une direction opposée, ce qui rend le dialogue compliqué
Dans ce contexte, comment peut-on alors aider quelqu’un qui refuse notre soutien ?
Il y a, selon moi, deux cas de figure à distinguer. Le premier porte sur les situations d’urgence, lorsque l’individu
représente un danger pour lui - même ou pour les autres. Dans ce cas , il est parfois nécessaire d’intervenir sans son consentement. Cela peut aller jusqu’à une hospitalisation sous contrainte Il s’agit d’une décision lourde, très difficile à vivre, mais qui peut dans certaines situations être le seul moyen de protéger le patient.
Le second cas de figure est plus fréquent C’est celui où il n’y a pas de danger immédiat, mais où la souffrance est bien présente. La posture à adopter est alors très différente et demande surtout de la patience . Plutôt que de vouloir forcer la personne à entreprendre telle démarche pour aller chez un psy, vous allez semer des graines qui germeront au fil du temps, par exemple en lui faisant simplement savoir que des ressources existent. Qu’il s’agisse de lieu d’aidance comme La Maison perchée (ou d’autres) ou des contenus accessibles à distance
Nos podcasts, par exemple, ont été pensés pour cela Ils permettent d’écouter – sans avoir à se déplacer ni à parler –des témoignages d’autres personnes confrontées aux mêmes souffrances Et parfois, cette simple écoute suffit à amorcer une démarche positive.
££ S’informer sur le trouble bipolaire aide à ne pas prendre les choses de façon trop personnelle quand le proche traverse des moments délicats.
« Les proches ont aussi le droit de souffler »
Association spécialisée dans l’accompagnement des jeunes adultes atteints de trouble psychique, La Maison perchée est un café associatif où les personnes concernées par un trouble psychique peuvent trouver du soutien grâce au partage d’expérience avec d’autres traversant des situations similaires.
C’est le principe de la « pair-aidance ».
Ce processus prend donc du temps ?
C’est là une autre grande difficulté pour les proches Le rétablissement se fait à un rythme propre à chacun, incompressible. Même en étant très investi et aimant, un proche ne peut pas faire le chemin à la place de l’individu concerné. Il faut accepter que cela prenne du temps L’essentiel est de ne pas brusquer la personne ni de précipiter les choses, mais plutôt de créer un cadre de soutien, d’être présent tout en lui laissant la liberté d’avancer à sa façon. Ce n’est que dans cet espace respectueux et non contraignant qu’elle pourra peu à peu se tourner vers les ressources ou les lieux qui lui correspondent
La clé est donc de savoir laisser de l’espace à la personne ?
Absolument. Le grand danger, c’est de tomber dans l’infantilisation Et c’est une réaction humaine : quand on souhaite aider quelqu’un à qui on tient, on pense généralement savoir ce qui est bon pour lui. Mais en voulant bien faire, on prive parfois l’autre de sa liberté d’agir Or le rétablissement désigne précisément une

période où la personne a besoin de se réapproprier son pouvoir d’agir, de faire ses propres choix. Cela suppose qu’elle ait de la place pour grandir et progresser à son rythme. Pour les proches, cela implique d’accepter qu’elle se cherche, voire se trompe Offrir cette liberté témoigne d’une véritable confiance, ce dont la personne a souvent le plus besoin, sentir qu’elle peut tracer son propre chemin, même s’il n’est pas le plus direct. Second effet vertueux : en laissant plus de liberté, l’aidant peut aussi commencer à s’alléger l’esprit, à lâcher prise en quelque sorte Ce qui est extrêmement bénéfique sur le long terme
Lors des phases maniaques, certains comportements peuvent devenir problématiques – comme les achats compulsifs ou les décisions abruptes. Comment aider concrètement, sans infantiliser ?
La première crise est souvent imprévisible Mais une fois cet épisode passé, il devient possible de mettre en place des outils concrets pour mieux traverser les suivants Ces dispositifs peuvent être pensés pendant les phases sans symptômes, dites « euthymiques », qui offrent de véritables fenêtres de dialogue avec
les proches. Les directives anticipées en psychiatrie sont l’un de ces outils : un document que le patient rédige lorsqu’il va bien , dans un moment de lucidité , pour préciser ce qu’il souhaite – ou ne souhaite pas – en cas de nouvelle crise Il peut y noter par exemple : « Si je recommence à faire des achats compulsifs, je suis d’accord pour que telle mesure soit prise », ou encore « Si je me mets en danger, j’accepte une hospitalisation » Il peut aussi désigner des proches à prévenir – ou, au contraire, ceux qu’il ne veut pas impliquer Ce type de document est particulièrement précieux en psychiatrie. Il permet à l’individu de conserver son pouvoir d’agir, même dans les moments où il perd en lucidité . Il s’agit de sa volonté , exprimée dans une phase de stabilité, qui fait référence Et cela évite que de telles décisions soient prises à sa place , dans l’urgence ou la confusion Il existe aussi des leviers très concrets : si l’on sait, par exemple, que les achats compulsifs sont un risque, la personne peut, de son propre chef, convenir avec sa banque de plafonds de dépense , de blocages temporaires ou d’alertes automatiques. Le plus important consiste à ouvrir le dialogue pendant les périodes d’accalmie , pour qu’elle choisisse ce
qui lui convient. Et dans bien des cas, cette démarche change profondément la manière dont la maladie est vécue En se mettant d’accord, l’individu bipolaire et ses aidants savent mieux comment envisager l’avenir, l’incertitude est réduite et cela constitue aussi un stress en moins pour l’entourage Or chaque moyen d’atténuer l’incertitude et l’angoisse est bénéfique également pour la stabilité des proches, afin qu’ils ne s’épuisent pas et puissent vivre de façon plus « sereine » cette situation ensemble.
Trouver la bonne distance semble vraiment difficile. Quand l’humeur fluctue violemment, comment s’y prend-on ?
Le maître mot est la flexibilité . Il faut savoir ajuster sa place aux besoins de la personne. Parfois, elle aura besoin d’être très proche de vous , d’avoir votre présence rassurante à ses côtés À d’autres moments, il lui faudra plus d’espace. La meilleure façon d’accompagner consiste à lui demander régulièrement de quelle manière elle souhaite être soutenue. Quelle aide serait utile pour elle ? Quelle présence attend - elle de vous
aujourd’hui ? Il est important de s’enquérir de ces choses-là, car ses besoins peuvent changer d’un jour à l’autre Rien ne sert de présumer ce qui est bon ou nécessaire à sa place Il suffit simplement de poser la question
Et puis , il faut aussi accepter de ne pas comprendre Car dans certains moments – notamment en cas de délire –, il est tout simplement impossible de saisir ce que vit l’autre, qui est d’ailleurs dans une autre réalité. Le rôle du proche est aussi de savoir renoncer à trouver des explications La simple présence représente déjà beaucoup. La personne vit ce qu’elle vit, elle partage ce qu’elle peut, et si cela semble impossible à concevoir, ce n’est pas grave . Je me souviens d’une phrase que m’a confiée mon frère lors d’une de mes crises , et qui m’a profondément marquée. Il m’a avoué se sentir comme un chien fidèle à côté de son maître : il ne comprenait pas ce que je disais, mais il était là, simplement Je pense qu’il s’agit de la bonne attitude à adopter : être là, même sans appréhender toute la situation, accepter que l’autre soit dans un autre monde Les proches pensent souvent qu’ils doivent trouver les bons mots , apporter des réponses Mais parfois, le silence suffit

Chaque semaine sont organisés différents ateliers, moments de partage où les pairs-aidants échangent sur leur vécu. Des temps « croisés » permettent également aux proches de se joindre à eux.
Être présent, c’est aussi juste partager un instant, une balade, un regard. Consentir à ne pas forcément comprendre peut représenter une démarche particulière pour l’entourage, et coûter un certain effort Mais c’est aussi une manière de lâcher prise, de renoncer à vouloir tout contrôler Psychologiquement, pour les aidants, ce moment clé a souvent quelque chose de salutaire. C’est une pression en moins qu’on se met sur les épaules. Et cela compte pour garder son équilibre psychique !
Un proche aidant doit-il aider à repérer les signes avant-coureurs d’une crise ?
L’objectif principal est de responsabiliser la personne, afin qu’elle puisse elle-même reconnaître ses signes d’alerte et se dire par exemple : « Je dors moins, que puis-je faire ? Dois-je consulter mon professionnel de santé ? » Mais parfois, son entourage, en pressentant une crise, contacte les médecins sans même la prévenir… Ce qui, à mon avis, n’est pas la meilleure approche Aujourd’hui, de nouvelles applications consacrées aux troubles bipolaires voient le jour. Elles analysent la voix des patients pour détecter des signes avant-coureurs de phases dépressives et transmettent automatiquement ces informations à leur entourage ou aux professionnels. Là encore, cela pose un vrai problème à mon sens Le sujet se trouve entièrement dépossédé de son rétablissement. Il est essentiel que tout cela se fasse avec son accord, en concertation, sans quoi il risque de se sentir infantilisé et de perdre confiance. La responsabilisation est un des piliers du rétablissement. Et quand les proches d’un patient réussissent à lui faire confiance, on les voit parvenir à respirer de nouveau, à ne plus porter sur leurs épaules tout le poids de la maladie, et à aller mieux à la fois physiquement et mentalement
Tout est donc une histoire de confiance ? Que peut-on dire
La meilleure façon
d’accompagner consiste à demander souvent à la personne comment elle souhaite être soutenue.
à des parents de jeunes bipolaires qui s’inquiètent pour leur avenir, leur insertion professionnelle ?
Quand un parent voit son enfant traverser une crise, tout semble s’effondrer. L’angoisse est immense. Mais dans ces moments - là , il doit avant tout lui faire confiance. Il existe un concept que je trouve très éclairant, celui de la « virtualité saine » Elle désigne le potentiel que chacun porte en soi d’aller mieux, de vivre pleinement , même quand on affronte une période très difficile Dans les épisodes de crise , cette possibilité semble s’effacer, mais elle ne disparaît jamais Et dans les phases de stabilité, elle reprend toute sa place. Pour les proches, le plus important est de continuer à discerner cette ressource chez la personne, même quand elle paraît absente. Et d’y croire sincèrement Parce que plus on reconnaît chez l’autre sa capacité à aller mieux et à se reconstruire, plus on l’aide à y croire lui-même £
Lorsque Mike fait greffer un implant cérébral à sa femme pour la sauver d’un coma définitif, il ne se doute pas qu’il vient de mettre le doigt dans un engrenage infernal…
Q«ui sait comment les drones insectes autonomes aident les fleurs ? » Au premier rang , une fillette lève la main pour balbutier le mot « pollinisation » Nous sommes dans une salle de classe de primaire, juste avant la sonnerie qui annonce la fin du cours. Rien d’extraordinaire, à ceci près que des institutrices comme Amanda ne parleraient pas de drones pollinisateurs en 2025… Mais ce clin d’œil futuriste est vite oublié lorsque la maîtresse embarque avec son mari guilleret qui l’attend devant l’école à bord de leur Volvo 760 break beige , parfaitement intemporelle . C’est une des recettes de la série Black Mirror que de mêler avec brio innovations futuristes et décors contemporains, voire vintage.
Combien de fois la série a-t-elle implanté des technologies quantiques dans un décor typique des années 1960 Voici donc qu’après la sortie des classes Amanda et son mari rejoignent l’hôtel-restaurant habituel où ils fêtent chaque année l’anniversaire de leur rencontre On devine alors que c’est le seul luxe que se paie ce couple bien accordé de la classe moyenne qui aimerait avoir un enfant Saliver ensemble devant un burger hallucinant est leur bonheur du moment . Les tourtereaux comptent à l’unisson « 3, 2, 1 » avant d’y mordre ensemble à pleines dents . La soirée se serait terminée sans nuage si une migraine n’avait présagé l’approche de la catastrophe.
© Avec l’aimable autorisation de Netflix/2025 (pour toutes les images de cet article)


professeur de psychologie sociale à l’université Grenoble-Alpes et membre de l’Institut de France, directeur de la maison des sciences humaines Alpes.
Institutrice dans une école de quartier, Amanda explique aux enfants comment des robots pollinisateurs butinent les fleurs…


Lors de l’entretien avec les responsables de la start-up Rivermind, le couple apprend qu’il va falloir envisager de nouvelles dépenses pour qu’Amanda puisse continuer à utiliser son cerveau.
Coup de fil au chantier où travaille
Mike. Amanda est à l’hôpital, intubée, dans un coma irréversible depuis qu’elle a perdu conscience de manière foudroyante à l’école. Une tumeur soudée au lobe pariétal, lui explique-t-on Tout s’effondre , mais lorsqu’une infirmière glisse à Mike le contact d’une start-up réputée faire des miracles, l’espoir renaît
On fait alors la connaissance de Gaynor, fervente représentante de Rivermind tirée à quatre épingles , qui lui propose de restaurer les fonctions cognitives d’Amanda après la prise d’empreinte des tissus à retirer, remplacés par un « tissu récepteur synthétique » qui téléchargera les fonctions cognitives lésées depuis un serveur distant . L’opération est gratuite , mais l’abonnement au streaming, nécessaire pour faire fonctionner la prothèse à distance , s’élève à 300 dollars mensuels Le fonctionnement de l’implant étant énergivore , Amanda aura besoin de dormir deux heures de plus chaque nuit pour récupérer Et , bien sûr, elle devra rester dans la zone de couverture du cloud . Mais cela semble dérisoire à Mike en échange de la résurrection de sa femme…
La vie reprend donc son cours. Mais comme il faut couvrir les dépenses occasionnées par ce nouvel équipement , Mike s’épuise à accumuler les heures supplémentaires Moyennant cet effort,
le cerveau de la jeune femme continue de fonctionner. Jusqu’à ce que se produise le premier grain de sable
« Il n’y a plus de réseau »
Quelques mois plus tard, le couple se trouve en voiture, se rendant sur leur lieu rituel d’anniversaire de mariage, quand Amanda perd brusquement connaissance. Ce n’est pas à cause d’une rechute de son cancer, mais parce qu’elle est
sortie de la zone de couverture du réseau
Son implant a cessé de fonctionner. Aussitôt, rendez-vous est pris avec Gaynor dans les locaux de Rivermind pour tirer tout cela au clair. Rien de grave, explique la chargée commerciale : seulement une conséquence du remaniement du réseau d’antennes du dispositif technologique D’ailleurs, pour continuer à profiter de l’offre, il suffit de passer à une formule d’abonnement supérieure et d’accéder ainsi à une couverture plus
Le transhumanisme est défini comme le désir d’améliorer l’être humain grâce à l’utilisation rationnelle et contrôlée de la technique. La paternité du terme est souvent attribuée à Julian Huxley, le frère du célèbre auteur de la glaçante dystopie Le Meilleur des mondes. Trois grandes thématiques structurent le transhumanisme : l’augmentation des capacités humaines, l’intelligence artificielle et l’immortalité. Comme l’illustre de manière poignante l’épisode de Black Mirror, l’une des critiques courantes de cette approche concerne les risques de polarisation des inégalités sociales dont elle est porteuse. Le téléchargement de l’esprit fait partie des mesures proposées par les transhumanistes pour prolonger la vie humaine, voire espérer l’immortalité. Il s’agit d’une duplication numérique de la structure neuronale humaine puis de son téléchargement dans un organe de stockage externe permettant l’émulation d’une véritable copie du cerveau. Cette idée, évoquée par le père de la cybernétique Norbert Wiener et reprise à son compte par le milliardaire russe Dmitry Itskov, est un fantasme technophile auquel certains profils psychologiques sont plus réceptifs que d’autres. Diverses études comme celle de Michael Laakasuo, de l’université de Helsinki, indiquent que des traits comme le narcissisme, la psychopathie ou le machiavélisme sont en partie liés au soutien du « téléchargement de l’esprit ». Les fans de science-fiction, eux aussi, y sont dans l’ensemble plus favorables.
Black Mirror : quand votre cerveau ne vous appartient plus
étendue du service de streaming. Mais le forfait, évidemment, est plus coûteux. Une nouvelle fois, au prix d’heures supplémentaires de plus en plus épuisantes, le couple va parvenir à retrouver son équilibre Mais, hélas, ce n’est que le début du cauchemar. Un matin, au petit déjeuner, Amanda entre dans un état second. Comme zombifiée, elle se met à vanter une marque de café, exactement comme si elle jouait dans un spot publicitaire . Dans un premier temps , cette scène décalée semble juste incongrue et inexplicable , et on n’y accorde pas plus d’importance. Mais le phénomène se reproduit peu après : un matin, elle débite une réclame pour des céréales au miel ; une autre fois elle incite un petit garçon dont les parents se disputent à consulter le site coeurduchrist com…
Le couple décide alors de supprimer ces insupportables publicités qui compromettent sérieusement l’emploi d’Amanda. Mais il y a un hic : pour cela, il faut passer à une formule d’abonnement plus chère à Rivermind. Alors, tant bien que mal, pour renflouer ses caisses, Mike s’inscrit secrètement sur le site Débile Débilos, où de pauvres bougres s’humilient en ligne pour de l’argent. La spirale infernale continue : au fil du temps, il faut augmenter les mensualités afin de maintenir le niveau initial de la prestation…
Asservissement numérique volontaire
C’est à ce moment de la série que l’on est saisi d’un malaise particulier : comme dans Black Mirror, les abonnés Netflix qui acceptent la publicité paient effectivement moins cher leur abonnement ! Voilà ce qui rend l’épisode si troublant : il ressemble terriblement au présent sous une fine pellicule de fiction. Sur Netflix, l’offre de séries et les publicités s’affineront avec le temps, et leur influence est une implacable réalité L’algorithme de recommandations de la plateforme est nourri par les microcomportements auxquels nous ne prêtons pas spécialement attention : les films et séries
regardés, ceux qu’on arrête en cours de route, etc. Par l’utilisation de modèles de traitement des données poussés, la plateforme capture nos préférences et nous pousse vers un carrousel de contenus formatés, influençant près de 80 % de nos choix selon le professeur Mattias Frey, de l’université de Londres, qui dirige un
Amanda doit payer un supplément pour utiliser son cerveau
« sans pub ». Une métaphore de nos vies à l’ère numérique.
département d’analyse des médias et de l’industrie culturelle. Difficile alors de s’échapper de cette prison algorithmique qui nous transforme en agents actifs, puisque, comme Amanda, nous risquons de devenir les rouages d’une mécanique numérique où chacun devient aussi un opérateur d’influence pour autrui Se soustraire à ces logiques est délicat, car elles s’appuient sur des ressorts technologiques et sociaux puissants Contrôler drastiquement l’influence des gigapouvoirs numériques , dont la concentration actuelle dans les Gafam est spectaculaire , est probablement une urgence de santé publique ( avec les risques de dépendance) tout autant que démocratique
Par ailleurs, le futurisme sidérant de Black Mirror nous confronte à des réalités déjà bien présentes, comme celle

7e saison, sortie le 10 avril 2025
À gauche : Un des collègues de travail de Mike lui parle d’un site qui permet de gagner de l’argent en se ridiculisant devant la caméra… Au milieu : Un élève d’Amanda lui confie que ses parents se disputent à la maison… Amanda se met alors à réciter une publicité pour un site chrétien de réconciliation…
À droite : La chargée de clientèle de chez Rivermind propose au couple de passer à une version augmentée de l’abonnement, moyennant finances... Un piège qui se refermera sur eux.
des implants cérébraux que développe aujourd’hui la société Neuralink, d’Elon Musk Ces interfaces reliant cerveau et ordinateur cherchent à convertir les signaux cérébraux en commandes destinées à des dispositifs externes , dans le but par exemple de compenser des pathologies La série nous avertit : cette technologie sera inévitablement marchandisée. Le jour où elle équipera vos cerveaux , il faudra payer un abonnement. Et la logique du marché est celle que nous voyons déjà : pour ne pas être soi-même un rouage du système publicitaire qui nourrit l’entreprise, il faudra payer aussi Comme devant votre série Netflix, où il faut débourser de l’argent pour ne pas être assailli de publicités, il faudra verser un supplément pour que votre esprit ne soit pas parasité par ces messages, comme on le voit de façon glaçante chez Amanda
Mais avant que les neurotechnologies de la société du milliardaire Musk ne prennent plus de place , pour le meilleur et pour le pire , il faut se rappeler que ce ne sont pas des puces cérébrales qui ont influencé le dernier vote présidentiel dans la démocratie la plus puissante du monde, mais bien les algorithmes de X , dont Musk est également le propriétaire . Pas besoin de microcouches de carbure de silicium insérées dans nos cerveaux : le temps


On parle de « pacte suicidaire » à propos d’un arrangement mutuel entre deux personnes qui décident de mettre fin à leurs jours dans une unité de temps et de lieu. La réalité de ces actes contredit le plus souvent la représentation romantique qui habite l’imaginaire européen et selon laquelle ce type de suicide serait le geste de couples d’amants empêchés. Ces morts restent rarissimes (entre 0,4 et 2,5 % des suicides). Selon les études épidémiologiques occidentales, la majorité des individus concernés sont des couples mariés (près de 80 %), les amants étant plus rarement touchés (de 6,4 à 20 % selon les recherches). En Europe, l’âge moyen des victimes oscille entre 54 et 78 ans. Comme dans Black Mirror, il s’agit généralement de situations où l’un des partenaires est atteint d’affections physiques invalidantes ou douloureuses et pour lesquelles il n’existe aucune perspective de guérison. Certaines études ont pointé que des troubles du sommeil pouvaient favoriser le passage à l’acte. La létalité du pacte suicidaire est élevée, ces comportements étant souvent soigneusement préparés et dissimulés, parfois durant plusieurs mois. Ses victimes sont souvent moins dépressives que celles de suicides solitaires.
moyen passé au niveau mondial sur les réseaux sociaux est exactement de deux heures quinze par jour, et c’est délibérément que nous y allouons notre « temps de cerveau disponible » . En juin 2025, Musk prétendait que sans lui , Donald Trump ne serait pas aujourd’hui le 47 e président des États - Unis Les preuves manquent pour en être certain, mais la capacité d’influence du réseau social a inquiété plusieurs démocraties européennes ces derniers mois
Un jour, Gaynor propose à Mike et Amanda un nouveau service , le plan « Lux » , qui permet d’intervenir directement sur l’état mental d’un individu par la simple manipulation du curseur d’une application sur smartphone Par exemple , il est possible d’amplifier temporairement la sensation de plaisir À l’occasion de leur anniversaire de mariage , Mike fait cadeau à sa femme d’une session d’une demi - journée , et positionne d’emblée le curseur d’Amanda
Mirror : votre cerveau vous appartient-il ?


à un niveau élevé. Les effets ne se font pas attendre : elle interpelle jovialement un conducteur de semi-remorque garé au restaurant, entame ensuite son burger sans attendre que Mike ait fait de même, et ce décalage se manifestera plus tard sous d’autres formes au lit, où ses extases stratosphériques l’amènent à ne pas beaucoup se soucier de son compagnon, lequel finit d’ailleurs par se demander ce qu’il fait là La désynchronisation du couple fait penser au phénomène d’atténuation empathique que peut induire une humeur très positive, comme l’a mis en évidence Hillary Devlin, de l’université Yale Cette chercheuse a montré que des personnes qui avaient une humeur positive et qui devaient deviner l’état émotionnel de quelqu’un qui racontait une expérience très éprouvante avaient plus de mal à y parvenir.
Le bout du voyage
Mais l’engrenage où le couple a mis le doigt va finir par les happer Un jour, financièrement asphyxié par un abonnement toujours plus exorbitant, Mike dévoile son identité en ligne en retirant son masque sur le site Débile Débilos pour en retirer l’argent qui lui manquait Hélas, reconnu par un collègue de travail, sa situation professionnelle devient intenable et il en vient aux mains avec l’intéressé qui termine estropié sous un
engin de chantier. Fatalement, Mike est licencié et se retrouve dans l’impasse
Un jour d’anniversaire , il parvient à offrir à Amanda trente minutes d’un boost d’humeur de Rivermind Elle choisira de placer la « sérénité » sur la position maximale, savourera l’instant avant de lui signifier que le moment tant redouté est arrivé . L’un et l’autre n’ont plus aucune échappatoire. Mike met alors à exécution un pacte suicidaire qu’ils ont scellé, réunis dans le choix tragique de se débrancher définitivement du système qui les a impitoyablement broyés
Le premier épisode de la nouvelle saison de Black Mirror est glaçant, précisément parce qu’il n’a rien de vraiment futuriste . Impossible de ne pas voir que les prémices du monde qu’il décrit semblent déjà en place Lorsque durant les débats actuels sur la régulation de l’accès aux réseaux sociaux ou de l’influence des écrans, certains dénoncent de simples « paniques morales » , on ne peut s’empêcher de frémir : s’agit-il d’une ventriloquie numérique au service d’intérêts dont eux-mêmes ne sont pas conscients, comme Amanda lorsqu’elle vente des céréales au miel ? £
H. C. Devlin et al., Not as good as you think ? Trait positive emotion is associated with increased self-reported empathy but decreased empathic performance, Plos One, 2014.
M. Frey, Netflix Recommands. Algorithms, Film Choice, and the History of the Taste, University of California Press, 2021.
M. Laakasuo et al., The dark path to eternal life : Machiavellianism predicts approval of mind upload technology, Personality and Individual Differences, 2021.
Dans sa chanson
Le 22 Septembre, Georges Brassens célèbre la fin d’un chagrin d’amour, et le regrette : « Le 22 septembre, aujourd’hui, je m’en fous / Et c’est triste de n’être plus triste sans vous » J’écoutais cette chanson dans ma jeunesse, et c’était ma première rencontre avec ce que l’on nomme « les métaémotions » : les émotions à propos des émotions Il peut exister des métaémotions « croisées » : on ressent une émotion à propos d’une autre émotion Par exemple, avoir honte de sa colère (« je n’aurais pas dû crier devant les enfants ») ; avoir peur de sa tristesse (« je ne vais pas bien depuis plusieurs jours, je crains de faire une rechute dépressive ») ; se sentir triste de sa honte (« ça me déprime d’avoir autant de complexes »), etc. Ou être heureux d’être triste, selon la définition que donnait Victor Hugo… de la mélancolie. Il peut aussi exister des métaémotions « au carré » : on ressent une émotion redoublée sur elle-même. Par exemple, se sentir triste d’être triste (chez les personnes dépressives :

CHRISTOPHE ANDRÉ
médecin psychiatre et psychothérapeute.
« C’est désolant cette vie de déprimé ») ; avoir peur d’avoir peur (chez les individus sou ff rant d’attaques de panique : « Si je commence à stresser, je vais perdre le contrôle ») ; être en colère de s’être mis en colère (chez les énervés chroniques : « C’est leur faute, ils m’ont poussé à bout, ils me le paieront »), etc
Quel bonheur d’être heureux !
Voilà longtemps déjà que les psychothérapeutes ont observé la fréquence de métacognitions (pensées sur nos pensées), notamment dans les ruminations anxieuses du trouble d’anxiété généralisée (TAG) : « Je vais devenir dingue, ou tomber malade, si je continue de me faire du souci comme ça . » Ces métacognitions sont ainsi une des cibles privilégiées de la psychothérapie cognitive du TAG Les métaémotions étaient jusqu’à présent moins explorées, mais cela pourrait changer Une étude de l’université de Saint-Louis, dans le Missouri, a examiné durant une semaine une population de 79 volontaires : plus
de la moitié d’entre eux rapportent de telles expériences de métaémotions, liées en particulier aux moments de déprime et de découragement, qu’elles ont tendance à amplifier. Une autre recherche, conduite auprès de 544 étudiants de l’université de l’Arkansas, révèle que les personnes sujettes à des métaémotions négatives ont davantage tendance à consommer de l’alcool, souvent dans l’espoir d’apaiser un mal-être profond Les psychothérapeutes soulignent que la non-acceptation des émotions douloureuses facilite la survenue des métaémotions. Lorsque je prends conscience d’une émotion douloureuse, il est préférable de ne pas lui tourner le dos : elle aura tendance à « faire des petits » et à engendrer elle-même d’autres émotions douloureuses en miroir. La solution est plutôt du côté de l’acceptation, au sens psychologique : accueillir et comprendre ce qui est là , sans chercher à le juger Le travail mené par des approches comme la méditation de pleine conscience va dans ce sens : se poser, observer ce qui se passe dans le corps et l’esprit,

quand sur la vaste mer, le vent soulève les flots, de contempler depuis la terre ferme, les terribles périls d’autrui » Il s’agit d’une métaémotion positive (soulagement) sur une émotion négative (eff roi par procuration en apercevant un vaisseau en détresse dans la tempête). Une étude néerlandaise auprès de 343 volontaires à propos de leur consommation de livres et de films tristes souligne aussi cela : se trouver confronté à des histoires dramatiques peut dans certains cas susciter des métaémotions favorables, comme le soulagement de ne pas être dans ces situations, ou la conscience de n’être pas seul à vivre des événements de vie adverses En psychologie positive, on encourage parfois les patients à prendre conscience de leurs ressentis agréables
bonheur d’être heureux, quelle chance de me sentir bien ! » Métaémotion positive au carré !
Dans ce domaine, pour le moment, l’humain est en avance sur les robots et l’intelligence artificielle : alors que ces derniers en sont encore en phase de tâtonnements quant à la capacité de ressentir des émotions, nos métaémotions montrent que nous sommes capables d’être émus par nos propres émotions ! Ce peut être pour le meilleur ou pour le pire, mais cela donne encore plus de sel à nos vies ! £
On peut avoir honte de sa colère, peur de sa tristesse, et même se sentir triste
Les métaémotions sont des émotions au carré, comme
et al., Meta-emotions in daily : Associations with emotional awareness and depression, 2019
E. M. Koopman, Why do we read sad books ? Eudaimonic motives and meta-emotions, Poetics, 2015.
H. Mitmansgruber et al., When you don’t like what you feel, Personality and Individual Differences, 2009.
A. Wells, Meta-cognition and worry : A cognitive model of generalized anxiety disorder, Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 1995.

Difficile de travailler sans une bonne tasse de café ?
Normal, la caféine est un boost pour vos neurones et améliore mémoire, concentration et vigilance. Mais avec un risque de dépendance et d’effets indésirables sur l’humeur. La clé ? Trouver la bonne dose…
£ En moins d’une heure, la caféine pénètre dans notre cerveau et commence à y produire ses effets.
£ Elle augmente la communication entre zones cérébrales et améliore la vigilance, la mémoire de travail et même les performances physiques.
£ Pris à des doses raisonnables, le café protégerait contre certaines maladies comme Parkinson et Alzheimer.
£ Un risque de dépendance existe, voire d’interaction avec la nicotine ou l’alcool. La dose de quatre tasses par jour ne devrait pas être dépassée.
Long, court, avec du lait, chaud ou froid… deux personnes sur trois boivent du café dans le monde, ce qui en fait la deuxième boisson la plus répandue à l’échelle de la planète, après le thé. L’arôme complexe, la variété des graines, des procédés de torréfaction et de préparation , font du café un univers en soi Mais les actions les plus puissantes qu’il exerce sur notre cerveau lui viennent d’une molécule psychoactive – la caféine – dont l’impact sur nos neurones est aujourd’hui de mieux en mieux documenté . Il en découle une multitude d’e ffets – stimulants, hédoniques –, mais aussi en partie addictifs ou neuroprotecteurs selon les cas, qui font que nous entretenons avec ce breuvage une relation à certains égards ambiguë Comment y voir plus clair ? Commençons par étudier la façon dont la caféine agit dans notre cerveau
La caféine booste les neurones
Une fois ingurgitée, la caféine va mettre en moyenne trente minutes pour passer dans la circulation sanguine. On dit que sa biodisponibilité est de 100 %, c’est-à-dire que toute la caféine ingérée se retrouve dans le sang et va pouvoir exercer son influence sur ses cibles dans l’organisme. Elle va aussi commencer à être dégradée, à un rythme plutôt lent puisqu’il faut entre quatre et six heures pour que la moitié de la dose absorbée ait été éliminée
La caféine pénètre dans le cerveau en traversant la fine paroi filtrante des vaisseaux sanguins, la barrière hématoencéphalique Là , elle se fixe sur des récepteurs présents à la surface des
L’adénosine est une molécule qui entraîne un état de fatigue au fil de la journée. La caféine s’oppose à ses effets en se fixant sur ses récepteurs neuronaux.
neurones : les récepteurs de l’adénosine Ces derniers sont à l’origine du ralentissement de notre activité neuronale lorsque nous sommes fatigués : au fil de la journée, notre organisme produit une molécule – l’adénosine – qui s’accumule avec la fatigue et active ces récepteurs, entraînant une baisse de la vigilance et favorisant le sommeil Or la caféine empêche justement l’adénosine de produire son action en bloquant le fonctionnement des récepteurs Dès lors, la fatigue disparaît De façon générale, le blocage des récepteurs de l’adénosine (il en existe de di fférents types, principalement les récepteurs A1 et A 2 ainsi que leurs différents sous - types) semble impliqué dans l’amélioration des performances cognitives, l’augmentation de la vigilance, le raccourcissement des temps de réaction ou la motivation à exécuter di fférentes tâches mentales mais aussi physiques On se sent plus alerte, plus motivé, de meilleure humeur et moins engourdi. C’est l’effet psychostimulant, bien connu des automobilistes qui sentent leur vigilance baisser sur l’autoroute : une tasse de café est alors la bienvenue, même si elle ne devrait jamais remplacer les pauses indispensables pour récupérer ses capacités attentionnelles. Et pour les sportifs, plusieurs études ont montré que le petit noir est de nature à booster les performances : en 2020, une métaanalyse portant sur 21 études menées conjointement par six universités anglaises, allemande, américaine et australiennes a conclu que des quantités modérées de caféine augmentent l’endurance musculaire, les performances dans les épreuves de lancer ou de
saut, ainsi que dans de nombreuses épreuves aérobies et anaérobies La cause ? Une fois de plus, le blocage des récepteurs de l’adénosine. Ceux-ci ont tendance à atténuer l’excitabilité des neurones, y compris les neurones moteurs qui commandent le tonus musculaire. Mais lorsqu’ils sont inhibés par la caféine, les contractions musculaires sont à la fois plus efficaces et durables, comme l’ont montré le chercheur Pei Zhang et ses collègues, de l’université du Connecticut
Mais quelle incidence le café a-t-il sur nos capacités intellectuelles ? À l’université de Séoul, des chercheurs ont fait passer des tests à des volontaires afin de mesurer leurs capacités cognitives. Plus particulièrement , ils ont évalué ce qu’on appelle leurs « fonctions exécutives » – comme la mémoire de travail, qui permet de garder à l’esprit diverses informations en temps réel afin d’effectuer un calcul, une comparaison, ou de tenir une conversation complexe. En laboratoire, on peut tester la mémoire de travail en faisant défiler des chi ff res sur un écran et en demandant à une personne de citer le chi ff re qui est apparu trois, quatre ou cinq positions avant celui sur lequel l'écran est arrêté. Un autre test consiste à tracer un trait reliant des chi ff res et des lettres suivant un ordre croissant et en les alternant : A-1-B-2-D7-J-9… On mesure le temps mis pour compléter la tâche et plus le temps est court, plus les fonctions exécutives sont efficientes
Les chercheurs coréens ont fait passer les volontaires dans une IRM pour observer les changements qui se produisaient dans leur cerveau avant et après l’ingestion d’une tasse de café. Les résultats ont montré d’une part que leurs scores s’amélioraient dans les tests d’évaluation des fonctions exécutives, et d’autre part que l’activité de leur cerveau se modifiait Les connexions se renforçaient entre les zones frontales et pariétales du cerveau, un circuit réputé intervenir dans les tâches cognitives demandant de la concentration et du discernement, et corrélé au niveau d’intelligence. Là encore, les auteurs de ces travaux publiés dans la revue Scientific Reports attribuent cet effet au blocage des récepteurs de l’adénosine. Alors, si le café fait du bien à la tête comme au corps, peut-on en prendre sans limite ?
L’usage excessif du café a plusieurs désavantages. À doses modérées, il est associé à une baisse de la mortalité d’origine cardiovasculaire, mais en grandes quantités, il provoque la libération d’adrénaline, qui fait grimper la pression artérielle et le
Après avoir bu une tasse de café, les zones antérieures et supérieures (cortex préfrontal et pariétal) du cerveau intensifient leur dialogue, ce qui se traduit par une amélioration de la mémoire de travail.
rythme cardiaque, pouvant aller jusqu’à des arythmies. Mais, en outre, quand on enfile les tasses à la chaîne, plusieurs phénomènes de dépendance peuvent apparaître. Certains auront noté qu’un petit noir pris au bon moment peut se montrer diablement efficace contre les maux de tête Il s’agit là d’un effet classique de la caféine. Les céphalées résultent souvent d’une dilatation des vaisseaux sanguins enveloppant le cerveau , au niveau des méninges, ce qui crée une surpression. Souvent à la suite d’un état de fatigue intense, l’organisme libère beaucoup d’adénosine, qui active ses récepteurs, lesquels provoquent alors l’entrée d’ions potassium dans les cellules musculaires qui tapissent les vaisseaux sanguins, provoquant leur relâchement : le diamètre des vaisseaux augmente et engendre la surpression douloureuse Or, en paralysant les récepteurs de l’adénosine, la caféine neutralise cet effet et réduit le diamètre des vaisseaux sanguins, soulageant le mal de tête
Fort bien, sauf que… en cas de consommation régulière de café, cet effet s’estompe Et lorsqu’on cesse de prendre de la caféine, un effet rebond peut se produire : les maux de tête reviennent en force, plus fréquents et plus intenses Pour les neurologues Camilo Jovel-Espinosa et Fidel SobrinoMejia, de l’hôpital Kennedy, à Bogotá, en Colombie, la caféine peut ainsi causer des maux de tête lorsque la consommation passe de 200 milligrammes par jour (l’équivalent de deux ou trois tasses quotidiennes) pendant plus de deux semaines à zéro Et ces maux de tête vont dès lors inciter à prendre de nouveau du café Un cercle vicieux qui n’est pas sans évoquer un schéma de dépendance Alors, peut-on parler d’addiction au café ?
Des risques d’addiction ?
Les addictions, de façon générale, font intervenir un circuit de neurones dans notre cerveau appelé « système de la récompense ». Ce système neuronal joue un rôle de premier plan dans notre quotidien, car il nous motive à exécuter certaines actions et à les mener jusqu’à l’obtention d’une récompense : le plaisir. Derrière cette émotion se cache une molécule, la dopamine
De nombreuses études, menées notamment par le Centre national des addictions américain du Maryland, ont permis d’observer que la caféine provoque la libération de dopamine dans une partie du striatum de notre cerveau, zone pivot du circuit de la récompense Les récepteurs de



l’adénosine sont de nouveau en cause En temps normal, ils freinent la libération de dopamine. Mais dès que la caféine s’y fixe et entrave leur fonctionnement, ils ne peuvent plus jouer ce rôle ralentisseur et le système de la récompense se déchaîne. Et ce d’autant plus lorsque le cerveau associe le café à un contexte plaisant. Le petit déjeuner, le café entre amis ou encore le café d’après le repas du dimanche midi contribuent à son renforcement Il serait pourtant exagéré d’a ffirmer de but en blanc que la caféine entraîne une véritable addiction Tout d’abord, de nombreuses situations ou substances mettent en œuvre le système de la récompense et procurent du plaisir, sans pour autant se transformer en dépendance : un bon dessert , un verre de vin savoureux , un rapport sexuel intense… Le lien entre plaisir, système de la récompense et addiction n’est pas automatique
Pour David Blum, chercheur à l’Inserm au centre de recherche Lille neuroscience et cognition, il existe une forme de dépendance (souvent pour apaiser des maux de tête), mais elle reste « modérée avec des manifestations comportementales plutôt limitées et qui disparaissent assez rapidement ». Cette boisson n’est généralement pas considérée comme une drogue d’abus, car ses effets et ses signes de sevrage dépassent rarement quelques jours et se limitent la plupart du temps à des maux de tête, de la fatigue ou de l’irritabilité Selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-5, qui recense notamment les troubles de l’usage de substances, on peut parler d’addiction
Récepteur de la nicotine
Récepteur de la dopamine activé
Récepteur de l’adénosine désactivé
au café uniquement dans certains cas bien définis
Des critères précis doivent être remplis, notamment une incapacité à résister à une pulsion ou à une tentation, et l’existence d’un préjudice notable pour l’individu concerné (comme l’incapacité à travailler efficacement sans la substance). Dès lors, un diagnostic de trouble de l’usage peut être suspecté si un consommateur de caféine répond à trois critères au moins sur une liste de neuf durant une période de douze mois (voir l’encadré page suivante). Selon ces indices, environ 7 % des consommateurs réguliers seraient alors identifiés comme sensibles à un trouble de l’usage du café.
Quand le café donne envie de fumer
La plupart des fumeurs auront noté à quel point le moment du café fait naître l’envie de griller une cigarette. Ce sont alors les fameuses pauses « caféclope » au bas des immeubles de bureaux Cette association s’explique par l’interaction entre les récepteurs de la dopamine et ceux de l’adénosine. Chez un fumeur, la nicotine provoque une libération de dopamine, qui engendre du plaisir en se fixant sur les récepteurs idoines. Mais ce plaisir est limité par la présence des récepteurs de l’adénosine, qui se collent aux récepteurs de la dopamine et les entravent, de sorte que la dopamine produit moins d’effet
En revanche , dès qu’on prend du café , la caféine bloque les récepteurs de l’adénosine Comme l’ont montré des recherches menées
L’action de la caféine au niveau d’une synapse En situation normale A , l’adénosine naturellement produite par le cerveau se fixe sur ses récepteurs situés à la surface d’un neurone post-synaptique. Ceux-ci entravent l’action des récepteurs de la dopamine. Lorsqu’on boit du café B , la caféine se fixe sur les récepteurs de l’adénosine : ceux-ci sont alors inactivés et ne peuvent plus freiner l’action des récepteurs de la dopamine, ce qui entraîne un surcroît de plaisir et de vigilance. Si, de surcroît, la personne se met à fumer C , la nicotine amplifie la libération de dopamine. C’est l’association café-cigarette : le plaisir est augmenté.
conjointement aux universités de Berlin , de Stockholm et de Cracovie, les e ffets de la dopamine sont alors démultipliés… Et si l’on ajoute de l’alcool, c’est le cocktail fatal ! La quantité de dopamine libérée est alors tout simplement augmentée, comme l’ont révélé récemment des travaux publiés par l’université de Vigo, en Espagne.
Une protection contre des maladies du cerveau
Le café est finalement comme toutes les substances psychoactives : ses atteintes dépendent de l’usage que l’on en fait . Tout l’art étant de choisir la dose intermédiaire qui augmentera vos capacités mentales et physiques sans produire de dépendance ni de suites néfastes sur votre système cardiovasculaire Dans ce cas, il se pourrait même que la caféine protège contre un certain nombre de maladies neurologiques Ainsi , depuis les années 2000, médecins et chercheurs étudient ses effets protecteurs contre diverses maladies, dont la maladie de Parkinson Ce trouble neurodégénératif est caractérisé par des perturbations motrices
comme des tremblements, une rigidité musculaire et des troubles posturaux. De nombreuses études, réunies en 2010 par João Costa et ses collègues, de l’université de Lisbonne, au sein d’une analyse globale des travaux sur ce thème, ont établi une corrélation inverse entre le risque de Parkinson et la consommation de café. De sorte que plus les individus boivent de café, moins ils risquent de développer la maladie. La maladie de Parkinson résulte d’une perte progressive des neurones produisant la dopamine
Si vous cochez trois des neuf critères ci-dessous pendant un an au moins, vous êtes probablement addict au café selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), comme environ 7 % des buveurs de café réguliers.
⊡ Envie persistante de café et impossibilité d’arrêter.
⊡ Consommation régulière, malgré le constat que cela cause ou exacerbe des problèmes psychologiques ou physiques récurrents.
⊡ En cas d’arrêt, symptômes de « sevrage » avec maux de tête, irritabilité, fatigue, difficultés de concentration ; et besoin de reprendre du café pour les dissiper.
⊡ Absorption de quantités plus importantes et pendant plus de temps qu’on ne le souhaiterait.
⊡ Consommation répétée de café conduisant à l’incapacité de remplir des obligations majeures au travail, à l’école ou à la maison (par exemple, retards ou absences réitérés au travail ou à l’école du fait de la consommation ou du sevrage de la substance).
⊡ Consommation malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, persistants ou récurrents, causés ou exacerbés par les effets de la substance (par exemple, disputes avec le conjoint à propos des conséquences de la consommation, problèmes de santé, coûts).
⊡ Phénomène de tolérance : besoin de quantités toujours plus élevées de substance pour se sentir bien, ou maintenir de bonnes performances ; émoussement de ces effets en cas de doses constantes.
⊡ Temps important passé à se procurer du café, à en consommer ou à se remettre de ses effets.
⊡ Envie impérieuse, fort désir ou besoin irrépressible de consommer la substance.
dans une zone profonde du cerveau appelée « substance noire ». La caféine améliorerait l’action de la dopamine en bloquant les récepteurs de l’adénosine, selon le principe mentionné plus haut. Ainsi, les neurones de la substance noire seraient plus à même de maintenir une bonne communication les uns avec les autres. Un autre effet résulterait de l’action d’un produit de dégradation de la caféine, la méthylxanthine. Selon certaines études menées par l’équipe de Pierre Sokoloff, à l’Inserm, ce métabolite provoquerait la libération d’ions calcium par les stocks intracellulaires, ce qui favoriserait la communication synaptique entre neurones et exercerait un effet neuroprotecteur…
Ces dernières années, de nombreuses études se sont penchées sur le rôle protecteur que pourrait jouer la molécule de caféine contre les maladies neurodégénératives comme celle d’Alzheimer. L’équipe de David Blum a mis en relation la consommation de café avec un risque réduit de développer cette maladie. En 2024, les résultats de l’étude Baltazar, menée sur une cohorte de 263 sujets atteints de la maladie d’Alzheimer ou de déclin cognitif léger, ont permis de montrer que plus une personne en déclin cognitif boit de café, moins elle sou ff re de troubles de la mémoire. Selon David Blum, le pivot de cet effet neuroprotecteur réside une fois de plus dans les récepteurs de l’adénosine. Ceux-ci se font de plus en plus nombreux dans le cerveau à mesure que l’on vieillit, et ils sont présents en très grande quantité chez les malades d’Alzheimer. Lorsque les récepteurs sont actifs, ils favorisent la formation de fragments du peptide bêta-amyloïde particulièrement toxiques pour les neurones : de ce fait, les bloquer (ce que fait la caféine) est donc particulièrement bienvenu. Le laboratoire travaille actuellement sur un autre essai clinique en double aveugle concernant le déclin cognitif dans la démence liée à la maladie d’Alzheimer au stade débutant à modéré. Pour cela, ils vont évaluer l’efficacité de la caféine et la comparer à l’effet d’un placebo Les résultats sont attendus pour fin 2026.
Pareils effets protecteurs sont observés à des doses de l’ordre 200 milligrammes de caféine par jour, soit l’équivalent de deux tasses de café. Mais cela dépend évidemment du type de boisson a ffectionnée Le café filtre, effectivement, procure
Les recommandations de l’agence européenne pour la sécurité des aliments sont de boire au maximum entre trois et quatre tasses de café par jour.
plus de 100 milligrammes par tasse Mais pas l’expresso. Contrairement à une idée reçue, celui-ci est plus pauvre en caféine, car le temps d’infusion est réduit : le goût amer en bouche donne l’illusion de quelque chose « qui réveille », mais ce n’est pas la caféine… Si vous optez pour un latte ou un cappuccino, les doses seront comprises entre 60 et 80 milligrammes, alors qu’un café instantané vous en procurera environ 90 milligrammes
À ces doses raisonnables, vous pourrez ainsi envisager une bonne préservation de vos neurones, et une certaine protection contre la dépression puisqu’une métaanalyse de 2020 a mis en évidence une réduction de 24 % du risque de dépression chez les buveurs modérés de café – probablement en partie à cause de la réduction de l’inflammation cérébrale permise par le blocage des récepteurs de l’adénosine et d’une stimulation de l’action de la dopamine. Les recommandations de l’Agence européenne pour la sécurité des aliments sont de boire au maximum entre trois et quatre tasses de café au quotidien, soit 400 milligrammes. Au-delà, à 500 milligrammes par jour, le toxicologue Cyril Willson avertit contre un risque d’augmenter l’anxiété, car les récepteurs de l’adénosine inhibent la libération d’adrénaline - qui stimule le système nerveux sympathique excitateur. Si on bloque trop les récepteurs, on risque de mettre en branle ce système, et d’entraîner palpitations, agitation, perturbations du sommeil, voire crises d’angoisse ou de panique
Certaines situations se prêtent mal à la consommation de café. Chez la femme enceinte, la caféine passe la barrière placentaire et atteint le fœtus À plus de deux tasses par jour, un risque de retard
de croissance intra-utérin est possible Des études réalisées sur plus de 2 000 femmes par l’Institut national de la santé des États-Unis ont établi un lien entre une consommation élevée, d’environ trois tasses par jour (environ 300 milligrammes de caféine, pour du café filtre), et un risque d’accouchement prématuré, voire de fausses couches
Le poids du bébé à la naissance pourrait être également touché, et des études sont en cours pour évaluer les risques de troubles du développement neurologique. Selon cette étude, les bébés pèseraient en moyenne 84 grammes de moins à la naissance quand la maman absorbe beaucoup de café, que lorsqu’elle n’en prend pas…
Maigrir en buvant du café ?
À ce propos, le café fait-il perdre du poids ? La caféine stimule la lipolyse, le processus par lequel le corps brûle ses graisses pour en tirer de l’énergie En outre, elle augmente les concentrations de leptine, l’hormone de la satiété… Tout cela tend à réduire le poids corporel, ce qu’a confirmé en 2018 une large étude réunissant treize essais cliniques randomisés et incluant 696 participants : pour chaque doublement de la consommation de caféine, la perte de poids corporel augmenterait de 22 % (ce qui ne veut pas dire que vous perdrez 22 % de votre poids !). Le café peut donc avoir des effets bénéfiques, à condition de ne pas dépasser 400 milligrammes de caféine par jour – soit environ quatre tasses – et de lever le pied dès six heures avant d’aller se coucher, pour ne pas risquer de perturber son sommeil. Il est alors temps de passer à un décaféiné ou à une tisane relaxante… £
bibliographie
T. M. McLellan et al., A review of caffeine’s effects on cognitive, physical and occupational performance, Neuroscience and Behavioral Reviews, 2016. H. Kim et al , Drinking coffee enhances neurocognitive function by reorganizing brain functional connectivity, Scientific Reports, 2021. M. Solinas et al., Caffeine induces dopamine and glutamate release in the shell of the nucleus accumbens, Journal of Neuroscience, 2002. J. Jastrzębska et al., Adenosine (A) (2A) receptor modulation of nicotine-induced locomotor sensitization, Neuropharmacology, 2014. J. Costa et al., Caffeine exposure and the risk of Parkinson’s disease, Journal of Alzheimer’s Disease, 2010.
Comment notre cerveau perçoit-il les odeurs ?
Cette question fascine Claire de March depuis son enfance. Il y a deux ans, sa curiosité a été récompensée. Elle a pour la première fois observé au microscope les capteurs de notre nez qui donnent naissance aux sensations olfactives.
Vous faites partie de la première équipe à avoir identifié la structure tridimensionnelle d’un récepteur olfactif, en 2023. Pourtant, ceux de la vue avaient été observés avant les années 2000… Quels ont été les obstacles à surmonter pour l’odorat ?
Le premier obstacle est tout bête : l’olfaction a été beaucoup moins étudiée par les biologistes que la vue Et pourtant, elle est au moins aussi fascinante. Songez que nous avons trois types de récepteurs visuels, mais que nous en avons
quatre cents pour l’odorat ! Cette profusion nous permet de distinguer bien plus de nuances d’odeurs que de couleurs : il y a des longueurs d’onde que nous ne percevons pas, alors que nous ne savons pas vraiment où se situent les limites de nos capacités olfactives. On suppose que l’être humain est capable de sentir entre dix mille et mille milliards d’odeurs. Ce qui fait une très, très grande marge… Mais même dix mille, c’est énorme ! Nous n’étions pourtant que quelques équipes à essayer d’observer la structure de ces récepteurs…
En plus de cela, nous nous heurtions tous à un même obstacle :
les récepteurs olfactifs, situés dans nos fosses nasales, derrière les yeux, sont des protéines particulièrement complexes à étudier en laboratoire
D’ordinaire, pour photographier des protéines, on les fait produire par des cellules humaines cultivées en laboratoire, puis on les observe grâce à la cryomicroscopie électronique
Cette technique offre une résolution à l’échelle de l’atome et fonctionne très bien : c’est ainsi que la structure 3D des récepteurs de la vue a été révélée. À ceci près que ceux de l’olfaction, en général, ne s’expriment pas dans les cellules cultivées en laboratoire… Beaucoup de chercheurs s’y sont cassé les dents

Chargée de recherche CNRS en chimie du vivant à l’Institut de chimie des substances naturelles, elle est lauréate du prix Irène Joliot-Curie 2023 dans la catégorie jeune femme scientifique.
Comment avez-vous surmonté cette difficulté ?
Nous avons cherché s’il n’y aurait pas tout de même un récepteur olfactif capable de s’exprimer dans les cellules cultivées en laboratoire. Pour cela, nous nous sommes efforcés de repérer, parmi les 400 récepteurs olfactifs humains, celui qui semblait le plus « universel », capable de s’exprimer dans une grande variété de cellules. Nous nous sommes alors concentrés sur les récepteurs présents en dehors du système olfactif, dans d’autres types de cellules. Notre hypothèse était que des récepteurs ancestraux, apparus très tôt dans l’évolution de la vie, devaient probablement remplir ces conditions Aujourd’hui, notre nez en possède quatre cents différents : pour arriver à une telle diversité, il a fallu que des récepteurs ancestraux, présents il y a très longtemps, évoluent, mutent… Ce
En partant de ces formes ancestrales, nous avons trouvé, parmi les quatre cents nôtres, un bon candidat pour être produit dans des cellules en culture en laboratoire, le récepteur OR51E2. C’est un de ceux qui ressemblent le plus à nos « consensus » ; effectivement, il est très conservé entre les espèces : sa version chez l’humain est la même que celle de la souris, du chien, de la vache… Notre hypothèse s’est révélée juste : il s’exprime magnifiquement dans les modèles cellulaires ! Nous avons pu l’observer et en tirer des images il y a un peu plus de deux ans…
Sait-on à quelle odeur réagit ce tout premier récepteur olfactif ?
Il appartient à la classe des récepteurs olfactifs de type « poisson », hérités de notre vie aquatique et qui permettent de sentir les molécules hydrophiles, solubles dans l’eau
Le premier des récepteurs olfactifs, aux origines de la vie vertébrée, devait être sensible à des molécules qu’on retrouve dans le fromage.
– Claire de March
qui les a forcément rendus de plus en plus spécifiques, certains s’exprimant préférentiellement dans certains tissus ou types cellulaires bien définis Notre nouvel objectif était dès lors de trouver les plus anciens, susceptibles de s’exprimer partout Pour cela nous avons comparé et recoupé les différents récepteurs, jusqu’à recréer numériquement un petit groupe de six que nous appelons « consensus ». Ils sont assimilables à des formes ancestrales et ressemblent à ceux d’autres mammifères ; l’un d’eux est proche d’un récepteur olfactif du crocodile
Ce qui est un autre indice de son apparition précoce dans l’évolution… Il perçoit les acides carboxyliques, qu’on retrouve notamment dans le fromage. Nous avons notamment pu photographier le moment où il capte de l’acide propionique, une molécule qu’on retrouve dans le parmesan. Ce qui veut dire que l’une des premières odeurs détectées dans le règne animal ressemble probablement à celle du fromage ! D’un point de vue évolutif, cela a du sens : les premiers organismes devaient trouver des nutriments pour survivre, or les acides carboxyliques sont émis par la fermentation Le
détecter permettait donc probablement de localiser des sources d’énergie.
Quel champ de recherche la connaissance de cette structure d’un récepteur olfactif, et de sa liaison avec une molécule odorante, peut-elle ouvrir ?
On pourra enfin saisir le mécanisme de l’olfaction, depuis le moment où une molécule pénètre dans notre nez jusqu’à celui où notre cerveau perçoit l’odeur Quand on y pense, c’est incroyable : l’homme a marché sur la Lune avant de comprendre comment fonctionne son odorat ! Pour l’instant, on en sait peu de choses, si ce n’est que nos récepteurs se comportent comme un piano… à quatre cents touches. Une molécule odorante joue une note en se fixant à plusieurs récepteurs : cela forme un accord Une touche peut aussi être activée par plusieurs molécules odorantes Ce sont toutes ces combinaisons qui créent les milliers de nuances d’odeurs que nous pouvons percevoir, mais on ne saisit pas encore tout. Imaginons qu’on reproduirait toutes les touches, une sorte de « nez virtuel » On simulerait les interactions entre les molécules odorantes et nos récepteurs, et on répondrait à des questions innombrables
Des molécules peuvent-elles « éteindre » des récepteurs ?
Les odeurs se composent parfois de centaines de molécules odorantes, mais si chacune se liait à un récepteur, les quatre cents types seraient tous activés en même temps ; c’est peu probable. Il est donc fort possible qu’une molécule odorante A puisse annuler l’activation d’un récepteur par une molécule odorante B quand ces deux molécules sont senties en mélange, mais nous n’en avons pas la certitude. On sait aussi que tout le monde ne perçoit pas les odeurs de la même manière La raison en reste
Membrane d’un neurone olfactif

Récepteur OR51E2
Acide propionique
Le récepteur olfactif OR51E2 est le premier dont la structure a été photographiée. Les chercheurs ont même pu visualiser la fixation d’une molécule odorante, l’acide propionique, sur cette protéine.
mystérieuse… Certains récepteurs sontils présents en plus grande quantité chez certaines personnes que chez d’autres ? Autre interrogation : le chien ou la souris en ont plus de mille types différents ; quelles odeurs supplémentaires peuvent-ils sentir ? En voyant directement la structure des récepteurs, on peut aussi imaginer créer des odeurs pour la parfumerie ou l’agroalimentaire… Ce serait comme « craquer » le code des odeurs Quelle combinaison pour la rose, la cannelle, la sueur ? On pourrait d’ailleurs bloquer certains récepteurs, et par conséquent les mauvaises odeurs…
Entrevoit-on des applications thérapeutiques de ces découvertes ?
Bien sûr… C’est contre-intuitif, mais on trouve des récepteurs olfactifs à d’autres endroits que dans les fosses nasales Les scientifiques ont d’abord estimé que de tels récepteurs
ne devaient pas y exercer de fonction particulière. Mais l’intérêt pour eux est monté d’un cran quand on en a trouvé dans des lignées cancéreuses Par exemple, le fameux récepteur des acides carboxyliques – celui que nous avons observé pour la première fois –s’exprime dans des cellules cancéreuses de la prostate, et son activation semble liée à la prolifération de ces cellules cancéreuses et des métastases. Mais il n’y a évidemment pas de molécule odorante à proximité des tumeurs, de sorte que ces récepteurs doivent détecter d’autres composants analogues dans l’environnement cellulaire. En les identifiant, l’espoir est de freiner cette activation Ce champ de recherche récent est très prometteur. Mais sans aller jusqu’à la cancérologie, on reconnaît aussi de plus en plus la perte de l’odorat comme une véritable pathologie Avant la crise de Covid-19, très peu de personnes savaient ce qu’est l’anosmie, alors que tout le monde savait nommer les pertes de la vue et de l’ouïe ! Cette
reconnaissance, couplée à l’avancée de la recherche, pourrait aider à développer la rééducation sensorielle à certaines odeurs, par exemple.
Justement, à propos du Covid, sait-on maintenant pourquoi certaines personnes ont d’abord perdu l’odorat puis l’ont retrouvé avec des sensations modifiées ?
Le virus attaque les cellules qui entourent et soutiennent les neurones. C’est ce qui entraîne la mort des neurones et la perte d’odorat. Mais il y a une différence majeure avec l’ouïe et la vue : les neurones olfactifs peuvent se reformer grâce à des cellules dites « basales » qui les entourent et qui les renouvellent tout au long de notre vie. La plupart du temps, on retrouve l’odorat lorsque l’infection s’arrête et que l’épithélium olfactif se reconstruit En revanche, il arrive que les connexions nouvellement formées ne soient pas identiques à ce qu’elles étaient avant l’infection. Dans ce cas, le sens revient dégradé, le café sent le nettoyant pour vitres… C’est le signe que quelque chose s’est passé de travers lors de la reconstruction des neurones : certains repoussent peut-être moins vite que d’autres Il manque peut-être vingt, trente touches au clavier complet Parmi les absentes, certaines étaient potentiellement essentielles pour sentir le café Si nous parvenons à identifier toutes les touches du clavier, nous pourrons répondre à cette question Et nous pourrons peut-être alors les réparer, comme un bon accordeur de piano. £
Retrouvez la version audio de cet entretien sur Braincast, le podcast de Cerveau & Psycho, accessible sur toutes les plateformes. Pour l’écouter, flashez ce QR code avec votre smartphone.










