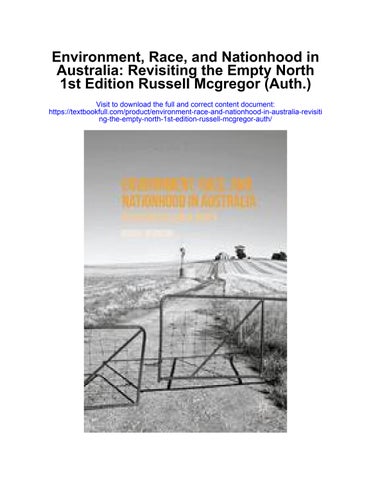A
BBREVIATIONS AND A CRONYMS
AAAS Australasian Association for the Advancement of Science
ABC Australian Broadcasting Commission
AGPS Australian Government Publishing Service
ANU Australian National University
ANZAAS Australian and New Zealand Association for the Advancement of Science
BITRE Bureau of Transport, Infrastructure, and Regional Economics
CDUP Charles Darwin University Press
CPD (HoR) Commonwealth Parliamentary Debates (Hansard), House of Representatives
CPD (Senate) Commonwealth Parliamentary Debates (Hansard), Senate
CPP Commonwealth Parliamentary Paper
CSIR Council for Scientific and Industrial Research
CSIRO Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
CT Canberra Times
CUP Cambridge University Press
FCAATSI Federal Council for the Advancement of Aborigines and Torres Strait Islanders
JCU James Cook University
JRAHS Journal of the Royal Australian Historical Society
MUP Melbourne University Press
NAA National Archives of Australia, Canberra
NAA(D) National Archives of Australia, Darwin
NADC Northern Australia Development Committee
NARU North Australia Research Unit
NAUK
National Archives of the United Kingdom
ABBREVIATIONS AND ACRONYMS
NCBD National Council for Balanced Development
NLA National Library of Australia
NTAS Northern Territory Archives Service
NTT Northern Territory Times (before 1927 Northern Territory Times and Gazette)
NTUP Northern Territory University Press
PTNC People the North Committee
QPD Queensland Parliamentary Debates
SMH Sydney Morning Herald
UNSW University of New South Wales
UQP University of Queensland Press
ZPG Zero Population Growth
L IST OF F IGURES
Plate 1 Map of Australia with the area north of the Tropic of Capricorn highlighted x
Plate 1.1 “White Australia, or the Empty North,” 1909
Plate 1.2 “A White Australia: Keep It So,” 1912
Plate 2.1 Griffith Taylor “Climograph,” 1918
Plate 6.1 Michael Terry’s expedition at the Southesk Tablelands, 1925
Plate 8.1 “The Bitumen”
Plate 9.1 Humpty Doo, 1958
Plate 12.1 Site of the Ord River Main Dam, 1970
CHAPTER 1
Anxieties Aroused
In 1907, Chris Watson, leader of the federal Labor Party, began an article on “Our Empty North” by quoting President Roosevelt’s warning against leaving it so. By then, Roosevelt’s admonition had been repeated so many times it barely needed quotation. Watson reiterated the president’s claim that rich lands lay in Australia’s north and, more stridently than Roosevelt, he stressed the dangers of Asia:
An immense area, practically unpeopled, unguarded, stretches there at our most vulnerable point, while, distant a few days steam, cluster the myriads of Asia, threatening ever to swarm across to the rich fields of a land, attractive in all respects to a frugal, industrious people, condemned at present to exist in a much poorer country.
Legions of white settlers were needed to garrison the north, he declared, and tropical Australia held the resources to sustain them.1
Watson, who had been Australia’s first Labor prime minister three years earlier, wrote his “Empty North” article shortly after touring the Northern Territory. While expressing some concern about the tropical climate, he thought it would “prove no serious deterrent to successful settlement.” The issue that consumed most space in Watson’s two-part article was the north’s suitability for farming, for as he explained: “Settlement must depend, in the main, upon agriculture.” Here, Watson conformed to long-established convention, upholding the cultivation of the soil as the only viable means of both sustaining a large population and validating
© The Editor(s) (if applicable) and The Author(s) 2016 R. McGregor, Environment, Race, and Nationhood in Australia, DOI 10.1057/978-1-349-91509-5_1
1
title to the land. Cattle-grazing offered no secure occupation, he stated, while mining was an “industry of secondary importance”: worth pursuing provided Chinese miners could be squeezed out, but unable alone to adequately people the north. Close settlement depended on agriculture, and Watson affirmed the Territory’s possession of abundant lands for that purpose.2 However, he side-stepped the question of why, if the Territory was so well endowed for agricultural pursuits, there were not already flourishing farms there. Other Australians were more perturbed by that anomaly.
This chapter explores three factors behind federation-era anxieties over Australia’s northern spaces. The first is the long history of failure to either build sound economic foundations or establish a viable population. There were some successes, all concentrated in a thin strip along the north-east coast of Queensland, but across the vast expanse from the Great Dividing Range west to the Indian Ocean, settlers were scarce and their enterprises precarious. The second section considers how Australians’ changing attitudes toward Asia influenced their perspectives on that part of the continent closest to it. After federation, the white Australia policy barricaded the nation against Asia, but as the third section shows, contemporaries were well aware that the great white walls had been breached before they had been built.
A LACKLUSTER PERFORMANCE
The first attempt at colonizing northern Australia was at Fort Dundas on Melville Island in 1824, followed by Fort Wellington on the nearby mainland in 1827. Both were abandoned in 1829. Their primary purpose was to assert British sovereignty over the north of the continent, with a secondary purpose of extending British commercial interests in the East Indies. The same motives underlay the third attempt at colonization, at Port Essington in 1838, with an additional purpose of providing refuge for survivors of the growing number of shipwrecks in the Torres Strait. Given the distance between Port Essington and the Torres Strait, the last of these motives was unlikely to be fulfilled. It wasn’t; nor was a viable trade with the Indies established, while the strategic motive quickly subsided since no rival power showed the least interest in colonizing northern Australia.3 Sickness and starvation stalked the settlement while the monsoon heat sapped the colonists’ energy. Thomas Henry Huxley, visiting Port Essington as a young surgeon–naturalist on HMS Rattlesnake in November 1848, damned it as “the most useless, miserable, ill-managed
hole in Her Majesty’s dominions.”4 A year later, the colonists of Port Essington burned the settlement to the ground and sailed away.
The American historian C. Harley Grattan observed that by the middle of the nineteenth century “the British had not solved the problem of settlement on the northern coast but they had securely established a pattern of failure which was to stand as a model for some years to come.”5 There was undoubtedly a pattern of failure, but the would-be colonizers clung to an image of northern Australia as a land with enormous potential for cultivation and commerce. Europeans then conceived the region very differently to how it is seen today. What we now call Southeast Asia was then Austral India or the Indies, an exotic land of tropical abundance, spices, and riches. Northern Australia was imagined as a southward extension of the Indies, with similar potential for agriculture and commerce. Prominent among those who promoted this vision was the entrepreneur George Windsor Earl, who spent six years at Port Essington trying to transform image into reality.6
At first, Earl’s ambition was to build a trading base in northern Australia, “an emporium of the Archipelago of the Arafura” extending along the northern coast and nourishing “a thriving trade with China.”7 Without abandoning that ambition, by the mid-1840s, his emphasis had shifted to tropical agriculture using the plentiful Asian labor available nearby. Earl envisaged a plantation economy in the region now called the Top End, with European planters supervising a numerous Asian workforce and with a multi-racial merchant community similar to that of Singapore.8 This was the conventional model for tropical colonization. Earl’s vision, shared by many of his contemporaries, presumed that the tropic lands of Australia held the fertile soils, abundant water, and other resources essential for intensive cultivation, and all that was needed to make the wilderness bloom was an injection of energy and enterprise. Such environmental optimism proved far more resilient than the aspiration for a multi-racial north.
When South Australia took control of the Northern Territory in 1863, its leaders shared Earl’s vision. They too regarded northern Australia as a southward projection of the Indies and imagined it had a climate and physiography much like Java’s. So they sought to establish tropical agriculture and cultivate trade with Asia, thereby building the combined South Australia–Northern Territory into a “Great Central State” extending from the Great Australian Bight to the Arafura Sea. They tried to do so according to the tenets of systematic colonization on which South Australia itself had been founded. Settlement would be carefully planned,
with the institutions of civilization—schools, churches, law, government— established at the outset and development proceeding in a rational and orderly fashion. But reality belied grand intentions. Bumbling beginnings at selecting and surveying a site for the capital were followed by lackluster efforts at development and settlement. Trade with Asia faltered; tropical agriculture floundered; and the Territory’s meager goldfields failed to attract a stable population. Into the 1880s, some South Australians continued to dream of Palmerston (Darwin) becoming another Singapore, but it was becoming clear that systematic colonization would not prove the success in the north that it had been in the south.9
European expansion into north Queensland was unencumbered by ideals of systematic colonization. It was conducted in brasher, more nakedly materialistic style, driven by graziers’ greed for more lands on which to pasture their sheep and cattle. Shortly before Queensland separated from New South Wales in 1859, squatters and goldminers had nudged north of the Tropic of Capricorn, as far as present-day Marlborough. In 1861, the frontier surged further north with the opening of the Kennedy district. From their base at Port Denison (Bowen), pastoralists quickly took up runs along the length of the Burdekin River and its tributaries, then pushed further west and north toward the Gulf of Carpentaria. On 1 January 1864, the government threw open two new pastoral districts, Burke and Cook, thereby making the entirety of north Queensland available to pioneer graziers.
Yet pastoralism did not reign alone in north Queensland. Plantations were established along the north Queensland coast from the late 1860s, the area under sugarcane expanding rapidly from the mid-1870s onward. Many field workers, especially in the early years, were Asian; some plantations were even owned by Asians, such as the Hop Wah plantation south of Cairns. But the majority of canefield workers were Pacific Islanders, known as Kanakas, who were indentured for periods of three years or longer, at low rates of pay and poor working conditions. Sugar was not the only crop; nineteenth-century north Queensland grew a wide range of tropical produce. But no matter what the crop, the plantation workforce was always predominantly non-white and the field laborers exclusively so. This accorded with both established practice in tropical colonies and the contemporary medical doctrine that members of the white race were unable to perform physical work in the tropics.
North Queensland’s economy was further diversified by mining, primarily of gold. After several short-lived alluvial rushes scattered around
the region, the discovery of the rich reefs of Charters Towers in 1872 put gold-mining on firm foundations. Charters Towers grew into a city of over 26,000 people in the 1880s—the biggest in Queensland outside Brisbane—with grand public buildings and its own stock exchange. With three branches of primary industry—pastoralism, agriculture, and mining—functioning with as much success as could be expected in a recently colonized region, north-eastern Queensland was set on a demographic and economic trajectory unique in tropical Australia. By the latter decades of the nineteenth century, the coastal region was reasonably populous and prosperous. West of the Great Dividing Range, things were very different, with insecure industries, little economic diversification and a tiny nonIndigenous population.
Although agricultural success stories were confined to north-eastern Queensland, they buoyed faith in the north more generally and helped sustain an image of the entirety of northern Australia as a land of tropical fecundity. What had been achieved in east-coastal Queensland, many commentators maintained, could and should be achieved elsewhere in the north. J. Langdon Parsons, South Australia’s Minister for Education and soon-to-be Government Resident for the Northern Territory, took this line after touring the sugar plantations around Mackay in 1883. From what he saw there, Parsons drew the conclusion that for sugarcane to flourish in the Territory, all that was needed was capital investment and colored labor. He betrayed no hint that factors such as climate, rainfall, and soil might be relevant to a region’s suitability for cane-growing, writing instead as if the tropical location of both Mackay and Palmerston guaranteed equivalence in sugar-growing potential.10
By the time Parsons conducted his tour of Mackay, several sugar plantations had been established in the Territory, including the Delissaville plantation on the Douglas Peninsula across the harbor from Palmerston. By 1884, £20,000 had been invested in Delissaville, for a total output of five tons of sugar that year and seven tons the year before. It folded in 1885. A few plantations struggled on but all were wound up before the end of the decade, and with them went a good deal of confidence in the future prospects of the Northern Territory.11 Maurice Holtze, curator of the government gardens at Palmerston, continued trying to prove the Territory’s suitability for agriculture by raising plots of sugarcane, cotton, indigo, tapioca, rice, tea, coffee, arrowroot, and other tropical produce. Despite success under the ideal conditions of the gardens, no crop was commercially successful. This was calamitous according to contemporary tenets
of settlement, for as Holtze explained: “Agriculture must ever remain a Country’s mainstay. Without successful agriculture no lasting prosperity is possible. The richest mines will at last become exhausted, pastoral occupation is suitable only for sparsely populated regions, but agriculture, like the brook, goes on forever.”12
For settler Australians in the nineteenth century, and well into the twentieth, agriculture meant far more than merely growing crops to fill human bellies. In a European tradition stretching back centuries, agriculture was imbued with moral qualities and the cultivation of the soil elevated to the highest form of land use, sealing claims to sovereignty over, and ownership of, the country. Colonial governments welcomed the growth of the pastoral and mining industries, but these alone could never secure the stability or density of population they sought. As the liberal member of the Queensland Legislative Assembly, Henry Jordan, explained in 1886:
To till the ground is properly to possess it. To feed sheep and cattle over the wilderness is but one remove from the occupation of it by the poor aboriginals of Australia … I think we should always remember that pastoral occupation is but one step towards what is properly called “settlement” in the Australian colonies, which, I understand, means population, agricultural progress, wealth and British colonisation in its highest form.13
This set of assumptions would course through decades of debate over northern Australia.
Although many Australians clung to an image of tropical luxuriance stretching across the north of the continent, not everyone was seduced by that fantasy. In 1882, South Australian geologist and botanist Professor Ralph Tate reported that the Northern Territory’s agricultural prospects were meager, with an unreliable, seasonally restricted rainfall and only small patches of fair-quality soil scattered across an otherwise unpromising land.14 Tate’s somber assessment drew criticism from some South Australian politicians, but this was merely a mild instance of disagreement over the agricultural potential of northern Australia which would generate a great deal of heat in future decades. It raised heated debate because the question could never be confined to mundane matters of resource appraisal but inevitably became entangled in moral and political issues concerning sovereignty and title to land.
Although the South Australian elite who propelled the colonization of the Northern Territory looked down on pastoralism and yearned for the
advent of the plough, by the 1880s, the Territory’s most viable industry was cattle-grazing. It had come across the Queensland border in the 1870s when cattlemen from that colony drove their herds westwards in search of new grasslands. This was the penultimate stage in the vast expansion of squatting that had begun west of the Blue Mountains in New South Wales in the 1810s, spreading northward and westward until it reached north-eastern Queensland in the early 1860s and north-western Queensland in the mid-1860s. The final phase came in the 1880s when the Queensland–Northern Territory cattlemen pushed across the western border of the Territory into the Kimberleys, where they met the vanguard of a smaller arc of pastoral expansion that had moved in stages up the Western Australian coast. Pastoralism was beset with difficulties, droughts, and depressions, but from the late nineteenth century, it was the most economically successful industry across northern Australia. Its big drawback was that it could never sustain a dense population.
THE AWAKENING EAST
At first, Asia represented opportunity. Early enthusiasts for colonizing northern Australia saw connectedness with Asia as a means of making the north prosperous and populous. When Fort Dundas was founded, John Barrow, Second Secretary to the Admiralty, predicted that it would soon “become another Singapore.”15 This meant acquiring a cosmopolitan social profile, drawing merchants and workers from the Indies, China, India, the Middle East, and Europe. The London-based North Australian Association, lobbying in 1862 for the colonization of the north, advertised one major benefit as “trade with the great Austral Archipelago” and another as “labor from the neighbouring archipelago.”16 These were among the strongest motives impelling South Australia to acquire the Northern Territory. Cultivating connections with Asia was less a motive for Queensland’s northward expansion but not entirely absent. Somerset was founded in 1864 near the tip of Cape York Peninsula in hope of becoming a “Singapore of Australia.”17 It met the fate of all other projected Singapores in northern Australia, quickly declining into a seedy retreat for pearlers and a ramshackle outpost of government authority. Later in the nineteenth century, many colonists continued to envisage an Asian future for northern Australia. Journalist William Sowden, who visited the Northern Territory as part of a South Australian parliamentary delegation in 1882, enthusiastically reported that local Chinese
businessmen had assured him Port Darwin would “become a second Singapore … a greater Singapore.” With equal enthusiasm, he predicted that the “future population of the Northern Territory will be two-thirds Chinese.”18 In similar vein, Mrs. Dominic Daly, daughter of the Territory’s first Government Resident, William Bloomfield Douglas, hoped to see a massive influx of Asians, for she could not “believe in any great success being attained in colonizing tropical Australia until it has become the home of the Chinese and Malay races.” This meant, she specified, not merely accepting Asian people as workers but welcoming them as culturally distinctive residents of the north:
When the entire coastline becomes a sea of waving palms, with Chinese and Malay villages fringing the shores, which are at present mere barren wastes of mangroves, with plantations of pepper, or gambier, and of tapioca and rice, the Northern Territory, backed up by the unswerving energy of the Australian squatter, miner, and planter, will present a spectacle almost unknown in the scheme of British colonization.19
In Daly’s vision of northern Australia’s future, the landscape would be Asianized but Europeans were reserved a dominant place in the social hierarchy.
While Daly lavished praise on the qualities and capabilities of Asians and Pacific Islanders, she dismissed Aboriginal people as “the most uninteresting race of human beings in the world.” Besides, they were believed to be doomed to extinction, so Daly took no heed of them when writing on northern Australia’s future:
In all other tropical countries over which the British flag flies we have taken possession of densely-populated Oriental settlements; here we have come to a country which requires such a population, and until it has been coaxed to come and to make it a home, we shall not reap the reward of the many years of toil and hardship that have been spent by the pioneers in Arnheim’s Land.20
In her view, there was something intrinsically Oriental about the tropics, and tropical lands would never reach their full potential until they had been thoroughly Orientalized.
Although Daly was adamant that Asian people must not be regarded as mere units of labor, she unabashedly celebrated their labor value when countering the “absurd and senseless” notion then gaining currency, “that
North Australia, unlike any other tropical country in the world,” could be developed by white people alone. It must be understood, she persistently reiterated, that developing the north was an instance of “tropical colonisation” and “to ensure its success different methods to those adopted in more temperate regions were necessary.”21 Many of Daly’s contemporaries, including most overseas experts on colonizing the tropics, shared her views.22 Writing on the centenary of the colonization of Australia, prominent Congregationalist pastor Robert Dale predicted that:
If tropical Australia is ever to be thickly populated, it will not be by men belonging to the great race which has created Sydney, Melbourne, and Adelaide; for they cannot endure severe and continuous labor in a tropical climate…. Englishmen, Scotchmen, Irishmen may find the capital, and may direct the labor; but the labourers themselves, who must form the great majority of the population, will be coloured people.23
But by the time Dale and Daly wrote, this long-held assumption about the tropics was under attack from devotees of an all-white Australia. Anti-Asian views had been expressed in Australia, sometimes violently, since the gold rushes of mid-century, but from the 1890s, they took a sharper edge as the notion gained currency that the East was “awakening.” Asians, it was feared, were poised to assert themselves on the world stage, perhaps overthrowing the dominance of the West. Sometimes, China was placed at the vanguard; sometimes, Japan; sometimes, an amorphous Asia was imagined to be awakening. Regardless of which Asian country roused first, geography consigned Australia to an exceptionally dangerous position, far closer to the awakening giant than any other country of predominantly European population. Northern Australia was in the most dangerous position of all, for while it was sparsely peopled, adjacent Asian countries held, in the cliché of the day, “teeming millions.” Surely, Australians thought, those millions cast covetous eyes on Australia’s north and would soon be in a position to turn covetousness into conquest. Prominent among those who forecast the imminent rise of Asia and consequent decline of the West was an English scholar resident in Australia, Charles Pearson. His book National Life and Character, first published in 1893, placed China at the center of a rising tide of colored races who would soon submerge the erstwhile “higher races” of Europe. With evident distaste, Pearson prophesied a world of independent colored nations, in which the white race would be “elbowed and hustled,
Another random document with no related content on Scribd:
Flatté mais résolu à me couvrir de honte, il poursuit : — Répétez la démonstration que je viens de faire.
Naturellement, je m’ensevelis dans un silence opaque. Et les camarades de pouffer.
Mais je veux avoir le dernier mot. Donc, je me lève et du ton le plus modéré je déclare : Monsieur, il est nécessaire que nous nous expliquions une fois pour toutes. Vous nous dites qu’AB égale CD. Je n’y vois pas d’inconvénient. Mais solliciter mon contrôle, je trouve que c’est me faire un honneur dont je me reconnais indigne. Je préfère vous croire sur parole.
Sur quoi, je m’incline profondément et je me rassieds. Les camarades se roulent.
Mais le professeur outré, l’index tendu, me désigne le dehors : — A la porte !…
Je me garde bien de protester. Sans perdre une seconde, aussi léger qu’un sylphe, je m’éclipse, tandis que le pédagogue lance à mes trousses une grêle d’épithètes malgracieuses.
Quelle joie d’échapper à cette atmosphère empestée de chiffres ! J’irai m’installer dans une classe vide à cette heure, et j’y mettrai au net mon devoir de latin. Je bénis les mânes de Cicéron, raseur insigne mais fort recommandable en l’occurrence, puisqu’il me valut cette aubaine.
Or, si je ne goûtais guère le Pois Chiche, par contre, j’aimais grandement Tacite et Virgile. La concision robuste de l’historien, son style de bronze, veiné d’or sombre, me ravissaient. Ce m’était une jouissance de le traduire en serrant le texte d’aussi près que possible, et jamais je ne plaignais ma peine lorsque j’avais à résoudre ses obscurités. Et puis j’appliquais ses sentences à la vie de collège.
Je me souviens qu’un jour, un maître d’étude, afin de réprimer quelque tumulte, condamna au séquestre les plus indomptables des perturbateurs de l’ordre. On devine que j’en faisais partie. Le vieux
domestique de confiance, chargé de me conduire à ce cachot, était fort débonnaire ; même il me dit son regret d’avoir à m’incarcérer. Mais moi je voyais en lui le satellite servile d’un despotisme exécrable, l’exécuteur des vengeances d’un Tibère ou d’un Caligula. Comme, avant de pousser le verrou, il m’engageait à me montrer désormais « plus sage », je le toisai fièrement et je lui plaquai à la face cette phrase vengeresse, empruntée à mon cher Tacite : « Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant… »
Bien entendu, il ignorait le latin et il crut à des injures.
— Ah ! monsieur, dit-il d’un ton de doux reproche, ce n’est pas bien de m’envoyer des sottises, moi je fais ce qu’on me commande…
— Et c’est là ton crime, vil prétorien, m’écriai-je, d’ailleurs je ne t’en veux pas, mais à celui qui compte sur ton obéissance. Ah ! il m’inflige la solitude pour avoir la paix !… Il aura la guerre !
Sans rancune, le bonhomme insista timidement pour que je me soumisse à l’inévitable. Mais je ne l’écoutais plus. Je lui tournai le dos. J’allai m’asseoir sur l’escabelle boiteuse qui, avec une table vermoulue, constituait le mobilier de la mansarde décorée du nom de séquestre. J’y pris l’attitude de Thraséas devant Néron et je gardai un silence digne. Dès que la porte fut verrouillée, je me mis à ruminer une invective latine où, comme de juste, les réminiscences de Tacite tenaient une place considérable. Aux intervalles de l’inspiration, j’observais les mœurs des araignées dont les toiles tapissaient, à profusion, le petit local. Et ainsi, le temps passait…
Pour Virgile, j’en raffolais encore plus que de Tacite. La magie de ses cadences, la mélodie insinuante de ses vers agrestes réveillaient mes esprits alanguis par le train-train monotone du collège. A les scander, une fièvre heureuse faisait battre mon cœur. Je conformais aux leçons de cet art souverain les lyrismes naïfs qui commençaient à me chanter dans la tête. Que j’ai aimé les Bucoliques !… Je les aime toujours. Après tant d’années, malgré tant de causes d’oubli, à travers les péripéties d’une existence mouvementée, elles n’ont pas cessé d’habiter ma mémoire. Et c’est
bien souvent que je me récite les strophes délicieuses de la première églogue :
Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi, Silvestrem tenui musam meditaris avena ; Nos patriae fines et dulcia linquimus arva ; Nos patriam fugimus, tu, Tityre, lentus in ombra, Formosam resonare doces Amaryllida silvas.
Et le final où chuchote une musique si tendrement invitante :
Hic tamen hanc mecum poteras requiescere noctem Fronde super viridi. Sunt nobis mitia poma, Castaneae molles et pressia copia lactis ; Et jam summa procul villarum culmina fumant…
Et, en contraste, le grand vers aux sonorités graves où se condensent la tristesse et l’anxiété vague qui accompagnent le crépuscule :
Majoresque cadunt altis de montibus umbrae[1] .
[1] Le latin tendant à devenir, pour un trop grand nombre de personnes, la plus étrangère des langues, il est peut-être nécessaire de traduire. Voici : « O Tityre, couché à l’ombre d’un hêtre touffu, tu cherches un air rustique sur ta petite flûte. Nous, cependant, nous fuyons par force nos labours aimés, il nous faut quitter les champs paternels Mais toi, Tityre, insoucieux et paisible, tu apprends aux échos de la forêt obscure à répéter le nom de la belle Amaryllis »
« Ici, sur un lit de feuillage, tu pourrais reposer cette nuit. J’ai des pommes douces, des châtaignes tendres et du lait caillé en abondance. Vois : déjà les toits des villages prochains commencent à fumer et l’ombre, en s’accroissant, tombe du haut des monts. »
Mais quelle traduction en prose réussirait à rendre cette poésie éolienne ? Aux amateurs de traductions en vers je signale avec plaisir la belle interprétation des Bucoliques publiée par M Ernest Raynaud chez Garnier
L’Énéide me conquit à un degré encore plus intense. A mon âge, je ne pouvais en saisir toutes les beautés ; par exemple, il va sans dire que la psychologie pénétrante de Virgile décrivant le désespoir de Didon m’échappait. Dois-je avouer que les plaintes de cette abandonnée, si émouvante pour quiconque a ressenti les souffrances d’un amour méconnu, m’ennuyaient passablement ?
Mais en vingt autres endroits du poème, j’absorbais, d’un esprit avide de splendeurs, les images grandioses dont fourmillent ces vers d’un incomparable coloris. D’instinct, j’appréciais, comme il sied, la vigueur de l’expression, la variété des rythmes, l’ingéniosité des coupes et des rejets, tout cet art sûr de lui-même et qui garde la ligne même lorsqu’il exprime les transports les plus effrénés. Ah ! la Muse de Virgile, c’est d’elle qu’il faut dire : Vera incessu patuit dea…
Comme de juste, c’étaient surtout les aventures fabuleuses et les batailles qui me passionnaient. Je me souviens que je vécus plusieurs jours enseveli dans un songe, très loin du réel, à cause de la Descente aux Enfers d’Énée guidé par la Sybille. Que de fois, depuis, je me suis répété le début de cet épisode ! Comme je sentais les ténèbres qui emplissent et l’espace fuligineux et l’âme du héros :
Ibant obscuri sola sub nocte per umbram, Perque domos Ditis vacuas et inania regna : Quale per incertam lunam sub luce maligna Est iter in silvis, ubi cœlum condidit umbra Juppiter, et rebus nox abstulit atra colorem [2].
[2] « Sombres, ils allaient par la nuit solitaire, à travers l’ombre, à travers les demeures vides de Pluton et le royaume des apparences. Ils allaient, comme sous la lune douteuse, aux clartés équivoques, vont les voyageurs dans les forêts, quand Jupiter couvre le ciel de
nuées obscures, quand la noirceur funèbre de la nuit a confondu toutes choses. » (Énéide, VI). Mais comme ici encore, il est impossible de transposer la musique des vers virgiliens !
Et les combats ! J’entendais siffler les flèches, tinter les cuirasses au choc des épées, hennir les chevaux, vociférer les combattants. J’étais épris de Camille, reine des Volsques, nouvelle Amazone, chasseresse nourrie du lait d’une cavale sauvage. Qu’elle m’était belle, menant à la charge contre les Troyens ses escadrons impétueux ! J’admirais le baudrier d’or miroitant sur sa poitrine fière et nue. Je respirais l’odeur de sa chevelure ondoyante. Je me brûlais à la flamme homicide de ses yeux. Et j’ai versé des larmes quand une javeline exécrable perça le sein de la vierge belliqueuse !…
Je n’en finirais pas si je continuais à évoquer toutes les magnificences de l’Énéide. Pour conclure, je mentionne que ce fut Virgile qui développa en moi l’amour de la grande poésie. J’ajoute que la connaissance du latin m’a rendu d’incomparables services, lorsque j’ai suivi ma vocation littéraire. Tout écrivain dont l’art s’imprègne de la sève latine, c’est-à-dire tout écrivain qui fit « ses classes d’humanité » au temps où il y avait encore des « humanités », vous tiendra, s’il est sincère, un propos analogue. Voyez Vallès. A coup sûr, ni les opinions de l’homme, ni son caractère ne sont louables. Mais il a eu beau bafouer l’antiquité, railler les études classiques, il n’en possède pas moins un style aussi solide qu’évocatoire. Nul des lecteurs de Jacques Vingtras ne me démentira. Eh bien ! tenez pour assuré que ce don de bien écrire il le doit en grande partie au fait que, bon gré mal gré, il apprit le latin à fond au collège. La marque lui en resta.
L’histoire, comme je l’ai dit, m’intéressait également. Les manuels où l’on nous la faisait étudier étaient fort secs et par trop sommaires. Le professeur chargé du cours ne suppléait pas à cette pénurie de développement et il ne savait guère ressusciter les siècles écoulés. Tout se réduisait pour lui à des récitations monotones de textes arides. Il nous bourrait la mémoire de dates et de résumés synoptiques sans prendre la peine de nous commenter, d’une parole
vivante, ces froides énumérations. Sous lui, on avait la sensation de passer en revue les vieilles tombes poudreuses d’un cimetière désaffecté.
Il importe pourtant de signaler qu’on ne nous apprenait pas que la civilisation a commencé en 1789 et qu’auparavant le monde croupissait dans la barbarie, l’ignorance et la misère. Le règne du Seignobos-Aulard n’avait pas encore commencé. Le mot de Providence apparaissait çà et là. Le rôle bienfaisant de l’Église dans la formation de la société européenne n’était pas envisagé comme un détail incongru et susceptible de pervertir nos jeunes cervelles. Bref, nos maîtres ignoraient l’art de nous inculquer l’athéisme sous prétexte de neutralité.
Ils ne nous prêchaient pas davantage l’humanitairerie aggravée de communisme. Au contraire, un véritable esprit patriotique régissait alors l’enseignement. On mettait en relief les gloires de notre pays. On cultivait en nous l’idée qu’il nous faudrait préparer la revanche sur l’Allemagne, notre vainqueur de la veille. Et l’on n’avait pas de peine à nous faire concevoir qu’un peuple, qui accepte la défaite, avec les mutilations territoriales qu’elle implique, est un peuple en décadence.
Nous comptions, comme pensionnaires, un certain nombre d’Alsaciens venus de Mulhouse et de Colmar. Parce qu’ils protestaient de cette manière contre l’annexion, leurs parents avaient à subir les sévices des fonctionnaires du Reich. Ces petits « récupérés » nous contaient les souffrances de leurs familles en butte aux vengeances prussiennes. Et ces récits navrants contribuaient à stimuler notre amour de la France.
Or, si je ne m’assimilais qu’à regret les relavures éventées et dépourvues de condiments que nous servaient nos manuels d’histoire, je voulais pourtant m’instruire. Je ne tardai pas à découvrir le moyen de substituer à ce brouet incolore un aliment plus monté de ton.
Il y avait au collège une bibliothèque où le surveillant général sollicité par moi — et qui, du reste, s’en fichait éperdument — me
permit de puiser à peu près sans contrôle.
Comme de juste, je choisis d’abord les livres qui parlaient de Napoléon. Le premier qui me tomba sous la main fut l’Histoire du Consulat et de l’Empire, de Thiers. Les vingt-deux tomes qu’elle comporte je les avalai d’une haleine.
Le style de Thiers ne m’emballa point. Traînant et grisâtre, il me fit l’effet d’une limace qui ramperait parmi les abeilles d’or du manteau impérial. La phraséologie prud’hommesque dont il affublait ses gloses m’était en horreur. Enfin, je jugeai digne de châtiment ce « sentencieux raccommodeur de vieux parapluies » — ainsi que le nomme si drôlatiquement Léon Bloy — parce qu’il poussait l’outrecuidance jusqu’à donner des leçons de stratégie et de tactique au Maître des Armées.
— Ah ! Foutriquet, disais-je, si je te tenais, avec quelle joie, usant d’un gourdin noueux, je te meurtrirais le derrière !…
Néanmoins, par le seul effet de sa narration, beaucoup plus étendue que l’exposé ratatiné des manuels, je m’aperçus que l’Empire n’était pas l’épopée radieuse, sans taches et sans défauts, que je m’imaginais jusqu’au jour où j’entrepris cette lecture. Quelque chose de l’aveuglement par orgueil monstrueux où sombra finalement Napoléon commença de m’apparaître. Ce ne fut d’abord qu’un demi-jour. Mais, lorsque je le vis en 1813, après Bautzen, refuser la paix aussi avantageuse qu’honorable offerte par Metternich, je conçus l’énormité de ses fautes politiques et je criai de douleur en découvrant les répercussions désastreuses qu’elles ont eues sur l’avenir de notre patrie.
L’idole s’effrita. J’essayai bien d’en rapprocher les morceaux en évoquant ses victoires. Mais je dus m’avouer que les suites en furent éphémères. Alors le sillage de clarté couleur de sang tracé par Napoléon à travers notre histoire me devint celui d’un météore qui n’illumine, quelques secondes, le ciel nocturne, que pour s’éteindre aussitôt. Il tombe, il éclate et ne laisse après lui qu’un peu de poussière incandescente, puis une poignée de cendres obscurcies et désormais stériles.
C’est alors que je découvris la Révolution. Cette mare fangeuse et fétide, où des énergumènes, des intrigants et des coquins pataugent, coupent des têtes et s’entr’égorgent au nom de la fraternité, me fut dépeinte comme un océan de pure lumière par l’Histoire des Girondins de Lamartine, et les dithyrambes de Michelet. On conviendra que c’étaient là deux excellentes fabriques d’idées fausses.
Nul n’a mieux jugé que Sainte-Beuve le premier de ces livres. Je le cite avec plaisir : « Je sais, écrit-il, que M. de Lamartine a plusieurs cordes à sa lyre. Or, la seule application d’un talent de cet ordre et de cette qualité à un tel sujet, à ces natures hideuses et à ces tableaux livides de la Révolution était déjà une cause d’illusion et une pente au mensonge. Aussi, voyez ce qu’il a fait ; il en a dissimulé l’horreur, il y a mis le prestige. Il y a glissé un coin de cette lune du cap Misène qu’il tient toujours en réserve au bord d’un nuage et qui embellit tout ce qu’elle touche. A travers ce sang et cette boue, il a jeté des restes de voie lactée et d’arc-en-ciel. Sa couleur ment. Même en forçant et en gâtant sa manière, il n’a pas atteint à la réalité de ce qu’il voulait peindre, ou il l’a dépassée. Au lieu d’une horreur sérieuse et profonde, il n’a produit, par ses descriptions, comme dans un roman, qu’un genre d’impression presque nerveuse. Je me demandais, en constatant cet effet de la lecture des Girondins, si c’est là l’effet que doit produire l’histoire. Je ne dirai pas que cet ouvrage émeut, mais il émotionne : « Mauvais mot, mauvaise chose. »[3]
[3] Causeries du lundi, IV Soit dit en passant, je suis enchanté de trouver ici la condamnation de cet odieux néologisme : émotionner, qui obtint, depuis, une si étrange vogue au détriment du verbe émouvoir, voué à l’ostracisme par d’impardonnables patoisants.
Je ne connaissais pas Sainte-Beuve et, si je l’avais connu, ses critiques, contredisant mon initiation émerveillée à l’outrance déclamatoire, m’auraient sans doute fort déplu. Ce qui advint, c’est que Lamartine, me jetant aux yeux la poudre d’or de cette poésie
dont il recouvre les fureurs et les crimes de la Révolution, réussit à m’éblouir d’une façon durable. L’affreux cuistre Robespierre, Marat le frénétique, d’autres monstres encore, m’apparurent de grands hommes. J’acceptai qu’il comparât ce gavroche pervers de Desmoulins à Fénelon. — Oui à Fénelon ! Comme s’il y avait quoi que ce soit de commun entre l’auteur de Télémaque et le folliculaire du Discours de la Lanterne, qui lichota, d’une langue frétillante, le couteau de la guillotine jusqu’au jour où, sa propre tête étant menacée, il préconisa la clémence !
A l’école de Lamartine, je pris aussi les rhéteurs incontinents de la Gironde pour des foudres d’éloquence, leur sottise infatuée de soi et leur politique d’hurluberlus pour de la sagesse et des vues profondes. J’admirai tout : le bonnet rouge au front de Louis XVI et du Dauphin, les diatribes enragées de l’Ami du Peuple et du Père Duchêne, le sabre de Théroigne et le tricot de Rose Lacombe, le fauteuil mécanique de Couthon, le gueuloir de Danton, les canonniers de l’ivrogne Henriot, et jusqu’à la perruque du « vertueux » Roland.
Ce fut une fièvre chaude qui alla au paroxysme dès que j’entrepris la lecture de Michelet. Celui-là me mit un incroyable tohubohu dans la cervelle. Chez lui, nul enchaînement dans le récit ; il ne se donne même point la peine d’exposer les faits. Mais, à propos des moindres vétilles et des incidents les plus saugrenus, un accès de lyrisme incohérent l’empoigne. Alors, il hurle, il sanglote, il se pâme de rire, il écume, il roucoule des alleluias ou vocifère des invectives. Tour à tour — plus souvent pêle-mêle, — il décerne le Panthéon ou condamne au barathre les fantômes qu’enfante son imagination désordonnée. Chacun de ses chapitres semble la conséquence d’une crise de nerfs. A le lire de sang-froid — ce qui n’était pas mon cas à cette époque — on croit assister aux gambades d’un dément échappé de sa cellule et qui, coiffé de son pot de chambre, pinçant d’une guimbarde échevelée, célébrerait, sur l’air de la Carmagnole, la gloire nonpareille de ses dieux lares : « les géants de 93 ».
Lamartine, le rêveur incurable, Michelet l’halluciné furent donc les écrivains qui, les premiers, me déformèrent le jugement en ce qui concerne la Révolution. D’autres vinrent ensuite, plus calmes et plus ternes, mais non moins aberrants. Ce que je tiens à souligner, c’est qu’à partir de ces lectures initiales, les principes révolutionnaires, si justement dénoncés comme sataniques, par Joseph de Maistre, se gravèrent dans mon âme. L’exaltation sans limites des droits de l’individu au grand dommage de l’esprit social, la mise en pratique de la devise : « ni Dieu ni maître, mon bon plaisir », la haine de toute règle devinrent mes directives pour longtemps. Il y eut, comme on le verra, des intervalles d’apaisement, de soumission passagère à une discipline. Mais toujours le penchant au non serviam démoniaque reprenait le dessus. Et si la Grâce n’était intervenue pour éclairer ma raison, il est fort probable que ces folles maximes continueraient de me représenter le seul Credo qu’un « homme libre » puisse admettre.
La littérature française occupait dans ma pensée une place égale à celle tenue par le latin. La saine beauté de l’art classique nous était offerte par quelques tragédies de Corneille et de Racine Cinna, le Cid, Andromaque, Athalie — Molière avec le Misanthrope. On nous faisait étudier aussi tout Boileau.
Le choix était excellent. Mais je ne goûtais pas beaucoup ces maîtres. Leur forme me paraissait trop sage ; leur sens de la mesure m’agaçait. Leur connaissance profonde de la nature humaine, je n’avais pas encore assez vécu pour en apprécier la valeur. L’adolescent, de sensibilité turbulente, que j’étais, exigeait, pour s’émouvoir, moins de pondération et davantage de cris. Il me fallait du panache, des sentiments excessifs, de la grandiloquence à fracas. Corneille m’inspirait à peine quelque considération. Racine m’ennuyait. Qu’il pardonne ce blasphème à celui qui l’aima tant depuis ! Pour Molière, ma préférence allait vers Amphitryon, toutefois sans emballement. Quant à Boileau, je le haïssais ; je le surnommais le Louis XIV des Petdeloups et je trouvais absurde qu’il
eût condamné aux verges l’auteur de Childebrand, ce patronyme hirsute me paraissant plus pittoresque que ceux d’Ulysse et d’Agamemnon.
Au contraire, les romantiques, dont je pris une première idée dans les Morceaux choisis de l’inoffensif Merlet, me conquirent tout de suite. Afin de les mieux connaître, je me fis apporter du dehors, par un externe complaisant, les poésies de Musset et plusieurs volumes de Victor Hugo. Le peu d’argent dont je disposais y passa tout entier. Ensuite, il me fallut recourir à mille ruses pour les déguster en cachette. Car, dans ce temps-là, l’Université excommuniait l’un et l’autre poète. A les lire, on risquait la confiscation, un ample pensum et les anathèmes du professeur tonnant contre « le mauvais goût ».
C’était le fruit défendu ; par conséquent, je voulais le cueillir. Là, comme partout, mon esprit de rébellion faisait des siennes.
Les apostrophes et les prosopopées un peu niaises de Rolla, les tirades ampoulées de Franck dans La Coupe et les Lèvres, la verroterie grossière, l’exotisme en fer-blanc peinturluré de teintes crues des Orientales me semblèrent des merveilles de style et de passion vraie. La bosse de Quasimodo, le rictus de Gwynplaine, je les tenais pour des modèles de pathétique dont seule la décrépitude d’un pédagogue ranci dans le classique pouvait méconnaître la splendeur
Cependant, comme je soignais beaucoup mes compositions et que la grammaire y était respectée, comme, parallèlement, je continuais de cultiver avec dilection Horace et Virgile, le professeur ne me faisait pas trop d’observations. Tout en blâmant les touches de couleur violente dont j’empâtais çà et là mes devoirs, tout en relevant avec amertume mes imitations des romantiques, il me donnait de bonnes notes. Il était rare que je ne fusse pas « premier en narration française ».
Bientôt, mon exubérance littéraire ne se contenta plus des travaux prescrits par la règle. Les images qui me bouillonnaient, comme des laves en fusion, dans la tête voulaient s’étaler librement
ailleurs. J’inventai de fonder un journal hebdomadaire, où quelques amis, qui partageaient ma fièvre, deviendraient mes collaborateurs.
Ils accueillirent ma proposition avec enthousiasme. A la besogne !…
Ce périodique — six feuilles de papier écolier cousues ensemble — s’intitula le Combat. En sous-titre : poésie, critique, libres propos. Il portait cette épigraphe empruntée au Cid et où se gonflait notre naïf orgueil : Nos pareils à deux fois ne se font point connaître !…
Un de nous, doué pour la calligraphie, recopiait les poèmes et les proses que nos cerveaux en ébullition ne cessaient de produire. Le journal paraissait tous les samedis soir, à un exemplaire et circulait clandestinement parmi nos camarades de classe, qui, moitié goguenards, moitié admiratifs, s’en disputaient la lecture.
Je dégorgeai là tout un fatras archiromantique, truffé de réminiscences d’Hugo et de Musset, et dont je ne me rappelle que ce détail : j’avais entrepris une transposition en vers de Han d’Islande que j’abandonnai d’ailleurs au troisième chant, parce que, soudain, ce labeur inepte m’assomma. Un seul vers en surnage dans ma mémoire. Le voici, truculent à souhait :
Han buvait l’eau des mers dans le crâne des morts…
Ne trouvez-vous pas qu’il résume tout le romantisme ? Pour moi, je le jugeai sublime, d’autant plus que mes émules m’en firent de grands éloges… Somme toute, il n’y avait pas grand mal à ce que nous nous dépensions de la sorte. C’était une soupape ouverte aux vapeurs volcaniques qui nous distendaient les méninges. D’autre part, le pion de notre étude celle des grands — y acquit le repos. Avant le journal, nous imaginions sans trêve de terribles farces contre lui. Devenus auteurs, pourvus d’un public, nous étions tout entiers à la production et nous le laissions tranquille. Aussi, ce martyr, objet habituel de notre cruauté plus ou moins inconsciente, apprécia si fort sa quiétude insolite qu’ayant mis la main sur quelques numéros il se renseigna auprès des « bons élèves »,
incapables de dissimuler un secret à l’autorité. Quand il eut appris de quoi il retournait, désireux de prolonger l’armistice, il feignit de n’avoir rien vu et se garda d’informer le Principal.
Le Principal le sut tout de même, et voici comment. Comme je l’ai dit, la politique absorbait non seulement tous ses loisirs, mais une partie des heures qu’il aurait pu consacrer au collège dont il avait la responsabilité.
Or, en cette année, la France était fort troublée, à l’intérieur, par les manigances des républicains qui intriguaient et se démenaient pour conquérir le pouvoir. Jamais l’Ote-toi de là que je m’y mette, cher aux démagogues, ne montra autant d’effronterie.
L’Assemblée nationale, composée, en majorité, de conservateurs et de catholiques, très honnêtes gens, mais contaminés à la fois de libéralisme et de tous les préjugés propres aux Parlements, venait de retirer sa confiance à Thiers et de renvoyer ce petit Machiavel de la Cannebière à ses faïences et à ses bronzes soi-disant d’art[4] . Elle l’avait remplacé par le maréchal de Mac-Mahon, soldat loyal et intrépide, chef d’État insuffisant. Sous la conduite de Gambetta, qui faisait le bravache à travers les provinces et lançait alors son cri de guerre : « Le cléricalisme, voilà l’ennemi », les héros futurs du Panama s’efforçaient de persuader au pays qu’on voulait le placer sous le joug « du sabre et du goupillon ».
[4] Cette hideuse collection d’apocryphes et d’objets truqués encombre aujourd’hui une des salles du Louvre.
Un gouvernement énergique et clairvoyant eût coffré ces braillards séditieux. Mais, conformément à l’incurable nigauderie dont les libéraux n’ont cessé, ne cessent, ne cesseront de donner des preuves, on ne sut pas agir vite et bien. On ne manifesta ni volonté suivie ni vigueur dans la répression. Tout en proclamant l’urgence d’établir « l’Ordre moral » on ne prit que des demimesures. On se contenta de vexations puériles ou ridicules à l’égard des agitateurs. On leur permit de tournebouler les cervelles de telle sorte que les élections de 1876 donnèrent la majorité aux républicains. La Chambre nouvelle entra en conflit avec le Maréchal.
Celui-ci, le 16 mai 1877, choisit un ministère franchement hostile à la Constitution démocratique. Puis, avec l’appui du Sénat, où les conservateurs restaient les plus nombreux, il déclara la Chambre dissoute. Une campagne électorale prolongée commença où le gouvernement n’employa que des moyens légaux — et avec quelle mollesse ! — tandis que les Républicains redoublaient de vociférations, de trafics louches, de violence sournoise. Ils finirent d’affoler la pauvre bête à vue basse qui a nom : Suffrage universel.
Les choses en étaient là au moment où nous rédigions notre journal. Bien entendu, entre nos quatre murs, nous ne percevions qu’un écho très affaibli de tout ce tumulte, assez, toutefois, pour conjecturer, d’après la mine morose du Principal, que ses opinions, fort attachées au gouvernement, ne l’emporteraient pas à Montbéliard, ville en grande partie protestante et férue des billevesées gambettistes. Autre indice d’un sérieux grabuge : en quatre ou cinq mois, trois sous-préfets s’étaient succédé. Chacun d’eux avait visité le collège et cette formalité officielle nous valut l’octroi d’une demi-journée de congé supplémentaire. Aussi ces mutations rapides nous avaient beaucoup plu tout en nous étonnant un peu.
Enfin nous avions pu prendre une vague notion de la crise politique par les discussions de nos professeurs d’ailleurs presque tous anticléricaux et républicains. Nous en saisissions quelques bribes et nous en tirions des hypothèses plus ou moins saugrenues.
Il paraissait alors une brochure périodique à deux sous qui portait ce titre : la Lanterne de Boquillon. C’était un infect recueil de quolibets, écrit en un style crapuleux et où l’Église, le Maréchal, l’armée, les conservateurs étaient copieusement insultés. Des externes l’apportaient en classe, s’en divertissaient et ne se faisaient pas faute de nous les passer après lecture.
Ici encore, des gouvernants à la hauteur de leur tâche de préservation sociale auraient supprimé, sans hésiter une minute, cet infâme torchon. Mais nos grelottants libéraux avaient bien trop peur qu’on les accusât d’attenter à la liberté de la presse pour prendre une mesure pourtant fort nécessaire. Avec un ahurissement qui
n’avait d’égal que leur inertie, ils encaissaient toutes les mornifles, se bornant à y opposer de timides objurgations et de filandreux appels à la modération.
Enclin, comme je l’étais, à tout ce qui sentait la révolte, je lus en jubilant les diatribes de Boquillon. Même, j’en transcrivis des passages que j’insérai dans nos libres-propos. Jusque-là ces notules nous servaient principalement à décocher des brocards au personnel enseignant ou administratif du collège. Parfois, après les avoir « cloués au poteau des couleurs » — comme dit Rimbaud — nous nous livrions à des danses de cannibales autour de certains professeurs que nous estimions trop fertiles en pensums et en retenues. On leur attribuait — sans en rien connaître que par des ragots ineptes — des mœurs déplorables. On parodiait leur façon d’enseigner. On bafouait leurs tics et leurs manies. D’autres fois, on imputait à l’économe des collusions ténébreuses avec les fournisseurs. Ou bien on critiquait la monotonie des menus et l’on dénonçait la coriacité des viandes servies au réfectoire. Le tout, sans trop de perversité foncière et en des termes où il entrait plus d’espièglerie que de fiel. Et enfin jamais nous n’avions abordé la politique.
Un des nôtres, qui possédait un talent précoce de caricaturiste, illustrait le Journal de dessins grotesques où Principal, pédagogues, maîtres d’étude se révélaient d’une ressemblance frappante sous l’exagération voulue de leurs défauts physiques. Ce crayon irrespectueux signait ses croquis du pseudonyme de Milo. Nous le retrouverons.
Quand j’eus introduit la politique dans les libres-propos, il y eut des protestations parmi les rédacteurs comme parmi les lecteurs. Les uns déclarèrent que la politique était, pour eux, dépourvue de tout intérêt. Les autres, que les balivernes venimeuses de Boquillon leur semblaient écœurantes au point de vue du style et de la qualité des idées. — En quoi ils avaient bien raison. — Mes collaborateurs me représentèrent le danger de répandre ces ignominies. En cas de saisie, notre culpabilité s’en trouverait aggravée.
Mais moi, rédacteur en chef, à qui le choix des matières à insérer était confié, très imbu de mon privilège, je ne voulus rien entendre. En tant que littérature, cette prose me paraissait ignoble, tout comme à mes amis. Mais elle flattait mes tendances subversives. Et donc je maintins Boquillon…
Or, dans ma famille, nous possédions une vieille cousine célibataire et munie de rentes. De ce côté, il y avait ce qu’avec un cynisme d’autant plus cocasse qu’il est inconscient la bourgeoisie appelle des « espérances ».
Calviniste austère, la cousine présentait un visage taillé dans du buis jaunâtre. Sa voix rêche, ses préceptes frigorifiques hantaient mes cauchemars quoique, depuis ma petite enfance, je ne l’eusse vue que deux ou trois fois, à de longs intervalles. Ce que je gardais surtout dans la mémoire, c’étaient ses attitudes. Elle se tenait tellement raide que je me demandais si, par mégarde, elle n’aurait pas avalé son parapluie, soigneusement roulé au préalable.
On m’avait recommandé de lui écrire au nouvel an et la veille de son anniversaire. Cette date néfaste approchait et je ne savais comment m’acquitter de la corvée. Enguirlander ma lettre de formules toutes faites, y étaler des sentiments affectueux dont je ne pensais pas le premier mot me dégoûtait. Car l’existence de cette huguenote pétrifiée m’était aussi indifférente que les phases de la lune. Qu’elle se portât bien, cela m’était égal ; qu’elle fût aux prises avec un catarrhe chronique, c’était tant pis pour elle. Alors, que lui dire ?
Ma pénurie d’imagination sur ce point me fit prendre enfin le parti le plus insensé. Avec le vague espoir de l’apitoyer sur mon sort, je lui confiai que l’internat m’ennuyait d’une façon effroyable ; que je rêvais souvent d’évasion ; que si la durée de mon séjour forcé dans cette prison se prolongeait par trop, je ferais le nécessaire pour qu’on m’expulsât. Pour comble d’aberration, j’assaisonnai le tout d’une phrase d’argot, cueillie dans Boquillon et qui témoignait du
plus intense mépris de l’autorité — universitaire ou autre. Et, à l’appui de cette élégante référence, je citais mon auteur !
Maintenant le drame commence.
Au reçu de cette épître, la cousine, rendue furieuse par ma prose sans vergogne ni fard, l’envoie au Principal en y joignant des appréciations vinaigrées sur sa manière d’élever les enfants qui lui sont confiés.
Le Principal reçoit le paquet à son bureau, vers cinq heures du soir. Quoiqu’il portât le nom pacifique de Colombe, c’était un homme irascible. En mainte occasion nous en avions eu des preuves cuisantes.
Déjà, qu’une antique demoiselle au verjus mette en doute la valeur de l’éducation qu’il est censé nous donner, cela l’horripile. Mais ce qui le courrouce encore bien davantage, c’est qu’un de ses élèves méconnaisse le bienfait de vivre sous sa loi et — surcroît d’abomination — se soit laissé influencer par un misérable pamphlétaire. Comment les libelles de l’odieux personnage ont-ils pu s’introduire dans le collège ? Tout l’ordre moral, qu’il chérit, qu’il soutient de ses votes et de son influence, lui en paraît ébranlé.
Mais s’attarder à méditer douloureusement sur ce scandale ne servirait de rien. Il faut agir… Il bondit hors de son fauteuil, renversant, du même coup, son encrier dont le contenu en profite pour éclabousser largement les paperasses qui s’étalent devant lui. Sacrant, fulminant des imprécations, il arrive comme un obus dans l’étude, où, à l’abri d’un rempart de dictionnaires, j’aiguise les Libres Propos de la semaine. Là, il éclate.
Pour commencer, il m’empoigne à bras-le-corps et me lance au milieu de la salle. Ce procédé brutal me met en rage. Au lieu de tomber à genoux en larmoyant comme il s’y attendait sans doute, je me campe vis-à-vis de lui, rouge comme un petit coq et je le toise d’un air de défi qui redouble sa colère.
D’une voix saccadée, tant l’indignation le suffoque, éparpillant à droite et à gauche des étincelles de salive, il lit ma lettre. Mes camarades, tout pantois, les yeux dilatés à se rompre les paupières,
gardent un silence d’épouvante. Le pion, blême d’effroi, sentant que la bourrasque ne tardera pas à se détourner vers lui, voudrait bien sauter par la fenêtre ou se cacher sous le paillasson.
Ayant fait l’exposé de mes crimes, non sans de foudroyantes parenthèses à mon adresse, le Principal ajoute, d’un ton sarcastique, où siffle déjà une rafale de punitions vengeresses : Ah ! Monsieur s’occupe de politique !… Nous allons voir…
Il s’interrompt ; par une inspiration soudaine, il se précipite sur mon pupitre, l’ouvre, le fouille et y découvre la collection de notre journal flanquée d’une série complète de Boquillons. Cette dernière est lancée tout de suite dans la boîte aux ordures. Mais notre chère feuille, confidente de nos rêves et de nos doléances, il se met à la parcourir en poussant des exclamations ironiques ou réprobatrices. Voici que lui saute au regard sa propre caricature soulignée d’une parodie des Châtiments, où ses opinions sont traitées sans aménité aucune. Cette contribution à sa biographie achève de lui faire perdre tout sang-froid.
Sommé, avec une insistance furibonde, de livrer mes complices, je reste bouche close. Je me laisserais tuer plutôt que de dénoncer personne. Ni invectives, ni menace ne parviennent à me tirer une syllabe.
— Soit, dit le Principal, nous éluciderons cela plus tard…
Alors viennent les sanctions. Il est signifié au maître d’étude, coupable au moins de négligence dans l’exercice de ses fonctions, d’avoir à quitter le collège dès le matin suivant.
Pour moi, mis au pain sec et à l’eau, je suis expédié au séquestre avec mille lignes à copier. Le lendemain, il me faudra écrire des excuses à la cousine de malheur qui m’attira ce revers. Le Principal lui-même préviendra mon père de mon inconduite et lui exposera les principes horribles dont je me suis volontairement intoxiqué. Enfin je serai privé de sortie jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Fort bien. J’avoue que j’avais surabondamment mérité cette répression.
Mais le Principal ne s’en tint pas là. Ce passionné de politique crut devoir gratifier les élèves et le pion, atterré, mais rancuneux, d’une harangue des plus intempestives. Il fit l’apologie du gouvernement, exalta le 16 Mai, dénigra la République et conclut en prescrivant à ses auditeurs de fermer l’oreille aux propos empoisonnés des « Catilinas de bas étage » qui sapaient l’ordre moral.
Ah ! ce fut un beau discours de réunion publique et, chose si rare, le Principal s’exprimait en bon français. Cependant, ces belles tirades ne convenaient guère à des collégiens. Et, d’autre part, il y avait imprudence à s’épancher ainsi.
On le lui fit bien voir. Les élections produisirent un renforcement de la majorité républicaine à la Chambre. Puis le Sénat aussi fut entamé gravement. L’avocasserie démagogique triomphait. Elle brima de telle façon le Maréchal que celui-ci donna sa démission. Il fut remplacé par Grévy, vieux résidu de basoche, aggravé de son gendre Daniel Wilson, qui vendait la Légion d’honneur au plus offrant.
L’infortuné Colombe, que dénonça, sans doute, le pion renvoyé, fut passé au creuset par l’autorité nouvelle, ivre de représailles. On découvrit en son cas plus de plomb réactionnaire et clérical que d’or démocratique. Le grief majeur invoqué contre lui fut son discours aux élèves qui, du reste, n’en avaient absolument rien retenu. On le mit à la retraite sans différer d’une minute.
Pour moi, le bénéfice que je tirai de sa déconfiture, ce fut la réapparition de notre journal, prudemment interrompu pendant les derniers mois de son règne. Du coup, j’y mis cette épigraphe empruntée à l’ode III d’Horace : Impavidum ferient ruinae !…
Mais j’éliminai Boquillon.
La religion qui comptait le plus d’adhérents à Montbéliard et dans le pays alentour était alors le protestantisme. La population de la petite ville se partageait entre quatre ou cinq sectes où chacun,
selon la coutume en vigueur chez nos frères séparés, prenait de la doctrine ce qui lui semblait s’ajuster à sa tournure d’esprit et laissait le reste.
Mon père aurait désiré que je continue d’être élevé en dehors de toute confession. Mais en une localité où nous avions des parents luthérien zélés, il craignit leur réprobation ; quoique j’eusse été baptisé catholique, sur les instances de ma grand’mère, il décida donc que je suivrais le culte réformé.
— Après tout, dit-il, le protestantisme c’est un moindre mal…
J’allais donc au temple le dimanche et j’assistais à la conférence que donnaient une fois par semaine deux pasteurs qui alternaient.
Autant qu’il m’en souvienne, c’étaient de fort braves gens, pieux et charitables et qui, sans obtenir grand résultat, faisaient, je crois, le possible pour nous inculquer quelques rudiments d’instruction religieuse. Leur prédication portait d’autant moins qu’au collège régnait, dans le corps enseignant et surveillant, une indifférence profonde à l’égard de toute religion. Certains professeurs même ne dissimulaient pas trop leur matérialisme agressif.
Nullement secondés, ces pauvres pasteurs étaient encore desservis par leur manque d’éloquence. Sans flamme, monotones et grisâtres, leurs discours m’ennuyaient au delà de toute mesure. Je demeurais aussi imperméable à leurs arguments qu’un manteau de caoutchouc à la pluie.
N’oubliez pas que, depuis ma naissance, j’avais entendu railler, comme inutile ou délétère, toute pratique religieuse. En conséquence de cette première éducation négatrice, j’éprouvais de la répulsion pour l’idée de Dieu. Il s’ensuivait une mise en défense presque instinctive contre quiconque eût été tenté de me la faire admettre.
Ces sentiments, je ne les manifestais guère. A quoi bon ? La religion tenait si peu de place dans nos études ! Mais je les fortifiais en moi comme un rempart contre toute tentative éventuelle sur mon indépendance follement ombrageuse.