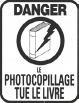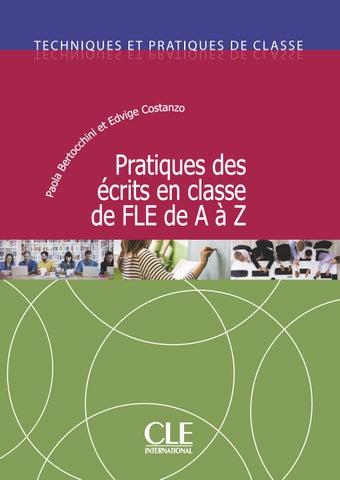TECHNIQUES ET PRATIQUES DE CLASSE TECHNIQUES ET PRATIQUES DE CLASSE
Paola BertocchinietEdvige
Costanzo Pratiques des écrits en classe de FLE de A à Z



TECHNIQUES ET PRATIQUES DE CLASSE
TECHNIQUES ET PRATIQUES DE CLASSE
Paola BertocchinietEdvige
Costanzo
Pratiques des écrits en classe de FLE de A à Z
Avertissement
Nous ne sommes pas en mesure de garantir la pérennité des liens Internet mentionnés dans cet ouvrage.
Direction éditoriale : Béatrice Rego
Conception maquette et couverture : Alinéa
Couverture réalisation : Dagmar Stahringer
Mise en page : Virginie Langlais
ISBN : 978-209-036232-9
© CLE International, 2025
92, avenue de France 75013 Paris
contact@cle-inter.com
Dépôt légal : juillet 2025
Sommaire
Deuxième Partie
22. W comme… Wow les perles !
23. X comme… X, Y, Z : générations
Z comme… Zodiaque
PRÉFACE
Lieux d’écriture, Productions écrites, Question d’écritures et aujourd’hui, Pratiques des écrits de A à Z, on ne peut pas dire qu’en matière d’écrit, Paola Bertocchini et Edvige Costanzo n’aient pas de suite dans les idées ! Mieux, chez elles, l’écriture est une gourmandise. Et elles revendiquent volontiers le plus délicieux de tous les péchés, y compris quand, à une époque, je pense aux années 1980, l’écrit n’avait pas bonne presse. Où il fallait presque s’excuser de constater que, en dépit des apparences et malgré les oukases de la didactique, pour des raisons scolaires (les épreuves d’examen en particulier) ou pour des raisons professionnelles, l’écrit constituait encore un passage obligé de l’apprentissage.
Aujourd’hui sur nos écrans d’ordinateur et surtout de smartphone, où que nous soyons, dans un bus, dans le métro, en voiture, assis sur le banc d’un parc, dans un ascenseur ou gravissant un escalier mécanique ou pas… nous passons notre temps à écrire, à envoyer et à répondre à des messages, à tchater sur les réseaux sociaux comme sur nos messageries… nous sommes aujourd’hui passés dans l’ère de l’écrit illimité.
Illimité… s’agissant d’écrit, c’est depuis toujours le parti pris de Paola Bertocchini et d’Edvige Costanzo.
On retrouvera donc dans Pratiques des écrits de A à Z ce qui relève, dans l’apprentissage comme dans la vie, de la nécessité, du plaisir et du désir d’écrire.
À la nécessité d’écrire appartient tout ce qui relève d’un passage obligé par les techniques à maîtriser de productions de textes, techniques qui ne craignent pas de recourir à un certain fonctionnalisme et qui invitent à le mettre en œuvre pour des raisons évidentes d’efficacité dans la transmission du message.
Au plaisir d’écrire, répond le penchant revendiqué de nos autrices pour une écriture libérée, sans autre objet qu’elle-même, au destinataire aléatoire, plaisir à la fois solitaire et partagé, qui convoque les dimensions créative, ludique ou imaginaire de l’écriture. Pour solliciter ces dimensions que tout un chacun, apprenant et enseignant, porte en soi, nos deux muses mettent à disposition toute une petite fabrique de textes qui invite à se nourrir et à se libérer des contraintes de l’écriture.
Quant au désir d’écrire, il naît de cette incitation qui émerge des textes lus, des plaisirs de lecture qui viennent stimuler notre envie et notre invention. On peut compter sur nos deux glaneuses pour proposer un florilège d’écrits d’amoureux de la langue, de princes des écarts avec les mots, de curieux de formes en tout genre… Incitation… imitation… Après tout, les Anciens ne vantaient-ils pas l’imitation comme première étape de la création ? Je dirais volontiers, comme premier désir d’écrire.
Pratiques des écrits de A à Z…, nous y sommes. Maintenant, c’est à vous.
Jacques Pécheur
AVANT-PROPOS
Pratiques des écrits de A à Z reprend des propositions faites pendant deux ans dans la rubrique « Questions d’écriture » que nous avons tenue dans Le français dans le Monde. Les questions et les réponses qui suivent rendent compte brièvement des finalités et des caractéristiques de l’ouvrage.
• Pourquoi cet ouvrage ?
Pratiques des écrits de A à Z se propose de systématiser et d’enrichir les approches de l’écrit en privilégiant la production écrite qui, comme l’oral, pose problème dès qu’on dépasse la phrase et qu’on a besoin de passer à des écritures plus complexes.
• Pour qui ? Et pour quoi faire ?
L’ouvrage, destiné à tous les enseignants, en formation initiale ou continue, est construit sur une démarche d’autoformation basée sur deux moments : une réflexion sur sa propre situation d’enseignement et des propositions de travail pour les apprenants(es) autour de situations d’écriture réelles ou simulées qui peuvent être facilement transposées en classe.
Il ne suffit pas, par exemple, de dire, à propos d’un/une élève « il/elle ne sait pas faire un résumé » si on n’a pas pris conscience que le « faire court » d’un résumé implique une série d’opérations qui s’apprennent et qu’il faut donc maitriser, en tant qu’enseignant, pour pouvoir les enseigner à son tour.
• Quand et comment l’utiliser ?
En complément d’un manuel, pour préparer des activités d’écriture en fonction d’un parcours qui donne plus ou moins d’importance à l’écrit….
À la carte, en fonction des besoins, envies, curiosités… Le tableau synoptique (pp. 42-44) avec les contenus détaillés permet des entrées en adéquation avec les nécessités et les choix de l’enseignant(e).
• Qu’est-ce qu’on y trouve ?
Des situations d’écriture. Chacune d’entre elles est organisée de la manière suivante :
a) une Présentation de la situation en trois points :
- rappel des caractéristiques linguistico-culturelles d’un élément déclencheur qui pourra tour à tour concerner un lieu, une modalité, une typologie, etc. ; - justification du choix d’utilisation de l’amorce en question en classe de FLE ;
- proposition d’une démarche pédagogique, à destination des enseignants, avec exemplification des tâches et des activités qui mènent à une production écrite.
b) une Fiche de travail avec des activités pour la classe : elle indique le niveau des destinataires, l’objectif de la tâche finale en production écrite et les matériaux à utiliser (médias, internet, textes littéraires…). Pour chaque activité, on précise l’organisation du travail (individuel, binôme, groupe, plénière…) et la/les compétence visée (CO, CE, PO, PE, mixte).
Première partie
L’écrit, les écrits
Chapitre 1
Écrit vs oral : codes et grammaires
Langue écrite et langue orale sont deux codes différents d’une langue qui se mettent en place de façon hétérogène selon une série de paramètres :
- la communication écrite est décalée, la communication orale est immédiate et en présence, orientée par l’intonation et les gestes du locuteur et par les réactions de l’interlocuteur ;
- le scripteur ne partage pas le même espace spatio-temporel que le destinataire, il n’est pas présent et il peut ne pas être connu ; vu ce décalage, le scripteur a la possibilité de revoir et, éventuellement, modifier son écrit, ce qui n’est pas possible à l’oral ;
- le texte est structuré de manière rigoureuse selon les conventions de l’écrit (orthographe, ponctuation …) et claire pour ce qui est de la syntaxe et du lexique utilisé.
Mais il y a aussi des similitudes entre langue orale et langue écrite. À l’oral, les répétitions, les ruptures, les pauses pour chercher un mot existent pour les plus jeunes comme pour les adultes, pour les plus faibles comme pour les plus forts. À l’écrit, la production d’un texte exige aussi des tentatives, des essais, des pauses, indépendamment de la compétence en langue avant d’arriver à sa forme définitive. Ces remarques élémentaires qui montrent les différences et les points de contacts entre les deux codes, oral et écrit, ont donné lieux, dans le temps, à différents choix en didactique des langues.
On doit aux approches communicatives la prise de conscience que, dans le domaine de la compréhension orale, les pratiques de classe en vigueur, sous prétexte de faciliter la tâche aux apprenants, se basaient sur des exemples d’oral tout à fait artificiels, dus à la persistance de deux clichés majeurs :
- l’oral est la transcription de l’écrit ;
- la langue orale doit privilégier un registre « standard ».
Pour avoir raison du premier, il suffit de rappeler que la compréhension orale et la compréhension écrite jouent sur deux plans différents, dus à la matérialité de l’un et à la volatilité de l’autre. Les processus qui en découlent voient ainsi, pour l’écrit, la possibilité du retour au texte à travers des lectures successives, des aides visuelles (ponctuation, mise en page, alinéas…), alors que pour l’oral on est devant
L’écrit, les écrits
l’impossibilité de reprise du message, qui reste éphémère avec et malgré toutes les informations qui peuvent l’accompagner (gestes, mimiques…).
Quant au deuxième cliché, si les traits de l’oralité, tels que les hésitations, les reprises, les phatèmes, les ruptures syntaxiques… servent à faire la différence avec l’écrit, on a vite fait de constater que les registres de l’oral sont bien loin du prétendu « standard », tout à fait artificiel, et qu’il faut assumer la nécessité de parler d’une grammaire du français oral.
1. GRAMMAIRE DE L’ORAL : TRAITS DE L’ORALITÉ
Quand on dit « grammaire », l’association immédiate qui vient à l’esprit est « règle ». Qu’elle soit prescriptive (liée à un bon usage identifié dans les milieux académiques) ou simplement descriptive (liée à l’usage tout court), la norme est là pour rappeler que le cœur de toute grammaire est fait de régularités, et le français oral n’y échappe pas. Compte-tenu de ce que les deux codes de l’oral et de l’écrit partagent, il reste des traits porteurs dans le français courant, distinctifs de la grammaire de l’oral, que l’on peut ainsi résumer :
- disparition de certains temps verbaux comme le passé simple (remplacé par le passé composé), l’imparfait du subjonctif (remplacé par le présent) et le futur (remplacé par le futur proche) ;
- remplacement du syntagme sujet-verbe par des formes emphatiques (c’est eux qui…, c’est un ami que…) qui, permettant l’utilisation de formes invariables, facilitent la compréhension.
- élimination du ne de la négation (je veux pas…, je parle pas…) accompagné de phénomènes de contraction phonétique (ex. ch’ais pas pour je sais pas ou ch’uis pas pour je suis pas).
- généralisation de l’emploi de on comme forme pronominale remplaçant tour à tour nous (on sort ce soir au lieu de nous sortons ce soir), tu et vous (alors, on regarde la télé, les enfants ? au lieu de vous regardez la télé, les enfants ?), ils (on me l’a dit hier au lieu de ils me l’ont dit hier).
- interrogations intonatives (vous partez ?) ;
- éléments phatiques pour assurer la communication (c’est mardi ! ce soir pas de sorties - t’as compris ? - tu restes à la maison) ;
- phrases incomplètes (la salade avec tomates ou sans ?).
2. GRAMMAIRE
DE L’ÉCRIT :
COHÉRENCE ET COHÉSION
L’écrit aussi, comme l’oral, a ses spécificités.
Dans sa tentative de répondre aux sempiternelles questions « Qu’est-ce qui fait la cohérence d’un texte ? » ou « Y a-t-il vraiment une différence entre cohérence et cohésion ? », ou encore « Est-ce la cohérence compréhensive de la cohésion ou viceversa ? », la littérature spécifique présente des différences d’école assez importantes à l’égard de ces deux notions. Comme il ne s’agit pas de prendre position pour l’une ou l’autre de ces écoles, la définition et l’illustration des deux notions ici proposées sont celles retenues dans la pratique scolaire courante.
La cohérence est déterminée par l’ancrage du texte au contexte et se manifeste comme une « continuité de sens ». Elle concerne la structure sémantique d’un texte et demande au lecteur :
- une compétence linguistique qui le rend capable de gérer les marques de cohésion que le texte comporte ;
- une compétence référentielle adéquate donnée par son « encyclopédie », l’ensemble des connaissances qu’il peut activer pour les confronter avec le texte, l’élaborer et donc le « comprendre » ;
- une compétence « textuelle » proprement dite, liée à l’activation de scénarios cognitifs concernant les différents types de textes, qui permet la mise en œuvre des capacités inférentielles.
La cohésion est traditionnellement définie comme l’ensemble des éléments linguistiques dont le texte se sert pour assurer la liaison entre ses différentes parties ; elle est donc liée à l’organisation interne du texte.
Élément de la cohésion, mais relevant aussi de la cohérence, la coréférence comprend les différents moyens permettant à deux ou plusieurs unités linguistiques de renvoyer au même référent. Ces moyens se divisent en deux groupes : les premiers - endophoriques - renvoient au contexte verbal (ou « co-texte »), les secondsésophoriques - ne deviennent compréhensibles que s’ils peuvent être rapportés au contexte énonciatif.
La cohésion endophorique est assurée par les procédures de reprise (anaphore) et/ou d’anticipation (cataphore) suivantes :
- l’anaphore lexicale (ou réitération), effectuée à travers des opérations de substitution qui permettent d’établir des relations entre mots présentant des équivalences de sens à des degrés différenciés, telles que :
• la répétition ;
• la périphrase ou la paraphrase ;
L’écrit, les écrits
• la synonymie, l’hyperonymie, l’antonymie ;
• l’emploi de termes d’ordre général (chose, matière…)
- l’anaphore grammaticale qui comprend des phénomènes comme :
• la pronominalisation (pronoms personnels de troisième personne, démonstratifs, possessifs) ;
• l’ellipse, omission d’un ou plusieurs mots que le contexte ou la syntaxe demanderait ;
• les concordances des formes verbales ;
• l’emploi de certains déterminants (article défini, adjectifs démonstratifs, possessifs)
- les connecteurs, éléments linguistiques qui servent à établir des relations entre deux propositions (connecteurs intraphrastiques) ou deux phrases (connecteurs transphrastiques), à valeur logique, spatiale ou temporelle. Parmi eux :
• des formes assimilées aux adverbes qui assurent au texte une articulation sur le plan de la logique (cependant, toutefois, pourtant, bref…), de la succession (puis, enfin…) … ;
• des conjonctions de coordination ou de subordination (donc,mais,bienque,car…) ;
• des prépositions (à cause de, à force de, après…).
La cohésion ésophorique est assurée par la deixis, référence à la réalité extralinguistique, dont les formes les plus fréquentes sont la deixis de personne, la deixis spatiale et la deixis temporelle.
Les déictiques personnels se réfèrent à la personne qui parle/écrit (pronoms de première personne je / nous) ou aux destinataires de l’acte d’énonciation (pronoms de deuxième personne tu / vous).
La deixis spatiale renvoie au lieu de l’énonciation et s’exprime à travers les déictiques spatiaux (adverbes de lieu, adjectifs et pronoms démonstratifs qui mettent l’énoncé en rapport avec la situation dans l’espace…).
La troisième, la deixis temporelle, renvoie au moment de l’énonciation et se matérialise avec les déictiques temporels (adverbes de temps et, plus généralement, éléments linguistiques qui mettent l’énoncé en rapport avec la situation temporelle de l’énonciation).
Chapitre 2
Écrit et apprentissage : comment on apprend
1. LE PROCESSUS COGNITIF
Le terme « cognitif » est notamment lié à la connaissance et la cognition « désigne l’ensembledesactivitésperceptives,motricesetmentalesmobiliséesdansletraitement de l’information en provenance de l’environnement » (Cuq 2003 : 44). Cela donne lieu à un processus que l’on peut ainsi synthétiser, de manière volontairement simplifiée :
1. saisie et sélection des éléments d’information nouveaux que l’environnement présente à une personne en situation d’apprentissage implicite (ex. expérience de vie quotidienne) ou explicite (tâche scolaire) ;
2. traitement de l’information par la mémoire de travail (à court terme) ;
3. sémantisation des éléments traités dans la mémoire à long terme d’où ils seront récupérés pour être réactivés selon les besoins.
Dans ce processus, où les acquisitions se présentent comme une conséquence de l’activité mentale, l’apprentissage ou la mémorisation n’ont pas d’existence autonome. L’activité mentale débouche sur un produit, la compréhension ou la production langagière par exemple, mais ce n’est pas celui-ci qui est stocké par le sujet. « Ce qui est stocké, c’est l’activité mentale qui en est la cause et qui met en jeu, à son tour, un traitement perceptif, des opérations psycholinguistiques... et qui fait que le rappel, loin d’être une simple réactivation de traces latentes, correspond à une nouvelle construction mentale basée sur les traces laissées par une activité mentale antérieure » (Gaonac’h, 1987 : 108).
Et pendant l’activité d’apprentissage, on ne passe pas directement d’un état d’ignorance à un autre de compétence, mais plutôt par différents états de compétence transitoire selon les stratégies d’apprentissage mises en jeu par l’apprenant. C’est là le principe majeur de l’hypothèse constructiviste qui, depuis ses premières formulations par Piaget, enrichie des apports sociocognitifs de Vygotsky et interactionnels de Bruner, se voit aujourd’hui aux prises avec les modèles connexionnistes, systèmes computationnels fondés sur les principes du traitement de l’information neuronale qui ont l’ambition d’expliquer les mécanismes sous-jacents aux changements comportementaux en cours pendant le développement cognitif.
L’écrit, les écrits
Mais, sans nier la place croissante que ces derniers modèles prennent dans la connaissance du processus d’apprentissage, il nous semble que l’idée de l’activité mentale structurante peut encore être considérée comme l’aspect le plus intéressant pour l’enseignement/apprentissage des langues étrangères, car elle permet aussi de reconsidérer certains processus d’acquisition comme les interférences langue maternelle-langue étrangère ou l’utilisation de routines, encore liées à une explication de type behaviouriste à cause du poids exercé sur l’activité mentale par l’environnement. Loin de nier l’importance de ces processus, le constructivisme souligne la nécessité d’insérer leur rôle dans le contexte plus large de stratégies qui utilisent des processus à la fois différenciés et dépendent de l’activité mentale de l’apprenant. Celle-ci, à son tour, selon une première hypothèse, comporte une approche formelle du langage et s’exerce de manière abstraite, rationnelle car « le développement d’un processus d’acquisition ne consiste pas à apprendre les règles du système mais à les découvrir, ou plus exactement à en établir un système intériorisé. Les interactions avec l’environnement sont fondées sur le postulat qu’il fonctionne bien selon ce système de règles, faute de quoi celui-ci doit être modifié en conséquence » (Ibidem, p. 121)
En réalité, toujours selon Gaonac’h, lorsqu’on apprend une langue, ce sont des situations de langage qu’on apprend et c’est sur celles-ci que l’activité mentale s’exerce, ce qui comporte la mise en place de compétences multiples et variées et lie l’efficacité de la compétence de communication/interaction aux conditions dans lesquelles elle est censée se réaliser.
Le fait que les activités de langage soient structurées par des objectifs plus larges que le simple linguistique comporte aussi la prise en charge, du point de vue des acquisitions, de la complexité des activités langagières dans lesquelles, comme dans toute activité mentale complexe, on peut distinguer entre opérations dites de haut niveau (concernant l’organisation sémantique, discursive et pragmatique du discours) et opérations de bas niveau (concernant la morphosyntaxe, la phonologies et la graphie). Si celles-ci sont suffisamment automatisées, davantage d’effort mental sera disponible pour les opérations de haut niveau.
L’acquisition des différentes fonctions et grammaires d’une langue est donc liée à l’intégration efficace entre les deux types d’opérations, ce qui, pour la langue étrangère, pose le problème ultérieur des tâches d’apprentissage, car ce sont les schèmes d’action, les « programmes » qui doivent être au cœur des démarches pédagogiques à privilégier et non pas les produits/comportements. Mais si certains acquis permettent aujourd’hui de parier sur cette priorité à garder pour le développement de méthodologies conséquentes dans tout apprentissage, quel est l’état des lieux dans le panorama des langues étrangères, surtout pour ce qui est de l’écriture et des écrits ?
2. LES MÉTHODOLOGIES
On sait que l’enfant apprend à comprendre et à parler la langue maternelle avant d’aller à l’école et qu’il apprendra par la suite à lire et à écrire. Mais ce qui est évident pour la langue maternelle ne l’est pas, ou pas toujours, pour une langue étrangère et la didactique des langues a vu alterner différentes méthodologies qui ont donné, dans le temps, la priorité à l’apprentissage de l’oral sur l’écrit ou vice-versa, ou encore à la coexistence des deux.
La méthode grammaire-traduction (xixe siècle et début xxe), par exemple, privilégie l’étude des textes littéraires qui font l’objet de questions écrites et sont utilisés aussi pour l’apprentissage du vocabulaire et de la grammaire. L’oral est limité à la lecture à haute voix et, dans le meilleur des cas, à des « classes de conversation » ; l’écrit, quant à lui, se résume à la pratique de la traduction sous l’aspect du thème et de la version.
L’avènement de la méthode directe (Mauger Bleu, à partir des années 1950) déplace l’attention sur l’apprentissage de l’oral introduit par l’enseignant qui parle tout le temps en langue étrangère pour amener les élèves à la parler eux-mêmes. On privilégie le vocabulaire quotidien, à la base de textes fabriqués exprès pour ce type d’apprentissage ; la phonétique et la grammaire sont à l’honneur et l’accès à l’écrit se fait à travers des exercices de grammaire explicite avant d’aboutir à l’utilisation des textes littéraires.
L’apparition des méthodes audio-visuelles (Méthodologie Structuro-globaleaudiovisuelle = SGAV, à partir des années 1960) bouleverse la donne en donnant la priorité absolue à l’apprentissage de l’oral et en repoussant le « passage à l’écrit » à un deuxième moment. À la base linguistique du structuralisme et de la psychologie behaviouriste s’ajoute l’apport de la psychologie de la Gestalt et on arrive alors à une vraie codification des moments de la classe de langue ainsi définis :
- présentation de dialogues fabriqués pour l’apprentissage par des films fixes et des bandes enregistrées ;
- mémorisation des dialogues ;
- exploitation du vocabulaire et de la grammaire proposés, choisis sur la base de leur fréquence et de leur rentabilité ;
- utilisation de tableaux et des exercices structuraux pour la mémorisation des structures ;
- réemploi de l’acquis à travers une dramatisation ou une conversation.
C’est l’approche communicative (à partir des années 1980) qui provoque une véritable révolution dans l’enseignement/apprentissage des langues par le fait de donner
L’écrit, les écrits
la même importance non seulement à la langue orale et à la langue écrite en tant que codes, mais aussi et surtout à la variété qu’ils présentent et qui amènent à parler des oraux et des écrits. Il s’agit, dès le début, de présenter aux apprenants des documents authentiques où la langue est toujours contextualisée et les implicites culturels ne sont pas négligés.
La perspective actionnelle (à partir de la fin des années 1990), dernière en date des méthodologies contemporaines, part de la considération que l’apprenant d’une langue est déjà un usager et donc, en tant quel tel, « un acteur social ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier… » (CECR : 2002, p. 15). L’approche communicative s’enrichit de notions comme l’interaction et la médiation, qui s’ajoutent aux quatre compétences classiques, et privilégie le constructivisme comme référant psychologique. L’apprentissage de la langue est concrètement organisé autour d’une « tâche réelle », souvent complexe, à diviser en sous-tâches plus simples qui comprennent aussi des tâches classiques d’apprentissage.
Dans ce contexte, l’écrit reprend aussi sa place en début d’apprentissage, car dans la vie réelle les écrits sont partout : dans la ville, à la maison, à l’école… L’introduction des documents authentiques, à l’oral comme à l’écrit, due à l’approche communicative, a ouvert le chemin à l’analyse des situations de communication en classe des langues ; avec la perspective actionnelle les situations de communication et d’interaction sont appelées à être authentiques autant que possibles.
La production écrite aussi, déjà passée, avec l’approche communicative, de la réalisation de phrases à celle de textes de la vie courante (d’une prise de notes à la main à un texto, à un courriel, …) se doit d’être non seulement cohérente du point de vue de la mise en texte mais aussi de la mise en discours situationnelle.
Certes, nombreuses sont les capacités à acquérir, d’ordre intellectuel (organiser et formuler des idées), mais aussi d’ordre langagier (connaissance de l’orthographe, de la grammaire et de la syntaxe) ; à plus forte raison la production écrite pose problème quand il ne s’agit pas de langue maternelle mais de langue étrangère.
La collection Techniques et pratiques de classe propose aux enseignants de langue et aux étudiants en formation des ouvrages pour répondre aux questions théoriques et pratiques que pose l’enseignement des langues.
Chaque titre de la collection contient une introduction méthodologique générale et des fiches de différents niveaux pour une application immédiate en classe.
Pratiques des écrits en classe de FLE de A à Z
Ce guide pour enseigner l’écriture en FLE, alliant théorie et pratiques concrètes, explore les différences entre écrit et oral, les objectifs de l’écriture, les types de textes à enseigner, et propose des activités variées, y compris numériques.
Objectifs
Développer chez les apprenants une maîtrise de l’écrit en FLE en alliant techniques, créativité, plaisir, efficacité et activités motivantes
Organisation
1. Partie théorique et didactique (8 chapitres) : les spécificités de l’écrit en FLE, ses finalités, les types de textes à enseigner, les méthodes d’apprentissage expliqués de manière claire et facile à mettre en pratique.
2. 24 fiches pédagogiques pratiques variées et directement exploitables en classe.