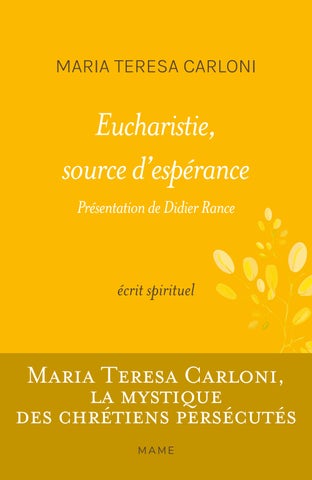Eucharistie, source d’espérance
Présentation de Didier Rance
Maria Teresa Carloni, la mystique des chrétiens persécutés
MAME
MARIA TERESA CARLONI
Eucharistie, source d’espérance
Présentation de Didier Rance
Présentation de Didier Rance
Traduction de Dominique de La Rochebrochard
Traduction de Dominique de la Rochebrochard
écrit spirituel
Présentation
UNE VIE DONNÉE
À sa mort, le 17 janvier 1983, Maria Teresa Carloni laisse à ses concitoyens d’Urbania, petite ville d’Italie centrale, le souvenir d’avoir fondé la section locale des donneurs de sang et, sinon, d’avoir été une femme malade, pieuse, effacée et connue pour son humilité – avec ce fait étrange d’une noria de cardinaux et d’évêques lui rendant visite.
Qui fut Maria Teresa Carloni1 ? Née en octobre 1919 dans une famille noble et aisée, orpheline à trois ans, élevée par une grand-mère sévère, enfant pieuse mais dégoûtée avant ses dix ans par la médiocrité et l’inconduite de prêtres, adolescente révoltée (sa devise : « Le possible je l’ai fait, l’impossible je dois le faire »), elle s’est éloignée de l’Église.
1. Pour découvrir sa vie de façon plus détaillée que dans les pages qui suivent, voir D. Rance , Maria Teresa Carloni. Mystique au service des chrétiens persécutés, Paris, Salvator, 2020.
Quand la guerre éclate, elle s’engage à Rome comme infirmière. Mais le jeune médecin avec qui elle va se fiancer est tué sous ses yeux par une patrouille trop nerveuse alors qu’ils rentrent une nuit d’une mission médicale. Sa vie semble finie. Retournée à Urbania, elle louvoie entre tentation du suicide et velléités littéraires.
En 1951, malgré son aversion pour l’Église, elle accepte d’aller quérir le père Campana, curé de la paroisse, pour porter les derniers sacrements à sa grand-mère, et se surprend à lui demander une rencontre. Elle vient le voir le 6 avril et, après des heures de discussions et de confession, connaît une conversion foudroyante et décide aussitôt de servir le Christ et les pauvres. Des tentatives de vie religieuse lui montrent que là n’est pas sa voie. Libérée de tout souci matériel par sa fortune, elle consacre sa vie, sous la direction du père Campana, à prier pour la sanctification des prêtres et sert comme infirmière dans un camp de réfugiés victimes d’une inondation du Pô puis dans un préventorium d’enfants touchés par la tuberculose.
C’est là qu’une voix intérieure s’impose peu à peu à elle, lui demandant de se donner totalement à Jésus. Le père Campana prend conseil pour en discerner l’origine. Convaincu qu’elle est celle de Jésus lui-même, il demande à la jeune femme de ne rien forcer, d’attendre1. Bientôt, la voix lui demande si elle accepte de s’offrir avec Jésus
« pour le salut de beaucoup ». Elle répond : « S’il le veut, je le veux ». Le Vendredi saint suivant elle souffre la Passion
durant trois heures1. Elle est ensuite stigmatisée et connaîtra désormais d’incessantes souffrances, des attaques démoniaques, des phases de dégoût de vivre et d’agonie.
Toujours habitée par le désir de servir toujours davantage les pauvres, elle reçoit de la voix la demande de s’offrir pour les victimes de Staline et de ses affidés, surtout évêques et prêtres. Elle répond : « Si le Seigneur le veut et s’il me donne la force nécessaire, j’accepte. »
La Vierge Marie est aussi entrée dans sa vie avec la conversion. Elle écrit en 1954 un traité de spiritualité mariale de 1619 pages qu’elle envoie à Pie XII.
Sa vie prend peu après un tournant étonnant : non plus seulement ses prières et ses souffrances offertes pour l’Église persécutée mais aussi des actions. C’est alors qu’elle écrit, entre juin 1955 et février 1956, les Méditations sur l’eucharistie, ainsi que les neuf Lettres au père Campana sur l’eucharistie (dont cinq reprennent une des Méditations) qui composent le présent ouvrage.
CONTEXTE DE CES MÉDITATIONS
La vie de Maria Teresa est en 1955 tout sauf tranquille. Elle ne s’est nourrie que de l’eucharistie durant tout le Carême, dans la plus grande discrétion. Elle revit tous les vendredis les « Trois Heures » et celles du Vendredi saint ont été particulièrement éprouvantes : agonie, sueurs de sang, couronne d’épines, accablement par les douleurs des stigmates et de blessures – des coups apparaissent sur son
1. Elle les revivra quasiment tous les vendredis jusqu’à sa mort, où qu’elle soit. Le lecteur des Méditations eucharistiques comprendra vite combien celles-ci sont irriguées par son expérience mystique de la Passion du Christ.
corps. Ses journées à Urbania sont bien denses : messe quotidienne à la paroisse1, bréviaire, chapelets, chemin de croix, prières pour les prêtres, et par les initiatives caritatives et sociales – elle crée la branche locale des donneurs de sang, offre le sien autant qu’elle le peut et monte une école de soins infirmiers.
Mais c’est surtout le temps des premières missions derrière le Rideau de fer, à la demande de la voix. Elles ont commencé à distance, à l’automne 1954, quand elle offre la souffrance qui la saisit pour le cardinal Stepinac prisonnier en Croatie. Puis elle se rend une nuit de décembre par bilocation en Pologne auprès du cardinal Wyszyński, emprisonné depuis des mois. Le chef de l’Église de Pologne est alors abattu à cause de la répression contre son Église et de son impuissance. Mais, dans les jours qui suivent, son moral change du tout au tout, comme le montrent ses Notes de prison2. La rencontre suivante ne fut pas moins étonnante, quoique physique. Le 5 juin 1953, Maria Teresa rencontre à Innsbruck les cardinaux
Stepinac et Mindszenty, pourtant tous deux assignés à résidence dans leurs pays respectifs d’où ils se sont éclipsés3. Ils l’informent sur la situation de leurs Églises et lui donnent un message de leur main pour Pie XII. Dès son
1. Jean XXIII lui permettra en 1962 d’avoir une chapelle dans sa maison. Au témoignage de Giuseppe Mangani, jeune voisin qui vient servir la messe, son visage quand elle communie est radieux et inspirant (D. Rance , Maria Teresa Carloni , p. 122).
2. Après sa libération, il se rend à Rome et y rencontre chez Pie XII Maria Teresa. Il authentifie sa mission devant le pape, puis par écrit (D. Rance, Maria Teresa Carloni , p. 91).
3. Détails dans D. Rance , Maria Teresa Carloni , p. 76-81.
retour, elle obtient d’être reçue par le pape. Convaincu par les documents qu’elle lui remet, il la charge aussitôt d’une mission à la basilique Saint-Pierre, puis la met au défi de distinguer des hosties consacrées de celles qui ne le sont pas, ce qui donne lieu à un miracle eucharistique sous les yeux du pape.
Rentrée à Urbania, Maria Teresa commence, le 21 juin, à écrire dans un grand cahier des Méditations sur l’eucharistie, tout en déployant par ailleurs une grande activité d’écriture : deux études sur la messe, une sur Angèle de Foligno, deux cahiers de Méditations diverses, un commentaire de l’Apocalypse, des réflexions sur divers sujets.
Elle achève sa quinzième Méditation le 25 juillet, puis repart pour une semaine sur un bateau dans les eaux grecques où elle rencontre de nouveau le cardinal Stepinac, ainsi que le cardinal Wyszyński et des représentants d’Églises persécutées, qui lui remettent de nouveaux messages pour le pape. De retour en Italie, elle écrit une Méditation et le rapport qu’elle remet à Pie XII le 20 août, avant de reprendre le 25 son cahier pour neuf nouvelles Méditations. Elle revoit le pape le 30 septembre, et rédige encore six Méditations du 5 au 17 octobre, suivies de trois autres du 3 au 11 novembre et d’une non datée. Enfin, elle écrit ses quatre dernières Méditations en trois jours, du 12 au 14 février 1956 – au total, 257 pages manuscrites, auxquelles s’ajoutent des Lettres sur l’eucharistie1.
Les voyages, naturels ou surnaturels, les « Trois Heures », les souffrances lancinantes et la fatigue d’écrire des nuits entières épuisent Maria Teresa. Elle est si affaiblie que, lors d’un voyage à Rome, elle tombe dans la rue et manque passer sous un autobus. Mais on cherchera en vain dans ces pages des plaintes, et pas plus des révélations personnelles, car elle s’efface devant ces missions dont elle se sent indigne – insistant sur sa petitesse et sa faiblesse dans une rare confidence, la nuit du 25 au 26 août, alors qu’elle vient d’écrire la Méd. XVII1 (comment Jésus Eucharistie nous introduit à la Vie véritable) et, la même nuit, la Lettre VII sur Marie, Mère de l’humanité :
Je suis trop misérable et trop nulle pour pouvoir supporter le poids de tant de faveurs célestes, qui transforment la grâce en souffrance rédemptrice et la souffrance en grâce sanctificatrice. À dire vrai, je ne regrette pas les dons reçus, mais je ne peux pas m’empêcher de répéter souvent : « Miserere mei, Deus », et ces mots qui s’écoulent avec la sincérité du cœur me rendent plus calme et plus préparée2.
Mais ne nous y trompons pas : sa vie est le soubassement de ce qu’elle écrit.
1. Les références aux Méditations sont indiquées par l’abréviation Méd. suivie de leur numéro et, éventuellement, de celui du paragraphe concerné.
2. Cité dans A. Di Chio et L. Mirri, Una donna nel Cuore della Chiesa , Bologne, Minerva, 2003, p. 464.
LA COMPASSION ACTIVE POUR LES PERSÉCUTÉS ET L’EUCHARISTIE
Pourtant, martyrs et persécutés, au cœur de sa vie, semblent bien peu présents dans ses Méditations sur l’eucharistie, sinon dans les Méd. IX et X. En réalité, il n’en n’est rien. Maria Teresa nous livre là le cœur de sa pensée, liant en une gerbe serrée les martyrs, la croix, l’eucharistie, la foi, la charité, le combat eschatologique entre Bien et Mal, le salut.
Il nous révélera comment toute l’œuvre de son Église, qui marque sa présence au monde, doit toujours être entravée et combattue pour former ce corps mystique des âmes qui, à travers les siècles, les luttes et les martyres, s’opposera au royaume du mal pour préparer son Royaume, qu’il remettra ensuite au Père à la fin des temps, comme trophée de son triomphe.
Il nous révélera comment nous, ses âmes, devons porter la croix de la vie de notre temps, des persécutions des hommes et de Satan, car c’est seulement ainsi que nous lui appartiendrons. Nous serons alors dignes d’entrer un jour dans sa gloire, lui qui déjà comme Chef est assis à la droite du Père, prépare son corps mystique, le sanctifiant dans la douleur, dans la vérité, et le nourrissant de sa très sainte humanité1.
Les hommes plongés dans les ténèbres ne l’ont pas reconnu, l’ont rejeté, ont repoussé de la terre sa très sainte humanité, persécutant jusqu’à aujourd’hui ses œuvres, son Église, chassant la vérité de ses voies ; ils ont inventé des
fables, se sont fait passer pour des dieux, eux qui ne sont qu’une poignée de poussière que la mort disperse et destine à l’oubli1.
Pourquoi ce rôle éminent donné au martyre pour la construction du Royaume ? Partons des paroles de Jésus : pour être son disciple, il faut prendre sa croix et le suivre2. Pour aller où ? Là où la sienne le conduit, les Évangiles le montrent. La première annonce de la Passion précède cette injonction3, qui s’adresse à tous : le martyre est l’horizon de toute vie chrétienne, comme l’affirme Vatican II4. La précision « chaque jour5 » implique de plus que les modalités de la croix sont plurielles – si les martyrs prennent la croix au sens le plus évident, ascètes et pénitents seront vite considérés comme des martyrs non sanglants. Parmi eux se trouvent, quoique rares, les mystiques qui souffrent la Passion avec Jésus – ainsi le premier stigmatisé connu, saint François d’Assise, qui livre son secret quand il demande deux grâces à Jésus : avant de mourir ressentir la souffrance endurée dans la Passion et ressentir son amour de charité sans mesure en celle-ci6. Maria Teresa, mystique et « Apôtre de l’Église persécutée7 », voit
1. Méd. X, 7.
2. Mt 10, 38 et 16, 24 ; Mc 8, 34 ; Lc 9, 23 et 14, 27 ; voir aussi Jn 15, 20.
3. Mt 16, 21-23 ; Mc 8, 31-33 ; Lc 9, 22.
4. « Que si cela [le martyre] n’est donné qu’à peu, tous doivent être prêts à confesser le Christ devant les hommes et à le suivre sur le chemin de la croix » (Lumen Gentium 42).
5. Lc 9, 23.
6. Troisième considération sur les stigmates.
7. Titre d’un des ouvrages en italien qui lui sont consacrés.
de façon assez similaire sa vie unifiée entre souffrance1 et charité. Elle écrira :
J’ai beaucoup souffert, mais plus je souffrais, plus je sentais que je pouvais encore souffrir. J’ai cru avoir compris ceci : les persécutés, les martyrs pour avoir confessé le Christ, face au martyre, savent résister. Ce qu’humainement parlant on semble incapable de concevoir, c’est que la force qui existe dans ces créatures fragiles prend un visage surnaturel, le visage Divin2,
et le cardinal Tomášek (qui a connu la persécution et la prison) lui écrira de même :
Qui travaille pour le Règne de Dieu fait beaucoup. Qui prie pour le Règne de Dieu fait mieux encore. Qui souffre pour le Règne de Dieu fait tout. Voici votre mission3.
D’autre part, le propre de l’eucharistie, pour Maria Teresa, est de faire passer de la foi à la charité, de la croyance à l’union et à la communion (un autre nom pour l’eucharistie). C’est le sujet de la Méd. XII (voir aussi Méd. IV, 6). Dans l’eucharistie, Jésus a trouvé le moyen le
1. Elle n’a pas d’appétence pour la souffrance en soi : « La souffrance ne me plaît pas », écrit-elle en mai 1958, ajoutant : « Est-ce de l’orgueil ? » (A. Di Chio et L. Mirri, Maria Teresa Carloni. Apostola della Chiesa perseguitata , Pérouse, Éd. Archidiocèse, 2005, p. 230).
2. 5 avril 1963 ; cité par Campana, Una Missione per la Chiesa perseguitata , p. 182.
3. A. Di Chio et L. Mirri, Maria Teresa Carloni. L’Apostola della Chiesa perseguitata , Gorle, Velar, 2019, p. 22.
plus sage pour que nous soyons avec lui par la foi et surtout l’amour de charité :
Le sacrement d’amour de Jésus est le divin réconfort qu’il a voulu nous laisser avant de nous quitter. Dans son amour immense et délicat, bien que tout-puissant, il a choisi de demeurer parmi nous de manière inouïe : tout en étant réellement présent, il est également caché pour cultiver notre foi et notre désir de le rechercher par l’amour1.
Or la perfection de l’amour de charité auquel l’eucharistie nous conduit, ce sont les martyres et les luttes, car c’est par eux que le Corps mystique informé par l’eucharistie se construit (voir ci-dessus, Méd. IX). Avant que Vatican II l’écrive2 et que Jean-Paul II, dans la bulle d’indiction du Grand Jubilé, affirme ce primat de la charité dans le martyre, Maria Teresa le propose. Sa méditation nous renvoie aux premières générations de chrétiens liant dans l’eucharistie souffrances et présence du Christ (Lettres de saint Ignace d’Antioche ; Actes des martyres ; décisions papales3…) et, à notre époque, aux témoignages de martyrs et de confesseurs de la foi4. Ils éclairent ces Méditations et ils en sont éclairés.
1. Méd. XXV, 1.
2. « Le martyre est considéré par l’Église comme une grâce éminente et la preuve suprême de la charité » (Lumen Gentium 42).
3. Félix Ier demande au iie siècle que les messes soient célébrées sur un Mémorial de martyr.
4. Martyrs de l’eucharistie tels Mgr Coba (Albanie), Mgr Romero (Salvador), ou ceux des attentats lors de messes au Nigeria, au Pakistan... Voir aussi le réconfort apporté par l’eucharistie dans les camps et les prisons et les mouvements eucharistiques clandestins, par exemple en Lituanie (Chrétiens de l’Est, 30, 1981, p. 73-76).
Dans un monde où toute souffrance est à fuir (fut-ce dans l’euthanasie), cette vision de la vie eucharistique comme participation au « corps livré » et au « sang versé » pour la rémission des péchés, tournée vers les fins dernières, pourrait sembler passée, dépassée, tout comme le martyre. Mais non ! Guerres, épidémies, misère, perte du sens moral et existentiel et d’autres fléaux frappent notre humanité, et l’Église. Nous ne pouvons en être complices mais devons vivre entre deux paradoxes : agir pour l’avènement du bien et reconnaître que la souffrance et la croix sont un passage obligé pour que cette lutte soit victorieuse, tout comme on ne peut dissocier l’Homme de la Croix du Christ glorieux de Pâques.
L’eucharistie nous aide à le vivre, « source inépuisable de vie spirituelle » selon Vatican II (Perfectae Caritatis, 6), tandis que Jean-Paul II nous invite à être « toujours des âmes eucharistiques pour pouvoir être d’authentiques chrétiens » (19 août 1979). L’eucharistie peut transformer une existence, Maria Teresa en témoigne. Elle précise souvent dans ses médiations que la vie eucharistique est une vie doublement cachée : Jésus comme caché, « condensé1 » dans l’âme et l’âme en Jésus2 (tout en étant tournée vers l’amour et le service des autres) : les deux reviennent plus de soixante fois dans ces Méditations.
Dans un monde qui retourne au tragique, ces Méditations font partager ce qu’est une âme « eucharistique »
1. L’expression « condensé » est patristique, cf. H. U. von Balthasar, « L’Eucharistie », Communio II, 5 (1977), p. 33-37. Cf. Méd. X, XI et XVI.
2. Sujet de la Méd. II. Voir aussi Méd. IV, 13 ; Méd. VI, 1, 5, 8 ; Méd. XI, 9.
dont il a tant besoin et son martyre (sous une forme ou une autre). De telles âmes ont existé dès les débuts de l’Église puis dans une cohorte de saints, existent encore, cachées, et nous recevons d’elles (cf. Méd. II, 11-12). C’est une vocation authentique (les contrefaçons existent). Mais même si une telle âme ne nous est pas donnée au niveau où elle le fut à Maria Teresa, avec le prix à payer, nous pouvons, comme la Cananéenne de l’Évangile, en demander des miettes. C’est pourquoi « l’héritage de Maria Teresa Carloni appartient à toute l’Église1 ».
UNE MYSTIQUE DE LA VIE EUCHARISTIQUE
Le terme eucharistie est fort riche : celle-ci est sacrifice et Présence réelle, célébration liturgique (messe), sacrement, mystère, mémorial de la Passion, gage du Ciel, communion, Pain de Vie et Coupe du Salut, source et sommet de la vie chrétienne ; elle fait l’Église2… On pourrait cependant s’étonner du peu de place apparente de la messe dans ces Méditations3 : c’est que Maria Teresa prépare à la même époque deux essais sur celle-ci, convaincue que
toute une vie de prière et de pénitence ne pourra avoir la valeur, même de façon infinitésimale, des dons et des grâces reçues en une seule messe bien suivie et vécue4.
1. Mgr Loris Capovilla, secrétaire de saint Jean XXIII (20 février 2003), cité par D. Rance , Maria Teresa Carloni , p. 106.
2. La Table analytique du Catéchisme de l’Église catholique (CEC) propose neuf rubriques pour ce terme ; celle sur L’Identité de l’eucharistie offre treize entrées. Pour approfondir : Kevin Irwin, Models of the Eucharist , New York, Paulist Press, 2005.
3. La Méd. XXI lui est consacrée ; indications pratiques dans les Méd. XXVI à XXXVI.
4. Dans Comment je vis le Saint sacrifice, non publié
Ces Méditations sont, pour leur part, centrées sur le mystère de Jésus Eucharistie et la vie de l’âme « eucharistique ». Bien avant que le Synode de 2005 ne popularise l’expression, elles offrent un bon exemple de culture eucharistique. L’eucharistie est vue comme éducatrice qui transforme l’âme et la conduit de la vision de la foi à celle de l’amour – jusqu’au passage de la mort, « rêve d’amour devenu réalité » (voir ci-dessous).
Les chapitres sont courts et, à la mesure de la richesse du sujet, ne suivent pas de plan rigide ; tout au plus les Méditations I à IX sont plutôt centrées sur la relation à Jésus, les Méditations X à XV sur le Ciel, les Méditations XVI à XXV sur la vie eucharistique et les Méditations XXVI à XXXVI sur les dispositions et fruits de la communion. Les confidences et même le je sont absents, le style est sobre, les superlatifs rares quoiqu’un lyrisme contenu perce çà et là (ainsi Méd. IX ou Méd. XXXVIII, 2).
Comment devenir une âme « eucharistique », but de la transformation désirée par Jésus pour nous ? Maria Teresa
Carloni propose ceci :
[Avoir] une grande douleur face au péché. Cette grande douleur, immense, nous la ressentirons quand nous éprouverons une grande haine vis-à-vis du péché, que nous utiliserons comme une lame tranchante au sein de notre être1.
Car le péché constitue la vraie mort, alors que Jésus donne la vie dans l’eucharistie (cf. Jn 6, 54 ; ici Méd. XVIII, 6).
Vidée de soi-même, nue (Méd. I, 10), l’âme peut alors être apprivoisée par Jésus et, dans l’intimité avec lui, amour qui cherche l’amour et s’y abandonne (Méd. III, 7 ; 12), participer à la mission confiée sur la croix à l’Église, devenue coopératrice du mystère pascal qui nous sauve et auquel participe toute la Trinité (Méd. XXIII, XXIV, et surtout la dernière, Méd. XXXVIII).
Deux Méditations (V et XXXVII) et cinq lettres (IV à VIII, originales sauf la IV) sont consacrées au lien profond entre la Vierge Marie et l’eucharistie. Maria Teresa part aussi du « corps livré » et du « sang versé » car Marie y est présente comme à la croix :
De même que, dans la vie terrestre, Marie coopéra à notre sanctification, mourant mystérieusement avec lui au Calvaire et nous prenant comme ses enfants, conformément à sa volonté, de même maintenant, dans l’eucharistie, cette Mère, notre Mère admirable et très douce, nous apparaît proche, intime au grand mystère qu’il accomplit dans les âmes1.
Il y a ici une forte convergence avec ce qu’écrira des décennies plus tard Jean-Paul II2. Ce qu’il écrit, « par sa vie tout entière, Marie est une femme “eucharistique” » (Ecclesia de Eucharistia, 53), est développé par Maria Teresa : tous deux mettent au miroir de l’eucharistie Marie à la croix, mais aussi les autres épisodes mariaux
de l’Évangile, ainsi l’Annonciation (Ecclesia de Eucharistia 55 – Lettre V), la Visitation (Ecclesia de Eucharistia 55 ; 48 – Lettres VI et VII), Cana (Ecclesia de Eucharistia 54 et Redemptoris Mater 21 – Lettre VIII). Comme plus tard Redemptoris Mater (21 ; 40 ; 41), Maria Teresa met aussi l’accent sur l’action de Marie à l’intérieur du rôle d’unique Médiateur de son Fils dans l’eucharistie. Pour Jean-Paul II, « Marie conduit les fidèles à l’eucharistie » (Redemptoris Mater 44). Pour Maria Teresa Carloni, dans l’eucharistie, cette Mère, notre Mère admirable et très douce, nous apparaît proche, intime au grand mystère qu’il accomplit dans les âmes. L’eucharistie opère par son intermédiaire, Marie est la médiatrice de cette action si profonde parce qu’il nous sanctifie par son humanité, instrument de l’œuvre de Dieu. Et son humanité ne vient-elle pas toute de Marie1 ?
Il me semble entrevoir dans ce mystère eucharistique la plus grande efficacité de la vertu médiatrice de la Vierge. En effet, c’est ici, dans le mystère eucharistique, que la Vierge est proprement médiatrice, nous offrant l’humanité qui nous sanctifie, l’humanité du Christ qui est toute sienne2.
La pointe de cette mariologie eucharistique pourra sembler trop audacieuse : Marie y est appelée « Mère de l’eucharistie ». Mais il n’en est rien : après les intuitions
1. Méd. V, 4-5.
2. Méd. V, 7 ; voir aussi Méd. XXII, 1 et 7 ; Lettre VIII.
de saint Éphrem, Jean Gerson, Docteur très-chrétien pour sa rectitude doctrinale, développe ce titre (Traité sur le Magnificat, 1428).
La Méditation XIX sur l’eucharistie et le temps est une des lignes de force du texte, auquel elle donne son soustitre dans l’édition italienne. Maria Teresa y développe, sans les mots qu’elle ignore, la distinction faite par Paul Tillich entre chronos, le temps quantifié, et kairos, le temps qualifié. Dans l’eucharistie, le temps n’est plus écoulement mais présence : Jésus est le seul dont les hommes répètent aujourd’hui ce qu’il a dit et fait car il est toujours présent dans le sacrement pour le dire et le faire. L’eucharistie est ainsi tension eschatologique entre le déjà-là et le pas-encore, que souligne l’expression de Maria Teresa « temps consommé1 » (titre de la Méd. XIX), tension annoncée par Jésus le Jeudi saint (Mc 14, 35 ; cf. 1 Co 11, 26), qui creuse la soif des fins dernières :
Tout en rassasiant l’âme avec le pain si doux du Ciel, Jésus suscite la soif, au plus profond de l’âme, de le désirer, lui qui se donne caché pour regagner ensuite le monde invisible2.
Nous ne laissons plus errer notre esprit, nous apaisons nos fantasmes et mettons en sommeil nos passions. En mettant tout en lui, nous oublions le lieu où nous nous trouvons, et
1. Consumato signifie à la fois « consommé » et « consumé » – l’italien a les deux sens (c’est un écho évident du « Consumatum est » de Jésus sur la croix dans l’Évangile de saint Jean). Après avoir hésité entre les deux possibilités, nous retenons « temps consommé » (par analogie à Lumen Gentium 48, cité dans CEC 1042).
2. Méd. VIII, 2 ; cf. Méd. XV.
le temps passe tellement vite qu’une heure avec lui semble un instant1 !
L’eucharistie est donc le véritable chef-d’œuvre de Jésus Christ : c’est un chef-d’œuvre divin qui trône entre le temps et l’éternité, conduit le Ciel à la terre et la terre au Ciel, consume tout ce que l’homme peut donner à Dieu et que Dieu peut recevoir de ses créatures2.
La mort est l’autre grand kairos de l’eucharistie, qui est son viatique (Méd. XXV, 4), et qui y conduit l’âme « eucharistique » par l’espérance qui ne sera pas déçue (Méd. VIII ; Méd. X ; Méd. III, 4). Pleine de celle qu’éprouve Maria Teresa Carloni, la Méditation se fait ici lyrique :
Qu’est donc la mort pour l’âme eucharistique ? Rien d’autre qu’un rêve d’amour devenu réalité ! Lorsqu’elle recevra l’eucharistie comme viatique, elle qui s’est toujours nourrie pour se nourrir à la vie éternelle, elle exultera d’une joie indicible, et, se serrant contre Jésus, qui a été sa vie, elle ne se préoccupera de rien d’autre que de s’accrocher à lui pour ne plus jamais le quitter. Elle sera dans l’éternité bienheureuse, alors que son corps, calice de son âme sainte, reposera au tombeau en attendant l’aube de sa résurrection3.
Enfin, grand témoin de la Passion, Maria Teresa est aussi témoin de la victoire du Ressuscité, mentionnée en Méd. II, 1 et Méd. XXV, 11, et elle écrira plus tard :
1. Méd. XIX, 2, cf. Méd. V, 12, 13.
2. Méd. XXI, 15.
3. Méd. XXV, 11.
Finalement les cloches sonnent ; donc le Christ est ressuscité ! Je l’ai attendu, tant attendu ! […] Le Christ a vraiment envahi un monde en attente, mais en attente de quoi ? De rédemption peut-être ; mais au train où vont les choses, il faut reconnaître que c’est avec un cœur angoissé, pour lui offrir des exactions, de la vengeance, de la haine, des calamités, des tortures, de la persécution, des pleurs, de la déception et du désespoir. Le Christ ressuscité se penche sur une terre martyre, écoute les vociférations des pervers, les chants des martyrs… Peut-être voudrait-il maudire les premiers et bénir les seconds, mais ce n’est pas le cas : c’est la Pâque de la résurrection, de la vie, pour tous et pour tous1.
APRÈS LES MÉDITATIONS SUR L’EUCHARISTIE
Maria Teresa poursuit ses rencontres par bilocation, y compris dans le Goulag, et ses autres missions d’intermédiaire entre l’Église persécutée et Rome. Le soutien de quatre papes, de Pie XII à Jean Paul II2, et l’amitié des chefs des Églises persécutées appartiennent à l’Histoire. Outre ses voyages physiques et rencontres surnaturelles, elle organise des aides en y dépensant sa fortune et suscite des générosités, publie des ouvrages sur le cardinal Beran,
1. Cité dans D. Rance , Maria Teresa Carloni , p. 126-127. Tout comme la Transfiguration, « dite par erreur miracle, car elle est en fait cessation du miracle, Jésus y fut pour la première et dernière fois montré dans son essence réelle divine (le miracle, était et est son humanité) » (Diario di una mystica nella Terra del Signore, Milan, Edizioni Terra Santa, 2016).
2. Y compris Paul VI qui, tout en faisant mener l’Ostpolitik du Vatican, lui dit le 25 février 1963 : « J’approuve, je bénis, j’encourage et je supplie de continuer votre ministère en faveur de l’Église persécutée selon les directives de mon saint prédécesseur Pie XII » (Vincenzo Speziale , Maria Carloni Stigmatizzata , Tavagnacco, Segno, 2014, p. 92). Il lui fait octroyer le privilège de conserver le saint sacrement dans sa demeure privée.
sur l’Église bulgare, des Vies de saints (Véronique Giuliani, Josaphat Kunciewicz, Venceslas de Prague) et écrit d’autres textes inédits. Elle aide aussi l’Église persécutée au Soudan, adoptant plusieurs séminaristes et s’y rendant pour un voyage risqué en 19601.
Usée par les souffrances et la maladie, elle meurt en janvier 1983. Sa cause de béatification est ouverte le 1er octobre 2016 dans son diocèse et elle se poursuit désormais à Rome.
I L’eucharistie transforme l’âme 21 juin 1955
Dans l’adorable sacrement eucharistique, Jésus ne purifie pas seulement l’âme, il la transforme pour qu’elle devienne un seul corps avec lui, qu’elle devienne membre de son corps mystique, qui est son Église.
Cette finalité est celle du divin Sauveur depuis qu’il a annoncé le mystère. C’est le désir de Jésus : faire des siens un seul corps avec lui, comme lui n’en forme qu’un avec le Père et le Saint-Esprit puisqu’ils ont la même nature divine. Merveille des merveilles, qu’il faut comprendre, pénétrer, avoir le désir de mettre en œuvre dans la force de la vertu divine. Parce que, sans Jésus, nous ne valons rien et ne pouvons rien. Ni beaucoup, ni peu, juste rien.
Mais, bien qu’en demeurant par essence ceux que nous sommes, en ayant conscience de notre moi, comment pourrons-nous réellement nous transformer ?
Cette transformation est une élévation qui n’est pas due à notre nature, et qui ne dépend donc pas de nos forces. C’est une élévation totalement nouvelle, à tel point que
cela devient une création qui s’ajoute à la première, que c’est une véritable déification par la grâce. Jésus préside maintenant à cette transformation, lui qui opère admirablement, tant par la foi que par la charité ou par l’action de l’Esprit Saint qu’il nous a donné et qu’il nous envoie pour nous envelopper.
Pour donner à cette âme ainsi élevée sa nourriture et lui permettre de grandir, Jésus a créé l’eucharistie, au sein de laquelle il appelle l’âme. La nourrissant de lui-même, il la fait toute sienne, grâce à sa présence réelle et à l’Esprit qui l’inonde pour la sanctifier.
L’âme qui veut atteindre cette grande finalité proposée par Jésus dans l’eucharistie ne doit pas faire autre chose que suivre la même voie que Jésus a prise et prend pour venir à elle. Comme Dieu vient à sa créature dans l’eucharistie par un acte d’amour infini, ainsi l’âme doit aller à lui, monter vers lui, se reposer en lui avec un amour généreux et constant.
L’amour est le seul moyen de nous unir à Dieu, d’adhérer à lui, de former avec lui un même esprit. En effet, bien que nous, créatures, soyons infiniment éloignées de Dieu, de l’abîme de notre cœur surgit le désir, lequel, augmenté de la grâce, nous permet de nous réunir à l’Infini.
L’amour pénètre plus intensément une âme nue. Il ne s’apaise pas, ne s’arrête pas tant qu’il n’a pas pris possession de toutes les vertus de l’être aimé, pour, autant que possible, former une seule entité de l’être aimé et de celui qui l’aime, une identité d’intelligence et de volonté.
Dans l’eucharistie, l’amour de Jésus est si grand et si généreux de lui-même que s’il trouve une âme qui se donne à lui dans une véritable pauvreté, avec générosité et un amour impatient, il en prend possession et s’impose en roi de chacun de ses mouvements internes et externes.
Mais il convient que l’âme soit nue, qu’elle n’ait aucune propriété, ni externe, ni interne. Sinon, comment Jésus pourrait-il normalement, même si c’est surnaturel, permettre réellement, en union avec l’Esprit Saint, la transformation de la créature humaine en créature nouvelle ?
Si l’être humain désire profondément cette transformation, alors, en s’approchant de la communion, cette âme choisie sera tellement attirée par Jésus qu’elle s’oubliera elle-même. Elle sera tellement pleine de l’aimé qu’elle se sentira plus en lui que dans son propre corps. Car l’âme est alors en Jésus par la force de son esprit et de sa volonté, tandis qu’elle demeure dans son corps pour lui donner cette vie qu’ont également les animaux.
Cette âme n’ayant aucune propriété ni de son esprit ni de sa volonté se laisse cependant tout entière, en essence et en puissance, pénétrer par Jésus. Alors, n’est-il pas vrai que, bien qu’en demeurant un être humain, elle est transformée, portant en elle l’image vivante de Jésus, exprimant la façon de faire propre à Dieu, arrivant presque aussi à lui ressembler dans l’aspect extérieur ?
L’amour opère également ceci : il transforme même l’apparence de l’amant dans l’aimé, et plus son dévouement d’amour a été et demeure grand, plus il lui ressemble. Merveille que cela, qui existe aussi dans l’amour
EUCHARISTIE, SOURCE D’ESPÉRANCE
naturel, mais qui, dans le surnaturel, devient perfection et vision de beautés du divin cachées aux profanes, découvertes et savourées par les esprits humbles et purs, par les âmes simples.
Ô ! Vraiment, Jésus a porté par ce sacrement d’amour les merveilles divines sur la terre, la vraie formation des âmes à la très haute vision de Dieu.
Son anéantissement eucharistique mène les âmes sincères à un tel abandon d’elles-mêmes qu’elles se sentent transfigurées dans l’image parfaite de leur Chef !
L’eucharistie est enseignement à la vie cachée
22 juin 1955
L’eucharistie, par la réalité de la présence de Jésus dans l’âme, la fait revivre à tout ce qu’elle a reçu dans le baptême, qui est la mort de la vieille nature humaine et la résurrection à une nouvelle nature, celle de Jésus Christ.
L’homme oublie souvent sa renaissance permise par l’eau du baptême et l’Esprit Saint en vertu des mérites de Jésus Christ. En oubliant ce qu’il a reçu par simple libéralité de Dieu, il se lie aux autres hommes, mène leur vie, et ne se distingue plus de ceux qui vivent selon les passions et se laissent entraîner par les mauvais penchants du cœur.
Mais si cet homme reçoit la grâce de reconnaître et d’apprécier les divins mystères de la Rédemption, et spécialement de l’eucharistie, alors – s’il s’en approche avec pureté, une intention droite et un désir tourné vers Jésus – il va se renouveler et commencer la vie qui va le transformer en Jésus Christ son Sauveur.
À ce moment, l’âme chrétienne, opérant une mutation de l’esprit, changeant le sens de sa vie, commence à se détacher de toute la vie mondaine qui lui donne la nausée. Prise d’un ardent désir de plaire à Dieu, elle transforme toutes ses actions, même les plus humbles et communes, en une louange continue au Seigneur.
Cette âme est patiente, douce, pleine de mansuétude et d’humilité, ne cherche pas sa satisfaction mais se donne volontiers aux autres. Elle brûle d’ardeur envers son prochain, dont elle oublie les offenses et les torts, et l’aime au point de faire siennes ses misères et ses joies.
Elle est pleine de compassion pour les maux du monde, prie pour ses frères lointains. Elle se fait ainsi victime cachée pour les convertir, ainsi que toutes les âmes qui forment l’Église de Jésus Christ et qui entendent, annoncé sur toute la terre par le vicaire de Jésus Christ, le pape, le magistère infaillible de vérité et l’amour de toutes les âmes, qui sont le prix du sang de l’Homme-Dieu.
Les âmes de cette trempe sont rares, il est vrai, mais elles existent. Si on veut les reconnaître, en plus d’une vie vertueuse, on les retrouvera au repas des anges chaque jour, y puisant toute la force nécessaire pour vivre une vie plus angélique qu’humaine.
En effet, l’eucharistie renouvelle quotidiennement ces âmes jusqu’à les transformer. Car on n’obtient pas cette vie nouvelle de Jésus Christ si l’on ne se nourrit pas de lui spirituellement, et l’on ne peut entretenir son élévation spirituelle qu’en s’abreuvant à cette même source de vie.
En voulant découvrir comment ces âmes sont parvenues à se cacher en Jésus Christ et à y demeurer, tout en ressemblant à toutes les autres quand on converse avec elles, on touchera alors au mystère de la vie du Christ.
En effet, la mort qui est survenue en elles n’est pas matérielle mais spirituelle et mystique : elle est survenue par la vertu du baptême et de l’incorporation au Christ dans l’eucharistie. Tous ceux qui n’ont pas la foi ne peuvent donc l’imaginer et ne peuvent comprendre ce que signifie renaître spirituellement.
On ne peut même pas connaître parfaitement la vie de ces âmes choisies, éparpillées dans le monde dans toutes les différentes classes sociales, car cette vie est cachée en Christ, en Dieu.
Quand on ne connaît pas le Christ mystique, on ne peut même pas pénétrer et admirer les admirables effets qu’il produit dans l’âme à travers ses sacrements, en particulier l’eucharistie.
Pour les chrétiens communs, le Christ est l’HommeDieu venu sur cette terre, tel que nous l’a transmis l’Histoire. Alors que, en réalité, il continue sa mission dans le monde, grâce à l’Église et dans l’Église des âmes. Elle forme son corps mystique, composé de toutes les âmes qui le suivent avec sincérité, se revêtant de lui, vivant sa vie sur cette terre, et qui jouiront de sa gloire au Ciel.
Ce grand mystère du Christ caché dans l’Église n’apparaît pas au chrétien superficiel, et encore moins aux incrédules ; mais c’est un si grand mystère qu’il rassemble l’histoire des siècles qui se déroulent pour le Christ.
Dieu n’a pas donné le temps aux hommes pour leurs plaisirs, pour leur orgueil humain qui les pousse à conquérir la nature ou des empires, mais bien pour former la nouvelle humanité en Jésus Christ.
Voilà pourquoi la vie de celui qui suit Jésus Christ et en vit la vie est un mystère, rappelant ainsi les paroles de l’Apôtre : « En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu1. »
Actuellement, le monde suit une course vertigineuse, on ne sait vers où, voulant réaliser par ses découvertes une vie qu’il ne connaît même pas, et qui, gonflé d’orgueil, ramène tout au matériel et à l’intelligence déifiée.
Qui se préoccupe de Dieu, de Jésus, de son Église, de l’âme, de l’éternité ?
On ne pense même pas à ceux qui mettent en œuvre cette merveilleuse transformation en Jésus Christ, et, quand on est face à eux, on les prend pour des visionnaires et des fanatiques.
C’est ainsi que le monde méconnaît le Christ et l’Église des âmes, dans lequel le Christ est présent de manière pérenne et forme son corps mystique.
Merveilleuse vision qui se dissimule dans le mystère.
Voilà pourquoi l’apôtre saint Jean disait à ce sujet : « Ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est2. » Roi pour les siècles des siècles et d’immense majesté.
L’eucharistie conduit à l’abandon 23 juin 1955
L’âme ne se sent jamais aussi sûre que quand elle grandit en plaçant sa confiance dans le Seigneur, et qu’elle s’abandonne en lui. Si elle regarde en elle, au fur et à mesure que la lumière y grandit, elle prend réellement conscience d’elle-même : poussée au mal depuis l’adolescence, attirée par les vanités qui l’entourent, paresseuse, elle n’est qu’un amas de misères dont le temps, jusqu’à la disparition du monde, est compté. À la lumière du Seigneur, elle n’est rien, qu’elle soit savante, puissante, ou bien même estimée des hommes.
Cette âme a besoin d’être prise en main, d’être sauvée des pièges et de l’insensibilité auxquelles elle est soumise par ses vices sombres et vulgaires. Il faut l’encourager à s’élever car elle a été créée pour cela. Elle doit sentir ce souffle de vie que Dieu lui a donné en la rachetant du péché. Il faut aussi la sauver de ce péril auquel travaille le diable, qui la pousse à se décourager de n’être bonne à rien. Évidemment, que peut faire de bien une âme qui se laisse
dominer par les passions ou par les tendances à la vacuité qu’elle porte en elle ?
Même une âme bonne voit Dieu de trop loin : elle l’adore, mais ne le suit pas, car elle n’est pas touchée par son amour. Il faut donc, pour la délivrer de tant de maux, que Dieu étende sa main bienfaisante et l’attire dans les funicules1 d’Adam, par les voies de l’amour. Et Dieu, qui est amour, accompagne cette âme au plus près, descend du Ciel, s’en approche et l’appelle à goûter la substance de son humanité qui lui est donnée en nourriture dans l’eucharistie.
Cet acte de miséricorde infinie que seul l’amour de Dieu tout-puissant pouvait opérer touche les fibres les plus délicates de l’âme et crée en elle un sentiment de grande confiance.
Se voyant ainsi approchée par Dieu, comme si Dieu avait besoin de son amour, l’âme prend courage et pénètre les profondeurs de l’amour. Elle sent Dieu si proche, si bon, si aimant, qu’elle ne peut pas faire moins que de se donner à lui et de se confier totalement à lui. Il faut en effet une ouverture de l’âme pour instaurer la confiance avec celui que l’on aime. Si l’on n’ouvre pas les portes de son être, par nature fermées aux autres, on reste étranger à l’autre.
Mais ici, dans l’eucharistie, le cœur de Dieu est plus qu’ouvert à celui qui médite avec foi le mystère : il est déchiré, et appelle chacun à y entrer : « Venez à moi, vous
tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos » (Mt 11, 28). Il n’y a donc rien d’autre à faire qu’à ouvrir l’âme à celui qui connaît notre secret et veut qu’on la lui ouvre. Car, si le cœur reste fermé, il n’y a pas de confiance, il n’y a pas d’ouverture de l’âme. Si ce cœur si fermé, si dur, si orgueilleux, s’ouvre à l’amour de Jésus qui descend du Ciel – et qui, même voilé, existe substantiellement comme au Ciel, et se donne à quiconque a foi en lui –, alors une lumière mystérieuse se reflète dans l’âme, une chaleur inhabituelle l’envahit, et une douceur sans fin la pénètre : « Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! » (Ps 33, 9).
Voilà tout ce que Jésus fait pour ouvrir les cœurs affligés, engourdis, de ses créatures, voilà la manière de Dieu pour les attirer à lui et leur faire sentir qu’il n’est pas un Dieu de majesté terrible qui habite dans les Cieux mais le Dieu d’amour qui visite les âmes et veut les remplir de sa vie. Dieu devient donc tellement proche de nous qu’il devient notre nourriture spirituelle, se fait notre serviteur, devient notre Époux, notre guide, notre réconfort, vie de notre vie. Et, alors, de quoi avoir peur ? Quand Dieu se fait tellement nôtre qu’il se donne en nourriture pour nous, quand il éveille dans notre esprit le désir et notre volonté de vivre de l’amour, quand il est notre compagnon, notre aide, de quoi avoir peur ? Ni les passions les plus vives, ni les tentations insidieuses de Satan, ni l’attraction de certaines créatures, ni tout ce qui fascine le monde ne valent la peine de se retenir d’aller vers Dieu. Ce ne sont pas nos
forces qui l’emportent, mais Dieu, qui devient le protecteur de notre être, notre force, notre réconfort.
Rassurée d’être habitée par Dieu, l’âme va alors au-devant de ses ennemis, et les met en déroute d’un seul regard, car étant désormais possession de Dieu, c’est Dieu qui gagne toutes les batailles d’un seul regard. L’âme ne s’arrête pas seulement là : dans ce chemin de confiance, caressée par Dieu, elle entre dans la vie de son Cœur, du Cœur de Jésus, où sont cachés tous les trésors de grâce et de gloire. C’est Dieu lui-même qui attire l’âme dans les tréfonds de son être profond comme l’infini, et, là, elle voit tout le présent et l’avenir. Si elle ne le voit pas dans la clarté de la gloire, elle le voit par sa confiance dans le bien-aimé qui lui fait comprendre combien sa vie sera d’autant plus apaisée qu’elle s’abandonnera en lui, lui qui préside aux événements du monde comme de chaque être humain.
Connaître de manière si haute et si profonde Dieu, ellemême, ce qui peut lui arriver, ses combats, ses victoires, ses jours, sa fin, toutes ces choses qui sont dans la main de Dieu – mieux qu’en nous, qui ne voyons rien et ne connaissons pas notre avenir – est une grande et heureuse élévation de l’âme.
L’âme parvient alors à un tel abandon en Dieu, atteint un tel oubli d’elle-même, qu’elle vit dans la plus grande sérénité, sa vie est paix. Sa vie est un abandon continuel aux volontés très savantes de Dieu, comblée de la bonté que Dieu cache sur ses chemins.
L’âme n’accomplira rien d’autre que ses devoirs, non pas avec angoisse, ni mécaniquement, mais comme elle le doit, face à Dieu qui voit tout, même le plus petit soupir. Elle n’atteindra pas la perfection, que ce soit pour se purifier, grandir, et s’unir, par elle-même, mais en faisant grandir la grâce. Elle y veillera nuit et jour, se méfiant d’elle-même, mais toujours pleine de confiance en Dieu, toujours prête à repousser sa vieille nature qui voudrait reprendre le contrôle.
Plus qu’aucune autre voie du Seigneur, l’eucharistie nous rapproche de cette confiance en Jésus, de notre doux Sauveur. Elle conduit à un abandon, véritable principe de vie céleste, car il fait tomber toute inquiétude, enlève toute crainte, nous fait sentir la vie divine de Jésus qui travaille continuellement à la nôtre, parfois même à notre insu. La bonté de Jésus est si grande que c’est lui qui veut nous soustraire aux imperfections quotidiennes, nous envoyant des épreuves adaptées et proportionnées à nos forces ; c’est lui qui pense à nous donner les satisfactions de la pénitence, de compensation à la divine justice, car, sans lui, que vaudraient les prières de demande et les pénitences ? Comme est grande la bonté de Jésus, comme est divine la manière qu’il utilise pour gagner nos cœurs et les faire tellement siens que nous n’avons d’autre choix que de l’aimer !
Il fait le reste en nous, nous embellissant, nous préparant à sa gloire, car bien que nous ne puissions rien faire, nous sommes son accomplissement, son corps mystique. Voilà pourquoi il nous nourrit, nous fait vivre comme
EUCHARISTIE, SOURCE D’ESPÉRANCE
la vigne fait vivre ses sarments, nous fait bouger selon sa volonté, comme la tête gouverne les membres du corps. Si les âmes comprenaient le don qui leur est fait, et qu’il veut faire à toutes, en étant invitées à s’abandonner en lui, alors, par cet abandon, et tout en affrontant les épreuves, les douleurs, les embûches, le tourment de l’exil, et les dangers de le perdre, cette vie serait un vrai morceau de paradis. Malgré les ténèbres et les épreuves, au milieu de cet exil obscur, il serait toujours en nous, comme dans la barque avec ses disciples, en pleine tempête (cf. Mc 4, 35-41).
Maria Teresa Carloni (1919-1983) est une figure extraordinaire de l’Église du xxe siècle. Fille de bonne famille très tôt orpheline, elle se révolte adolescente contre la médiocrité du clergé et s’éloigne de l’Église. Mais, en 1951, elle connaît une conversion fulgurante, et entre dans une vie mystique d’une rare intensité. S’offrant avec Jésus « pour le salut de beaucoup », elle partage son agonie les vendredis, reçoit des stigmates, et bénéficie d’un don de bilocation qui l’aide à mener un apostolat auprès des chrétiens persécutés derrière le Rideau de fer. Ses pages magnifiques sur l’eucharistie, traduites pour la première fois en français, sont le fruit d’amour de cette vie totalement offerte à la Vie même du Christ. Elles offrent un regard pénétrant sur le mystère de sa Présence qui bouleverse notre manière de vivre la messe et qui illumine notre vie spirituelle, au quotidien. Un chef-d’œuvre de la littérature mystique, introduit et éclairé par Didier Rance.
Didier Rance, diacre, historien, ancien directeur national de l’Aide à l’Église en détresse (AED), a écrit la première biographie en français de Maria Teresa Carloni, Maria Teresa Carloni. Mystique au service des chrétiens persécutés (Salvator, 2020).