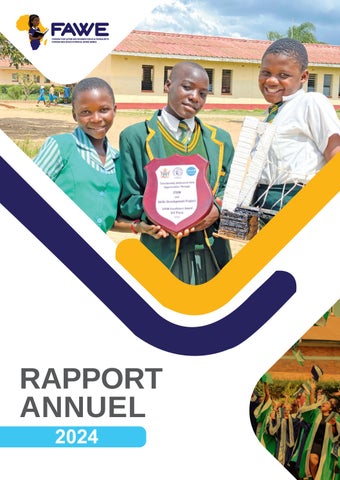RAPPORT ANNUEL 2024

Le Forum des éducatrices africaines (FAWE) est une organisation non gouvernementale panafricaine à base d’adhésion dont les activités sont menées par 34 antennes nationales en Afrique subsaharienne et ce, en vue de promouvoir l’éducation des filles et des femmes. La vision, la mission et l’objectif du FAWE sont tous résolument orientés vers le bien-être de l’éducation des filles. Le Secrétariat régional du FAWE est basé à Nairobi, au Kenya.
Antennes nationales du FAWE: Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Namibie, Nigéria, Tchad, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Gambie, Togo, Ouganda, Zambie, Zanzibar et Zimbabwe.
DROIT D’AUTEUR:

Cette publication ne peut pas être reproduite à quelque fin que ce soit sans l’autorisation écrite préalable du FAWE. Le FAWE ne peut être tenu responsable de toute inexactitude. Des parties de cette publication peuvent être copiées à des fins de recherche, de plaidoyer et d’éducation, à condition que la source soit reconnue.
©FAWE Forum for African Women Educationalists (FAWE).
Photo de couverture: Des écoliers du Zimbabwe présentent fièrement leur trophée du prix d’excellence en STIM.
Les participants au programme de bourses FAWE/Fondation Mastercard lors de leur cérémonie de remise des diplômes à Kigali, au Rwanda.
boursiers éthiopiens bénéficient d’une nouvelle chance en matière d’éducation
D’un petit village à l’université de Woldia - l’histoire de Sindu Yitna
Améliorer la vie des jeunes filles kenyanes: le projet Imarisha Msichana
Le triomphe de Mary contre des forces presque insurmontables
Le meilleur gain de Sharlyne Achieng grâce aux clubs Tuseme
Promouvoir les meilleures pratiques journalistiques tenant compte de l’égalité des sexes
SHARE: Promouvoir l’égalité des sexes et les droits de santé en Afrique
L’information se rapproche des communautés au Ghana
Améliorer les soins de santé inclusifs: 120 agents de santé formés à la santé sexuelle et
36
37
38 reproductive et au langage des signes
Les femmes et la participation politique: Renforcer les capacités de la prochaine génération de 39 leaders africains
Données pour le changement II: utilisation des preuves pour mettre fin à la violence basée sur le 40 genre en milieu scolaire
Construire des espaces d’apprentissage plus sûrs: Co-création d’un Manuel de prévention des VBG 40 pour l’enseignement supérieur
Promouvoir l’enseignement sensible au genre grâce au programme Echidna
41
Ouvrir des portes, changer des vies: Les initiatives du FAWE en matière de bourses d’études pour 42 l’éducation des filles
Bourses du Commonwealth: Promouvoir le leadership des femmes grâce à l’enseignement supérieur
42
Le Fonds pour l’éducation des filles africaines (AGEF): Un engagement local en faveur de la 43 deuxième chance
Bourses Imarisha Msichana: Une seconde chance pour les mères adolescentes
43
Bourses d’aide sociale attribuées par le personnel: La solidarité en action 43
Renaître les rêves: Le combat d’Alice pour l’éducation 44
Politique. Pouvoir. Progrès: Le plaidoyer du FAWE en action
L’Année de l’éducation 2024 de l’UA : Un moment décisif pour l’avenir de l’éducation en Afriquee 47
Un tournant pour l’agenda de l’éducation en Afrique
Principales réalisations de l’Année de l’éducation 2024 de l’UA
47
48
L’impératif de genre: Promouvoir l’éducation des filles et des femmes 48
Perspective d’avenir: Maintenir l’élan audelà de 2024
FAWE au Comité de la condition de la femme (CSW68)
Le FAWE au Sommet pour l’avenir: Assurer une place aux filles et aux jeunes femmes dans l’Afrique
48
50
52 de demain
Le FAWE participe à la Conférence inaugurale de la CAE à Arusha, en Tanzanie
53
Promouvoir l’éducation des filles: FAWE Nigeria montre la voie avec vision et conviction 54
Le FAWE dirige le GIMAC en mettant l’accent sur l’éducation
La semaine compétences en Afrique 2024: Changer le langage sur l’EFTP et l’autonomisation des filles
Le FAWE se fait le champion de la participation des filles aux STIM lors de la Conférence continentale
55
56
57 de l’UA
ASSUREZ LEUR SÉCURITÉ: L’engagement du FAWE à mettre fin à la VBG en milieu et les communautaire
Le FAWE plaide en faveur de l’éducation des filles lors de la 81ème session ordinaire de la CADHP
58
60
L’égalité entre les sexes dans le domaine éducatif: Le leadership du FAWE au sein du Groupe 61 sectoriel pour l’éducation des filles et des femmes du CESA
Priorité aux droits et au bien-être de l’enfant africain
Le FAWE se fait le champion de l’éducation des filles au CIES 2024 à Miami
62
63
Définir l’avenir de l’éducation en Afrique: Le FAWE à la Conférence continentale de l’UA sur l’éducation 65
Des connaissances qui favorisent le changement: Le programme de recherche et 66 d’apprentissage du FAWE
Donner vie à la recherche: Documentation des expériences des enfants au Ghana et au Sénégal
67
Construire des écoles sensibles au genre pour un changement durable: Les programmes KIX CoE et 67 KIX Normes de genre
L’éducation en temps de crise: Donner la parole aux enfants réfugiés et déplacés à l’intérieur du pays
68 grâce au programme KIX Tuseme du GPE
Urgence de l’éducatiion: Des chiffres qui racontent l’histoire
Tuseme: Une voix dans le chaos
Leçons tirées du terrain: Ce qui marche dans les environnements fragiles
Au-delà de Tuseme: Un appel à des solutions holistiques
Renforcer les systèmes de connaissances: Jeter les bases d’un centre de recherche sur l’éducation
69
70
71
71
72 des filles en Afrique
Le manuel du FAWE sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire
73
Mise à l’échelle des initiatives qui marchent: Les modèles éducatifs du FAWE en action 74
Les modèles du FAWE : Le moteur de l’accès à une éducation de qualité, à la formation et au bien-être 75 des jeunes Africains
Pédagogie sensible au genre (GRP) 75
Enseignement et Formation Techniques et Professionnels (EFTP)
Lutte Contre la Violence Basée Sur le Genre en Milieu Scolaire
Agir pour une bonne cause: Les anciens du FAWE bâtissent un patrimoine
Sommaire exécutif
Une démarche courageuse pour l’éducation des filles en Afrique
L’année 2024 a marqué un point tournant pour le Forum des éducatrices africaines (FAWE). Dans le cadre de l’Année de l’éducation de l’Union africaine, le FAWE a lancé son nouveau Plan stratégique 2024-2028, une feuille de route qui intègre l’égalité des sexes et l’apprentissage inclusif au cœur du programme de développement de l’Afrique.
Ancré dans trois objectifs stratégiques, le travail du FAWE au cours de cette année a mis l’accent sur:
• L’amélioration de l’accès des filles et des femmes à une éducation et à des formations de qualité
• La production et l’utilisation de la recherche pour éclairer les politiques et les pratiques éducatives

Dr Martha Muhwezi, Directrice Exécutive du FAWE Afrique.
• Le renforcement des capacités institutionnelles et l’efficacité opérationnelle du réseau du FAWE Du niveau communautaire jusqu’au niveau international, le FAWE est resté un promoteur fort et défenseur de systèmes éducatifs sensibles au genre qui autonomisent les filles et les jeunes femmes en Afrique.
Principaux jalons de 2024
• La phase II du partenariat entre la Fondation Mastercard et le FAWE a été lancée. Elle vise à offrir à 10 550 jeunes de 10 pays africains des bourses, des possibilités de formation professionnelle et un soutien à l’entrepreneuriat, afin de donner plus d’autonomie aux jeunes les plus marginalisés d’Afrique, en particulier les filles et les jeunes en situation de handicap.
• La phase II du programme a été lancée avec succès dans quatre pays (Ouganda, Zambie, Malawi et Éthiopie), réunissant les principales parties prenantes afin de jeter les bases d’une mise en œuvre harmonieuse.
• 272 boursiers ont obtenu leur diplôme au Rwanda et plus de 5 000 filles ont repris l’école au Kenya dans le cadre du programme Imarisha Msichana. En Éthiopie, une aide d’urgence a permis à des filles menacées d’abandon scolaire de poursuivre leurs études en médecine, témoignant ainsi de leur résilience et de l’efficacité d’une intervention rapide.
• Grâce à l’innovation numérique du FAWE, une application Tuseme a été testée dans 160 écoles à travers le Kenya, avec plus de 15 000 apprenants inscrits, favorisant l’autonomisation et l’acquisition de compétences pratiques grâce à une plateforme numérique accessible.
• Le FAWE a participé à des plateformes mondiales et continentales de plaidoyer de haut niveau, notamment le Sommet de l’avenir, l’ACERWC, l’ACHPR et les conférences GIMAC, où il a plaidé en faveur d’investissements dans l’éducation des filles, le leadership des jeunes et les droits sexuels et reproductifs.
• En partenariat avec l’UNESCO et l’ADEA, le FAWE a contribué à la réalisation des rapports fondamentaux sur l’alphabétisation « Spotlight on Africa » en documentant les expériences vécues par des enfants au Ghana et au Sénégal, faisant ainsi le lien entre la recherche et l’impact réel.
• Le FAWE a continué à mener des efforts de recherche dans toute la région, publiant des études sur les normes de genre, l’accès à l’éducation, l’impact des écoles sensibles au genre et un manuel sur la violence basée sur le genre en milieu scolaire qui est utilisé pour former les enseignants sur cette question à travers le continent. Le travail du FAWE au Burkina Faso, au Tchad, en RDC et à São Tomé a révélé de nouvelles perspectives sur l’engagement communautaire, la gestion des règles et la persistance de normes sociales néfastes.
• Le FAWE a également mené des actions de renforcement institutionnel à travers des ateliers régionaux de renforcement des capacités, améliorant les compétences des équipes nationales dans les domaines de la communication, de la collecte de fonds, de la gestion des subventions et de la mise en œuvre des programmes, afin de garantir un impact plus fort et plus durable à travers le réseau.
• Le FAWE a œuvré à l’amélioration de la gouvernance de ses antennes à travers des assemblées générales et des séances d’initiation des membres du Conseil d’administration au Bénin, au Nigeria, au Rwanda, etc.
Perspectives
La mission du FAWE reste claire: libérer le potentiel de toutes les filles africaines grâce à l’éducation. L’organisation est fière de ce qui a été accompli, mais encore plus inspirée par ce qui reste à faire. En collaboration avec ses partenaires, les gouvernements et les communautés, le FAWE continuera à briser les barrières, à lutter contre les inégalités et à construire un avenir où chaque fille pourra s’épanouir.
Leur réussite est notre objectif. Leurs rêves sont notre responsabilité. Dr Martha Muhwezi,
Directrice exécutive du FAWE
En lisant ce rapport annuel, nous vous invitons à réfléchir au chemin parcouru et à vous joindre à nous pour continuer à bâtir un avenir où chaque fille africaine aura le droit et la possibilité d’apprendre, de diriger et de s’épanouir.
Remerciements
Le Forum des éducatrices africaines (FAWE) adresse ses sincères gratitudes à toutes les personnes qui ont contribué aux réalisations présentées dans ce rapport annuel.
Nous tenons tout d’abord à remercier le Conseil d’administration du FAWE Afrique, sous la direction de l’honorable Aicha Bah Diallo, pour sa supervision stratégique, son engagement et ses conseils sans faille, qui continuent de conduire l’organisation vers sa vision de l’égalité des sexes dans le cadre éducatif.
Nous saluons également le dévouement et le leadership du Secrétariat régional, dirigé par Mme Martha Muhwezi, Directrice exécutive, dont la vision continue d’étendre l’impact du FAWE en Afrique. Nous tenons à remercier tout particulièrement Mme Teresa Omondi-Adeitan, Directrice exécutive adjointe et responsable des programmes, pour son travail exceptionnel dans la coordination de la mise en œuvre du Plan stratégique du FAWE et la supervision de l’excellence des programmes au sein du réseau.
Nous sommes profondément reconnaissants à nos partenaires au développement et à nos bailleurs de fonds pour leur confiance, leur partenariat et leur soutien sans faille. Vos contributions ont joué un rôle déterminant dans le maintien et la croissance de nos initiatives visant à autonomiser les filles et les jeunes femmes africaines grâce à l’éducation.
Nous exprimons notre sincère gratitude à nos 34 antennes nationales. Votre dévouement et votre leadership au niveau national ont permis de traduire la vision du FAWE en actions permettant de changer la vie des communautés. Vos efforts inlassables sont la clé de notre succès.
Nous remercions également l’ensemble du personnel du Secrétariat régional du FAWE, dont le professionnalisme, la collaboration et l’engagement ont contribué à réaliser ce rapport.
Nous tenons à remercier tout particulièrement le département de gestion des connaissances, dirigé par M. Gordon Aomo, qui a veillé à ce que ce rapport soit basé sur des données factuelles et reflète l’impact de notre travail.
Nous remercions également le département de communication, sous la direction de M. Kossi Tsenou, avec le soutien de Mlle Emily Buyaki, M. Birane Diarra, M. Jérémie Sagna et M. Alvin Musebe, pour avoir efficacement documenté, conçu et diffusé les étapes importantes et les témoignages du FAWE.
À nos membres, anciens boursiers et participants aux programmes, nous vous remercions pour vos témoignages, vos expériences et votre résilience. Vos témoignages sont au cœur de ce rapport et continuent d’inspirer notre mission collective.
En lisant ce rapport annuel, nous vous invitons à réfléchir au chemin parcouru et à vous joindre à nous pour continuer à bâtir un avenir où chaque fille africaine aura le droit et la possibilité d’apprendre, de diriger et de s’épanouir.
Préambule
WL’éducation d’une fille ne se limite pas à transformer sa vie : elle crée un effet en cascade qui améliore la vie des familles, revitalise les communautés et accélère le développement national. Depuis plus de 33 ans, le Forum des éducatrices africaines (FAWE) poursuit sans relâche sa mission visant à éliminer les obstacles à l’éducation des filles et à défendre les droits des femmes et des filles en Afrique.
L’année 2024 n’a pas été une année comme les autres. Déclarée Année de l’éducation par l’Union africaine, elle a été l’occasion d’une réflexion et d’une réinvention, une chance d’imaginer une Afrique où chaque enfant, en particulier chaque fille, a accès à une éducation transformatrice, inclusive et préparée pour l’avenir. Le FAWE a saisi cette occasion avec une vision claire et un engagement sans faille.

Honorable Aïcha Bah Diallo, Présidente du Conseil d’administration du FAWE Afrique.
Sous la direction de la directrice exécutive, le Dr Martha Muhwezi, et avec le soutien du Secrétariat régional, le FAWE a réalisé des progrès significatifs tout au long de l’année. L’organisation a lancé son nouveau plan stratégique (2024-2028) et mis en place le programme « Second Chance Pathways for Increased Access to Tertiary Education for Marginalized Young Women and Men » (Une deuxième chance pour améliorer l’accès à l’enseignement supérieur des jeunes femmes et hommes marginalisés), un programme étalé sur sept ans mis en œuvre dans dix pays et qui vise plus de 10 550 jeunes, notamment des réfugiés, des mères adolescentes et des jeunes en situation de handicap, à accéder à l’enseignement supérieur et à des moyens de subsistance dignes.
Les efforts de plaidoyer du FAWE ont eu un impact tout aussi important. En tant que principal organisateur de la plateforme GIMAC pendant l’Année de l’éducation de l’UA, l’organisation a amplifié la voix des filles et des jeunes femmes, veillant à ce que leurs besoins restent au cœur des priorités éducatives du continent.
Le FAWE a également renforcé son rôle dans les espaces régionaux consacrés aux politiques et aux droits humains, en gardant son statut d’observateur auprès du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (ACERWC) et de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ACHPR). À Maseru et à Banjul, le FAWE a présenté des recommandations clés sur l’éducation des filles, lesquelles ont figuré dans les documents officiels finaux, affirmant ainsi la crédibilité et l’influence de l’organisation.
En outre, le FAWE a continué à codiriger le groupe de travail de l’Union africaine sur l’éducation des filles et des femmes, tout en contribuant aux groupes de travail sur le développement professionnel des enseignants, l’éducation de la petite enfance et l’EFTP, garantissant ainsi que la perspective de genre reste intégrée dans l’ensemble de l’écosystème éducatif africain.
L’année s’est achevée par la participation du FAWE au Sommet de l’Avenir à New York, où l’organisation s’est jointe aux leaders mondiaux pour élaborer un programme d’éducation inclusive. En marge de cet événement, lors de la réunion parallèle « Powering Parity » organisée par la Fondation Mastercard, le FAWE a lancé la phase II de son partenariat avec la Fondation, une étape importante dans la mission commune visant à transformer les possibilités d’éducation pour les jeunes les plus marginalisés d’Afrique.
Derrière chaque chiffre de ce rapport se trouve une histoire de courage, de résilience et de transformation, qu’il s’agisse de filles qui reprennent leur place à l’école après une grossesse, d’enseignants qui adoptent des pratiques inclusives ou de communautés qui commencent à considérer les filles non plus comme une charge, mais comme les leaders de demain.
Ce rapport annuel est plus qu’un simple bilan des réalisations accomplies ; c’est un appel à l’action. Le FAWE invite tous ses partenaires et parties prenantes à approfondir leur collaboration, à amplifier leur voix commune et à maintenir le cap pour construire un avenir où aucune fille africaine ne sera laissée pour compte et où chaque rêve aura la possibilité de s’épanouir.
Par l’honorable Aïcha Bah Diallo, présidente du conseil d’administration du FAWE Afrique
Abbreviations and Acronyms
ACER-UK Conseil australien de la recherche en éducation
ADEA Association pour le développement de l’éducation en Afrique
AMWIK Association des femmes œuvrant dans le domaine des médias au Kenya
AU CIEFFA Centre international pour l’éducation des filles et des femmes en Afrique de l’Union africaine
AUDA-NEPAD Agence de développement de l’Union africaine
AU ESTI Union africaine, Éducation, Science, Technologie et Innovation
CAE Communauté d’Afrique de l’Est
CESA Stratégie continentale pour l’éducation en Afrique
CFF Commission de la condition de la femme
CIES Association d’éducation comparée et internationale
COCAFEM Concertation des Collectifs d’Associations de Femmes de la région des Grands Lacs
CUA Commission de l’union africaine
DG Directeur general/ Directrice générale
ECOSCOC Conseil économique et social
EDUFAM Éducation des filles pour un avenir meilleur
EFTP Enseignement et formation techniques et professionnels
FLN Lecture et calcul de base
FPP Femmes et Participation Politique
GIZ Agence allemande pour la coopération international
GIMAC La campagne « Le genre: mon programme »
GPE Partenariat mondial pour l’éducation
GRP Pédagogie sensible au genre
HEAC Certificat d’accès à l’enseignement supérieur
HERS-EA Ressources éducatives pour l’enseignement supérieur – Afrique de l’Est
IDP Déplacé interne
INES Ruhengeri (Rwanda) Institut d’Enseignement Supérieur de Ruhengeri
KCPE Certificat d’enseignement primaire du Kenya
KCSE Certificat d’enseignement secondaire du Kenya
MGF Mutilations génitales féminines
NU Nations unies
OIT Organisation internationale du travail
RDC République démocratique du Congo
SDSR Santé et droits sexuels et reproductifs
SPG Groupe de planification stratégique
SR Secretariat régional
SRGBV Violence basée sur le genre en milieu scolaire
STIM Science, technologie, ingénierie et mathématiques
TI Technologie de l’information
UA Union africaine
UE Union européenne
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance
VBG Violence basée sur le genre



CHAPITRE
Le Dr Fikadu Asfaw, responsable du développement de la force de travail à la Fondation Mastercard, Éthiopie, signe un tableau pour marquer le lancement de la phase II du programme FAWE/Fondation Mastercard en Éthiopie. Sont présentes la Dr Martha Muhwezi, Directrice Exécutive du FAWE (à droite), Mme Lydia Madyirapanzi, Directrice Exécutive du FAWE Zimbabwe (deuxième à droite), Mme Mary Mwakawago, responsable de programme du FAWE Tanzanie (au centre), et Mme Susan Opok Tumusiime, Directrice Exécutive du FAWE Ouganda (tenant un téléphone portable).
Dr. Martha R.L. Muhwezi: Une source d’inspiration pour l’éducation des filles en Afrique.
Le FAWE Afrique célèbre l’obtension du doctorat de sa Directrice exécutive, Dr. Martha Muhwezi, qui a servi l’organisation avec dévouement pendant plus de 15 ans. Martha a obtenu son doctorat en études sur les femmes africaines à l’Université de Nairobi. Le choix de sa spécialisation n’est pas une surprise, car elle est réputée pour sa passion pour l’éducation de qualité des filles et l’égalité des sexes dans l’éducation pour les filles africaines. Cette réussite académique renforce son expertise en matière de politique éducative et de défense de l’égalité entre les hommes et les femmes, ce qui lui permet de jouer un rôle de premier plan dans l’élaboration de politiques en faveur de l’éducation des filles en Afrique. Cette étape remarquable témoigne de son dévouement, de sa persévérance et de sa passion pour la promotion de l’égalité des sexes et de l’éducation.
À un moment où les progrès vers l’égalité des genres dans l’éducation connaissent des reculs, le FAWE reste convaincu qu’avec une cheffe d’équipe d’exception, cette distinction académique viendra renforcer la production de recherches de qualité qui éclairent les politiques éducatives à travers le continent. Sa voix est reconnue dans les principaux forums, y compris l’Union africaine et les sommets mondiaux sur l’éducation, où elle continue à promouvoir des politiques de transformation qui garantissent aux filles un accès égal à une éducation de qualité. Elle a été reconnue et récompensée par diverses institutions, notamment en étant nommée parmi les 10 finalistes pour la médaille de l’éducation en Afrique de 2023 par T4 Education et HP en collaboration avec Microsoft. La médaille de l’éducation en Afrique est la plus prestigieuse distinction africaine dans le domaine éducatif.
Mme Martha continue d’être à l’avant-garde des efforts visant à remédier aux disparités entre les sexes dans le domaine de l’éducation. Elle a plaidé


sans crainte en faveur des politiques éducatives tenant compte de la dimension de genre en Afrique, en menant des actions de plaidoyer de haut niveau auprès des gouvernements, des partenaires au développement et des organisations de la société civile pour défendre des politiques qui maintiennent les filles à l’école, notamment la réintégration des mères adolescentes, la lutte contre la violence basée sur le genre en milieu scolaire et l’amélioration de l’accès des filles aux sciences et technologies de l’ingénerie.
Sa recherche doctorale s’est spécifiquement penchée sur les perspectives de genre dans l’enseignement technique et professionnel (EFTP); une base analytique plus profonde pour relever les défis auxquels sont confrontés les jeunes dans le monde entier porte sur l’acquisition de compétences dans le monde
Dr Martha Muhwezi, Directrice Exécutive du FAWE Afrique.
des sciences. Le domaine examine le lien entre les structures sociales, la dynamique du pouvoir et les inégalités systémiques - des questions clés qui influencent directement les politiques éducatives. Forte de cette expertise, Martha Muhwezi est bien placée pour faire en sorte que les recommandations politiques soient davantage fondées sur des données probantes et tiennent davantage compte de la dimension de genre, tout en s’alignant sur les objectifs plus larges de

La dernière réussite académique de Martha Muhwezi n’est pas seulement un triomphe personnel, c’est un investissement dans l’avenir de la politique éducative en Afrique. En combinant sa vaste expérience sur le terrain avec une recherche avancée, elle est prête à renforcer l’impact du FAWE, à favoriser une meilleure mise en œuvre des politiques et à élever le niveau du débat sur l’égalité des sexes dans le secteur de l’éducation. Elle est une source d’inspiration pour les filles en Afrique que le FAWE défend en faveur de leurs droits à l’éducation.
“On nous dit de laisser notre lumière briller et si elle brille, nous n’aurons pas besoin de le dire à qui que Dwight L. Moody
Gardez toute la lumière, Dr. Martha, le FAWE est fier
Un héritage de leadership transformateur et de partenariat avec le FAWE
Pendant plus d’une décennie, Reeta Roy a fait preuve d’un leadership visionnaire au sein de la Fondation Mastercard, en lançant des initiatives qui ont façonné l’éducation, les opportunités économiques et l’équité entre les sexes en Afrique. Alors qu’elle quitte son poste de présidentedirectrice générale, le FAWE réfléchit à l’héritage remarquable qu’elle laisse derrière elle - un héritage défini par l’impact, la collaboration et un engagement inébranlable en faveur de l’autonomisation des jeunes femmes et des jeunes filles.
Le mandat de Reeta à la Fondation Mastercard a transformé le FAWE et le secteur de éducatif en général. Sous sa direction, la Fondation a privilégié les
Reeta Roy, Présidente et Directrice Générale de la Fondation Mastercard.
solutions africaines, reconnaissant que le changement durable doit être ancré dans les connaissances, les aspirations et l’action des communautés locales. Cette philosophie était au cœur de notre partenariat, permettant au FAWE d’étendre sa portée, de renforcer ses capacités institutionnelles et d’affiner ses efforts de plaidoyer afin d’influencer les politiques aux niveaux national et régional.
Grâce à des initiatives telles que le programme des bourses de la Fondation Mastercard, le Programme d’accès à l’enseignement supérieur (HEAC) et le programme Phase II qui a changé la donne, des milliers de jeunes femmes qui étaient autrefois confrontées à des obstacles considérables en matière d’éducation ont eu la possibilité de réécrire leur avenir. Ces programmes n’ont pas seulement amélioré l’accès à l’éducation, mais ont également fourni un mentorat, un développement du leadership et des voies d’accès à un emploi digne, garantissant que l’éducation se traduise par des opportunités dans le monde réel.
Le FAWE s’est consolidé grâce à cette collaboration. Avec le soutien de la Fondaion Mastercard, nous avons pu renforcer nos structures, améliorer notre approche programmatique et amplifier notre plaidoyer en faveur de systèmes éducatifs sensibles au genre. Ce partenariat a renforcé la capacité du FAWE à plaider en faveur de l’éducation des filles à grande échelle, en veillant à ce qu’aucune fille ne soit laissée pour compte, quel que soit son origine ou sa situation.
Martha Muhwezi, Directrice exécutive du FAWE, s’est exprimée sur le leadership et l’impact de Reeta Roy :
“Le leadership de Reeta Roy a été véritablement transformateur, non seulement pour la Fondation Mastercard, mais aussi pour les millions de jeunes dont la vie a changé grâce aux opportunités qu’elle a contribué à créer. Sa foi dans le potentiel des filles et des jeunes femmes africaines a alimenté des programmes révolutionnaires qui ont remodelé le paysage de l’éducation et de l’emploi. Le FAWE lui est profondément reconnaissant pour son partenariat, sa vision et l’impact durable de son travail. Alors qu’elle entame un nouveau chapitre, nous célébrons l’héritage qu’elle laisse derrière elle - un héritage d’inclusion, d’autonomisation et d’opportunités.
Alors que Reeta quitte la Fondation, le FAWE reste engagé à promouvoir la vision commune d’une Afrique où l’éducation libère le plein potentiel de chaque fille. Son héritage continuera à nous inspirer et à nous guider dans nos efforts pour que l’éducation reste un outil puissant de transformation, d’équité et de prospérité.
Le FAWE exprime sa profonde gratitude à Reeta Roy pour son leadership extraordinaire et son soutien indéfectible. Les graines qu’elle a plantées continueront à fleurir, façonnant la vie des générations à venir.
Le leadership de Reeta Roy a été véritablement transformateur, non seulement pour la Fondation Mastercard, mais aussi pour les millions de jeunes dont la vie a changé grâce aux opportunités qu’elle a contribué à créer. Sa foi dans le potentiel des filles et des jeunes femmes africaines a alimenté des programmes révolutionnaires qui ont remodelé le paysage de l’éducation et de l’emploi. Le FAWE lui est profondément reconnaissant pour son partenariat, sa vision et l’impact durable de son travail. Alors qu’elle entame un nouveau chapitre, nous célébrons l’héritage qu’elle laisse derrière elle - un héritage d’inclusion, d’autonomisation et d’opportunités.
Le FAWE Afrique dévoile son Plan stratégique 2024-2028 à l’occasion de la Journée internationale de l’éducation
Le 24 janvier 2024, le FAWE Afrique a marqué un point tournant dans son parcours vers l’égalité des sexes dans le domaine éducatif en lançant son Plan stratégique 2024-2028 à Lusaka, en Zambie. Cette nouvelle feuille de route a réaffirmé l’engagement inébranlable du
SO 1
Améliorer l’offre et l’accès à une éducation de qualité et à des opportunités de formation pour les filles et les femmes en Afrique.
FAWE à promouvoir l’éducation des filles et des femmes dans le continent.
Le Plan stratégique s’articule autour de trois objectifs stratégiques clés:
SO 2
Améliorer la production et l’utilisation des résultats de recherche pour éclairer les politiques et les pratiques éducatives.
“Le Plan stratégique 2024-2028 du FAWE représente notre vision de l’avenir. Il s’agit d’un cadre global qui fixe des objectifs et des stratégies ambitieux pour résoudre les problèmes complexes qui entravent la réalisation de l’équité entre les sexes dans l’éducation “, a déclaré Mme
Aïcha Bah Diallo, Présidente du Conseil d’administration du FAWE Afrique.
Chacun de ces objectifs stratégiques est aligné sur des initiatives ciblées conçues pour créer un impact durable. En privilégiant les politiques sensibles au genre, en éliminant les barrières systémiques et en favorisant un environnement éducatif inclusif, le FAWE vise à autonomiser des millions de filles et de femmes à travers l’Afrique.
S’exprimant lors du lancement, le ministre zambien de l’éducation, l’Honorable Douglas Syakalima, a souligné l’alignement entre la vision du FAWE et les objectifs nationaux en matière d’éducation : “Le Plan stratégique du FAWE s’intègre parfaitement aux objectifs de la Zambie en matière d’éducation, en mettant l’accent sur l’inclusion et l’égalité des chances pour tous. Dans un pays où l’accès à l’éducation reste un défi, le FAWE a été une lueur d’espoir, travaillant sans relâche pour démanteler les barrières qui entravent le parcours éducatif, en particulier pour les jeunes filles”. Le dévoilement du Plan stratégique souligne l’engagement
SO 3
Renforcer les capacités institutionnelles et améliorer l’efficacité opérationnelle du réseau du FAWE.
de longue date du FAWE en faveur de la promotion de l’égalité des sexes dans l’éducation. Au cours des trois dernières décennies, le FAWE a collaboré avec les gouvernements, les partenaires locaux, les écoles et les communautés afin d’intégrer le genre dans les politiques et les interventions en matière d’éducation, influençant ainsi un changement transformateur à travers l’Afrique. Martha Muhwezi, Directrice exécutive du FAWE Afrique, a fait part de ses réflexions sur les réalisations et les aspirations futures du FAWE:
“Je suis profondément fière des étapes remarquables franchies au cours des cinq dernières années et de l’héritage durable construit au cours des 30 années d’existence du FAWE. Ensemble, nous avons autonomisé d’innombrables filles à travers l’Afrique, en brisant les barrières et en ouvrant les portes de l’éducation. Alors que nous entamons le prochain chapitre avec notre nouveau plan stratégique, je suis pleine d’optimisme. Avec un engagement inébranlable et des efforts de collaboration, nous visons à amplifier notre impact, à transformer plus de vies et à définir un avenir où le potentiel de chaque fille est nourri et célébré.”
L’élan s’est poursuivi en 2024, avec les antennes nationales du FAWE telles que le FAWE Zambie, le FAWE Malawi et le FAWE Sierra Leone qui ont lancé leurs propres plans stratégiques, renforçant ainsi leur engagement
en faveur des meilleures pratiques de gouvernance et de l’impact local.
Le Plan stratégique 2024-2028 du FAWE sert de feuille de route pour l’action et un impact mesurable. Au cours des cinq prochaines années, le FAWE se concentrera sur le renforcement des capacités organisationnelles et du leadership, l’amélioration des résultats programmatiques et la promotion du développement durable. Les principaux domaines prioritaires comprennent l’élargissement de l’accès à une éducation de qualité, l’amélioration des résultats de l’enseignement et de l’apprentissage, la promotion de politiques sensibles au genre et le plaidoyer en faveur de réformes systémiques aux niveaux national et régional.
Alors que le FAWE s’engage dans cette nouvelle phase stratégique, l’organisation reste fidèle à sa mission qui consiste à s’assurer qu’aucune fille n’est laissée pour compte dans la transformation de l’éducation en Afrique.
Avec des aspirations audacieuses et une vision claire, le FAWE est prêt à réaliser des progrès significatifs en matière d’égalité des sexes et d’éducation à travers le continent.
Numérisez Pour Accéder au Document
Complet du Plan Stratégique.

As we embark on the next chapter with our new strategic plan, I am filled with optimism. With unwavering commitment and collaborative efforts, we aim to amplify our impact, transforming more lives and shaping a future where every girl’s potential is nurtured and celebrated.” Dr. Martha Muhwezi


(En haut) Le ministre de l’Éducation de Zambie, l’Honorable Douglas Syakalima, coupe le ruban symbolisant le lancement du Plan stratégique du FAWE Afrique (2024-2028) en Zambie. L’honorable Aicha Bah Diallo, Présidente du Conseil d’administration du FAWE Afrique (troisième à gauche), la professeure Sarah Anyang Agbor, vice-présidente du Conseil d’Administration du FAWE Afrique (à droite), la professeure Enala Tembo Mwase, Présidente du Conseil d’Administration du FAWE Zambie (deuxième à gauche) et l’Honorable Simon De Comarmond, l’une des fondatrices et membre du Conseil d’administration du FAWE Afrique, assistent à la cérémonie.
(En bas) Photo de groupe lors de la cérémonie de lancement.
La gouvernance: Le pilier de la force du réseau du FAWE
Au Forum des éducatrices africaines (FAWE), la gouvernance n’est pas seulement une structure - c’est le fondement qui soutient et propulse la mission du réseau, à savoir promouvoir l’éducation sensible au genre à travers l’Afrique. Tout au long de l’année 2024, le FAWE a réaffirmé son engagement ferme en faveur d’une gouvernance participative, transparente et responsable au sein du secrétariat régional et de ses 34 Antennes nationales.
Au niveau national, plusieurs Antennes nationales ont tenu leurs Assemblées générales, renforçant ainsi l’importance de la participation des membres et du renouvellement du leadership. Les Assemblées générales sont des moments essentiels pour examiner les réalisations, fixer des priorités stratégiques et s’assurer que les structures de gouvernance sont alignées sur la vision et les valeurs fondamentales du FAWE.
En 2024, le Secrétariat régional du FAWE a soutenu les systèmes de gouvernance dans les différentes antennes, notamment le FAWE Kenya, le FAWE Congo Brazzaville, le FAWE Tanzanie, le FAWE Libéria, le FAWE Éthiopie et le FAWE Burundi. Des Assemblées générales complètes, suivies de l’intronisation de Conseils d’administration
nouvellement élus, ont été organisées au FAWE Seychelles, au FAWE Guinée, au FAWE Nigéria, au FAWE Bénin et au FAWE Mali. Chacune de ces réunions a joué un rôle crucial dans le renforcement du leadership, le renouvellement des mandats et la réaffirmation de l’engagement des antennes à l’égard de la mission du FAWE.
Reconnaissant la nécessité d’une capacité institutionnelle forte pour soutenir une programmation efficace, le FAWE a donné la priorité au renforcement des capacités de gouvernance. Au total, 42 participants issus de 11 Antennes nationales ont été formés en 2024 sur la gestion efficace des programmes et les pratiques de gouvernance afin de renforcer l’égalité entre les sexes dans le domaine de l’éducation. En outre, plusieurs antennes, notamment le FAWE Zimbabwe, le FAWE Ghana, le FAWE Libéria, le FAWE Tchad, le FAWE Mali, le FAWE Namibie, le FAWE Somalie, le FAWE Togo et le FAWE Zambie, ont entrepris des initiatives de renforcement de la gouvernance, allant de la révision des politiques internes à l’augmentation du nombre de membres et à la planification stratégique.
Au niveau régional, le FAWE Afrique, conformément

Dr Martha Muhwezi, Directrice Exécutive du FAWE Afrique (à gauche) et l’Honorable Aïcha Bah Diallo, Présidente du Conseil d’Administration du FAWE Afrique (à droite) lors de la Conférence panafricaine de l’UA sur l’éducation des filles et des femmes.


(en bas à gauche) De gauche à droite, Mme Catherine Mwangi, Chargée des finances du FAWE, Mme. Moussa Ba, Secrétaire Général du Conseil d’administration du FAWE
Mali, Mme Magnigne Diarra, Directrice Exécutive du FAWE Mali, le Dr Amadou Sy Savané, Ministre de l’Éducation du Mali, Mme Teresa Omondi-Adeitan, Directrice exécutive adjointe et responsable des programmes du FAWE Afrique, Mme Fraciah Kagu, Chargée du plaidoyer et des partenariats du FAWE Afrique, et Mme Fatimata Kane, Chargée de programme du FAWE Afrique, posent avec le ministre malien de l’Éducation dans les bureaux du ministère à Bamako, au Mali.
à ses statuts, a organisé avec succès deux réunions du Conseil d’administration en 2024. Le Conseil d’administration du FAWE Afrique, composé d’éminents éducateurs et dirigeants du continent, assure la supervision, l’orientation stratégique et la responsabilité fiduciaire de l’ensemble du réseau. Les réunions du Conseil d’administration ont été l’occasion d’examiner les performances régionales du FAWE, sa viabilité financière et son orientation politique. Des décisions clés ont été prises pour rendre opérationnel le Plan stratégique 2024-2028, renforcer la collaboration entre les Antennes nationales et affiner le programme de plaidoyer du FAWE au niveau continental.
Tout au long de ces processus, l’engagement du FAWE

(en bas à droite) Le personnel du FAWE Sénégal et du FAWE WASRO dans les bureaux du ministère de l’Éducation à Dakar, au Sénégal. De gauche à droite : Mme Ndeye Fatou Diouf, Mme Ndeye Oumou, Mme Khairy Sall Diouf, Mme Adama Mbaye et Mme Fatimata Kane.
en faveur d’une gouvernance inclusive et participative est resté clair. Les Assemblées générales et les réunions du Conseil d’administration ne sont pas simplement des exercices administratifs - ce sont des espaces essentiels où les visions sont affinées, les partenariats sont renforcés et l’énergie collective est exploitée pour promouvoir l’éducation des filles et des femmes en Afrique.
Dans un paysage où la gouvernance est souvent le facteur de différenciation entre la vision et l’impact durable, le FAWE continue d’être un phare de la façon dont une gouvernance forte, transparente et axée sur les valeurs peut transformer des vies à travers les générations.
(En haut) Membres du Conseil d’Administration du FAWE Afrique.
Renforcer le réseau du FAWE: Renforcement des capacités pour créer un impact
Conformément à l’objectif stratégique 3 du FAWErenforcer les capacités institutionnelles et améliorer l’efficacité opérationnelle du réseau du FAWE - deux formations essentielles sur le renforcement des capacités ont été organisées en 2024. Ces sessions, qui ont eu lieu en Ouganda (avril 2024) et à Saly au Sénégal en mai 2024, ont rassemblé les Antennes nationales du FAWE afin de renforcer les compétences, les connaissances et la collaboration au sein du réseau.
Les formations ont couvert un large éventail de sujets essentiels à l’avancement de la mission du FAWE, notamment les stratégies de collecte de fonds, la communication efficace, la gestion des subventions, la gouvernance, le plaidoyer et la mise en œuvre des modèles éprouvés du FAWE. Ces sessions ont fourni aux Antennes nationales les outils nécessaires à la mobilisation des ressources, à l’amélioration des efforts de plaidoyer et au renforcement de la mise en œuvre des projets pour
un plus grand impact.
Grâce à l’apprentissage par les pairs et aux sessions dirigées par des experts, les participants ont approfondi leur compréhension des meilleures pratiques en matière de croissance et de durabilité organisationnelles. Les formations ont également favorisé la collaboration entre les pays , garantissant que le plaidoyer et les interventions programmatiques du FAWE restent solides, fondés sur des preuves et adaptés aux besoins des filles et des femmes en Afrique.
En investissant dans son réseau, le FAWE continue à construire une base plus solide pour réaliser sa vision d’un système éducatif équitable et inclusif en matière de genre dans le continent. Ces initiatives de renforcement des capacités témoignent de l’engagement du FAWE à doter ses équipes des connaissances et des compétences nécessaires pour susciter un changement durable dans le domaine de l’éducation.

Le personnel du FAWE Afrique lors de la réunion de lancement de la Phase II du programme FAWE/Fondation Mastercard qui s’est tenue à Mbale, en Ouganda.

Le personnel du FAWE des antennes nationales, le personnel du FAWE Afrique et les membres du Conseil d’administration du FAWE Afrique lors d’une réunion de renforcement des capacités à Saly, au Sénégal.

Le personnel du FAWE de toute l’Afrique pose pour une photo de groupe lors de la réunion de lancement de la Phase II du programme FAWE/Fondation Mastercard qui s’est tenue à Mbale, en Ouganda.

CHAPITRE

Transformer Les Vies Grâce À L’éducation et aux Opportunités
Accorder une deuxième chance: La Phase II du programme FAWE-Fondation Mastercard
Que représente le programme?
Lancé en 2024, la Phase II du Programme FAWE- Fondation Mastercard, intitulé Second Chance Pathways for Increased Access to Tertiary Education for Marginalized Young Women and Men (Parcours de deuxième chance pour améliorer l’accès à l’enseignement supérieur des jeunes femmes et hommes marginalisés), est une initiative transformatrice d’une durée de sept ans (20242030) mise en œuvre dans 10 pays africains: Ouganda, Rwanda, Zambie, Malawi, Ghana, Liberia, Tanzanie, Zimbabwe, Éthiopie et Sénégal.
Le programme cible 10 550 jeunes femmes et hommes âgés de 15 à 25 ans, en mettant délibérément l’accent sur l’atteinte des groupes marginalisés, notamment les jeunes handicapés et les réfugiés, qui représentent 10 à 15 % de la population cible. Ledit programme cherche à améliorer l’accès à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle pertinente, en créant des voies viables vers un travail digne, l’entreprenariat et l’apprentissage tout au long de la vie.
Ancré dans l’engagement du FAWE en faveur de l’innovation et de l’équité, le programme s’aligne sur la stratégie “Young Africa Works” de la Mastercard Foundation et sur son cadre de programmation plus large en matière d’éducation et de transitions, qui prévoit que 30 millions de jeunes Africains, en particulier des femmes, auront un emploi digne d’ici 2030.
Lancement officiel dans quatre pays
L’année de sa création, le programme a été lancé en Ouganda, en Éthiopie, en Zambie et au Malawi, à l’issue d’un processus rigoureux de planification et d’intégration. Ces lancements sont le fruit d’une coordination et d’une collaboration étroites avec les parties prenantes locales, notamment les ministères de l’éducation, les institutions publiques et les partenaires de la société civile.
L’engagement des parties prenantes a mis l’acent sur l’élimination des obstacles systémiques à l’enseignement supérieur, en particulier le manque d’opportunités de transition qui aident les jeunes défavorisés à passer de l’enseignement secondaire à l’enseignement supérieur. S’appuyant sur les leçons tirées de la Phase I en Ouganda, où les programmes de transition ont considérablement amélioré l’accès à l’université et aux filières d’EFTP, le FAWE est en train d’étendre ce modèle de plaidoyer à huit autres pays.
En échangeant avec les ministères de l’éducation, les conseils nationaux de l’enseignement supérieur, les organismes d’accréditation des programmes d’études, les universités et les institutions d’EFTP, le FAWE jette les bases de l’institutionnalisation des opportunités de la deuxième chance. Ces engagements de haut niveau sont essentiels pour créer un environnement politique et des systèmes d’appui institutionnel qui permettent un accès équitable à l’enseignement supérieur.

(de gauche à droite) Mme Susan Opok-Tumusiime, Directrice Exécutive de l’antenne nationale du FAWE en Ouganda, Mme Lydia Madyirapanzi, Directrice Exécutive du FAWE au Zimbabwe (au centre) et Mme Antonia Mutoro, Directrice Exécutive de l’antenne nationale du FAWE au Rwanda (à droite) lors du lancement de la Phase II du programme FAWE/Fondation Mastercard en Éthiopie.

(à gauche): l’Honorable Madalitso Kambauwa Wirima, Ministre de l’Éducation du Malawi, et le Dr Martha Muhwezi, Directrice Exécutive du FAWE, lors du lancement de la Phase II du programme FAWE/Fondation Mastercard au Malawi.

(à gauche) M. Wesley Chabwera, Directeur Exécutif du FAWE au Malawi, Mme Susan Opok-Tumusiime, Directrice Exécutive du FAWE en Ouganda, M. Richard Chelagat, Directeur Administratif et Financier et du FAWE Afrique, le Dr Martha Muhwezi, Directrice Exécutive du FAWE Afrique, Mme Teresa Omondi-Adeitan, Directrice Exécutive Adjointe et responsable des programmes du FAWE Afrique, M. Costern Kanchele, Directeur Exécutif du FAWE Zambie, Mme Mary Mwakawago, Responsable de programme du FAWE Tanzanie, et Mme Lydia Madyirapanzi, Directrice Exécutive du FAWE Zimbabwe, lors du lancement de la phase II du programme FAWE/Fondation Mastercard en Zambie.

Les participants au lancement de la Phase II du programme FAWE/Fondation Mastercard en Ouganda posent pour une photo de groupe.

Anciens boursiers du FAWE, à savoir (de gauche à droite) Abayneh Abule, Abdurahman Mohammed, Maria Andualem, Kasech Dires et Fitsum Wendesen lors du lancement de la Phase II du programme FAWE/Fondation Mastercard en Éthiopie.

Le ministre de l’Éducation de Zambie, M. Douglas Syakalima, coupe le ruban symbolisant le lancement du plan stratégique du FAWE Zambie (2024-2028) en Zambie. Sont présents le professeur Enala Tembo Mwase, Président du Conseil d’administration du FAWE Zambie, la Directrice Exécutive du FAWE, le Dr Martha Muhwezi, (à gauche) le Dr Maggie Madimbo, membre du Conseil d’administration du FAWE Afrique, Mme Chiemelie Umenyiora, Responsable des affaires publiques et de la communication à la Fondation Mastercard, et Mme Teresa Omondi-Adeitan, Directrice Exécutive Adjointe et responsable des programmes du FAWE Afrique.
(de gauche à droite) Mme Naomi Kamitha, chargée de programme au FAWE Afrique, Mme Chiemelie Umenyiora, responsable des affaires publiques et de la communication à la Fondation Mastercard, et Dr Martha Muhwezi, Directrice Exécutive du FAWE.


(de gauche à droite) Mme Emily Gumba, Responsable des programmes au FAWE, M. Costern Kanchele, Directeur Exécutif du FAWE Zambie, et Mme Catherine Mwangi, Chargée des finances du FAWE Afrique.

Mme Emily Gumba, responsable de programme senior du FAWE (3eà gauche), pose avec le personnel du FAWE Éthiopie.
Inscription des jeunes femmes et des jeunes hommes issus de communautés défavorisées
D’ici à la fin de 2024, le programme s’est fixé pour objectif d’inscrire 1 100 participants dans les quatre pays de lancement et a presque atteint cet objectif avec 1 092 inscrits (789 femmes et 303 hommes), ce qui témoigne d’une forte dynamique depuis le début.
Ouganda: 500 étudiants inscrits
Éthiopie: 192 étudiants inscrits
Zambie: 200 étudiants inscrits
Malawi: 200 étudiants inscrits
Cette réussite est attribuée à l’efficacité des campagnes de mobilisation et de sensibilisation qui ont suscité une forte adhésion des communautés et encouragé les jeunes, en particulier les filles, à saisir l’opportunité d’une seconde chance d’éducation et d’une amélioration de leurs moyens de subsistance.
Une étape stratégique: le lancement du partenariat lors d’un événement parallèle de l’AGNU
Le programme a été officiellement lancé a l’échelle mondiale lors de l’événement Favoriser la parité: L’éducation inclusive pour un avenir durable, en marge de la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York. Organisée par la Fondation Mastercard, cette réunion a rassemblé des ministères de l’éducation, des partenaires au développement, des représentants de la société civile et des agences multilatérales afin d’accélérer l’éducation inclusive pour les jeunes Africains.
La signature de la phase II du partenariat entre le FAWE et la Fondation Mastercard, qui réaffirme leur
vision commune de l’équité en matière d’éducation et de l’apprentissage sensible au genre, a été au cœur de cette rencontre.
Cette deuxième phase s’appuie sur l’héritage de la Phase I, qui a amélioré l’accès à une éducation de qualité pour des milliers de filles en Afrique. Avec une portée plus large et une inclusion plus profonde des populations marginalisées, la Phase II représente un engagement encore plus important pour transformer les systèmes éducatifs et s’assurer qu’aucun jeune n’est laissé pour compte.

La directrice Exécutive du FAWE, Dr Martha Muhwezi (3eà gauche), se joint à des partenaires et parties prenantes clés pour manifester leur solidarité lors d’un événement parallèle organisé par la Fondation Mastercard en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis.
Le Programme de bourses d’études
FAWE/Fondation
Mastercard: Une lueur d’espoir pour les jeunes femmes et les jeunes hommes
Le FAWE, en partenariat avec la Fondation Mastercard, a permis à des jeunes gens doués sur le plan académique mais financièrement défavorisés, en particulier en Afrique, d’accéder à un enseignement secondaire et universitaire de qualité et pertinent. Les étudiants sélectionnés pour le programme bénéficient d’un ensemble holistique de soutiens financiers, sociaux et académiques tout au long de leurs études et lors de leurs transitions post-universitaires. Le programme est constitué d’un réseau mondial d’établissements d’enseignement et d’organisations à but non lucratif. En Éthiopie, le programme a touché un total de 800 jeunes femmes et hommes (600 filles et 200 garçons) tandis qu’au Rwanda, le programme a aidé 1200 jeunes femmes à obtenir une éducation de qualité tout au long de l’école secondaire et de l’université.
600
Des jeunes femmes éthiopiennes bénéficient du programme de bourses FAWE/ Mastercard Foundation
1,200
200
Des jeunes hommes en Éthiopie ont bénéficié du programme de bourses FAWE/ Mastercard Foundation
Les jeunes femmes soutenues par le programme bénéficient d’une éducation de qualité tout au long de leurs études secondaires et universitaires au Rwanda.
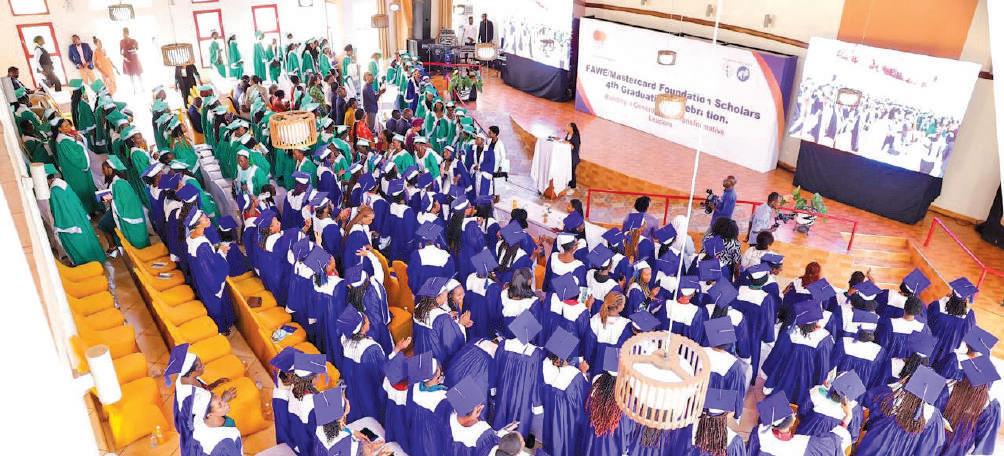
Les participants au programme de bourses du FAWE/Fondation Mastercard lors de leur cérémonie de remise des diplômes à Kigali, au Rwanda.
272 boursiers du FAWE et de la Fondation Mastercard diplômés au Rwanda
Le 27 septembre 2024, le FAWE Rwanda a organisé une cérémonie émouvante pour célébrer la remise des diplômes et la réussite de 272 jeunes femmes qui faisaient partie du programme de bourses d’études, rendu possible grâce à un partenariat avec le FAWE Afrique et la Fondation Mastercard. Ces boursières ont obtenu leur diplôme à l’Université du Rwanda et à
l’INES Ruhengeri, marquant ainsi une étape importante dans leur parcours académique et personnel.
La remise des diplômes a été honorée par la présence d’éminents partenaires issus de ministères, de partenaires de développement, du secteur public, de membres du FAWE et d’anciens étudiants du FAWE, tous réunis pour célébrer cette étape importante.
L’événement a été empreint de joie et de fierté, car ces jeunes femmes ont non seulement achevé leurs études, mais ont également acquis des compétences cruciales utiles pour l’avenir. Grâce au soutien de la Fondation Mastercard. Cette bourse complète comprend les frais de scolarité, l’allocation, le mentorat, l’orientation professionnelle, la formation au leadership, les compétences en matière d’entrepreneuriat et le soutien à la création d’entreprise. Ces ressources ont préparé les diplômés à entrer avec confiance dans la prochaine phase de leur vie, qu’il s’agisse d’entrer sur le marché du travail ou de poursuivre des études. Cette cérémonie de remise des diplômes a non seulement mis en lumière les réalisations individuelles de ces boursières, mais aussi l’impact qu’un soutien complet peut avoir sur la construction d’un avenir prospère pour les jeunes femmes au Rwanda.
Au cours de cette cérémonie, le FAWE Rwanda a récompensé le personnel qui a accompli un long et difficile parcours avec les boursières pendant une période de 10 ans depuis qu’elles ont rejoint le programme. Ils ont travaillé sans relâche et contribué à la réussite de ces boursières. Ces personnes, qui ne sont pas seulement des membres du personnel du FAWE Rwanda, ont travaillé et travaillent encore très dur pour s’assurer que ces boursiers reçoivent tout le soutien dont ils ont besoin et qu’ils se portent bien physiquement et psychologiquement, ils les suivent jour et nuit, quelle que soit l’heure, pour s’assurer que rien n’empêchera le boursier de bien réussir à l’école, et c’est pourquoi les boursiers les appellent Tantes et Oncles. Les boursiers les plus performants, qui ont été de grands leaders à

(En haut) L’Honorable Claudette Irere, Ministre d’État à l’Éducation du Rwanda, Mme Teresa Omondi-Adeitan, Directrice Exécutive Adjointe et responsable des programmes du FAWE Afrique, et Mme Antonia Mutoro, Directrice Exécutive du FAWE Rwanda, lors de la cérémonie de remise des diplômes du programme de bourses du FAWE/Fondation Mastercard à Kigali, au Rwanda.
divers égards, ont également été récompensés.
À ce jour, 704 jeunes femmes ont obtenu leur diplôme grâce à ce partenariat, dont plus de 75 % ont réussi à trouver un emploi digne et 29 % d’entre elles ont poursuivi des études supérieures. Cette réussite témoigne du pouvoir de l’éducation et de l’engagement d’organisations telles que le FAWE et la Fondation Mastercard Foundation à élever les jeunes femmes et à les aider à réaliser leurs rêves.
Des jeunes femmes ont obtenu leur diplôme grâce à ce partenariat, plus de 75 % d’entre elles ayant réussi leur transition vers un emploi décent et 29 % d’entre elles poursuivant leurs études supérieures à ce jour.
Le discours de clôture a été prononcé par la Ministre de l’Education, l’Honorable Irere Claudette, qui a félicité le FAWE Rwanda pour sa contribution essentielle à l’avenir du Rwanda et de l’Afrique. Elle a rappelé aux diplômés que l’obtention d’un diplôme implique de grandes responsabilités et les a exhortés à continuer à viser l’excellence, car ils sont la clé du progrès.

(En bas) Mme Teta Kayitaba, membre du Conseil d’Administration du FAWE Rwanda (à l’extrême droite), M. Daniel Mundeva, responsable du réseau du programme de bourses de la Fondation Mastercard, en compagnie du personnel du FAWE Rwanda lors de la cérémonie de remise des diplômes du programme de bourses du FAWE/Fondation Mastercard à Kigali, au Rwanda.

Tsedeke Wondesen, ancienne boursière du programme FAWE/Fondation Mastercard.
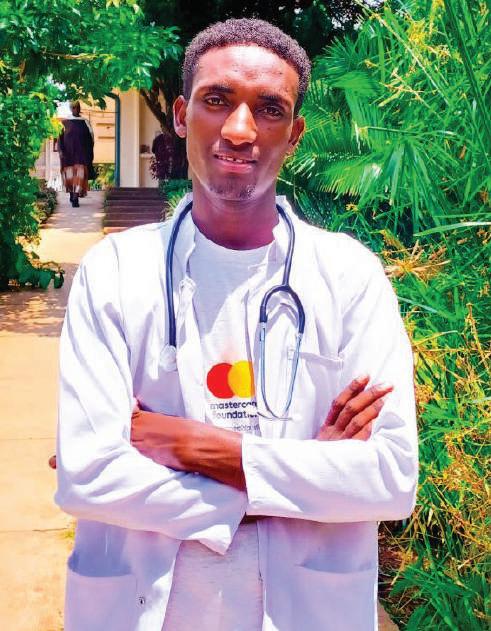
Wontesha Woma, ancienne boursière du programme FAWE/Fondation Mastercard.
3 boursiers éthiopiens bénéficient d’une nouvelle chance en matière d’éducation
En Éthiopie voisine, FAWE-Éthiopie a obtenu une demande urgente d’aide grâce à son réseau d’anciens boursiers : trois étudiants en médecine risquaient de devoir abandonner leurs études en raison de difficultés financières. L’un d’entre eux avait déjà quitté l’école de médecine. Comprenant la gravité du problème, le FAWE Éthiopie est rapidement passé à l’action. Grâce à leur intervention, deux étudiants - Wontesha Woma et Tsedeke Wondesen - ont reçu une aide financière non liée aux frais de scolarité, notamment une allocation mensuelle, des frais médicaux, du matériel pédagogique, des fournitures sanitaires et des vêtements, ce qui leur a permis de poursuivre leurs études sans interruption. Quant au troisième étudiant, Habtamu Abebe, qui avait déjà abandonné ses études, il a bénéficié d’une aide financière pour poursuivre ses études en gestion d’entreprise jusqu’à ce qu’il passe à l’école nationale de l’armée de l’air, où ses dépenses ont été entièrement prises en charge par le gouvernement. Aujourd’hui, Wontesha et Tsedeke poursuivent leur parcours pour devenir médecins, tandis qu’Habtamu s’engage avec confiance dans une nouvelle voie. Leurs réussites témoignent de la puissance d’une intervention opportune et d’un dévouement sans faille à la formation des futurs professionnels.
Aujourd’hui, Wontesha et Tsedeke poursuivent leur parcours pour devenir médecins, tandis qu’Habtamu s’engage avec confiance dans une nouvelle voie. Leurs réussites témoignent de la puissance d’une intervention opportune et d’un dévouement sans faille à la formation des futurs professionnels.

Sindu Yitna, ancienne boursière du programme FAWE/ Fondation Mastercard.
D’un petit village à l’université de Woldial’histoire de Sindu Yitna
Sindu Yitna, une jeune femme tenace originaire d’un modeste village, a transformé les défis en une odyssée inspirante qui résonne à travers les générations. Élevée par sa mère dévouée à la suite de la disparition de son père, la poursuite de l’éducation par Sindu est un symbole de résilience. Surmontant les contraintes financières, les prouesses académiques de Sindhu l’ont conduite au FAWE en 2014, où elle a trouvé un soutien inestimable en matière d’orientation professionnelle et de conseil, de service de mentorat, de formation linguistique et d’autonomisation. Animée par sa passion pour l’apprentissage et sa détermination à surmonter les obstacles dans son village, Sindu a déménagé à Adama City où elle avait vécu dans la maison de sa tante. Son parcours académique s’est poursuivi à l’université de Woldia en 2010 E.C., marquant un pas décisif dans la quête de connaissance et de développement personnel
de Sindu. Tout au long de son parcours, la détermination inébranlable de Sindu et son engagement en faveur de l’éducation témoignent du pouvoir de transformation de la résilience et de la poursuite de ses aspirations.
Alors qu’ils étaient à l’Université de Woldia, Sindu et Rahel Tekalign, anciens boursiers du FAWE, se sont lancés dans une mission visant à unir les étudiants au-delà des divisions sociétales. Leur vision s’est concrétisée par la création du club d’éthiopianisme, un symbole d’unité célébrant la riche histoire de l’Éthiopie.
Sindu Yitna, une jeune femme tenace originaire d’un modeste village, a transformé les défis en une odyssée inspirante qui résonne à travers les générations.
Le club d’éthiopianisme, né de leur vision, visait à primer sur les divisions ethniques et à favoriser la capacité des étudiants à résoudre les problèmes. L’association était un bastion de l’unité, organisant des célébrations et contribuant au paysage culturel et littéraire. Leurs programmes allaient de l’exploration de la littérature historique à l’organisation de débats d’experts, en passant par l’organisation d’événements caritatifs destinés à aider les enfants des rues et les personnes démunies. Le sens du leadership et le dévouement inébranlable de Sindhu l’ont distinguée et lui ont valu d’être reconnue à l’intérieur et à l’extérieur de l’université. Sa participation à des programmes culturels, ses expressions poétiques et son engagement dans des actions caritatives sont devenus emblématiques de son caractère. Cherchant à étendre son impact, Sindu s’est plongée dans une formation à la gestion de programmes en ligne, ce qui témoigne de sa résilience et de sa détermination.
Améliorer la vie des jeunes filles kenyanes: le projet
Imarisha Msichana
La grossesse chez les adolescentes reste un défi important au Kenya, en particulier à la suite de la pandémie du COVID-19. Pour y remédier, le FAWE Kenya, en partenariat avec la Fondation Mastercard, met en œuvre le projet Imarisha Msichana dans 20 comtés, dont Migori, Homa Bay, Siaya, Busia, Nairobi, Machakos, Kiambu et au-delà. Cette initiative transforme la vie de milliers de filles en les sensibilisant à l’éducation sexuelle, en favorisant la réinsertion des mères adolescentes dans les écoles et en améliorant la culture numérique des apprenants.
L’une des principales stratégies à l’origine de ce changement est le modèle d’autonomisation TusemeFAWE qui encourage les filles et les garçons à s’élever contre les obstacles à l’éducation. En réponse à l’ère numérique, le FAWE a numérisé le modèle Tuseme, élargissant ainsi sa portée et son impact. La phase pilote au Kenya a touché 160 écoles, formé 8 000 apprenants à la culture numérique et à la sécurité en ligne, et inscrit plus de 15 000 élèves à l’application Tuseme pour une formation en ligne.
Le projet a permis à plus de 5 000 mères adolescentes de retourner à l’école, réclamant ainsi leur droit à l’éducation et à l’avenir. Notamment, 153 de ces filles ont reçu des bourses complètes, couvrant plus que les frais de scolarité et assurant un soutien holistique.
Le projet Imarisha Msichana a également renforcé la collaboration multisectorielle, en engageant les parties prenantes dans les 20 comtés pour renforcer les systèmes d’orientation et promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR). Une étape importante a été le lancement du rapport d’analyse de la situation sur les grossesses chez les adolescentes,

(En haut) Mme Ruth Oloo, Responsable du programme Genre à la Fondation Mastercard, avec Mme Emily Gumba, responsable principale de programme au FAWE, lors du lancement du rapport d’analyse situationnelle du programme Imarisha Msichana sur les grossesses chez les adolescentes au Kenya et de la remise des prix des médias à Nairobi, au Kenya.
qui a rassemblé les parties prenantes, y compris les responsables gouvernementaux et les partenaires au développement, afin d’éclairer la politique et l’action. Dans un effort supplémentaire pour maintenir l’impact, le projet a déployé une composante d’engagement des médias et de récompenses, formant les journalistes à des reportages sensibles au genre et reconnaissant ceux qui ont fait prevue d’excellence dans la mise en lumière de l’éducation des filles et des questions de genre. À l’avenir, l’application Tuseme, actuellement testée au Kenya, devrait être déployée à l’échelle du continent, afin que des milliers d’autres jeunes Africains aient accès à cette plateforme numérique transformatrice. Vous trouverez ci-dessous des histoires de changement résultant du programme.

Le triomphe de Mary contre des forces presque insurmontables
Voici Mary Wanjiru Mbugua, originaire de la ville de Murungaru à Kinangop, dans le comté de Nyandarua, dont l’histoire ne ressemble à aucune autre. Mary n’était qu’une adolescente lorsqu’elle est tombée enceinte en 2020. Elle a perdu tout espoir de réaliser son rêve de terminer ses études lorsqu’elle a été contrainte d’abandonner l’école, ses parents ne pouvant subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant.
En juin 2022, sa vie s’est améliorée lorsqu’elle est retournée à l’école. Elle a rejoint le club Tuseme où elle a été encadrée et soutenue pour faire face à sa situation unique de mère étudiante adolescente, ce qui lui a valu les moqueries et les railleries de ses camarades de classe. Elle a pu reprendre espoir et confiance, et a finalement été élue présidente du club TUSEME, où elle a défendu la protection des filles contre les abus et les grossesses précoces, la participation des filles à l’enseignement des STIM et la conservation de l’environnement avec le soutien du Mouvement Ceinture Verte. Elle a également été élue à la tête de l’école, inspirant d’autres filles à devenir des leaders.
En 2024, Mary passe ses examens KCSE à l’école secondaire de Murungaru et obtient la moyenne de B. Ces excellents résultats lui permettront d’obtenir une place dans l’une des universités kenyanes dans le cadre des stages en cours. Elle envisage d’obtenir une licence en sciences infirmières et d’être un modèle pour les jeunes filles, en leur montrant qu’en dépit de


leur situation du passé, c’est possible d’atteindre ses objectifs. Avec le soutien d’organisations telles que le FAWE, elle souhaite devenir mentor afin d’aider les mères adolescentes à se réinscrire à l’école et à renouer avec leurs rêves. La direction de l’école lui a offert une opportunité où elle sert actuellement de mentor à ses pairs.
En ses propres termes, Mary déclare,
Je voudrais remercier le FAWE pour sa contribution à l’autonomisation des filles et des femmes. Tout le bien que vous faites continuera à transformer la jeune fille et la société en général. Je suis convaincue que pour de nombreuses filles, le FAWE est comme une oasis. Vous avez donné de l’espoir à celles d’entre nous qui ne voyaient que l’obscurité sur leur chemin. Je vous remercie personnellement de tout cœur de m’avoir permis de faire partie de votre histoire. Le voyage jusqu’à la Conférence de la Campagne Gender is My Agenda, au Ghana, pour représenter le FAWE lors du lancement du Manuel du FAWE sur la violence basée sur le genre en milieu scolaire (SRGBV) en juillet 2024, a été l’apogée du rêve de toute écolière. Continuez à tenir la lumière pour les autres. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci. Mary Wanjiru Mbugua
Alors que les étudiants font face aux défis de la vie, on remarque que les flux et les reflux de la vie présentent un caractère unique. Les clubs Tuseme ne sont pas seulement réservés aux mères adolescentes qui ont obtenu une seconde chance d’éducation en retournant à l’école. L’histoire de Sharlyne ci-dessous montre comment Tuseme a été une bénédiction de la manière la plus inattendue qui soit.
Mary Mbugua, participante au programme Imarisha Msichana.

Sharlyne Achieng’, participante au programme
Imarisha Msichana.
Le meilleur gain de Sharlyne Achieng grâce aux clubs Tuseme
Sharlyne Achieng est originaire du comté de Bungoma. Son espoir de poursuivre ses études a été anéanti lorsque sa mère est décédée en 2020, pendant les vacances de décembre. Elle a obtenu 313 points lorsque les résultats du KCPE ont été publiés quelques jours plus tard. Sa tante maternelle l’a accueillie, mais au lieu de l’emmener à l’école, elle a été contrainte à travailler comme serveuse dans un bar local, où elle a été arrêtée pour avoir travaillé comme mineure. Sharlyne s’est enfuie après avoir été libérée pour aller chez son oncle maternel qui l’a inscrite à l’école secondaire. Cette expérience a malheureusement été de courte durée, car elle a dû abandonner momentanément l’école en raison de problèmes familiaux. Sharlyne a alors trouvé un bienfaiteur qui l’a ramenée à l’école où elle a rejoint le club Tuseme.
Avec d’autres membres, Sharlyne Achieng s’est profondément impliquée dans les activités du club. Les membres ont commencé à parler des difficultés qui les affectaient et, avec les conseils spécialisés des parrains, ils ont commencé à partager leurs expériences, y compris les obstacles scolaires et sociaux à leur développement. C’est à ce moment-là que Sharlyne a fait part de ses difficultés aux membres du club. Elle avait été sauvée par un bienfaiteur qui ne pouvait cependant pas payer ses frais de scolarité. Grâce au club, elle a réussi à trouver un autre bienfaiteur qui l’a aidée à payer ses frais de scolarité.
Bientôt, la vie sociale et scolaire de Sharlyne a commencé à évoluer positivement. Avec la garantie d’un logement et du paiement des frais de scolarité, elle a commencé à améliorer son travail scolaire. Sur le plan social, elle a acquis la confiance nécessaire pour dire NON aux activités socioculturelles qui nuisent au bien-être et au développement d’une jeune fille. Grâce à sa participation
active, elle a représenté le club dans divers forums organisés par le FAWE dans le comté.
Avant de rejoindre le Tuseme Club, ses résultats étaient de l’ordre de la moyenne de D+ et moins, mais elle a commencé à s’améliorer. Son comportement était exemplaire à l’école, ce qui lui a permis de guider d’autres élèves. Sharlyne a passé le KCSE en 2024 et a obtenu la moyenne de C+, ce qui lui a permis d’entrer directement à l’université. Elle souhaite faire carrière dans le secteur de la santé.
Interrogée lors de la réunion d’évaluation d’Imarisha Msichana, Sharlyne a déclaré: “Le club Tuseme est une bénédiction,
Le club Tuseme est une bénédiction pour moi, je n’ai jamais eu le courage de me tenir devant les gens et de prendre la parole en public, mais grâce au club Tuseme et aux enseignements du club, j’ai acquis le courage de parler des problèmes qui me touchent, je n’avais pas d’endroit où rester, mais grâce à Tuseme, j’ai pu obtenir l’aide d’un bienfaiteur pour payer mes frais de scolarité et un endroit où me sentir chez moi”, a déclaré Sharlyne lorsqu’elle a raconté son histoire lors de la réunion d’évaluation de l’IMP à Bungoma, en 2024. Sharlyne Achieng
Les histoires de Mary et de Sharlyne sont quelques-unes des nombreuses histoires positives qui ont émergé de l’installation des clubs Tuseme dans les écoles du Kenya. Chaque élève qui rejoint le club a une histoire positive unique à raconter sur l’impact du club dans sa vie et celle de ses proches. Les clubs Tuseme sont un cadeau qui ne cesse d’être offert.
Promouvoir les
meilleures pratiques journalistiques tenant compte de l’égalité des sexes
Les médias sont un élément essentiel de la communication telle que nous la connaissons aujourd’hui. Ceux-ci jouent un rôle essentiel en informant, en persuadant et en changeant la culture du public sur diverses questions d’actualité. Ils ont été en première ligne dans la lutte contre les grossesses chez les adolescentes et les mariages précoces en Afrique, en particulier au Kenya. Toutefois, les êtres humains n’existent pas dans le vide, car ils sont le produit de leur société et de leur environnement. Il est donc probable que même lorsque les journalistes écrivent des articles sur des sujets tels que la grossesse des adolescentes et le mariage précoce, des préjugés et des stéréotypes personnels peuvent apparaître. C’est pour cette raison que le FAWE, par l’intermédiaire du FAWE Kenya, a organisé une formation pour 60 journalistes sur la rédaction et le reportage sensible au genre. Tirée des 20 comtés où le programme Imarisha Msichana est mis en œuvre, cette activité visait à doter les journalistes des compétences nécessaires pour couvrir des sujets portant sur le genre de manière responsable et respectueuse de la dignité humaine.
Les participants étaient des représentants de journalistes travaillant dans la presse écrite, l’audiovisuel et les médias sociaux, issus de diverses maisons de presse locales et internationales, ainsi que des journalistes indépendants.
Dans le but de reconnaître et de promouvoir l’excellence en matière de reportage sensible au genre, le FAWE a organisé une cérémonie de remise des prix aux médias afin de récompenser les journalistes formés qui ont fait preuve d’un engagement et d’une excellence remarquables pour mettre en lumière les questions de genre dans leurs reportages. L’événement a été le point culminant des efforts visant à encourager les reportages inclusifs qui amplifient les voix des groupes marginalisés et promeuvent l’équité en matière de genre. Au total, 45 articles ont été soumis par des journalistes des comtés où nos projets sont mis en œuvre, ce qui témoigne d’une grande diversité de récits et de reportages percutants. Un jury indépendant, composé de journalistes expérimentés du Conseil des médias du Kenya et de l’Association des femmes dans les médias du Kenya (AMWIK), a examiné les candidatures. Les critères d’évaluation étaient les suivants: la pertinence et l’impact de l’article
La profondeur de la recherche et l’exactitude des faits
Approches novatrices en matière de narration
L’éthique du reportage et la sensibilité au genre.
Nancy Kering, journaliste de Citizen TV, a remporté le concours. Son reportage a mis en lumière le nombre de filles qui se marient avant l’âge de 18 ans, peu après avoir subi des mutilations génitales féminines (MGF) dans le comté de Kajiado, au Kenya. Dans son article, Nancy a présenté les efforts entrepris par le FAWE dans la lutte contre le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines, tels que la création de clubs Tuseme dans les écoles et le plaidoyer en faveur de la réinsertion des mères adolescentes à l’école.
Le FAWE, par l’intermédiaire de l’équipe du programme Imarisha Msichana et des journalistes, a établi une formidable relation de travail. Les journalistes se sont également engagés à améliorer et à accroître leurs reportages sur les questions de genre.
Regardez le Reportage Gagnant Ici.https://www. youtube.com/ watch?v=7sr8oB9x_


La journaliste de Citizen TV Nancy Kering (à gauche) reçoit un prix d’excellence pour ses reportages sur les questions de genre de la part de Mme Catherine Matara, représentante du ministère de l’Éducation du Kenya, lors du lancement du rapport d’analyse de la situation sur les grossesses chez les adolescentes au Kenya et de la remise des prix des médias du programme Imarisha Msichana.
(De gauche à droite) M. Richard Chelagat, Directeur Administratif et Financier du FAWE, le professeur Hazel Mumbo, Trésorière honoraire du Conseil d’Administration du FAWE, et Mme Teresa Omondi-Adeitan, Directrice Exécutive adjointe et responsable des programmes du FAWE Afrique, reçoivent des œufs de la communauté ghanéenne.
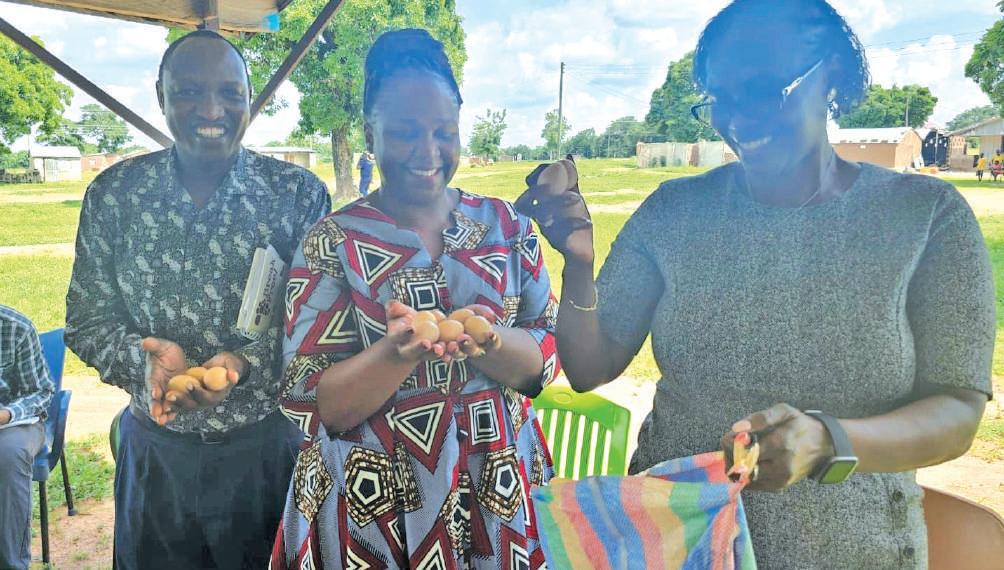
SHARE: Promouvoir l’égalité des sexes et les droits de santé en Afrique
Le programme SHARE (Sexual Health and Reproductive Education - Éducation à la santé sexuelle et reproductive) continue de promouvoir l’égalité des sexes et les droits à la santé des filles et des jeunes femmes marginalisées au Ghana et en Ouganda. Ancré dans des solutions communautaires, le programme, fondé par Affaires mondiales Canada, autonomise les jeunes femmes et renforce les systèmes locaux afin de soutenir leurs droits, leur éducation et leur bien-être.
En Ouganda, le FAWE a facilité la réintégration scolaire de 247 filles, les aidant à reprendre leurs études après des périodes d’interruption, souvent dues à des grossesses précoces ou au travail des enfants. L’adoption d’un règlement local dans le district de Buyende, interdisant la pêche des enfants et les marchés de nuit - deux activités connues pour exposer les filles à l’exploitation et à l’abandon scolaire - a constitué une avancée politique significative.
En outre, 53 jeunes femmes ont été dotées de compétences de vie essentielles et d’un soutien psychosocial, tandis que 71 membres de la communauté de pratique ont été formés au leadership féminin et aux stratégies de plaidoyer. Ces efforts permettent de mettre en place un solide réseau de base qui s’engage
à promouvoir les systèmes d’éducation et de santé sensibles au genre.
Au Ghana, les efforts de plaidoyer ont mis l’accent sur la remise en question des normes sociales défavorables aux femmes et sur la lutte contre les causes profondes des grossesses chez les adolescentes, de la violence basée sur le sexe et de l’inefficacité des soins parentaux. Le programme a formé 78 dirigeants communautaires à la santé et aux droits sexuels et reproductifs (SDSR), leur dotant les moyens de mener des conversations et des interventions éclairées au sein de leurs communautés.
En outre, 21 journalistes ont été formés à plaider en faveur de la santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescents, en mettant l’accent sur des reportages tenant compte des spécificités de chaque sexe. Cela a conduit à un changement notable dans les repportages des médias, mettant en évidence une couverture responsable et basée sur les droits des questions touchant les filles et les jeunes femmes.
Le programme SHARE est un exemple puissant de la manière dont le plaidoyer collectif, le leadership local et l’autonomisation des jeunes peuvent créer des environnements où les filles sont protégées, soutenues et habilitées à s’épanouir.

M. Richard Chelagat, Directeur Administratif et Financier du FAWE, et le professeur Hazel Mumbo, Trésorière Honoraire du Conseil d’administration du FAWE, lors d’une réunion au Ghana.

(De gauche à droite) – Le chef suprême de la région traditionnelle de Bongo, dans le nord-est du Ghana, Nana Baba Salifu Atamale Lemyaarum, en compagnie de M. Martin Okhako, chargé de programme au FAWE. L’équipe du FAWE a rendu une visite de courtoisie au chef dans le cadre du programme SHARE.
L’information se rapproche des communautés au Ghana
En 2024, le FAWE Afrique, en partenariat avec le FAWE Ghana dans le cadre du programme SHARE, a créé 16 centres d’information communautaires (CIC) dans quatre districts du nord du Ghana pour élargir l’accès à l’information sur la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR). Dirigés par les responsables du FAWE, notamment le Professeur Hazel Miseda Mumbo, Mme Teresa OmondiAdeitan et M. Richard Chelagat, les CIC sont des espaces sûrs, gérés par la communauté, qui facilitent l’apprentissage, le dialogue et l’orientation en collaboration avec le personnel de santé et les dirigeants locaux. Au cours de leur première année d’existence, les CIC ont impliqué 609 personnes - 437 femmes et filles et 172 hommes et garçons - afin d’approfondir la sensibilisation aux SDSR des adolescents et de renforcer les systèmes d’appui communautaire, conformément à l’engagement du FAWE en faveur d’une autonomisation inclusive et communautaire.
Rien qu’en 2024, les CIC ont organisé des séances d’engagement communautaire qui ont touché 609 personnes, dont 437 femmes et filles et 172 hommes et garçons 609
Le FAWE a fait un progrès significatif dans la promotion de systèmes de santé inclusifs en formant 120 agents de santé à la santé et aux droits sexuels et reproductifs (SDSR) et à la langue des signes de base en 2024.
Améliorer les soins de santé inclusifs:
120 agents de santé formés à la santé sexuelle et reproductive et au langage des signes
En 2024, le FAWE a fait un grand pas en avant dans la promotion de systèmes de santé inclusifs en formant 120 agents de santé à la santé et aux droits sexuels et reproductifs (SDSR) et à la langue des signes de base. L’initiative, mise en œuvre dans le cadre du programme Make Way, visait à doter les prestataires de soins de santé des compétences nécessaires pour offrir aux jeunes handicapés des services accessibles et adaptés à leurs besoins. La formation a permis de combler une lacune importante du système de soins de santé, à savoir la nécessité de disposer de prestataires capables de comprendre et de répondre aux divers besoins de tous les jeunes, en particulier ceux qui vivent avec un handicap. En renforçant les capacités en matière de santé sexuelle et reproductive et de langue des signes, le programme a amélioré la communication entre les travailleurs de la santé et les clients, améliorant ainsi l’accès aux services essentiels pour les jeunes marginalisés.
Cette approche s’aligne sur le principe fondamental de Make Way: utiliser une approche intersectionnelle pour démanteler les barrières à la SDSR. Le programme reconnaît que les jeunes peuvent être confrontés à de multiples formes de discrimination qui se chevauchent, liées au handicap, au genre, à l’ethnicité ou au statut social, qui aggravent leur vulnérabilité et limitent leur accès aux services de santé.
Grâce à cette intervention, le FAWE a non seulement renforcé la prestation de services, mais a également contribué à modifier les perceptions et les pratiques au sein du système de santé. En conséquence, les prestataires de soins de santé sont désormais plus conscients, mieux équipés et plus inclusifs, posant ainsi les bases d’un système qui garantit qu’aucun jeune n’est laissé pour compte dans l’accès à ses droits sexuels et reproductifs. Ce travail s’inscrit dans le cadre du plaidoyer plus large du FAWE en faveur d’un monde où chaque jeune, indépendamment de ses origines ou de ses capacités, a accès à une éducation sexuelle complète, à l’autodétermination, à la contraception et à des soins de qualité.
Grâce à cette intervention, le FAWE a non seulement renforcé la prestation de services, mais a également contribué à modifier les perceptions et les pratiques au sein du système de santé. En conséquence, les prestataires de soins de santé sont désormais plus conscients, mieux équipés et plus inclusifs, posant ainsi les bases d’un système qui garantit qu’aucun jeune n’est laissé pour compte dans l’accès à ses droits sexuels et reproductifs.
Les femmes et la participation politique: Renforcer les capacités de la prochaine génération de leaders africains
Au cours des cinq dernières années, le FAWE a été l’un des principaux partenaires de mise en œuvre du projet Femmes et Participation Politiques (FPP), dirigé par International IDEA en collaboration avec six partenaires régionaux et continentaux. L’initiative est conçue pour accroître la participation et l’influence des femmes dans la vie politique et publique en Afrique, conformément au Protocole de Maputo, aux Objectifs de développement durable (ODD) et aux cadres de gouvernance régionaux.
Le projet FPP est actuellement actif dans huit pays - le Botswana, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, l’Eswatini, le Kenya, le Sénégal, la Tanzanie et le Zimbabwe - où il promeut des systèmes politiques inclusifs et renforce les capacités des femmes leaders actuelles et en devenir.

En 2024, le FAWE a mené des engagements de haut niveau au Kenya, y compris un atelier ciblant les jeunes femmes leaders et les aspirantes politiques. L’événement a vu la participation de la Commission électorale indépendante et des frontières (IEBC) et du Bureau du Registre des partis politiques. L’atelier a sensibilisé les participants aux systèmes électoraux, aux cadres juridiques et aux structures des partis politiques, tout en encourageant une préparation précoce aux futures élections.


L’un des points forts de la réunion a été une session de mentorat menée par des femmes parlementaires expérimentées, dont l’Honorable Millie Odhiambo Mabona, qui ont partagé leurs expériences personnelles et offert des conseils pratiques aux jeunes femmes désireuses d’entrer dans la vie politique.
Au niveau régional, le FAWE a contribué au lancement de la deuxième édition du Baromètre du FPP en Afrique du Sud - un outil de plaidoyer et de redevabilité qui suit et met en évidence les progrès réalisés en matière de participation politique des femmes en Afrique.
En parallèle, le FAWE a développé un module scolaire modèle régional visant à inculquer des valeurs de leadership aux filles et aux jeunes femmes. Le module promeut un leadership éthique, inclusif et civique dès le plus jeune âge, jetant ainsi les bases d’une future génération de femmes leaders transformatrices.
Grâce à ces efforts, le FAWE continue de renforcer son engagement à mettre en place des systèmes de gouvernance inclusifs où les femmes et les filles africaines peuvent participer et diriger.
Prof. Nana Jane Opoku Agyemang, Vice-Présidente du Ghana.
Mme Cynthia Barasa, assistante de programme du FAWE, s’exprimant lors d’un événement de FPP.
Données pour le changement II: utilisation des preuves pour mettre fin à la violence basée
sur le genre en milieu scolaire
Le programme Données pour le changement II est une initiative de collaboration entre le FAWE et Together for Girls, qui s’appuie sur les succès de la première phase pour conduire à des changements systémiques par le biais d’interventions basées sur des preuves.
La phase I du programme a mis l’accent sur la collecte et l’analyse de données afin d’améliorer les résultats en matière d’éducation pour les réfugiés et les populations déplacées de force, en mettant délibérément l’accent sur les données ventilées par sexe. L’accent a notamment été mis sur les adolescentes et les jeunes femmes dans les communautés d’accueil, ce qui a permis d’obtenir des informations essentielles sur les défis et les besoins éducatifs qui leur sont propres.
La phase II passe maintenant de la collecte de données à l’action et à la mise en œuvre. Le programme pilote actuellement le Manuel du FAWE sur la violence basée sur le genre en milieu scolaire au Nigeria, au Malawi et au Zimbabwe. Ce Manuel est conçu comme une boîte à outils pratique pour les éducateurs, les chefs d’établissement et les administrateurs, les dotant de stratégies pour prévenir et répondre à la violence basée sur le genre en milieu scolaire.

(Debout) Mme Cynthia Barasa, assistante de programme FAWE, s’exprimant lors d’un atelier organisé au Zimbabwe par le programme Donneées pour le changement II.
Outre le Manuel, des fiches d’information et du matériel de sensibilisation sont diffusés pour soutenir la formation et sensibiliser les communautés. L’objectif global est de renforcer les systèmes scolaires, de créer des environnements d’apprentissage sûrs et d’éliminer la violence basée sur le genre à l’intérieur et autour des écoles et autres établissements d’enseignement. Grâce au programme Données pour le changement II, le FAWE réaffirme son engagement en faveur d’une éducation sûre, inclusive et sensible au genre, en veillant à ce que chaque fille puisse apprendre dans un environnement exempt de violence et de peur.
Construire des espaces d’apprentissage plus sûrs:
Co-création d’un Manuel de prévention des VBG pour l’enseignement supérieur
En 2024, le FAWE a participé à la phase zéro du programme de la Fondation Mastercard par le biais d’une initiative de collaboration de six mois avec le Wellesley Centers for Women (WCW), le Gender Centre-Ghana et le CREAWKenya. Cette phase fondamentale visait à développer une approche culturellement informée et spécifique au contexte pour prévenir la violence sexuelle et basée sur le genre dans les établissements d’enseignement supérieur qui accueillent les boursiers de la Fondation Mastercard.
L’initiative a adopté une approche écologique et participative, en mettant l’accent sur le contexte local et les nuances culturelles. La contribution du FAWE au cours de cette période s’est focalisée sur la collecte de données contextuelles, en identifiant les questions clés, et
en s’engageant avec les parties prenantes pour informer la co-création d’un programme complet.
L’objectif final est de co-développer un manuel de prévention et de réponse aux VBG adapté aux établissements d’enseignement supérieur, en particulier ceux qui sont affiliés aux programmes d’études de la Fondation. Une fois finalisé, le manuel servira de ressource clé pour promouvoir des environnements universitaires sûrs, inclusifs et favorables pour les jeunes femmes et les jeunes hommes en Afrique.
Cette phase zéro marque le début d’un long parcours vers des solutions durables à la violence sexuelle et basée sur le gnre dans les établissements d’enseignement supérieur, jetant les bases d’une phase de co-création et d’une éventuelle mise à l’échelle.
Promouvoir l’enseignement sensible au genre grâce au programme Echidna
Le programme Echidna Global Scholars a continué à soutenir le plaidoyer du FAWE pour des pratiques d’enseignement sensibles au genre en Eswatini, en Tanzanie, au Soudan du Sud et au Nigéria en 2024. L’initiative visait à améliorer les environnements d’apprentissage en s’attaquant aux obstacles systémiques qui entravent l’accès des filles à une éducation de qualité.
En Tanzanie, le FAWE a collaboré avec l’Institut d’éducation des adultes pour réviser les modules d’enseignement dans le cadre d’une approche genre. L’antenne a également mis en avant son leadership en matière de renforcement des capacités des enseignants lors de la Conférence régionale sur l’éducation de la Communauté d’Afrique de l’Est à Arusha, où elle a plaidé en faveur de la mise en œuvre de politiques de réintégration scolaire pour les jeunes mères.
En Eswatini, le FAWE a élaboré une straté gie de
plaidoyer complète et a commandé des recherches pour examiner le statut de l’éducation des filles et l’impact des grossesses précoces sur les taux d’abandon scolaire. Ces efforts visent à informer les politiques nationales qui favorisent des environnements d’apprentissage inclusifs.
Au Nigeria, le FAWE a lancé un rapport de référence sur les grossesses chez les adolescentes, qui a mis en évidence les effets conjugués de l’insécurité sur l’éducation des filles. L’antenne a également élaboré un tableau de bord pour évaluer la mise en œuvre par le pays du Protocole de Maputo, révélant des obstacles culturels persistants à la lutte contre la violence basée sur le genre et à l’accès à l’éducation pour les filles.
Grâce au Programme Echidna, le FAWE et ses Antennes sont en train d’établir des preuves, d’influencer les politiques et d’équiper les systèmes éducatifs afin qu’ils répondent plus efficacement aux besoins des filles et des jeunes femmes en Afrique.
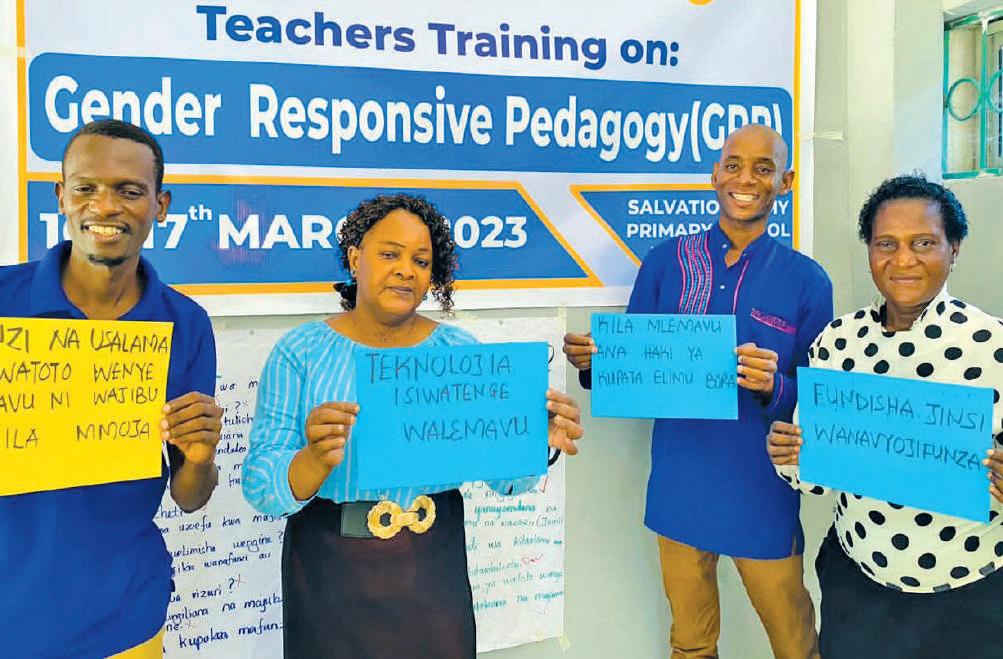
Des enseignants tanzaniens brandissent des messages lors d’une formation en GRP.
Ouvrir des portes, changer des vies: Les initiatives du FAWE en matière de bourses
d’études pour l’éducation des filles
L’éducation est plus qu’un droit, c’est une bouée de sauvetage. Au FAWE, les bourses d’études ne sont pas seulement une question de frais de scolarité; elles sont une voie vers la dignité, l’opportunité et la transformation. Dans toute l’Afrique, les initiatives du FAWE en matière de bourses d’études sont conçues pour atteindre les personnes les plus marginalisées - les mères adolescentes, les jeunes filles issues de communautés démunies et les chercheurs en herbe. Ces programmes reflètent la conviction du FAWE que chaque fille, quelle que soit son origine ou sa situation, mérite d’avoir la chance d’apprendre et de diriger.
In Numbers
17
des femmes de 14 pays ont obtenu avec succès des bourses du Commonwealth pour l’année universitaire 2024/2025.

153
La FAWE a accordé 153 bourses complètes à des mères adolescentes menacées d’abandon scolaire. Ces bourses ne se limitent pas à des aides financières : elles incluent un mentorat, un soutien psychosocial et des actions de sensibilisation communautaire pour lutter contre la stigmatisation.
17 femmes de 14 pays ont obtenu avec succès des bourses du Commonwealth pour l’année universitaire 2024/2025.
14

Bourses du Commonwealth:
Promouvoir le leadership des femmes grâce à l’enseignement supérieur
La collaboration du FAWE avec la Commission des bourses du Commonwealth continue d’ouvrir des voies académiques mondiales pour les femmes africaines. Ces bourses prestigieuses, financées par le gouvernement britannique, offrent une prise en charge complète des études de troisième cycle au Royaume-Uni, permettant aux boursiers de contribuer au développement durable et à l’innovation dans leur pays d’origine.
En 2024, le FAWE a joué un rôle clé dans la nomination de candidates talentueuses à travers l’Afrique. Sur 52 candidatures - comprenant 27 candidats à la maîtrise et 25 candidats au doctorat - 17 femmes de 14 pays ont obtenu des bourses du Commonwealth pour l’année académique 2024/2025.
Ce partenariat est plus qu’une opportunité académiquec’est un investissement stratégique dans l’avenir de l’Afrique. Les boursiers sélectionnés sont prêts à devenir des leaders influents dans les domaines de la science, de l’éducation, des politiques publiques et du développement, renforçant ainsi la voix du continent dans les espaces mondiaux de recherche et d’innovation.
L’éducation est plus qu’un droit, c’est une bouée de sauvetage. Au FAWE, les bourses d’études ne sont pas seulement une question de frais de scolarité; elles sont une voie vers la dignité, l’opportunité et la transformation.
Le Fonds pour l’éducation des filles africaines (AGEF): Un engagement local en faveur de la deuxième chance
Lancé en 2022, le Fonds pour l’éducation des filles africaines (AGEF) est l’initiative phare du FAWE visant à soutenir certaines des filles les plus vulnérables d’Afrique, en particulier les mères adolescentes, en leur donnant une seconde chance d’accéder à l’éducation.
Le Fonds soutient actuellement des filles au Kenya, au Togo, en Eswatini, au Libéria et au Burundi, reflétant ainsi l’engagement du FAWE à ne laisser aucune fille de côté.
En 2024, le FAWE a renforcé cet engagement avec le lancement de l’AGEF pour le Bureau sous-régional de l’Afrique de l’Ouest. Le lancement a eu lieu lors de la réunion annuelle de planification et d’examen du FAWE à Naivasha, au Kenya, où le personnel a fait preuve d’une solidarité remarquable en faisant des contributions personnelles, symbolisant un engagement collectif à élargir les opportunités pour les filles à travers le continent.

(de gauche à droite) Mme Teresa Omondi-Adeitan, Directrice Exécutive adjointe et responsable des programmes FAWE Afrique, Mme Catherine Badji, Chargée de finances, Dr Martha Muhwezi, Directrice Exécutive FAWE Afrique, Dr Bity Diene, Coordinatrice WASRO, et M. Richard Chelagat, Directeur Administratif et Financier FAWE, posent pour une photo lors de la remise des fonds AGEF au bureau WASRO. Cette cérémonie s’est déroulée à Naivasha, au Kenya.
L’AGEF a également continué à bénéficier de la générosité des entreprises. North and South Travel, sous la direction de Kanveer Lochab, a parrainé deux mères adolescentes supplémentaires au Kenya cette année. Cela porte à cinq le nombre total de filles soutenues par le fonds, dont une qui a terminé avec succès l’école secondaire et se prépare maintenant à commencer une formation diplômante en 2025.
Bourses
Imarisha Msichana: Une seconde chance pour les mères
adolescentes
Dans le cadre du programme Imarisha Msichana, le FAWE a accordé 153 bourses d’études complètes à des mères adolescentes risquant d’abandonner l’école. Ces bourses ne sont pas seulement financières, elles comprennent également un mentorat, un soutien psychosocial et un plaidoyer communautaire pour lutter contre la stigmatisation. Ce programme est la pierre angulaire de la mission du FAWE, qui consiste à veiller à ce que les filles confrontées à des grossesses précoces ne soient pas exclues de façon permanente du système éducatif. Imarisha prouve qu’avec le soutien adéquat, les filles peuvent retourner à l’école, s’épanouir et réécrire leur avenir.
Grâce à l’AGEF, le FAWE montre comment la philanthropie africaine et les partenariats public-privé peuvent avoir un impact tangible, en redonnant espoir, en reconstruisant l’avenir et en réaffirmant le pouvoir de transformation de l’éducation pour chaque fille africaine.
Bourses d’aide sociale attribuées par le personnel:
La solidarité en action
Au FAWE, l’engagement commence au sein de l’organisation. En 2024, le personnel du FAWE a poursuivi son initiative de base visant à soutenir l’éducation des filles en mettant en commun ses ressources pour financer l’éducation secondaire de jeunes filles au Kenya. Ce programme de bien-être interne reflète les valeurs qui animent la mission du FAWE - la solidarité, l’empathie et l’action. Il montre que le changement ne nécessite pas toujours un financement externe; il peut commencer avec le personnel qui croit au pouvoir de l’action collective.
Renaître les rêves: Le combat d’Alice pour l’éducation
Le parcours d’Alice Meseno Pere, du désespoir au triomphe, a commencé par un documentaire et s’est achevé lorsqu’elle a fièrement eu en main un bulletin de notes du Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE). Son histoire est celle d’une résilience, d’un espoir inébranlable et du pouvoir transformateur de l’éducation.
Née dans le pittoresque comté de Narok, au Kenya, Meseno est l’aînée des enfants de M. et Mme Pere. Elle a grandi en rêvant de devenir avocate, inspirée par les histoires de femmes Maasai qui avaient défié les barrières culturelles, échappant aux mutilations génitales féminines (MGF) et aux mariages d’enfants pour poursuivre des carrières juridiques. Déterminée à suivre leurs traces, elle a travaillé dur à l’école primaire de Naning’oi malgré les ressources limitées de l’établissement, notamment des salles de classe inadéquates et l’absence de bibliothèque.
Cependant, son parcours a pris un tournant inattendu en 2020, lors de la pandémie de COVID-19. Lorsque les écoles ont fermé dans tout le pays, d’innombrables filles ont été confrontées à une vulnérabilité accrue, et Meseno n’a pas fait exception à la règle. À l’âge de 14 ans, elle est tombée enceinte peu après avoir obtenu son certificat d’études primaires au Kenya (KCPE). Elle a donné naissance à un petit garçon au début de l’année 2021, juste au moment de la réouverture des écoles.
Son histoire a attiré l’attention du FAWE lorsqu’elle a été présentée dans le documentaire Her Stolen Childhood (Son enfance volée), qui mettait en lumière les difficultés rencontrées par les jeunes filles tombées enceintes pendant la pandémie. Sa situation s’est aggravée lorsque son père, incapable de payer les frais d’inscription à l’école secondaire, s’est arrangé pour la marier à l’âge de 15 ans. Mais sa mère, qui croyait fermement en l’éducation, a refusé d’abandonner. Avec l’aide de l’oncle de Meseno, elle a obtenu une place pour sa fille à l’école secondaire de Melelo.
La nouvelle de sa situation critique est parvenue au Secrétariat régional du FAWE, où le personnel a fait preuve d’un remarquable élan de solidarité. Ils ont collecté des fonds pour couvrir les frais de scolarité, d’internat, d’uniforme et de papeterie, assurant non seulement son retour à l’école mais couvrant également ses frais de scolarité pour le trimestre suivant.
“J’ai été anéantie lorsque j’ai appris que ma fille aînée était sur le point d’être mariée. Cela m’a brisé le cœur de penser qu’elle vivrait la même vie que moi. J’ai toujours rêvé d’éduquer mes enfants pour qu’ils aient une vie meilleure. J’ai prié et Dieu a répondu à mes prières”, a déclaré sa mère, Mme Noontawaua Pere.
Ayant bénéficié d’une seconde chance, Meseno s’est entièrement consacrée à ses études. Elle s’est présentée aux examens du KCSE et a obtenu un C-. Bien qu’elle ne rêve plus de devenir avocate, elle s’est découvert une nouvelle passion - la gestion des ressources humaines - et se prépare à rejoindre un établissement d’enseignement supérieur pour obtenir un diplôme dans ce domaine.
“Je suis très reconnaissante au FAWE. Sans leur intervention rapide, je n’aurais jamais pu aller à l’école secondaire. Aujourd’hui, j’ai un avenir, non seulement pour moi, mais aussi pour mon enfant. Même mon père a changé d’avis et tous mes frères et sœurs, garçons et filles, sont scolarisés. Le foyer de Pere sera un foyer de personnes éduquées, et cela me rend très heureuse”, a déclaré Mme Meseno.
Son histoire n’est pas unique. Partout en Afrique, trop de filles risquent de perdre leur éducation en raison de difficultés financières, de grossesses précoces ou de mariages forcés. C’est pour cette raison que le FAWE a lancé le Fonds pour l’éducation des filles africaines en novembre 2022. Ce fonds a déjà soutenu quatre filles au Kenya, leur permettant ainsi d’achever leur éducation secondaire.

Je suis très reconnaissante au FAWE. Sans leur intervention rapide, je n’aurais jamais pu aller à l’école secondaire. Aujourd’hui, j’ai un avenir, non seulement pour moi, mais aussi pour mon enfant. Même mon père a changé d’avis et tous mes frères et sœurs, garçons et filles, sont scolarisés. Le foyer de Pere sera un foyer de personnes éduquées, et cela me rend très heureuse”, Meseno
Alice Meseno Pere, bénéficiaire de l’aide sociale du FAWE.


CHAPITRE
Des écoliers kenyans s’adressent à la presse lors de la Journée de l’enfant africain 2024.

L’Année de l’éducation 2024 de l’UA : Un moment décisif pour l’avenir de l’éducation en Afrique
L’éducation est le fondement du progrès en Afrique, définissant la trajectoire sociale, économique et politique du continent. Consciente de ce fait, l’Union africaine (UA) a déclaré 2024 Année de l’éducation, une initiative historique visant à catalyser l’action en faveur de la mise en place de systèmes éducatifs résilients, inclusifs et de qualité sur l’ensemble du continent. Cette année a signifié plus qu’un simple engagement renouvelé; il s’agissait d’un appel à faire tomber les barrières systémiques, à adopter l’innovation et à donner la priorité à l’éducation en tant que force motrice du développement durable.
Un tournant pour l’agenda de l’éducation en Afrique
Depuis des décennies, l’éducation en Afrique est confrontée à des défis persistants: faibles taux de scolarisation, nombre élevé d’abandons scolaires, infrastructures inadéquates et disparités entre les sexes qui continuent d’exclure des millions d’enfants, en particulier les filles. Selon l’UNESCO (2023):
L’Année de l’éducation de l’UA a offert une occasion unique de relever ces défis avec urgence et détermination. Les gouvernements, les
32 millions
30% 28% d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire ne sont toujours pas scolarisés, les filles constituant la majorité des exclus.
Seuls 30 % des élèves africains passent à l’enseignement secondaire, ce qui limite l’accès aux opportunités économiques et à l’apprentissage tout au long de la vie.
Moins de 28 % des diplômés en STIM en Afrique sont des femmes, ce qui met en évidence les écarts persistants entre les hommes et les femmes dans les domaines scientifiques et technologiques.
La Directrice Exécutive du FAWE, Dr Martha Muhwezi, s’exprimant lors de la Conférence panafricaine de l’UA sur l’éducation des filles et des femmes, qui s’est tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie.
organisations de la société civile et les partenaires mondiaux se sont mobilisés pour promouvoir les politiques et les programmes visant à promouvoir une éducation inclusive et de qualité pour tous.
Principales réalisations de l’Année de l’éducation 2024 de l’UA
Cette année a été marquée par des progrès transformateurs dans plusieurs domaines clés:
• Engagements en matière de politique et d’investissement: Les gouvernements africains se sont engagés à augmenter les budgets de l’éducation, dans le but d’atteindre le point de référence mondial consistant à allouer 20 % des dépenses nationales à l’éducation (Rapport mondial de suivi sur l’éducation, 2024).
• Expansion de l’apprentissage numérique: L’élan en faveur d’une éducation fondée sur la technologie s’est traduit par une adoption accrue d’outils et de plateformes numériques, comblant ainsi les lacunes en matière d’apprentissage dans les régions éloignées et mal desservies.
• Renforcement de l’EFTP et de la préparation de la main-d’œuvre: L’accent a été mis davantage sur l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) afin de doter les jeunes Africains de compétences adaptées à l’évolution des marchés du travail.
• Renforcement de la collaboration régionale: L’UA a mené des efforts pour aligner les cadres nationaux d’éducation sur la stratégie continentale d’éducation pour l’Afrique (CESA 16-25) et l’Agenda 2063, garantissant ainsi une approche cohérente du développement de l’éducation.
L’impératif de genre: Promouvoir l’éducation des filles et des femmes
Si l’éducation pour tous est un objectif universel, il n’en reste pas moins que les filles et les jeunes femmes continuent de se heurter à des obstacles importants qui les empêchent d’accéder à l’éducation et de l’achever. L’Année de l’éducation de l’UA a mis en évidence l’urgence de combler le fossé entre les sexes:
• Promouvoir des écoles sûres et inclusives: En s’attaquant à des problèmes tels que la violence basée sur le genre en milieu scolaire et le manque d’installations d’hygiène menstruelle, qui sont tous deux des causes majeures d’abandon scolaire chez les filles.
• Accroître la participation des femmes dans les STIM: les gouvernements et les institutions ont multiplié les initiatives visant à accroître la représentation des femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques.
Perspective d’avenir: Maintenir l’élan audelà de 2024
L’Année de l’éducation de l’UA ne doit pas être considérée comme une campagne d’une seule année, mais comme le fondement d’une transformation durable. Pour maintenir cet élan, les dirigeants africains, les éducateurs et les parties prenantes doivent:
• Renforcer la mise en œuvre des politiques pour s’assurer que les réformes de l’éducation se traduisent par un impact mesurable.
• Accroître l’investissement dans l’éducation des filles, en reconnaissant qu’une fille éduquée est un catalyseur de la croissance économique, de la réduction de la pauvreté et du progrès social.
• Favoriser des partenariats plus solides entre les gouvernements, la société civile et le secteur privé pour stimuler l’innovation et le changement à long terme.
L’Année de l’éducation 2024 de l’UA a posé les jalons d’un avenir où chaque enfant africain, quel que soit son sexe ou son milieu, aura accès à une éducation de qualité. Cette année a été marquée par un regain d’espoir, des engagements audacieux et des initiatives révolutionnaires. À mesure que nous avançons, le défi est clair: il s’agit de veiller à ce que les progrès accomplis ne soient pas seulement maintenus, mais accélérés. La transformation de l’éducation en Afrique a commencé - il est maintenant temps de tirer parti de cet élan et de créer un continent où l’apprentissage est véritablement un droit pour tous.

• Développer la pédagogie sensible au genre: encourager les systèmes éducatifs africains à intégrer des méthodes d’enseignement qui favorisent l’équité entre les sexes dans les salles de classe.
Mme Catherine Asego, Responsable principale du plaidoyer et des partenariats au FAWE, s’exprime lors d’une table ronde en marge de la Conférence panafricaine de l’UA sur l’éducation des filles et des femmes, qui s’est tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie.

La délégation du FAWE présente à la Conférence panafricaine de l’UA sur l’éducation des filles et des femmes à AddisAbeba, en Éthiopie.
FAWE au Comité de la condition de la femme (CSW68)
“Accélérer la réalisation de l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles en s’attaquant à la pauvreté et en renforçant les institutions et le financement dans une perspective de genre”.
Le mois de mars est le mois de la femme, et tous les chemins mènent aux réunions de la Commission de la condition de la femme (CCF) qui se tiennent à New York, aux États-Unis d’Amérique. Le CSW est une commission fonctionnelle du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) et le principal organe intergouvernemental exclusivement dédié à la promotion de l’égalité des sexes, des droits et de l’autonomisation des femmes. La CCF est le plus grand processus annuel de participation de la société civile au sein des Nations unies, incarnant les principes de dialogue, de collaboration et d’action collective qui sont essentiels pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles dans le monde entier.
Mme Teresa Omondi Adeitan, Directrice exécutive adjointe et responsable des programmes du FAWE, a représenté le FAWE à la 68ème session de la Commission de la condition de la femme, 2024. Cette participation est intervenue après plusieurs années d’absence du FAWE à la CCF dans le cadre d’un effort visant à redonner de la visibilité à l’éducation des filles en Afrique. Le FAWE a été représenté lors d’événements, notamment celui organisé par le COCAFEM avec lequel le FAWE s’est associé pour mettre en œuvre la subvention de l’EDUFAM sur l’éducation dans les situations d’urgence. Le FAWE a formé divers acteurs de l’éducation de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi sur ses modèles de Tuseme[1] , de Centres d’excellence[2] et de pédagogie sensible au genre[3]. Le FAWE défend ces modèles comme des moyens d’accélérer l’égalité des sexes et de lutter contre la pauvreté. Ces modèles améliorent l’accès à l’éducation et le maintien des filles à l’école.
Lors de panels organisés par le Population Council et l’UNICEF sur le pouvoir, la pratique et le potentiel pour la protection des adolescentes et un autre sur la responsabilisation et le leadership pour accélérer l’égalité des sexes dans et à travers l’éducation, le FAWE a partagé les stratégies mises en œuvre dans le cadre du

(À gauche) L’Honorable Jean Muonawauza Sendeza, Ministre du Genre, du Développement communautaire et de la Protection sociale du Malawi, avec Mme Teresa Omondi-Adeitan, Directrice Exécutive adjointe et responsable des programmes du FAWE Afrique, lors de la 68e session de la Commission de la condition de la femme à New York, aux États-Unis.
Dans le cadre de la protection sociale, les politiques de réinsertion doivent également cibler les mères adolescentes qui ne se sentent pas à l’aise pour retourner dans les écoles primaires et secondaires. Ces mères devraient bénéficier d’un soutien pour l’enseignement supérieur dans le cadre d’une formation technique volontaire (TVET)”. Mme Teresa Omondi - Adeitan, Directrice exécutive adjointe du FAWE Afrique.


Kenya. Le FAWE a partagé les stratégies mises en œuvre dans le cadre du programme Imarisha Msichana du Kenya sur l’investissement dans l’éducation et l’autonomisation des mères adolescentes pour qu’elles retournent à l’école.
La CSW68 a également été une opportunité retentissante pour le FAWE en tant que panéliste lors d’un événement co-organisé avec l’Union africaine, l’UA CIEFFA et l’UNICEF pour défendre l’éducation des filles et des femmes, en luttant contre toutes les formes de pratiques néfastes à l’encontre des femmes en Afrique. Cette discussion a eu lieu à un moment où le gouvernement gambien avait un projet de loi privé imminent proposant de réintroduire les mutilations génitales féminines en Gambie.
[1]Tuseme Youth Empowerment - Forum des éducatrices africaines: FAWE
“Il est méprisable que le monde entier soit rappelé pour discuter et convaincre certains dirigeants que les mutilations génitales féminines n’ont pas leur place à notre époque, ni en 2024, ni jamais. Les mutilations génitales féminines affectent gravement l’éducation des filles. Nous devons interpeller tous les dirigeants qui souhaitent réintroduire des pratiques culturelles sociales rétrogrades. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire un pas en avant et trois pas en arrière” a déclaré Mme Teresa Omondi Adeitan, Directrice exécutive adjointe du FAWE Afrique.
Tout au long de la CSW68, et à chaque fois que l’occasion s’est présentée, y compris en signant des pétitions, le FAWE a enregistré son appel au Parlement gambien pour qu’il n’adopte pas une loi aussi rétrograde. La nouvelle de l’échec du projet de loi a été accueillie avec jubilation non seulement en Afrique mais aussi dans le monde entier. De telles lois peuvent se propager rapidement et être désastreuses dans les espaces où l’égalité entre les sexes continue d’être repoussée et rarement financée.
La Commission de la condition de la femme (CCF) est un lieu d’effervescence qui offre une opportunité de solidarité, de plaidoyer de masse et de recommandations percutantes aux pays en matière d’autonomisation des filles et des femmes. C’est un espace de détermination, et le FAWE est déterminé à être présent chaque année à ce rassemblement mondial emblématique pour partager notre travail sur le continent et plaider pour le changement que nous désirons toujours.
[2]Centres d’excellence / Écoles sensibles au genre - Forum des éducatrices africaines: FAWE
[3]Pédagogie sensible au genre - Forum des éducatrices africaines: FAWE
Le FAWE au Sommet pour l’avenir: Assurer une place aux filles et aux jeunes femmes dans l’Afrique
Du 20 au 24 septembre 2024, les dirigeants mondiaux, les acteurs de la société civile et les institutions mondiales se sont réunis au siège des Nations Unies à New York pour le très attendu Sommet pour l’avenir, qui s’est tenu sous le thème “Solutions multilatérales pour un avenir meilleur” : “Des solutions multilatérales pour des lendemains meilleurs”. Au cœur de ce rassemblement de haut niveau se trouvait un appel à réimaginer la coopération mondiale face aux défis du 21ème siècle, notamment l’éducation, l’inégalité entre les sexes, le changement climatique et la marginalisation des jeunes.
Pour le FAWE , le Sommet n’était pas une simple réunion mondiale de plus. Il s’agissait d’une opportunité cruciale d’élever la voix des filles et des jeunes femmes africaines sur une plateforme mondiale et de s’assurer que l’éducation, en particulier pour les plus vulnérables, reste au cœur des objectifs du développement mondial.
Le FAWE a co-organisé un puissant événement parallèle sur le dialogue intergénérationnel axé sur l’accélération des progrès vers les ODD 3, 4 et 5 - bonne santé et bienêtre, éducation de qualité et égalité entre les sexes. La session a réuni des partenaires tels que le CIEFFA de l’Union africaine, ONU Femmes, la Fondation Hilton et le Partenariat Bakhita pour l’éducation, ainsi que le représentant des jeunes du FAWE au sein du conseil d’administration, Lamin Jarjusey. Ensemble, ils ont souligné la valeur du leadership des jeunes et la nécessité de placer les filles et les jeunes femmes au centre de l’élaboration de l’avenir de l’éducation.
Alors que le Pacte pour l’avenir était adopté par les Etats membres des Nations Unies, le FAWE s’est assuré que les réalités des filles africaines - souvent laissées pour compte en raison de la pauvreté, des conflits ou des normes sociales - n’étaient pas oubliées. Martha Muhwezi, Directrice exécutive du FAWE, a plaidé en faveur d’un système inclusif qui considère l’éducation comme un bien public, et a appelé à un plus grand investissement dans le leadership et l’autonomisation des filles à travers l’Afrique.
Le FAWE s’est également joint aux voix continentales pour célébrer l’Année de l’éducation 2024 de l’Union africaine, en participant à des événements organisés par l’UA et ses partenaires. Le FAWE y a amplifié le message selon lequel la prospérité du continent dépend d’investissements audacieux dans des systèmes éducatifs sensibles au genre. Nous avons plaidé en faveur de politiques qui comblent les écarts entre les sexes en matière d’accès et de résultats d’apprentissage, et avons souligné l’importance des données, de l’innovation et de la redevabilité dans la
de demain



conduite du changement à long terme.
Lors d’une session spéciale organisée par le Département de l’éducation, de la science, de la technologie et de l’innovation (ESTI) de l’UA, le FAWE a souligné le rôle de l’EFTP (enseignement et formation techniques et professionnels) pour doter les jeunes femmes de compétences pratiques leur permettant d’accéder à un emploi digne. Notre partenariat de longue date avec la Fondation Mastercard a été présenté comme un modèle de la manière dont les partenariats public-privé peuvent favoriser l’équité et l’impact à grande échelle.
La participation au Sommet de l’avenir a renforcé le programme de plaidoyer international du FAWE. Elle a permis d’affirmer que le leadership des jeunes, l’égalité des sexes et l’éducation ne sont pas des questions périphériques, mais des éléments fondamentaux de la transformation mondiale. L’événement a créé une nouvelle visibilité pour le travail du FAWE, a ouvert de nouvelles voies pour des partenariats stratégiques, et a renforcé notre voix dans l’élaboration de politiques qui comptent pour les filles africaines.
Alors que le monde s’apprête à mettre en œuvre le Pacte pour l’avenir, le FAWE reste déterminé à tenir les dirigeants mondiaux et continentaux responsables de leurs promesses, car l’avenir doit nous appartenir à tous, y compris à toutes les filles du continent africain.
La Directrice Exécutive du FAWE, Dr Martha Muhwezi, avec l’ancien Président de la Tanzanie, S.E. Jakaya Mrisho Kikwete (photo de gauche) et Mme Hajra Zahid, responsable de l’éducation des filles à la Fondation Mastercard.
Le FAWE participe à la Conférence inaugurale de la CAE à Arusha, en Tanzanie
Du 12 au 15 août 2024, la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) a organisé sa toute première Conférence régionale sur l’éducation à Arusha, en Tanzanie, sous le thème “Transformer l’éducation en Afrique de l’Est” : “Transformer l’éducation dans la Communauté d’Afrique de l’Est: De la politique à la pratique”.
Cet événement historique a réuni les ministres de l’éducation et les hauts représentants des huit États partenaires de la CAE, le commissaire de l’Union africaine chargé de l’éducation, de la science, de la technologie et de l’innovation, le professeur Mohamed Belhocine, des décideurs politiques, des parlementaires, des partenaires du développement, des organisations de la société civile et des institutions universitaires.
L’objectif : renforcer la collaboration régionale et faire avancer la réforme de l’éducation qui répond aux besoins des apprenants d’Afrique de l’Est.
Le FAWE a participé à cette rencontre importante, représenté par Carolyne Datche (Chargée de programme), Stanley Muigai (Chargé des technologies de l’information), Mary Mwakawago (Coordinatrice de programme - FAWE Tanzanie), et Catherine Asego (Chargée principale du plaidoyer et des partenariats).
Lors de deux présentations bien accueillies, l’équipe du FAWE a partagé des informations clés sur son travail de plaidoyer et de programmation:
• Lutter contre les grossesses chez les adolescentes grâce aux approches intégrées
Le FAWE a présenté une vue d’ensemble de ses interventions à multiples facettes pour lutter contre les grossesses chez les adolescentes en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. La présentation a démontré comment la recherche basée sur les données, les clubs Tuseme, les espaces sécurisés, le dialogue communautaire et les politiques de réinsertion scolaire améliorent collectivement l’accès à l’éducation et la rétention des filles dans la région.
• Renforcer les systèmes éducatifs grâce à une pédagogie sensible au genre (GRP)
L’équipe a également partagé ses expériences sur la mise à l’échelle du modèle de pédagogie sensible au genre du FAWE, une approche qui permet aux éducateurs d’acquérir les compétences, les connaissances et les attitudes nécessaires pour dispenser un enseignement inclusif et sensible

Mme Carolyne Datche, chargée de programme au FAWE, s’exprimant lors de la conférence inaugurale de la CAE à Arusha, en Tanzanie.
au genre. Le modèle GRP continue de s’avérer essentiel dans la reconstruction d’environnements d’apprentissage qui non seulement accueillent les filles mais les aident à s’épanouir.
L’engagement du FAWE à ce forum de haut niveau s’inscrit directement dans le cadre de son Objectif stratégique 1 (Accès à une éducation de qualité). En amplifiant les voix des filles et en plaidant pour des modèles éprouvés et évolutifs tels que GRP et Tuseme, le FAWE a contribué à influencer un discours régional sur l’éducation qui donne la priorité à l’équité, à la résilience et au bien-être de l’apprenant.
La Conférence régionale sur l’éducation de la CAE a souligné la valeur de l’action collaborative et le FAWE reste un partenaire de confiance dans la mobilisation de solutions pour l’égalité des sexes et l’apprentissage inclusif à travers l’Afrique de l’Est.

L’équipe du FAWE prend une photo de groupe lors de la conférence inaugurale de la CAE. (De gauche à droite) Mme Carolyne Datche, chargée de programme, M. Stanley Muigai, responsable informatique, Mme Mary Mwakawago, responsable du programme FAWE en Tanzanie, et Mme Catherine Asego, responsable principale du plaidoyer et des partenariats au FAWE.
Promouvoir l’éducation des filles:
FAWE Nigeria montre la voie avec vision
Avec une vision audacieuse de la transformation de l’éducation en Afrique, le FAWE Nigeria a réuni les principaux acteurs de l’écosystème de l’éducation pour sa Conférence annuelle nationale sur l’éducation des filles et son Assemblée générale en novembre 2024 à Abuja. Organisée sous le thème puissant “Eduquer et qualifier l’Afrique pour le 21ème siècle” , cette conférence a permis de renforcer l’autonomie des femmes et des filles grâce au leadership: Autonomiser les femmes et les filles grâce au leadership et à l’innovation”, le rassemblement a servi de plateforme stratégique pour inspirer, informer et mobiliser l’action.
Au cœur de l’événement, un appel à l’engagement collectif a été lancé pour que les filles et les jeunes femmes du Nigeria ne soient pas seulement scolarisées, mais qu’elles soient équipées pour diriger,

Le professeur Umar A. Pate, vice-chancelier de l’université fédérale de Kashere, à Gombe, remet un prix à la directrice exécutive du FAWE, le Dr Martha Muhwezi.
et conviction
innover et prospérer dans un monde en mutation rapide.
Un regard sur le leadership et l’innovation Martha Muhwezi, Directrice exécutive du FAWE Afrique, a souligné la nécessité de développer le potentiel de leadership des filles et d’élargir l’accès aux compétences du 21ème siècle. Elle a appelé à une augmentation des investissements dans les systèmes éducatifs qui sont sensibles au genre, inclusifs et axés sur l’innovation.
Son message a été repris par le Professeur Umar A. Pate, Vice-chancelier de l’Université fédérale de Kashere, Gombe, qui a salué le FAWE Nigeria pour ses contributions durables à l’éducation. Il a salué le FAWE Nigeria pour ses contributions durables à l’éducation :
De nombreuses revues ne dépassent jamais le volume 1 ou 2, mais le FAWE Nigeria a fait preuve d’un engagement inégalé par le biais de sa publication annuelle régulière.
C’est un modèle de ce qu’un engagement intellectuel soutenu peut accomplir”.
Prof. Umar A. Pate
Une plateforme pour le leadership intellectuel
La conférence a également été l’occasion du lancement officiel du Journal du FAWE Nigeria 2024, une publication qui présente les recherches et les perspectives d’éminents spécialistes de l’éducation. Avec des articles traitant de la politique, du genre, de la pédagogie et de l’innovation, le journal positionne le FAWE Nigéria comme une voix clé dans la réforme de l’éducation, non seulement dans le pays mais aussi à travers le continent.
Au fil des conversations, un thème s’est imposé : l’ éducation des filles n’est pas seulement une question de salles de classe, mais aussi de leadership, de dignité et d’opportunités. Grâce à cet événement, le FAWE Nigeria a renforcé son rôle de moteur du changement et d’organisateur d’un dialogue critique sur l’avenir de l’éducation des filles en Afrique.
Le FAWE dirige le GIMAC en mettant l’accent sur l’éducation
En 2024, l’Union africaine (UA) a déclaré que son thème de l’année était “Éduquer une Afrique digne du 21ème siècle “: Construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, tout au long de la vie, de qualité et pertinent”. L’Agenda 2063 de l’Afrique sert de plan stratégique pour transformer le continent en une puissance mondiale. Il donne la priorité au développement inclusif et durable, en mettant l’accent sur le progrès social et économique, l’intégration régionale, la gouvernance démocratique et la paix. Étroitement liée à l’Agenda 2063, la Stratégie continentale pour l’éducation en Afrique 20162025 (CESA 16-25) vise à révolutionner l’éducation et la formation, en veillant à ce que les ressources humaines de l’Afrique s’alignent sur les valeurs africaines fondamentales et contribuent à la vision de l’Union africaine. Les deux cadres reconnaissent le rôle essentiel de l’éducation dans la réalisation du développement durable et le renforcement du capital humain.
Lors des Conférences 2024 de la Campagne “Le Genre: mon agenda” (GIMAC) tenues en Ethiopie et au Ghana, un accent particulier a été mis sur l’augmentation du financement de l’éducation en exhortant les gouvernements à allouer 20% du budget national ou un minimum de 6% de leur PIB à l’éducation par le biais d’une budgétisation sensible au genre ; en plaidant pour une éducation universelle gratuite et en fournissant des programmes de retour à l’école pour les adolescentes enceintes et l’éradication du mariage des enfants ; en appelant à l’investissement dans l’éducation numérique avec l’inclusion à l’esprit et l’éducation sensible au genre par la mise en œuvre d’une pédagogie transformatrice de genre à tous les niveaux de l’éducation.
Au cours de la deuxième Conférence GIMAC à Accra, au Ghana, le FAWE a lancé son manuel sur l’approche miroir de la violence basée sur le genre en milieu scolaire qui fournit une approche holistique de l’identification, de la référence et du signalement des cas de VSBG. C’est au

À gauche, la délégation du FAWE au GIMAC.

Mary Mbugua, participante au programme Imarisha Msichana, fait une présentation lors de la conférence GIMAC 2024 au Ghana. Elle est entourée de Carolyne Datche, chargée de programme au FAWE, et d’Eva Ojwang’, coordinatrice du FAWE pour le comté du Kenya.
cours de cette session que Mary Wanjiru Mbugua, une jeune fille kenyane qui a bénéficié d’une seconde chance en matière d’éducation après être tombée enceinte alors qu’elle était à l’école. Mary a expliqué que la violence sexuelle et basée sur le genre était l’une des principales causes des grossesses précoces et de l’abandon scolaire chez les filles. Elle a exhorté les gouvernements et les décideurs politiques à donner la priorité à la mise en œuvre de la politique de réinsertion dans leurs pays respectifs, à investir davantage dans l’éducation des filles et à améliorer la collaboration entre les sociétés civiles et les partenaires privés afin d’accroître le financement. Mary a salué le projet Imarisha Msichana du FAWE en partenariat avec la Fondation Mastercard ( ), qui a permis à plus de 2 000 filles de se réinscrire à l’école et de réaliser leurs rêves.
Le rôle du FAWE en tant qu’organisateur principal des conférences GIMAC 2024 a fourni une occasion unique de travailler main dans la main avec les organisations de la société civile et les gouvernements afin de promouvoir une éducation de qualité pour tous. Le FAWE a mené des engagements au niveau régional avec les organes de l’Union africaine (UA) et les Communautés économiques régionales (CER) en établissant le profil de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’éducation.

(À droite) Mary Mbugua, participante au programme , pose avec d’autres élèves pour une photo avec le nouveau manuel SRGBV du FAWE intitulé.
La semaine compétences en Afrique 2024: Changer le langage sur l’EFTP et l’autonomisation des filles
Dans le cadre de l’Année de l’éducation de l’Union africaine, le département de l’éducation, de la science, de la technologie et de l’innovation (ESTI) de la Commission de l’Union africaine, en collaboration avec ses partenaires, a organisé la toute première Semaine des compétences en Afrique en 2024. Sous le thème “Compétences et emplois pour le 21e siècle: Développement de compétences de qualité pour une employabilité durable en Afrique”, l’événement a mis en évidence le besoin urgent de doter les jeunes Africains - en particulier les filles - des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour prospérer dans une économie mondiale dynamique et compétitive.
L’événement, qui a duré une semaine, a rassemblé des acteurs clés de tout le continent, notamment les ministres de l’éducation de la Gambie, de la Libye, de l’Ouganda, de la République centrafricaine et de la Sierra Leone, ainsi que des experts techniques et des partenaires de développement tels que la GIZ, l’OIT, l’UNESCO, l’AUDA-NEPAD, la Banque mondiale,
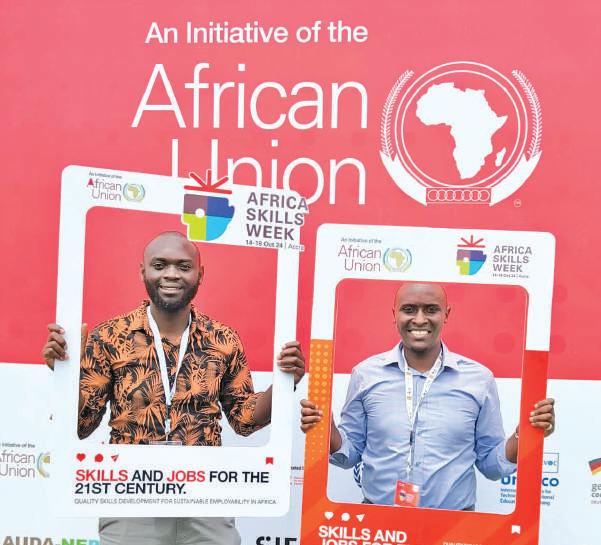
M. Martin Okhako, chargé de programme au FAWE (à gauche), avec M. James Njuguna, Chargé de la gestion des connaissances au FAWE, lors de la conférence de la Semaine des compétences en Afrique de 2024.

La délégation du FAWE à la Semaine des compétences en Afrique de 2024.
le Pacte ghanéen pour les compétences de l’Union européenne et la Fondation Mastercard, pour n’en citer que quelques-uns.
Tout au long de la conférence, un message a résonné clairement: L’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) doivent être considérés comme une voie viable, respectée et accessible, en particulier pour les filles et les jeunes femmes. Les délégués ont souligné la nécessité d’augmenter les investissements dans l’enseignement des STIM et de créer des environnements inclusifs qui permettent aux filles de suivre une formation professionnelle et d’entrer dans des domaines techniques traditionnellement dominés par les hommes.
Les gouvernements ont partagé des pratiques prometteuses, telles que la réduction du coût de la formation technique, l’intégration de l’esprit d’entreprise dans les programmes d’études et la mise en place de systèmes de soutien à la création d’entreprises pour encourager les entreprises dirigées par des jeunes. Le Ghana est apparu comme un modèle de progrès, démontrant comment des investissements intentionnels dans la formation, en particulier pour les filles, peuvent conduire à une transformation économique significative.
Cet objectif est en parfaite adéquation avec la mission du FAWE qui consiste à promouvoir l’égalité des sexes dans l’éducation et à doter les filles et les jeunes femmes des outils nécessaires pour réussir dans la
vie. Pour le FAWE, l’EFTP n’est pas seulement une voie éducative, c’est une stratégie d’autonomisation. A travers ses programmes, y compris le programme Parcours de deuxième chance pour améliorer l’accès à l’enseignement supérieur des jeunes femmes et hommes marginalisés, le FAWE continue de promouvoir l’EFTP et l’enseignement des STIM en tant que leviers essentiels pour briser les cycles de la pauvreté et de l’exclusion.
Comme cela a été souligné lors de la Semaine des compétences en Afrique, combler le déficit de compétences en Afrique nécessite des politiques délibérées, des financements accrus et une planification
tenant compte du genre. Pour le FAWE, cet élan offre une occasion unique d’intensifier son plaidoyer et sa programmation, en veillant à ce qu’aucune fille ne soit laissée pour compte dans le parcours de développement de l’Afrique.
La Semaine des compétences en Afrique 2024 a réaffirmé une vision commune: un continent où chaque jeune, quel que soit son sexe ou son milieu, a accès à des compétences pertinentes et de qualité qui lui permettent d’accéder à un emploi digne et à des moyens de subsistance durables. Pour le FAWE et ses partenaires, c’est plus qu’un objectif, c’est un engagement.
Le FAWE se fait le champion de la participation des filles aux STIM lors de la Conférence continentale de l’UA
Du 26 au 28 novembre 2024, le FAWE a fièrement participé à la Conférence continentale sur la transformation des STIM en Afrique, organisée par la Commission de l’Union africaine (CUA) et l’UNESCO à Addis-Abeba, en Éthiopie. Tenue sous le thème de l’Année de l’éducation 2024 de l’UA, “Transformer l’éducation en Afrique”, la conférence a rassemblé des décideurs politiques, des partenaires de développement, des éducateurs et des organisations de la société civile pour réimaginer l’éducation STIM en tant que moteur de l’avenir de l’Afrique.
Sous le thème “Transformer les STIM en Afrique”, la conférence a réaffirmé que l’éducation est un droit humain fondamental et un bien public. Elle a souligné le besoin urgent de réformer les programmes, de renforcer les capacités des enseignants, d’élargir l’accès à des environnements d’apprentissage de qualité et de s’attaquer aux disparités entre les sexes dans les domaines des STIM.
Le FAWE, représenté par une forte délégation dirigée par Mme Teresa Omondi-Adeitan, Directrice exécutive adjointe et responsable des programmes, a joué un rôle actif tout au long de la conférence. Mme Omondi-Adeitan a prononcé le discours d’ouverture des discussions de la deuxième voie sur le thème “Renforcer les fondements de l’éducation aux STIM”, appelant à une action audacieuse et inclusive afin d’accroître la participation des filles aux STIM.

M. Gordon Aomo lors de sa présentation à la conférence.
Collectivement, nous avons le pouvoir de réimaginer l’avenir de l’Afrique. Construisons un écosystème STIM qui soit inclusif, équitable et capable de relever les défis pressants auxquels notre continent est confronté. Faisons en sorte que des rêves comme celui d’Amina deviennent réalité”.
- Teresa Omondi-Adeitan, Directrice exécutive adjointe, FAWE Afrique

(À gauche) M. Gordon Aomo, responsable principal de la gestion des connaissances du FAWE, avec d’autres panélistes lors de la conférence sur les STIM à AddisAbeba, en Éthiopie.
L’équipe du FAWE, notamment Fraciah Kagu (Responsable du plaidoyer) et Gordon Aomo (Responsable de la gestion des connaissances), a également partagé les meilleures pratiques et les leçons tirées des modèles d’éducation sensible au genre du FAWE, en particulier la façon dont les interventions telles que Tuseme, les centres d’excellence et la pédagogie sensible au genre (GRP) ont ouvert des voies pour les filles dans le domaine des STIM à travers l’Afrique.
ASSUREZ LEUR SÉCURITÉ:
L’engagement du FAWE à mettre fin à la VBG en milieu et les communautaire
Du 25 novembre au 10 décembre 2024, pendant les 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre, le FAWE et ses 34 antennes ont lancé la campagne en ligne Keep Them Safe (Assurez leur sécurité) pour sensibiliser à la violence basée sur le genre (VBG) et amplifier les efforts visant à mettre fin à la violence dans les écoles et les communautés. La campagne a été l’occasion de diffuser les principales conclusions du programme “Ensemble pour les filles”, qui s’est focalisé sur la violence basée en milieu scolaire. Les résultats du programme ont révélé qu’une fille sur trois et un garçon sur cinq sont victimes de violence basée sur le genre avant d’atteindre l’âge de 18 ans. Cette statistique alarmante a mis en évidence le besoin urgent d’intervention. Les antennes du FAWE se sont
La conférence a débouché sur l’adoption du communiqué d’Addis-Abeba sur la transformation des STIM en Afrique, qui énonce les engagements suivants
• élargir l’exposition précoce aux STIM et réformer les programmes d’enseignement
• Renforcer le développement des enseignants pour un enseignement des STIM sensible au genre
• Encourager l’innovation et l’esprit d’entreprise
• Lutter contre les stéréotypes liés au genre et garantir des environnements inclusifs pour les filles et les apprenants marginalisés
• Accroître les investissements des secteurs public et privé dans la recherche et le développement des STIM.
La participation du FAWE a souligné son rôle en tant que principal défenseur de l’égalité des sexes dans l’éducation et l’innovation. Alors que l’Afrique se prépare à tirer parti de la puissance de sa démographie juvénile, le FAWE reste déterminé à veiller à ce que les filles ne soient pas laissées pour compte dans l’avenir des STIM.


activement engagées dans la campagne en partageant des informations sur leurs pays respectifs, en mettant en lumière les réalités de la violence basée sur le genre dans différents contextes et en appelant les parties prenantes à accroître leurs efforts dans la lutte contre la violence.
Martha Muhwezi, Directrice exécutive du FAWE, a souligné l’importance de l’action collective en déclarant: “Assurer la sécurité des enfants est une responsabilité partagée. Nous devons travailler ensemble - gouvernements, éducateurs, parents et communautés - pour construire un monde où chaque enfant peut apprendre dans un environnement sûr et favorable”.
La campagne s’est également appuyée sur la voix collective des anciens du FAWE à travers le réseau, y compris un message puissant de Wendy Muzite, Présidente du Réseau des anciens du FAWE, qui a exhorté les parties prenantes à passer à l’action: “L’élimination de la violence basée sur le genre exige plus que des conversations ; elle exige un engagement, une responsabilisation et une action concrète de la part de chacun d’entre nous.
L’un des temps forts de la campagne a été la tenue d’un séminaire en ligne sur le thème “S’unir pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes”: S’unir pour mettre fin à la violence contre les femmes. Cette discussion virtuelle a rassemblé des experts, des éducateurs et des militants qui ont exploré des solutions durables pour
prévenir et répondre à la violence basée sur le genre en milieu scolaire et communautaire. Le dialogue a renforcé l’idée que l’élimination de la violence est une responsabilité partagée qui nécessite l’engagement de tous les secteurs de la société.
Tout au long de la campagne, le FAWE a mis l’accent sur un message central: Leur sécurité est notre responsabilité. Les parents, les enseignants, les gouvernements et les membres de la communauté jouent tous un rôle essentiel pour garantir que les enfants grandissent dans un environnement sûr et favorable, exempt de violence et de discrimination.
La campagne “ Assurez leur sécurité” a réaffirmé l’engagement du FAWE à plaider en faveur d’espaces d’apprentissage sûrs et à renforcer les mécanismes institutionnels visant à protéger les enfants contre les dangers. En encourageant les partenariats, en renforçant la sensibilisation et en dotant les parties prenantes des outils adéquats, le FAWE continue à défendre un avenir où chaque fille et chaque garçon peut poursuivre son éducation sans crainte.
Scanner Pour Accéder à la Déclaration de Résultats de l’ACERWC.

Le FAWE plaide en faveur de l’éducation des filles lors de la 81ème session ordinaire de la CADHP
Le Forum des éducatrices africaines (FAWE) est fier d’avoir participé à la 81ème session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), qui s’est tenue du 17 octobre au 7 novembre 2024 à Banjul, en Gambie. La session a rassemblé des gouvernements, des organisations de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme pour réfléchir à l’état des droits de l’homme en Afrique. Les discussions ont mis l’accent sur le besoin urgent de systèmes éducatifs inclusifs, tout au long de la vie et fondés sur les droits, en s’appuyant sur le thème de l’Union africaine pour 2024 : “Éduquer une Afrique adaptée au 21ème siècle”.
Pour la première fois, le FAWE a fait une déclaration officielle devant la Commission, un moment historique rendu possible par sa récente accréditation en tant qu’organisation observatrice auprès de la CADHP. Ce statut marque une étape importante pour le travail de plaidoyer du FAWE, en accordant à l’organisation une plateforme formelle pour influencer le discours sur les droits de l’homme et pousser à la responsabilisation sur l’éducation des filles au niveau continental.
Dans son allocution devant la Commission, Mme Teresa Omondi-Adeitan, Directrice exécutive adjointe et responsable des programmes du FAWE, a mis l’accent sur les obstacles persistants à l’éducation des filles et des jeunes femmes. Il s’agit notamment de la pauvreté, des mariages d’enfants, de la violence basée sur le genre en milieu scolaire (SRGBV) et de l’accès limité aux informations sur la santé sexuelle et reproductive (SSR). Elle a appelé les États parties à:
• augmenter le financement de l’éducation, en particulier pour les filles des communautés marginalisées
• Appliquer des politiques de réintégration et de maintien à l’école pour les mères adolescentes
• Intégrer une éducation sexuelle complète pour lutter contre la violence sexuelle et basée sur le genre.
• Garantir l’accès à l’éducation pour les apprenants déplacés et les enfants handicapés.
Le FAWE a également réaffirmé l’importance de l’article 17 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et de l’article 12 du Protocole de Maputo, qui garantit aux femmes et aux filles le droit à l’éducation et à la formation.

(De gauche à droite) L’équipe du FAWE lors de la conférence de la CADHP. Mme Carolyne Datche, chargée de programme, Mme Emily Gumba, chargée de programme senior, Mme Teresa Omondi-Adeitan, directrice exécutive adjointe et responsable des programmes du FAWE Afrique, Mme Fraciah Kagu, responsable du plaidoyer et des partenariats, et Mme Yadicon Njie-Eribo, Directrice Exécutive du FAWE Gambie.
La session s’est achevée sur des engagements renforcés de la part des Etats membres et des parties prenantes afin de faire de l’éducation un droit fondamental pour chaque enfant africain. La participation du FAWE souligne son rôle en tant que voix principale pour l’équité entre les sexes dans l’éducation - et son statut d’observateur permet à l’organisation de demander des comptes aux responsables, d’influencer la réforme des politiques et d’encourager un changement systémique en Afrique.
La pauvreté, le mariage des enfants, la violence sexiste en milieu scolaire (VSMS) et l’accès limité aux informations sur la santé sexuelle et reproductive (SSR) constituent des obstacles persistants à l’éducation des filles et des jeunes femmes. Ms. Teresa Omondi-Adeitan
L’égalité entre les sexes dans le domaine éducatif: Le leadership du FAWE au sein du Groupe sectoriel pour l’éducation des filles et des femmes du CESA
La Stratégie continentale de l’éducation pour l’Afrique 2016-2025 (CESA 16-25) de l’Union africaine est un pilier essentiel de l’Agenda 2063, la vision de l’Afrique pour un développement inclusif et durable. Cadre dynamique et flexible, la CESA encourage la collaboration entre les acteurs nationaux, régionaux et continentaux afin d’accélérer la transformation de l’éducation. Pour coordonner l’action et renforcer l’impact, l’Union africaine a mis en place des groupes thématiques - des communautés de pratique dirigées par des institutions ayant une expertise technique dans des domaines spécifiques de l’éducation.
Le FAWE, en collaboration avec le Centre international de l’Union africaine pour l’éducation des filles et des femmes en Afrique (UA/CIEFFA), est fier de coprésider le Groupe thématique sur l’éducation des filles et des femmes du CESA. Cette position reflète non seulement l’engagement de longue date du FAWE en faveur de l’égalité des sexes dans l’éducation, mais aussi son rôle croissant dans l’élaboration des politiques, l’amplification du dialogue régional et l’obligation de rendre compte des résultats de l’éducation des filles à travers le continent.
En tant que co-responsable, le FAWE a utilisé cette
plateforme pour mobiliser les parties prenantes - y compris les gouvernements, la société civile et les partenaires de développement - afin de promouvoir les approches sensibles au genre dans les systèmes éducatifs. A travers le cluster, le FAWE a défendu les efforts visant à améliorer l’accès des filles à une éducation de qualité, à lever les obstacles tels que les mariages précoces et la violence basée sur le genre en milieu scolaire, et à promouvoir des politiques qui soutiennent la rétention, la transition et la réussite des filles à tous les niveaux de l’éducation.
En plaçant l’égalité des sexes au cœur de la mise en œuvre du CESA, le leadership du FAWE garantit que l’éducation des filles et des femmes reste une priorité absolue dans la planification et la réforme de l’éducation à l’échelle du continent. Le cluster sert non seulement de mécanisme de coordination mais aussi d’espace de partage des innovations, de suivi des progrès et de renforcement de la redevabilité collective dans la réalisation des objectifs de l’Agenda 2063.
Grâce à ce rôle, le FAWE continue d’influencer le changement au niveau des systèmes, en plaçant l’égalité des sexes au cœur du programme de transformation de l’éducation en Afrique.
En tant que co-responsable, le FAWE a utilisé cette plateforme pour mobiliser les parties prenantes - y compris les gouvernements, la société civile et les partenaires de développement - afin de promouvoir les approches sensibles au genre dans les systèmes éducatifs.
Priorité aux droits et au bien-être
Le FAWE a participé aux 24e et 25e forums des OSC en marge du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (ACERWC) à Maseru, au Lesotho. Lors de la convocation, le FAWE, dans son tout premier discours devant la commission, a souligné la nécessité pour les Etats membres de l’UA de protéger les droits des filles et des femmes à travers l’Afrique, ce qui a été adopté dans les déclarations finales. En outre, un sous-comité sur l’éducation a été créé afin de renforcer les droits des filles et de promouvoir l’éducation sur le continent. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Commission de Banjul) et le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (ACERWC). Le FAWE a le statut d’observateur auprès de ces deux comités et a présenté le statut de l’éducation des filles, appelant à la mise en œuvre de politiques qui respectent les droits à l’éducation.
Un certain nombre de recommandations ont été présentées au comité. Celles-ci comprennent:
1. La mise en place un groupe de travail dédié à l’éducation afin d’améliorer la collaboration entre les différentes parties prenantes : Le FAWE a recommandé au comité de créer un groupe de travail dédié à l’éducation afin de relever les défis pressants auxquels sont confrontées les filles en Afrique.
2. L’amélioration du financement de l’éducation - Le gouvernement a augmenté le financement de l’éducation à 20% des budgets nationaux.
3. La mise en œuvre de cadres politiques globaux pour la réinsertion scolaire: Les États membres doivent rendre des comptes et faire preuve d’efforts délibérés pour mettre en œuvre des politiques de réinsertion, en particulier pour celles qui sont affectées par l’impossibilité de payer les coûts cachés de l’école et le matériel non scolaire, les violences sexuelles et basées sur le genre, les grossesses précoces ou les mariages d’enfants.
4. Le renforcement des mesures de prévention contre la violence sexuelle et basée sur le genre et l’amélioration de l’éducation à la
sexualité: Lancer une formation complète pour les éducateurs et le personnel scolaire sur l’éducation sexuelle afin de prévenir les grossesses précoces, la sensibilité au genre, la lutte contre les brimades et la prévention de la violence, et éduquer les communautés sur l’importance d’environnements éducatifs sûrs et les droits des filles.
5. L’adopter des interventions démonstratives pour renforcer l’égalité des sexes dans le domaine éducatif: Le FAWE a essayé et testé divers modèles qui ont permis d’améliorer l’éducation des filles en Afrique, en particulier ceux qui contribuent à la rétention des filles à l’école. Le FAWE a exhorté les gouvernements africains à adopter des interventions telles que la Pédagogie sensible au genre (GRP) visant à améliorer les méthodologies d’enseignement, le matériel d’apprentissage et la qualité des enseignants.
Le FAWE a également salué les efforts de l’ACERWC dans l’élaboration d’un commentaire général sur le droit à l’éducation et a réitéré son engagement à défendre les droits des filles africaines. Le FAWE croit fermement que l’éducation est le plus grand facteur d’égalité et appelle à une responsabilité partagée afin de créer un avenir où chaque fille pourra réaliser son plein potentiel.

Mme Teresa Omondi-Adeitan, Directrice Exécutive adjointe et responsable des programmes FAWE Afrique.
de l’enfant africain

Délégation du FAWE à la réunion de l’ACERWC à Maseru, au Lesotho. (De gauche à droite) Mme Fraciah Kagu, Chargée du plaidoyer et des partenariats, M. Costern Kanchele, Directeur Exécutif du FAWE Zambie, Mme Teresa Omondi-Adeitan, Directrice Exécutive adjointe et responsable des programmes du FAWE Afrique, M. Wesley Chabwera, Directeur Executif du FAWE Malawi et la Chargée de programme, Mme Carolyne Datche.
Le FAWE se fait le champion de l’éducation des filles au CIES 2024 à Miami
La Conférence annuelle 2024 de la Société d’éducation comparée et internationale (CIES) s’est tenue du 10 au 14 mars à Miami, en Floride, sur le thème “Le pouvoir de la protestation”. Ce rassemblement a réuni des éducateurs, des chercheurs et des activistes afin d’explorer le rôle de la protestation dans le façonnement des paysages éducatifs. Le FAWE était représenté par la Directrice exécutive, Dr. Martha Muhwezi et la Responsable principale du plaidoyer et des partenariats qui ont participé activement à la conférence, contribuant aux discussions sur l’avancement de l’éducation des filles et des femmes en Afrique subsaharienne. Martha a participé à une table ronde sur la Coalition des
bonnes écoles ; des voix du Sud global tandis que Catherine a partagé des études de cas du FAWE concernant l’action collective pour défendre l’éducation des filles en Afrique.
Martha et Catherine ont toutes deux partagé des informations sur nos initiatives, en mettant en exergue des stratégies visant à surmonter les obstacles à l’éducation et à promouvoir l’équité entre les sexes sur le continent. Leur participation a souligné l’engagement du FAWE en faveur de l’autonomisation des femmes africaines par le biais de l’éducation et de la promotion des efforts de collaboration au sein de la communauté éducative mondiale.

Le FAWE organise un dialogue de haut niveau avec les ministres de l’Éducation en Afrique lors de la Conférence continentale sur l’éducation à Nouakchott, en Mauritanie. (De gauche à droite) Mme Catherine Asego, responsable principale du plaidoyer et des partenariats, Mme Alima Boukary Marcos, spécialiste de l’éducation, GCIUNGEI, M. Sarjoh Aziz Kamara, Vice-Ministre de l’Enseignement technique et supérieur, Sierra Leone, Mme Savia Mint N’Tahah, Ministre de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille de Mauritanie, Mme Simone YankeyOuattara, coordinatrice du Centre international pour l’éducation des filles et des femmes de l’Union africaine (CIEFFA), et le Dr Georgette Brou Coulibaly, experte du Comité pour l’égalité et l’équité entre les sexes dans la région MENA.
Définir l’avenir de l’éducation en Afrique: Le FAWE à la Conférence continentale de l’UA sur l’éducation
En décembre 2024, le FAWE a rejoint la Commission de l’Union africaine, l’UNICEF, les ministères de l’éducation et les partenaires à Nouakchott, en Mauritanie, pour la Conférence continentale sur l’éducation, marquant l’Année de l’éducation de l’UA. Tenu sous le thème “Eduquer et qualifier l’Afrique pour le 21ème siècle”, le forum a été un appel à l’action pour des systèmes éducatifs inclusifs, de qualité et sensibles au genre.
La délégation du FAWE, dirigée par Catherine Asego, Responsable principale du plaidoyer et des partenariats, et Naomi Kamitha, Chargée de programme, a présenté son leadership en tant que coresponsable du Groupe sectoriel de l’UA sur l’éducation
des femmes et des filles. L’un des points forts a été la contribution du FAWE sur la pédagogie sensible au genre (GRP) lors d’un panel sur le développement professionnel des enseignants, où les réussites au Malawi et en Tanzanie ont été partagées.
Le FAWE a également codirigé une session sur l’équité dans l’éducation aux côtés de l’AUCIEFFA, de l’UNGEI et de l’UNICEF, soulignant la nécessité de démanteler les barrières liées au genre, d’améliorer le financement et de garantir des espaces d’apprentissage sûrs. L’organisation a encadré ses interventions autour de l’éducation des filles, de la masculinité positive et de l’engagement des jeunes.
Les principales conclusions sont les suivantes:
Une demande croissante pour l’intégration de la BSG dans la formation nationale des enseignants;
L’alignement entre la stratégie du FAWE et le cadre du CESA 2026-2035 à venir ; L’élan pour positionner le FAWE en tant que centre de recherche sur l’éducation des filles ; L’importance d’engager les garçons et les anciens élèves dans la promotion de l’équité entre les sexes ;
Les possibilités de mettre à l’échelle les modèles du FAWE dans les contextes d’éducation en situation d’urgence.

La Chargée de programme du FAWE, Mme Naomi Kamitha (à droite), fait une présentation lors de la Conférence continentale sur l’éducation à Nouakchott, en Mauritanie.


Des élèves kenyans lisent un rapport du ministère de l’Éducation du Kenya.
Donner vie à la recherche: Documentation des expériences des enfants au Ghana et au Sénégal
Dans le cadre d’un puissant effort visant à établir un lien entre la recherche et l’impact sur la vie réelle, le FAWE s’est associé en 2024 à l’équipe du Rapport mondial de suivi sur l’éducation (GEM) de l’UNESCO et à l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) - hébergée par la Banque africaine de développement - afin de soutenir les rapports approfondis Spotlight on Africa.
Cette collaboration s’est focalisée sur la saisie des expériences vécues par les enfants au Ghana et au Sénégal alors qu’ils commencent leur parcours dans l’enseignement primaire. En suivant les histoires de quatre jeunes apprenants, l’initiative a pour but d’humaniser les données présentées dans les rapports Spotlight et de mettre en lumière ce à quoi ressemble la maîtrise de la lecture, de l’écriture et du calcul (FLN) du point de vue de l’enfant.
Grâce à des récits de type documentaire, le projet
explore les obstacles et les avancées auxquels ces enfants sont confrontés pour acquérir les compétences de base en lecture, en écriture et en calcul. De l’accès à une instruction de qualité et au matériel d’apprentissage à l’influence de la famille, de la communauté et de l’infrastructure scolaire, les réalités révélées offrent une vision convaincante des premières étapes de l’éducation en Afrique de l’Ouest.
En rendant la recherche plus compréhensible et accessible, cette initiative soutient des objectifs de plaidoyer plus larges: s’assurer que les systèmes éducatifs répondent aux besoins de chaque apprenant et que les politiques et les investissements en matière de FLN sont basés sur les expériences réelles des enfants africains. Pour le FAWE, ce partenariat est un nouvel exemple de la façon dont les données et les récits peuvent être utilisés ensemble pour favoriser le changement.
Construire des écoles sensibles au genre pour un changement durable: Les programmes KIX CoE et KIX Normes de genre
Bien que l’éducation soit un droit humain fondamental, l’accès à un apprentissage de qualité reste profondément inégal en Afrique de l’Ouest et du Centre, en particulier pour les filles. Dans toute la région, une crise d’apprentissage importante persiste: la plupart des enfants de 10 ans sont incapables de lire et de comprendre un texte simple, et les filles sont touchées de manière disproportionnée. Si les garçons sont également confrontés à des obstacles, les filles sont plus susceptibles de ne pas être scolarisées dès leur plus jeune âge, l’exclusion s’intensifiant au cours de l’adolescence en raison de la discrimination basée sur le sexe, des mariages précoces et des normes sociales.
En réponse à ces défis persistants, le FAWE a développé et mis en œuvre le Modèle d’écoles
sensibles au genre, une approche holistique visant à promouvoir l’égalité des sexes et à améliorer les résultats d’apprentissage des filles. Le modèle intègre la gestion des écoles sensibles au genre, la pédagogie, le matériel d’enseignement et d’apprentissage, des environnements sûrs et inclusifs, ainsi qu’un engagement communautaire actif.
Pour évaluer l’efficacité du modèle, le FAWE a mené une étude multi-pays dans dix écoles de quatre pays africains en utilisant des méthodes qualitatives et quantitatives. Les résultats ont révélé que le modèle contribuait de manière significative à la rétention, à la participation et à la persévérance des filles à l’école. Cependant, la recherche a également mis en évidence des domaines critiques à améliorer, notamment en ce qui concerne le soutien scolaire
de rattrapage, le développement du leadership, la gestion de l’hygiène menstruelle et la disponibilité des supports d’apprentissage.
Les Centres d’excellence pour l’échange de connaissances et d’innovations (KIX), un projet qui s’est achevé en 2024, ont démontré le partage et l’échange de connaissances par la publication d’un article intitulé “Masculinité et relations hommesfemmes: Comprendre les questions d’égalité dans le monde contemporain” dans le numéro 2024 des Mémoires de l’IFAN.
Parallèlement, le FAWE, par le biais de l’échange de connaissances et d’innovations (KIX) Normes de genre, a mené une étude intitulée “Normes sociales de genre et éducation des filles en Afrique de l’Ouest: Une approche comparative” - au Burkina Faso, en République démocratique du Congo (RDC), à Sao Tomé et Principe et au Tchad. La recherche visait à approfondir la compréhension de la manière
dont les normes de genre influencent les résultats scolaires et à identifier les voies d’un changement de comportement durable. À l’aide de récits de vie, de discussions de groupe et d’enquêtes, l’étude a permis d’identifier plusieurs obstacles persistants, notamment
• la pauvreté des ménages par rapport au coût élevé de la scolarisation
• Les mariages précoces et les grossesses d’adolescentes
• Soutien familial limité
• le poids disproportionné des responsabilités domestiques sur les filles.
L’étude souligne la nécessité d’intégrer les spécificités culturelles dans la conception et la mise en œuvre des politiques éducatives afin d’en garantir la pertinence et l’efficacité.
L’éducation en temps de crise: Donner la parole aux enfants réfugiés et déplacés à l’intérieur du pays grâce au programme KIX Tuseme du GPE
Partout en Afrique, les conflits, les catastrophes climatiques et l’instabilité politique obligent des millions d’enfants à abandonner l’école. De la guerre au Soudan aux crises de déplacement en République démocratique du Congo, au Mozambique et au Sahel, le droit à l’éducation est menacé. Alors que les camps de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI) sont bondés de familles fuyant la violence et les difficultés, l’éducation, qui est souvent la première victime des crises, est laissée pour compte.
Pour les filles déplacées, la situation est encore plus désastreuse. Nombre d’entre elles ne retournent jamais à l’école et sont exposées à des risques accrus de mariage précoce, de violence basée sur
le genre et d’exploitation économique. Plus elles restent longtemps hors de la salle de classe, plus leurs chances d’y retourner s’amenuisent. Résultat ? Une génération perdue, privée des opportunités que l’éducation pourrait offrir pour briser le cycle de la pauvreté et du déplacement.
Mais même dans ces situations désastreuses, l’espoir demeure. Une initiative offrant une solution pratique et évolutive est le projet GPE KIX Tuseme, un partenariat dirigé par FAWE, HERS-EA et ACERUK pour adapter et mettre en œuvre une éducation sensible au genre dans les camps de réfugiés et de personnes déplacées au Kenya, en Ouganda et en Éthiopie.
Urgence de l’éducatiion: Des chiffres qui racontent l’histoire

La crise de l’éducation dans les situations d’urgence ne concerne pas seulement l’accès aux écoles. Il s’agit du type d’éducation que les enfants reçoivent et de la
L’Afrique accueille certaines des plus grandes populations déplacées au monde, avec plus de 40 millions de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, dont la moitié sont des enfants.
40 millions 50%
Moins de 50 % des enfants réfugiés fréquentent l’école primaire; ce chiffre chute considérablement pour l’enseignement secondaire, en particulier pour les filles.
3%
Seuls 3 % des jeunes réfugiés dans le monde ont accès à l’enseignement supérieur.
question de savoir si elle leur permet de s’adapter à leur réalité, de se protéger et de se construire un avenir.

Membres du club Tuseme d’une école au Kenya.
Tuseme: Une voix dans le chaos
Tuseme, qui signifie “Prenons la parole” en kiswahili, est un modèle d’autonomisation éprouvé qui a aidé des milliers de jeunes à travers l’Afrique subsaharienne à développer une pensée critique, un leadership et des compétences en matière de plaidoyer afin de lutter pour leur droit à l’éducation et à l’égalité des sexes.
• Aujourd’hui, le FAWE étudie comment le modèle Tuseme peut être adapté aux communautés de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays (PDI), des lieux où l’instabilité, les traumatismes et les barrières culturelles réduisent souvent les jeunes, en particulier les filles, au silence. Dans le cadre du projet
Dans le cadre du projet de recherche GPE KIX Tuseme, le FAWE étudie comment le modèle peut être efficacement appliqué ou modifié pour répondre aux besoins uniques des apprenants déplacés.
de recherche GPE KIX Tuseme, le FAWE étudie comment le modèle peut être efficacement appliqué ou modifié pour répondre aux besoins uniques des apprenants déplacés.
• En utilisant les récits, le théâtre, le débat et le mentorat comme outils de base, le projet cherche à:
• Évaluer comment les jeunes déplacés peuvent être habilités à s’exprimer contre la violence et la discrimination basées sur le genre.
• Explorer les stratégies visant à faire des garçons des alliés dans la promotion de l’égalité des sexes dans les environnements fragiles.
• Équiper les enseignants, les parents et les dirigeants locaux d’approches permettant de soutenir l’éducation des filles dans un contexte de déplacement.
• Renforcer la résilience et les capacités de leadership des enfants, afin de leur permettre de défendre leurs droits même en temps de crise.

Mme Rose Atieno, Chargée du programme FAWE, fait une présentation lors de la réunion régionale du programme GPE KIX Tuseme à Addis-Abeba, en Éthiopie.
Leçons tirées du terrain: Ce qui marche dans les environnements fragiles
Au cours de la première phase du projet Tuseme, 12 écoles au Kenya, en Ouganda et en Ethiopie ont testé le modèle en même temps que d’autres interventions menées par le FAWE, telles que la pédagogie sensible au genre et l’infrastructure scolaire sensible au genre.
Les principaux enseignements tirés sont les suivants:
• Des espaces sûrs pour le dialogue sont essentiels. Les discussions communes entre garçons et filles sur des questions telles que les menstruations favorisent l’empathie et le soutien.
• L’engagement des parents remet en question les normes restrictives. Lorsque les parents participent à la conversation, les filles ont plus de chances de rester à l’école.
• L’éducation doit être flexible. Les horaires et les lieux des clubs doivent s’adapter aux réalités des enfants déplacés, en garantissant l’accessibilité et la sécurité.
• Les solutions à long terme doivent être institutionnalisées. La rotation des enseignants est élevée dans les situations de crise, ce qui rend cruciale l’intégration d’approches sensibles au genre dans les politiques nationales d’éducation.
Au-delà de Tuseme: Un appel à des solutions holistiques
Bien que le projet GPE KIX Tuseme ait un impact, l’éducation dans les situations d’urgence nécessite une action systémique sur plusieurs fronts:
• Les gouvernements doivent donner la priorité au financement de l’éducation pour les populations déplacées.
• Les gouvernements doivent donner la priorité au financement de l’éducation pour les populations déplacées. Il faut investir davantage dans la formation des enseignants pour les écoles touchées par les crises.
• La technologie et les modèles d’apprentissage flexibles peuvent combler les lacunes en matière d’éducation pour les enfants déplacés.
Des partenariats plus solides entre les ONG, les agences humanitaires et les communautés locales peuvent permettre d’étendre des interventions telles que Tuseme à l’ensemble des zones de conflit.
L’éducation est plus qu’un outil de réussite individuelle : c’est une bouée de sauvetage dans les situations d’urgence, un bouclier contre l’exploitation et le fondement de la reconstruction des sociétés.
Alors que l’Afrique continue d’être confrontée à des conflits, des catastrophes climatiques et des déplacements forcés, nous devons agir maintenant pour garantir que l’éducation reste un droit - et non un privilège - pour chaque enfant, d’où qu’il vienne. Lorsque les jeunes trouvent leur voix, ils ne se contentent pas de survivre à la crise, ils changent l’avenir

Photo de groupe réunissant tous les partenaires chargés de la mise en œuvre du programme GPE KIX Tuseme.
Renforcer les systèmes de connaissances: Jeter les bases d’un centre de recherche sur l’éducation des filles en Afrique
La recherche et la production de preuves restent au cœur de la mission du FAWE qui consiste à transformer les systèmes éducatifs pour qu’ils soient plus sensibles au genre. En 2024, le FAWE a approfondi son intérêt pour les systèmes de connaissances grâce à une collaboration clé avec la Fondation Bill et Melinda Gates, visant à établir une base solide pour que le FAWE émerge en tant que centre de recherche sur l’éducation des filles en Afrique.
Grâce à ce soutien, le FAWE a commencé à élaborer une stratégie de recherche complète - une étape essentielle pour aligner ses efforts de production de données probantes sur le plaidoyer et la mise en œuvre des programmes. Il s’agissait notamment d’opérationnaliser le plan de mise en œuvre de la stratégie et d’identifier les principaux partenaires
institutionnels essentiels à l’avancement programme de recherche.
La pierre angulaire de cette initiative a été le partenariat avec le Center for Research Institute in East Africa (CRI-EA). Grâce à cette collaboration, le FAWE a co-développé des stratégies de recherche sur mesure et a renforcé ses capacités internes en matière de gestion des connaissances, positionnant l’organisation comme chef de file de la recherche sur le genre dans le continent.
Ceci marque une étape importante dans le parcours du FAWE pour devenir un leader continental en matière de connaissances sur l’éducation des filles - un leader qui ne se contente pas de générer des données mais qui les transforme en actions pour un changement systémique.

Des écoliers du Zimbabwe présentent fièrement leur trophée du prix d’excellence en STIM.
Le manuel du FAWE sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire
Le Manuel du FAWE sur la violence basée sur le genre en milieu scolaire est une boîte à outils complète conçue pour doter les éducateurs, les administrateurs scolaires et les principales parties prenantes des connaissances et des compétences nécessaires pour prévenir et répondre à la violence basée sur le genre à l’intérieur et autour des établissements scolaires. Le manuel vise à favoriser des environnements d’apprentissage plus sûrs et plus inclusifs en renforçant les systèmes scolaires et les mécanismes de redevabilité.
Plus précisément, le manuel vise à:
1. Identifier les formes dominantes et les causes profondes de la violence sexuelle et basée sur le genre dans les établissements scolaires.
2. Développer et intégrer des interventions scolaires efficaces qui répondent à ces facteurs.
3. Suivre les progrès de la mise en œuvre, évaluer l’efficacité des interventions et affiner les stratégies pour garantir une amélioration continue.
Le modèle vise à la fois les responsables - notamment les administrateurs scolaires, les enseignants, les parents et les dirigeants communautaires - et les détenteurs de droits, en particulier les apprenants, en reconnaissant la nécessité d’une approche holistique et communautaire de l’élimination de la violence sexuelle et basée sur le genre.
Le Manuel sur la violence sexuelle et basée sur le genre a été officiellement lancé en 2024 lors de la conférence La Campagne “Genre: Mon Agenda” (GIMAC) à Accra, au Ghana. Ce lancement a constitué une plateforme de haut niveau pour souligner la nécessité de politiques ciblées et d’outils pratiques pour lutter contre la violence sexuelle et basée sur le genre en Afrique.
En plus de son déploiement régional, le manuel a

été testé au Zimbabwe, au Nigéria et au Malawi dans le cadre de la phase II du programme Données pour le changement, une initiative de collaboration entre le FAWE et Together for Girls. Ces programmes pilotes génèrent des données et des informations précieuses pour l’élargissement et l’intégration des mécanismes de prévention et de réponse à la violence sexuelle et basée sur le genre au sein des systèmes éducatifs nationaux.
Grâce à ce manuel, le FAWE continue de plaider en faveur d’environnements éducatifs transformateurs où chaque apprenant - en particulier les filles - peut se sentir en sécurité, soutenu et habilité à atteindre son plein potentiel.
Numérisez Pour Accéder au Manuel SRGBV.



Mise à l’échelle des initiatives qui marchent:
modèles éducatifs du FAWE en action
CHAPITRE
Des élèves participent à un cours de couture au Kenya.
Les modèles du FAWE : Le moteur de l’accès à
une éducation de qualité, à la formation et au bien-être des jeunes Africains
Dans sa quête d’excellence en matière de promotion de l’égalité des sexes dans le domaine éducatif, le FAWE utilise une variété d’interventions démonstratives qui comprennent la Pédagogie sensible au genre (PSG), les STIM, les Centres d’excellence et Tuseme (Swahili pour “Prenons la parole”).
Depuis plus de trois décennies, les modèles du FAWE ont joué un rôle déterminant dans l’émancipation de la jeune fille africaine des chaînes de l’analphabétisme, du manque d’éducation et de la mauvaise éducation. Ces modèles garantissent que nos bénéficiaires reçoivent une éducation holistique et qu’ils sont bien préparés au monde du travail et à la vie en général. Pour en savoir plus sur les modèles du FAWE, voir ci-dessous:
Pédagogie sensible au genre (GRP)
La pédagogie sensible au genre (PGS) permet aux éducateurs d’acquérir les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour que leurs pratiques d’enseignement soient inclusives et répondent aux besoins d’apprentissage spécifiques des filles et des garçons. Conscient que les approches d’enseignement traditionnelles renforcent souvent inconsciemment les préjugés liés au genre, la GRP aborde à la fois le contenu et la pédagogie, afin de garantir que les processus mis en place en classe favorisent l’équité et les résultats d’apprentissage.


Le personnel de FAWE RS et FAWE Kenya pose avec ses certificats après une formation en GRP de trois jours à Nairobi,
Avec l’appui de l’UNICEF, le FAWE a numérisé le modèle GRP et l’a déployé dans 15 pays. Rien qu’en 2024, 551 personnes se sont inscrites au cours de GRP, dont 205 ont achevé la formation complète. Au total, 1 212 enseignants et parties prenantes ont été formés dans les différentes antennes du FAWE, notamment au Zimbabwe, au Ghana, en Ouganda, en Eswatini, au Libéria, au Malawi, en Tanzanie, à Zanzibar, en Éthiopie, en Zambie et au Kenya. En conséquence, des plans d’action ont été élaborés dans plus de 100 écoles afin d’intégrer des pratiques respectueuses de l’égalité des sexes.

Mme Teresa Omondi-Adeitan, Directrice Exécutive adjointe et responsable des programmes du FAWE Afrique, avec le Dr José Sousa, directeur national du département des affaires transversales du ministère de l’Éducation du Mozambique.
au Kenya.
(À gauche) M. Wesley Chabwera, Directeur Executif du FAWE Malawi, avec Mme Naomi Kamitha, chargée de programme au FAWE, lors d’une session de formation en GRP organisée au Mozambique.

Au Rwanda, la formation numérique en GRP a été dispensée à un large éventail d’acteurs - des fonctionnaires du ministère aux enseignants des écoles secondaires - touchant environ 4 000 éducateurs. La GRP reste un modèle phare du FAWE et un levier clé pour atteindre l’équité de genre dans les salles de classe en Afrique.
Tuseme: Prenons la parole
Tuseme utilise des techniques de théâtre pour le développement afin de permettre aux jeunes, en particulier aux filles, de s’exprimer contre les obstacles qui entravent leur éducation. Ce modèle développe le leadership, la confiance en soi et les aptitudes à la vie quotidienne tout en encourageant les masculinités positives et la solidarité entre pairs.
En 2024, le modèle Tuseme a été mis en œuvre et étendu à de nombreux pays. Le FAWE Kenya, par le biais du programme Imarisha Msichana, a soutenu 160 écoles avec des équipements TIC, permettant à plus de 10 000 étudiants d’accéder à des informations sur la santé et les droits sexuels et reproductifs et de réviser leurs travaux. Au Rwanda, les clubs universitaires Tuseme ont facilité la réintégration de 11 enfants des rues dans le système éducatif et ont mené des campagnes de sensibilisation sur les grossesses précoces et la violence basée sur le genre.
D’autres projets d’envergure ont été enregistrés au Bénin, où un club a obtenu des matériaux pour un nouvel atelier de métallurgie, et au Burkina Faso, où les membres du club ont présenté leurs compétences
en matière de couture et utilisé les recettes pour soutenir les activités du club. Tuseme a été introduit ou relancé dans des écoles de Zanzibar, du Mozambique, de Namibie, du Mali, du Burkina Faso, du Zimbabwe, du Bénin et de la RDC, avec plus de 15 000 élèves participant activement aux activités de Tuseme sur tout le continent.
Centres d’excellence
Les Centres d’excellence du FAWE transforment des écoles ordinaires en environnements d’apprentissage inclusifs et favorables qui répondent aux besoins académiques, physiques et psychosociaux de tous les apprenants. Ces écoles offrent des enseignants formés, du matériel tenant compte de l’égalité des sexes et des structures d’appui communautaire qui contribuent à améliorer la rétention à l’école et la performance.
En 2024, le FAWE Sierra Leone a créé des centres d’excellence dans 27 écoles, permettant ainsi à 13 500 filles marginalisées d’accéder à l’éducation. En Tanzanie et à Zanzibar, 243 éducateurs et parties prenantes ont été sensibilisés à l’intégration de la violence basée sur le genre en milieu scolaire dans l’approche des Centres d’excellence.
Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STIM)
Le modèle STIM du FAWE aborde l’écart persistant entre les sexes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques.
Mme Natacha Danfourou, du FAWE Burkina Faso (recevant le fil), se joint à un groupe d’écolières pour une activité du Club des mères.

Un professeur d’informatique fait participer des élèves dans un laboratoire informatique au Kenya.
L’approche comprend la formation des éducateurs à un enseignement des STIM sensible au genre, l’engagement des décideurs politiques et la sensibilisation des communautés à l’importance de la participation des filles aux STIM.
Au Sénégal, avec le soutien de la Banque de logement du Sénégal, le FAWE a proposé des cours supplémentaires de STIM à 150 filles vulnérables. Ces interventions ciblées ont permis d’améliorer les performances et l’intérêt pour les matières en STIM, préparant ainsi un plus grand nombre de filles à poursuivre des carrières dans les domaines de la science et de l’innovation.
Clubs de mères
Les clubs de mères sont des systèmes de soutien communautaires qui mobilisent des ressources, offrent un mentorat et plaident en faveur de l’éducation des filles, en particulier pour les mères adolescentes et les filles vulnérables.
En 2024, le FAWE Kenya a soutenu les Clubs de mères dans cinq comtés, en aidant les jeunes mères à rester à l’école grâce au mentorat et à la formation aux compétences de la vie courante, telles que la fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables. En Gambie, des clubs de mères ont été mis en place dans sept régions afin de lutter contre les grossesses chez les adolescentes et de promouvoir la réinsertion scolaire.
Le FAWE Zambie, en collaboration avec la CAMFED, a engagé 162 leaders communautaires et a plaidé pour

Des membres des clubs de mères assistent à une session au Kenya.
l’adoption d’instruments politiques de réinsertion statutaire. Ces efforts ont permis de combler le fossé entre les écoles et les communautés, en veillant à ce que les filles reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour achever leur éducation.
Enseignement et Formation Techniques et Professionnels (EFTP)
Le FAWE reconnaît que l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) constituent une voie vitale pour les filles afin qu’elles acquièrent des compétences pratiques et une indépendance économique. En 2024, le FAWE Libéria a organisé une formation sur la GRP pour les institutions d’EFTP, formant un groupe de travail technique pour intégrer la GRP et le modèle Tuseme dans les programmes d’enseignement de l’EFTP. En Somalie, le FAWE a rénové un centre de formation en serres à Burtinle, renforçant ainsi la résilience des jeunes à travers le développement des compétences agricoles.
Lutte Contre la Violence Basée Sur le Genre en Milieu Scolaire
Le modèle de lutte contre la violence basée sur le genre en milieu scolaire du FAWE dote des éducateurs et des chefs d’établissement d’outils pour identifier, prévenir et répondre à la violence à l’intérieur et à l’extérieur des écoles. En 2024, 111 participants du Zimbabwe, du Nigeria, du Kenya et du Malawi ont été formés à l’aide du manuel SRGBV du FAWE. Le modèle a contribué à l’amélioration de la sécurité des apprenants, à la réinsertion des mères adolescentes et à l’augmentation du nombre d’inscriptions. L’Éthiopie a également formé des jeunes défenseurs pour lutter contre les mariages précoces et les obstacles à l’éducation liés aux conflits.
Agir pour une bonne cause: Les anciens du FAWE bâtissent un patrimoine
Au cœur de la mission du FAWE se trouve la conviction que l’éducation n’est pas seulement une question d’accomplissement personnel - il s’agit de doter aux jeunes de moyens de transformer leurs communautés. Cet esprit de restitution est un pilier central du travail du FAWE, et il continue de prendre un élan à travers les actions de son réseau d’anciens boursiers.
Lors d’une récente mission en Éthiopie, l’équipe du Bureau régional du FAWE, ainsi que des représentants des antennes nationales, ont eu le privilège de visiter la maison de retraite Sedekias à Adama, une ville située à un peu plus d’une heure d’Addis-Abeba. Ce remarquable établissement de soins a été fondé par d’anciens membres du FAWE Éthiopie, qui ont porté les valeurs de leadership et de service au-delà de la salle de classe afin d’avoir un impact durable sur la société.
Le foyer de Sedekias n’est pas seulement un sanctuaire pour les personnes âgées, c’est aussi un exemple florissant de durabilité et d’innovation communautaire. Sur place, le bétail est élevé pour générer des revenus et soutenir les opérations du foyer, garantissant ainsi la résilience et la dignité à long terme de ses résidents. Au cours de la visite, l’équipe a été témoin d’un moment particulier: l’une des vaches a mis au monde un veau. Dans un bel hommage au travail du FAWE, le veau nouveau-né a été nommé Tuseme, d’après le modèle d’autonomisation phare du FAWE qui inspire les jeunes à s’exprimer et à conduire le changement.
Dans le cadre de la visite, la délégation du FAWE a également planté des arbres dans l’enceinte de l’organisation - chaque antenne et le Secrétariat régional

(De gauche à droite) M. Kossi Tsenou, Responsable Principal de la communication, M. James Njuguna, Chargé de la gestion des connaissances, Mme Teresa Omondi-Adeitan, Directrice Exécutive Adjointe et responsable des programmes, et Mme Emily Gumba, responsable principale de programme, plantent un arbre au foyer Sedekias.
contribuant à un acte collectif d’espoir et d’héritage. Ces arbres sont un symbole vivant de la présence profondément enracinée du FAWE et de son engagement à créer des environnements de soins, d’équité et de transformation.
Le foyer Sedekias est un témoignage puissant de ce qui se passe lorsque de jeunes femmes et de jeunes hommes reçoivent les outils nécessaires pour diriger et apprennent aussi le besoin du partage. Grâce à des initiatives comme celle-ci, l’impact du FAWE continue de croître, collectivité après collectivité.

Le personnel du Secrétariat régional du FAWE, du FAWE Éthiopie, du FAWE Zimbabwe, du FAWE Ouganda, du FAWE Rwanda et du FAWE Tanzanie remet des denrées alimentaires et des produits de première nécessité au directeur du foyer Sedekias à Addis-Abeba, en Éthiopie.




















Mme Catherine Mwangi (à gauche) et Mme Lilian Bett (à droite), Chargées des finances du FAWE, lors du lancement du plan stratégique du FAWE à Lusaka, en Zambie.

(de gauche à droite) Mme Emily Buyaki, Chargée de la communication du FAWE, Mme Lilian Bett, Chargée des finances, et Mme Carolyne Datche, Chargée de programme, lors de la réunion des partenaires de la Fondation Mastercard à Nairobi, au Kenya.

Délégation du FAWE lors de l’atelier FPP à Nairobi, au Kenya

(de gauche à droite) Mme Naomi Susa, assistante exécutive de la Directrice exécutive, Mme Joan Too, Assistante Informatique et Administrative, Mme Grace Wambua, Responsable Senior des ressources humaines, et Mme Fatimata Kane, chargée de programme, lors de la formation FAWE en GRP à Nairobi, au Kenya.

Mme Anne Motanya, Chargée de la gestion des connaissances, fait une présentation lors de la réunion annuelle d’évaluation et de planification du FAWE à Naivasha, au Kenya.
Les membres du consortium régional Break Free! prennent une photo lors de la réunion annuelle à Lilongwe, au Malawi.