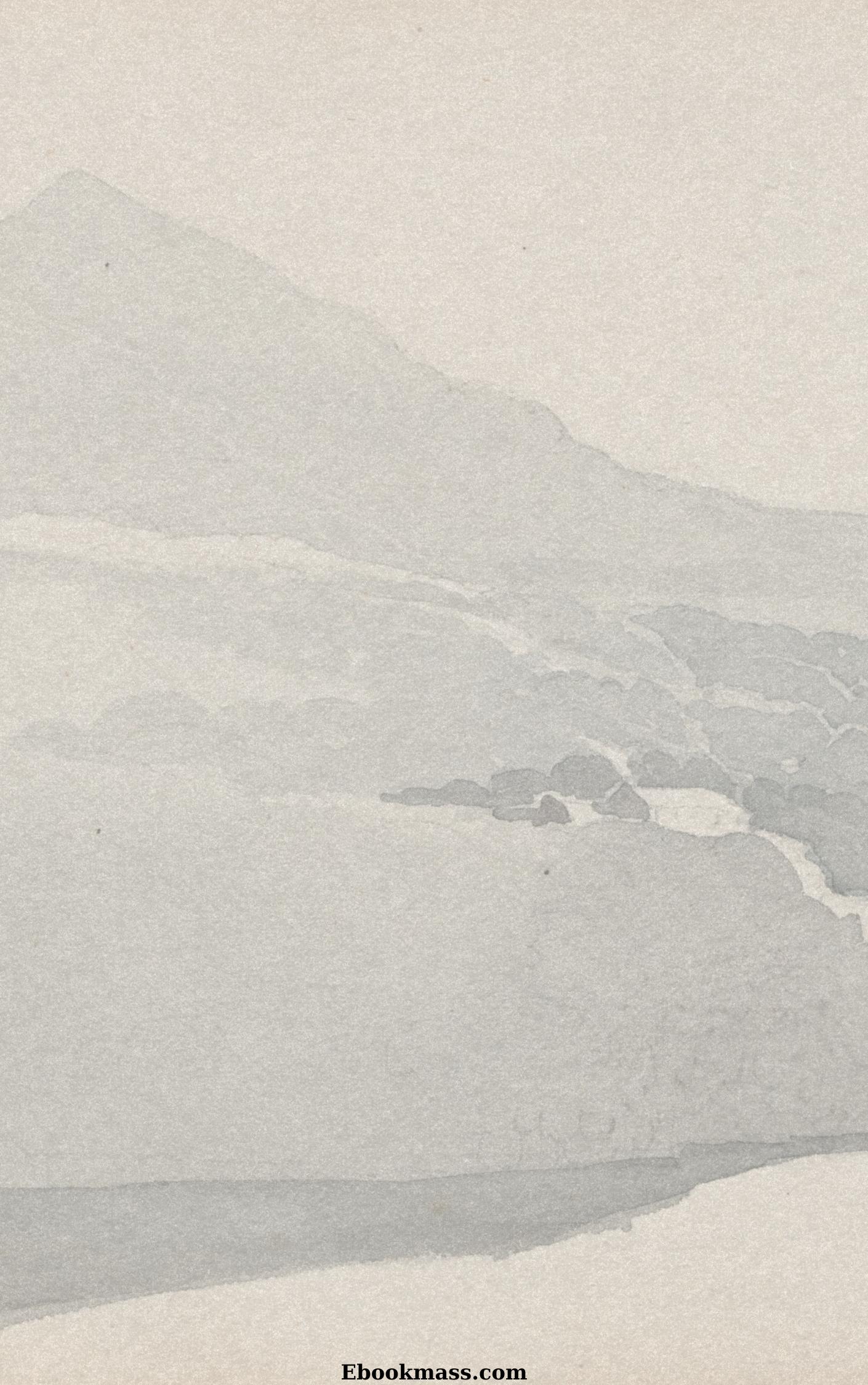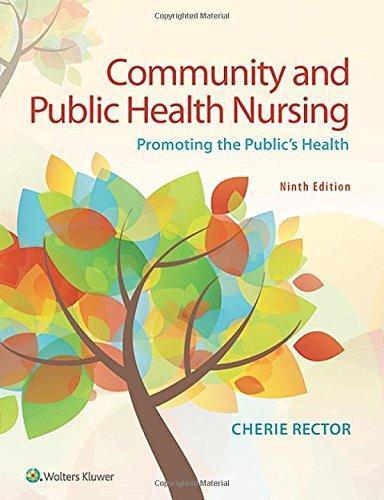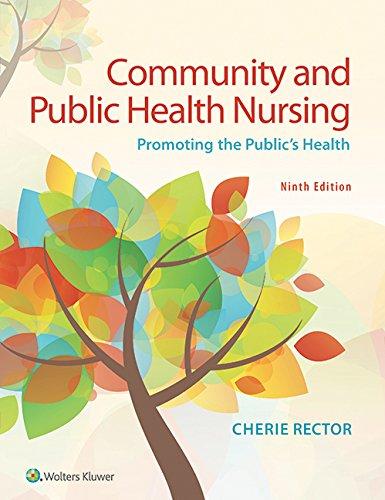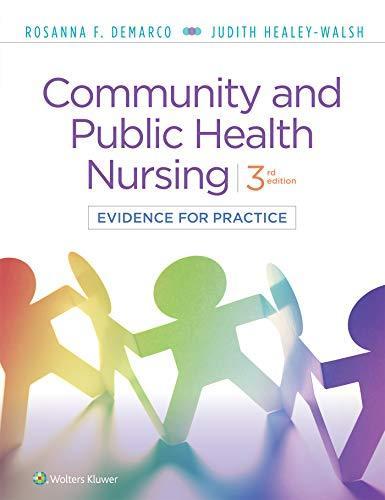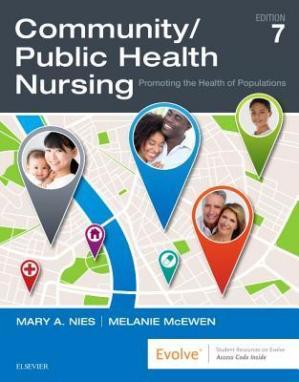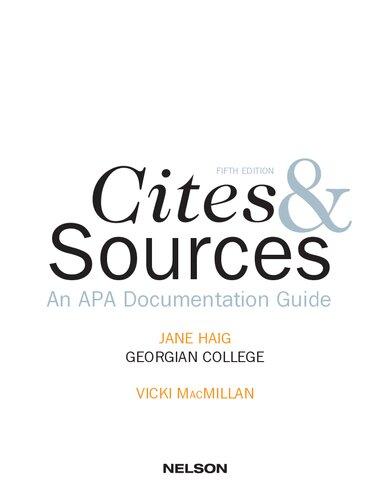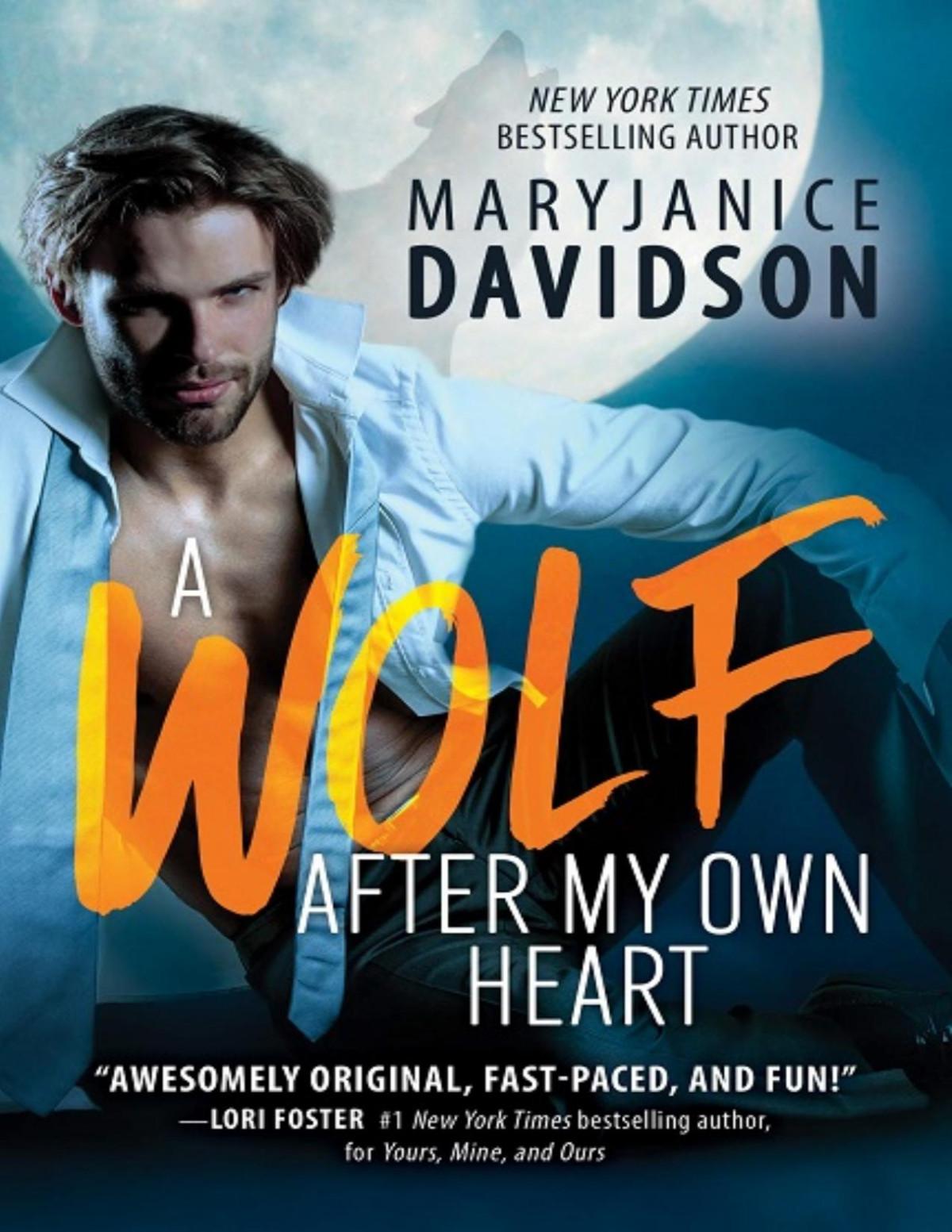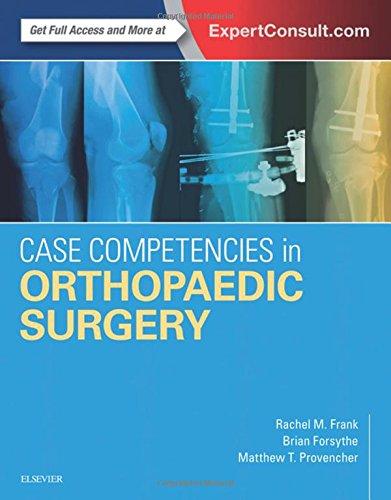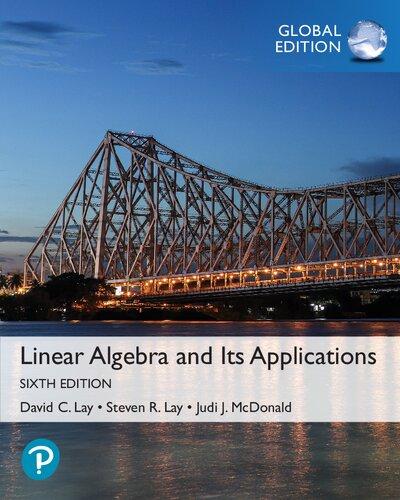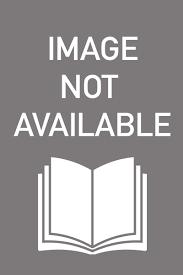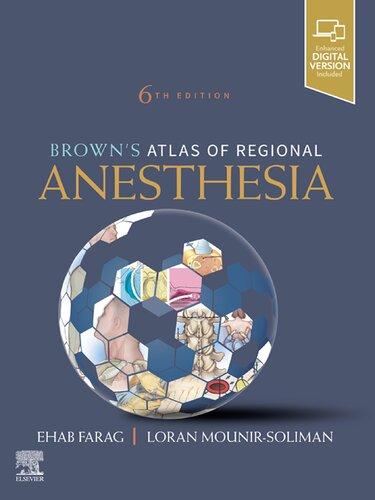CHAPITRE XI CHARLES MAURRAS
Ce n’est pas d’aujourd’hui que nous nous connaissons Charles Maurras et moi. Je l’ai rencontré pour la première fois au café Voltaire en 1890. A cette époque, les jeunes gens qui formaient l’école symboliste et l’école romane se réunissaient là presque tous les soirs. On y récitait des vers, on y discutait passionnément de littérature.
Les théories s’entrechoquaient, mais sans dogmatisme excessif. En général, nous n’étions ni pédants ni poseurs. Nous nous montrions désintéressés dans notre amour de l’art et nous ignorions ce charlatanisme assoiffé de lucre et de basse réclame dont on a vu tant d’exemples depuis.
La belle flamme de la jeunesse embrasait nos propos, vivifiait nos convictions. Et il régnait entre nous une amitié véritable qui, quelles que fussent nos divergences, nous unissait dès qu’il y avait à faire front contre l’ennemi commun.
Cet ennemi, c’étaient les plaisantins du journalisme qui nous représentaient comme d’absurdes névrosés ou comme des farceurs enclins à mystifier le public. C’étaient aussi certains critiques ankylosés d’esprit, comme Brunetière ou des nullités fielleuses, comme Doumic.
Maurras venait habituellement accompagné de Moréas et d’Amouretti. Avec le premier, il opposait au symbolisme, romantique, individualiste et révolutionnaire, la tradition classique et la discipline de l’intelligence. Avec Amouretti, mort jeune et dont il s’est maintes fois réclamé comme de son initiateur à l’idée monarchique, il commençait à réagir contre l’anarchisme des symbolistes et contre la faveur excessive qu’ils accordaient aux influences étrangères.
Tous trois occupaient une table de coin sans toutefois affecter en rien de faire bande à part. Ils se montraient irréductibles quant à leur doctrine, mais ce ne leur était pas un motif pour nous témoigner de l’aigreur ou du dédain. Moréas convoquait volontiers quiconque pour lui déclamer, de sa voix cuivrée, son plus récent poème. Amouretti et Maurras, moins expansifs, dialoguant de coutume sur un ton modéré, ne laissaient cependant pas de s’animer lorsque quelque stupidité malveillante était décochée par la presse contre la jeunesse littéraire. Alors ils partageaient l’indignation de tous. Et la grande salle du café s’emplissait de clameurs pour l’effarement des universitaires à la retraite et des philosophes fossiles qui, venant là depuis des temps immémoriaux, se résignaient à subir nos tumultes plutôt que de quitter la place.
Ce qui nous mit surtout en bons termes, Maurras et moi, ce fut une polémique.
A ce moment, l’école romane commençait à s’affirmer par des œuvres de valeur et notamment par la publication du Pèlerin passionné de Moréas, recueil de vers d’un beau lyrisme quoique alourdi d’archaïsmes inutiles. Ce mouvement suscita des contradictions où la mesure ne fut pas toujours observée. Le métèque yankee, de qui j’ai dit quelques mots plus haut, dépité de voir que beaucoup préféraient le livre de Moréas à ses rhapsodies informes, se distingua par le ton perfidement agressif de ses articles.
Moi aussi, féru de symbolisme à cette époque, je critiquai quelques-unes des tendances de l’école romane. Mais on eut à me rendre cette justice que mes réserves, d’ordre purement littéraire, ne manquaient ni à la loyauté ni au bon goût.
Maurras se plut à le reconnaître dans un article publié par l’Ermitage en 1891 et dont j’ai plaisir à citer quelques fragments en témoignage de nos bonnes relations.
Voici d’abord le début :
« Des nombreux adversaires de l’école romane, vous fûtes à peu près le seul, mon cher Retté, à montrer de la courtoisie. Vos discours furent véhéments et je n’y lus aucune injure. Je n’y vis pas la moindre trace de cette basse envie qui enfla, tout l’été, les moindres ruisseaux du Parnasse. Vous osiez opposer Brunehild à Hélène, Siegfried au valeureux Achille [19] . Vous répandiez sur nos félibres un singulier dédain et vous réussissiez à dire ces blasphèmes dans la prose d’un honnête homme. »
[19] J’étais et je suis encore, un grand admirateur de la musique de Wagner. De là, en ce temps, mon goût excessif pour les héros de la Tétralogie. Mais je n’ai jamais admiré ni défendu la nébuleuse métaphysique du Maître de Bayreuth. Il s’en faut !
On voit le ton. Plus loin, à propos de Shakespeare, Maurras combattait cette opinion, émise par moi, que Shakespeare était, malgré des emprunts aux littératures grecque, latine et italienne de la Renaissance, un génie essentiellement anglais. Il me répondait :
« Je m’obstine à tenir le grand Will pour un italien. Non que j’accorde la moindre importance aux emprunts qu’il put faire de Boccace et de Bandello. C’est l’âme de Shakespeare qui m’apparaît toute gonflée des sèves de la Renaissance. Et, pour mieux dire, c’est en lui que Florence et Venise trouvèrent leur plus belle fleur. Il abonda dans la nature. Il ignora la loi comme l’ignorent les faunes. Nulle peur de la chair, nulle trace d’anglicanisme chez ce contemporain d’Elisabeth… »
Il semble que nous exagérions tous deux. La note juste eût été de reconnaître à l’unisson que Shakespeare est un génie universel. Mais j’ai tenu à reproduire ces lignes parce qu’elles montrent que, même lorsque nous n’étions pas d’accord, ce qui arrivait souvent, comme on s’en doute, nos controverses demeuraient tout amicales.
En une autre occasion, Maurras fut, à son tour, à peu près le seul dans la jeune littérature à approuver mes protestations contre l’engouement des symbolistes pour Mallarmé. Comme je le rapporte précédemment, je passais alors auprès d’un grand nombre de poètes pour un déserteur du symbolisme. Aussi me vilipendaient-ils à qui mieux mieux.
Ce n’était pas seulement le bistournage de l’art mallarméen que je critiquais. C’était surtout le culte rendu à un poète poussant l’individualisme au point de n’être compris que par lui-même. Maurras le démêla fort bien dans ma polémique. Et il le dit dans la Revue encyclopédique, en des termes judicieux. Je lui ai su gré de l’aide qu’il m’apporta d’une façon aussi nette.
Plus tard, lorsque la politique nous jeta dans des camps fort éloignés l’un de l’autre, je ne cessai pas pour cela de goûter la grande poésie, toute parfumée d’hellénisme, d’Anthinéa. Et quel est le lettré qui ne partage pas mon sentiment ? J’estimais aussi que le psychologue incisif et perspicace qui écrivit les Amants de Venise avait porté le jugement définitif sur l’aventure tragi-comique de Musset-Pagello-George Sand. Et cela, je le pense toujours.
Bref, si je me séparais de Maurras sur le régime qui convient à notre pays, je gardais toute mon admiration pour son talent au point de vue littéraire, et j’appréciais particulièrement la puissance et la solidité de sa dialectique.
Ceci spécifié, j’en viens aux circonstances qui m’amenèrent à reconnaître le bien-fondé de ses campagnes pour la Monarchie.
Après mes pérégrinations au pays des marmottes, je veux dire parmi les tribus somnolantes qui professent, comme dans un songe, le libéralisme, je me sentis incliné au découragement en matière politique. Mes expériences m’avaient fort déçu. J’hésitais à en entreprendre de nouvelles. Et pourtant l’irréligion cultivée et développée systématiquement par le régime, la nonchalance et la tiédeur qu’un grand nombre de catholiques mettaient à défendre leur foi contre ses entreprises m’inquiétaient. Je me demandais, avec
tristesse, si l’Église retrouverait jamais, chez nous, des conditions de vie qui lui assurassent les moyens d’exercer en paix son ministère et le rang qu’elle a le droit de réclamer dans une société bien réglée.
En outre, préoccupé du gâchis où la démocratie maintient la France, je me disais : — Notre pauvre pays, débilité par plus d’un siècle d’empoisonnement révolutionnaire, je le compare à un homme qui prétendrait se passer de cerveau et de moelle épinière pour réfléchir et pour coordonner ses actes. De toute évidence, il lui manque un chef qui régisse l’activité de ses organes et qui ne soit pas soumis à leurs caprices et à leurs appétits impulsifs. Mais, ce chef, où le découvrir ?
J’imaginais parfois un César qui, porté au pouvoir par sa popularité, musellerait la révolution et nous donnerait la tête dont l’absence a produit le régime incohérent dont nous souffrons. Cependant j’avais trop étudié l’histoire moderne pour admettre que ce dominateur fût à la merci des plébiscites. J’avais aussi trop vérifié l’inconstance du Suffrage universel pour lui concéder le privilège de remettre sans cesse en question l’autorité à laquelle il se serait confié dans un moment d’enthousiasme.
Il faudrait, ajoutais-je, que le César fondât une dynastie et qu’à cet effet, il n’eût plus jamais à consulter les gouvernés sur la légitimité de son pouvoir. Mais cela, c’est une chimère. Et puis où prendre l’homme providentiel ?… Pas chez les Bonaparte. Cette famille a fait trop de mal à la France pour qu’elle leur livre de nouveau ses destinées.
Un homme nouveau ? On ne le voit pas poindre.
J’en étais là, vers 1910, quand je commençai de prêter attention aux idées de l’Action française. Presque tout ce que ses fondateurs publiaient dans leur revue puis dans leur journal me plaisait. Toutefois, ils me paraissaient trop peu catholiques. Et j’eus toujours, depuis mon adhésion au catholicisme, la conviction ferme qu’une renaissance nationale ne peut durer que si l’Église y participe largement.
D’autre part, je conservais des préjugés contre la Monarchie traditionnelle. Mais je dois dire que, dès cette époque, ils avaient peu de consistance. C’était plutôt un sentiment vague, survivance probable de mon passé révolutionnaire qu’une répulsion violente issue d’un raisonnement suivi.
Ce fut l’étude réfléchie des œuvres politiques et sociales de Maurras qui dissipa mes préventions et me rassura quant aux garanties qu’une Restauration donnerait à l’Église.
Je relus d’abord Le dilemme de Marc Sangnier et je fus impressionné d’une façon très favorable par la préface. Qu’on me permette de transcrire les passages qui me parurent les plus significatifs touchant les rapports de l’Action française avec l’Église.
Parlant au nom de ceux de ses collaborateurs qui ne pratiquaient pas comme au sien, Maurras dit :
« Quelqu’étendue qu’on accorde au terme de gouvernement, en quelque sens extrême qu’on le reçoive, il sera toujours débordé par la plénitude du grand être moral auquel s’élève la pensée quand la bouche prononce le nom de l’Église de Rome. Elle est sans doute un gouvernement ; elle est aussi mille autres choses. Le vieillard en vêtements blancs qui siège au sommet du système catholique peut ressembler aux princes du sceptre et de l’épée quand il tranche et sépare, quand il rejette ou qu’il fulmine ; mais la plupart du temps, son autorité participe de la fonction pacifique du chef de chœur quand il bat la mesure d’un chant que ses choristes conçoivent comme lui, en même temps que lui. La règle extérieure n’épuise pas la notion du Catholicisme, et c’est lui qui passe infiniment cette règle. Mais où la règle cesse, l’harmonie est loin de cesser. Elle s’amplifie au contraire. Sans consister toujours en une obédience, le Catholicisme est partout un ordre. C’est à la notion la plus générale de l’ordre que cette essence correspond pour ses admirateurs du dehors. »
Il ne s’agit donc pas ici d’une alliance éphémère avec l’Église en vue d’une manœuvre politique, mais d’une reconnaissance de ce
principe qu’elle incarne l’Ordre conçu dans son acception la plus élevée.
Lisons maintenant cette superbe déclaration :
« Je suis Romain parce que Rome, depuis le consul Marius et Jules César jusqu’à Théodose, ébaucha la première configuration de ma France. JesuisRomain, parce que Rome, la Rome des prêtres et des papes a donné la solidité éternelle du sentiment, des mœurs, de la langue, du culte à l’œuvre politique des généraux, des administrateurs et des juges romains. Je suis Romain, parce que si mes pères n’avaient pas été Romains, comme je le suis, la première invasion barbare, entre le Ve et le Xe siècle, aurait fait aujourd’hui de moi une espèce d’Allemand ou de Norvégien. JesuisRomain, parce que, n’était ma romanité tutélaire, la seconde invasion barbare, qui eut lieu au XVIe siècle, l’invasion protestante, aurait tiré de moi une espèce de Suisse. Je suis Romain dès que j’abonde en mon être historique, intellectuel et moral. Je suis Romain, parce que si je ne l’étais pas, je n’aurais à peu près plus rien de français. Et je n’éprouve jamais de difficulté à me sentir ainsi Romain, les intérêts du catholicisme romain et ceux de la France se confondant presque toujours, ne se contredisant nulle part. »
Toute cette préface découle des deux propositions qu’on vient de lire. Pour moi, quand je l’eus méditée, je me dis : — Ce n’est point ici la déclamation d’un rhéteur qui développera peut-être demain la thèse contraire. Ce n’est point non plus une ruse pour se créer des partisans au sein de l’Église. C’est l’affirmation droite, profondément sincère, d’une âme qui, si elle ne pratique pas encore, éprouve une vénération totale pour l’Église de Dieu, sa Mère. Je connais assez Maurras pour me tenir assuré de sa bonne foi. Il faut lui faire confiance.
Ensuite, en même temps que j’approfondissais Trois idées politiques, L’avenir de l’intelligence, l’Enquête sur la Monarchie, volumes de Maurras, sur lesquels je reviendrai tout à l’heure, j’étudiai deux autres de ses livres : LaPolitiquereligieuseet l’Action françaiseetlaReligioncatholique.
Ces deux volumes sont consacrés à la critique du libéralisme et à la réfutation de l’erreur politique où se confinent ceux qui croient à la possibilité d’une démocratie favorable au catholicisme en France. Le ton en est assez vif. Mais cette véhémence s’explique par le fait que les adversaires de l’Action française se montraient, le plus souvent, d’une odieuse mauvaise foi dans la discussion et que certains libéraux y employèrent des armes déloyales. C’est ainsi qu’on publia des brochures — anonymes, bien entendu — où des phrases tirées d’articles et de livres de Maurras et de ses amis étaient isolées du contexte et commentées de façon à leur attribuer un sens d’hostilité à l’Église.
Le procédé n’est pas nouveau. C’est celui dont les libéraux de jadis usèrent à l’égard de Veuillot pour soulever contre lui l’opinion des fidèles mal informés.
Il y eut, par exemple, l’Univers jugépar lui-même. Ce libelle fut publié d’abord sans nom d’auteur. Puis un abbé Cognat, familier de l’Évêché d’Orléans, en endossa la paternité sous la menace d’un procès qui eût montré sous un jour peu avantageux les inspirateurs du factum.
Là aussi, des fragments d’articles de Veuillot, extraits de la collection de l’Univers, depuis vingt ans, étaient juxtaposés avec un art perfide, tronqués ou falsifiés et entourés de commentaires qui en déformaient absolument la signification. Déjà Falloux — surnommé Fallax — avait témoigné d’une fourberie du même genre dans sa trompeuse Histoire du parti catholique. Et il n’est pas de ruses auxquelles le libéralisme n’ait eu recours dans l’intention de disqualifier Veuillot. Il est vrai que le pape Pie IX le prit sous sa protection et que ceux qui avaient tenté de le poignarder moralement dans le dos en restèrent diminués aux yeux des honnêtes gens de tous les partis [20] .
[20] Sur toute cette affaire et pour se renseigner sur les procédés obliques chers à certains libéraux de tous les temps, lire la Vie de Louis Veuillot par son frère Eugène (Lethielleux) et aussi le livre vengeur de l’abbé Ulysse Maynard : Monseigneur Dupanloup et son historien l’abbé
Lagrange. Ce dernier volume est épuisé. Mais on le trouve assez facilement dans les librairies d’occasions.
Traité à peu près comme le fut Veuillot, Maurras était donc autorisé à se défendre aussi vigoureusement qu’il le fit. Il manifesta d’ailleurs, dans sa polémique, ces mêmes solides qualités de logique et de franchise qu’on admire dans toute son œuvre.
Je n’entreprendrai pas l’analyse détaillée de ces deux volumes. Il suffira de mentionner que Maurras s’y disculpe, avec aisance, des imputations volontairement inexactes portées contre lui et les siens. Je transcrirai seulement deux citations qui, je l’espère, donneront l’envie de les lire aux catholiques, d’esprit impartial, qui ne les connaîtraient pas encore :
« Toutes les fois qu’il nous arrive d’établir une démonstration, notre point de départ invariable est une hypothèse faite en vue de parler au cœur, hypothèse qui prend l’appui ou l’attache sur quelque sentiment que nous supposons vif et fort chez nos auditeurs ou chez nos lecteurs.
« Ainsi, pour les conduire au roi, avons-nous dit aux patriotes : — SivousvoulezvraimentlesalutdevotrePatrie… ; aux nationalistes :
— Sivous tenezàsecouer lejoug del’étranger del’intérieur… ; aux antisémites : — Si vous désirez terminer le règne des Juifs… ; aux conservateurs : — Si lapréservation de l’ordre public estplus forte chez vous que vos divisions, vos préjugés, vos prudences…, au prolétariat de la grande industrie : — Si l’organisation sociale vous paraît vraiment plus nécessaire que tout… ; aux catholiques enfin : — Si votre volonté tend bien à triompher des persécuteurs de l’Église… Selon nous chacun de ces divers vœux est un chemin qui doit aboutir à la monarchie. Rien de plus facile que de montrer par notre examen de la situation — si complet et si rigoureux qu’on ne l’a jamais discuté — comment le roi seul pourra rendre au Catholicisme sa liberté, à l’ouvrier nomade un statut vraiment social, à la fortune acquise l’influence publique, aux conservateurs la protection et le contrôle que leur doit l’État, à l’antisémitisme la victoire prompte et paisible, aux nationalistes français leur délivrance
des métèques, à la Patrie entière la sécurité et l’honneur. Mais la portée de chacune de ces argumentations régulières, quelque puissante qu’elle fût au point de vue formel, s’évanouirait au point de vue pratique, nos hypothèses seraient réduites à l’état de prémisses mortes, si elles ne correspondaient à des sentiments réels et vivaces, si le patriotisme, le nationalisme, l’antisémitisme, le désir de l’ordre et de la conservation générale, l’aspiration syndicaliste et enfin la foi catholique n’existaient pas ou faiblissaient ou manquaient de ressort. Otez-les, et vous enlevez la raison d’être de notre œuvre, les sources d’énergie capable de la réaliser jusqu’au bout. Ces sentiments forment si bien le cœur, le centre de notre doctrine, que c’est uniquement en leur nom qu’il nous paraît possible de demander au public français d’abord son audience et son attention, ensuite le sacrifice de ses idées fausses, de ses nuées, puis l’abdication de son dangereux titre de roi nominatif, fictif et constitutionnel, enfin l’action directe en faveur du vrai roi. (Lapolitiquereligieuse, p. 100101). Cet exposé limpide, résumant avec tant de force les raisons d’être de l’ActionFrançaise, mérite, tout au moins, d’éveiller l’intérêt de quiconque désire une France prospère et catholique.
Ma seconde citation, je la détache de l’admirable lettre que Maurras écrivit au Pape Pie X pour lui faire connaître les buts de l’Action française et lui démontrer combien les accusations que le libéralisme portait contre elle à Rome étaient iniques et sans fondement. Je regrette fort de n’avoir point la place de la reproduire tout entière. Mais enfin en voici un des passages les plus décisifs : Rappelant les diatribes et les calomnies dont il avait été l’objet de la part des libéraux, Maurras répond :
« Assurément, l’ensemble des griefs, dont nous nous défendons (mes amis et moi), forme un torrent boueux où l’incompréhension le dispute à l’ignorance et est menée par des intérêts. Un consciencieux parallèle des allégations dirigées contre nous et de celle de nos paroles qui en ont fourni le prétexte fait apparaître, à chaque instant, la diffamation et la calomnie.
« La justice que j’en ai faite dans ce petit livre est probablement suffisante, peut-être même outrée et — bien qu’elle me semble
assez modérée — cette défense vigoureuse m’ôte le droit de me plaindre de rien ni de rien demander. En bonne justice, je me crois simplement autorisé à conclure que, pour nous imputer soit une volonté hostile à l’Église, soit l’intention ou le désir de la combattre et de l’offenser, nos écrits ne suffisent pas : il les faut travestir. Pour me composer un visage d’ennemi public ou secret de l’Église, il faut mentir. La vérité est que je n’ai rien approuvé ni rien enseigné qui soit une invitation directe ou dissimulée à combattre ses croyances ou à s’en détacher. La vérité est encore que, tout au rebours du langage des amis « libéraux » de l’Église, c’est au catholicisme entier, et au plus strict, c’est au catholicisme le plus soumis à sa loi, parce que catholique et non quoique catholique, au catholicisme comme tel, que sont toujours allés mes hommages d’admiration ou de respect donnés aux œuvres, aux actes ou aux enfants de l’Église. Tels sont les faits. Les uns et les autres peuvent parler en notre faveur, Très Saint Père… » (L’Action française et la Religion catholique, p. 277, 278).
La lecture de ces deux livres fit disparaître mes appréhensions touchant le catholicisme de l’Actionfrançaise. Et, par la suite, quand j’eus constaté que la plupart de ses rédacteurs étaient des catholiques pratiquants, dont nul ne pouvait, sans outrage, suspecter la sincérité, quand je vis Maurras prendre, en toute occasion, la défense de l’Église contre les attaques directes ou détournées de ses ennemis, je fus conquis d’une façon définitive. Il m’était d’ailleurs impossible de ne point adopter la conclusion du Père Descoqs dans son beau livre : Atraversl’œuvredeCharlesMaurras. La voici :
« L’ordre naturel que préconise le système de M. Maurras est le vrai ; loin de s’opposer à l’ordre surnaturel, il se trouve en harmonie parfaite avec lui, et Dieu y peut enter sa grâce sans obstacle. On a parlé, à propos de M. Maurras, d’apologétique du dehors. A voir M. Maurras se rencontrer fréquemment avec l’Église, on le croirait presque un de ses fils. M. Maurras comprend parfois mieux l’esprit catholique que certains catholiques. »
Nous sommes beaucoup qui espérons que bientôt « Dieu entera sa grâce » sur la bonne volonté de Maurras. Le jour où il sera non
plus un catholique de désir mais un catholique pratiquant, on pourra dire qu’il réalise en lui le nationalisme — intégral.
Or, tel qu’il était, j’admis, par son fait et en ce qui me concerne, qu’appuyer dorénavant la propagande de l’Action française, c’était aussi bien servir l’Église.
Une pensée fortement exprimée n’est pas toujours une pensée juste. Mais chez Maurras, et, en particulier, dans l’Avenir de l’intelligence, la force implique la justesse. De là, sa puissance de persuasion sur les esprits où les nuées du romantisme n’ont jeté qu’une ombre passagère.
Dans l’Avenir de l’intelligence, la thèse qu’il soutient peut se ramener à ceci : de notre temps, un pouvoir a remplacé tous les autres, celui de l’or. Et cet or, un petit nombre de financiers internationaux le détiennent en si grande quantité qu’ils influencent, d’une façon excessive et uniquement en vue de leurs intérêts, la vie des nations.
Maurras constatant le fait, écrit :
« Un homme d’aujourd’hui devrait se sentir plus voisin du Xe siècle, (c’est-à-dire de la pleine féodalité) que du XVIIIe . Quelques centaines de familles sont devenues les maîtresses de la planète. Les esprits simples qui s’écrient : Révoltons-nous, renversons-les, oublient que l’expérience de la révolte a été faite en France, il y a plus de cent ans et qu’en est-il sorti ? De l’autorité des princes de notre race, nous avons passé sous la verge des marchands d’or, qui sont d’une autre chair que nous, c’est-à-dire d’une autre langue et d’une autre pensée. Cet or est sans doute une représentation de la force, mais dépourvue de la signature du fort. On peut assassiner le puissant qui abuse, mais l’or échappe à la désignation et à la vengeance. Ténu et volatil, il est impersonnel ; son règne est indifféremment celui d’un ami ou d’un ennemi, d’un national ou d’un étranger. Sans que rien le trahisse, il sert également Paris, Berlin et Jérusalem. Cette domination, la plus absolue de toutes, est pourtant celle qui prévaut dans les pays qui se déclarent avancés… Sans
doute, le catholicisme résiste et seul. C’est pourquoi cette Église est partout poursuivie, inquiétée, serrée de fort près… Nos libres penseurs n’ont pas encore compris que le dernier obstacle à l’impérialisme de l’Or, le dernier fort des pensées libres est justement représenté par l’Église qu’ils accablent de vexations. Elle est bien le dernier organe autonome de l’esprit pur. Une intelligence sincère ne peut voir affaiblir le catholicisme sans concevoir qu’elle est affaiblie avec lui ; c’est le spirituel qui baisse dans le monde, lui qui régna sur les argentiers et sur les rois ; c’est la force brutale qui repart à la conquête de l’univers… »
Ces lignes furent écrites en 1905. Je suppose qu’après ce que nous avons vu depuis et ce que nous voyons encore, nul n’en contestera la valeur de prévision exacte.
J’étais d’autant mieux disposé à partager l’opinion de Maurras que ce qu’il affirmait de la sorte, selon l’ordre naturel, je n’avais cesse de le répéter dans mes livres catholiques en me plaçant au point de vue du Surnaturel. L’or, disais-je, en substance, c’est le mal, c’est la contre-Église déchaînée par celui que l’Évangile appelle « le Prince de ce monde ».
Cette persistance à dénoncer les méfaits de l’Or prépotent m’avait même valu l’animosité de certains catholiques qui s’efforcent aveuglément de « servir deux maîtres : Mammon et Jésus-Christ. »
Mais, comme le dit encore Maurras :
« Cette position du problème gêne quelques charlatans qui ont des intérêts à cacher tout ceci. Ils font les dignes et les libres, alors qu’ils ont le mors en bouche et le harnais au dos. Ils nient la servitude pour encaisser les profits, de la même manière qu’ils poussent aux révolutions pour émarger à la caisse du Capital. Mais constater la puissance, ce n’est pas la subir, c’est se mettre en mesure de lui échapper. On la subit, au contraire, lorsqu’on la nie par hypocrite vanité… Quand donc l’homme qui pense aura sacrifié les commodités et les plaisirs qu’il pourrait acheter à la passion de l’ordre et de la patrie, non seulement il aura bien mérité de Dieu [21] , mais il se sera honoré devant les autres hommes et il aura relevé
son titre et sa condition. L’estime ainsi gagnée rejaillira sur quiconque tient une plume. Devenue le génie de la cité, l’intelligence sera sauvée de l’abîme où descend notre art déconsidéré. »
[21] Maurras dit « de ses dieux », forme de langage admissible chez un classique qui n’est pas encore arrivé à la pleine Lumière.
Il passe ensuite en revue, avec des raccourcis bourrés d’idées ingénieuses et fécondes, la condition de l’Intelligence dans la société depuis le XVIe siècle jusqu’à nos jours.
Rien de mieux pensé, par exemple, que ce qu’il dit de Napoléon. Celui-ci avait beau dénoncer les méfaits de l’idéologie, il était luimême un idéologue, « un homme de lettres couronné ». Toute son œuvre porte la marque encyclopédiste ou celle de Rousseau. Et de ces deux influences, par son despotisme, naquit un semblant d’ordre.
« Mais, fait remarquer Maurras, ceux d’entre nous qui se sont demandés, comme Lamartine : cetordreest-ill’ordre ?et qui ont dû se répondre non, tiennent le rêveur prodigieux qui confectionna ce faux ordre pour le plus grand poète du romantisme français. Ils placent Napoléon à vingt coudées au-dessus de Jean-Jacques et de Victor Hugo, mais à plus de mille au-dessous de M. de Peyronnet. »
Dans la suite du XIXe siècle, Maurras relève également l’inaptitude de la plupart des représentants de l’Intelligence à concevoir comme néfastes les méthodes économiques nées de la Révolution.
« Les lettrés du XVIIIe siècle, dit-il, avaient fait décréter comme éminemment raisonnable, juste, proportionnée aux clartés de l’esprit humain et aux droits de la conscience, une certaine législation du travail d’après laquelle tout employeur étant libre et tout employé ne l’étant pas moins, devaient traiter leurs intérêts communs d’homme à homme, d’égal à égal, sans pouvoir se concerter ni se confédérer, qu’ils fussent ouvriers ou patrons. »
Ce régime était détestable ; « les faits économiques, s’accumulant, révélaient chaque jour le fond absurde, odieux, fragile,
des fictions légales… Mais les lettrés ne comprenaient du mouvement ouvrier (qui créait les syndicats contre cette anarchie), que ce qu’il présentait de révolutionnaire ; au lieu de construire avec lui, ils le contrariaient dans son œuvre édificatrice et le stimulaient dans son effort destructeur. Considérant comme un état naturel l’antagonisme issu de leurs mauvaises lois, ils s’efforcèrent de l’aigrir et de le conduire aux violences. On peut nommer leur attitude générale au cours du XIXe siècle un désir persistant d’anarchie et d’insurrection… Ainsi tout ce qu’entreprenait d’utile ou de nécessaire la force des choses, l’intelligence littéraire le dévoyait ou le contestait méthodiquement. »
La déconsidération qui en résulta auprès du public lettré eut pour effet de rejeter une portion notable des écrivains vers la littérature dite « de tour d’ivoire », au détriment de la culture générale.
« Cette littérature, continue Maurras, creusa un premier fossé entre certains écrivains et l’élite des lecteurs. Mais, du seul fait qu’elle existait, par ses outrances souvent ingénieuses, parfois piquantes, toujours très voyantes, elle attira dans son orbite, sans les y enfermer, beaucoup des écrivains que lisait un public moins rare. On n’était plus tenu par le scrupule de choquer une clientèle de gens de goût et l’on fut stimulé par le désir de ne pas déplaire à un petit monde d’originaux extravagants… Cette « littérature artiste » isola donc les maîtres de l’Intelligence. »
Ici encore, je me rencontrais avec Maurras, puisque, dès longtemps, je combattais la littérature de l’Art pour l’Art et qu’à propos de Mallarmé, j’en avais dénoncé les abus chez les symbolistes.
Ensuite Maurras stigmatisait la littérature industrielle qui, par souci de gagner beaucoup d’argent, corrompait le rudiment de goût qui peut subsister dans le « gros public » malgré tant d’assauts destructeurs.
« Que signifient, s’écriait-il, les cent mille lecteurs de M. Ohnet, sinon la plus diffuse, la plus molle et la plus incolore des
popularités ? Un peu de bruit matériel, rien de plus, sinon de l’argent. »
Comme de juste, sur ce point comme sur les autres, j’étais avec Maurras.
Ainsi dévoyée, et pervertie, l’Intelligence littéraire devait tomber fatalement sous le joug de la finance, surtout lorsqu’elle cherchait des ressources dans le journalisme.
Maurras proposait une réaction — celle-là même qu’il dirige aujourd’hui avec tant de maîtrise et de désintéressement.
Certes, l’entreprise présentait de grandes difficultés. Mais, concluait-il, « fussent-elles plus fortes encore, elles seraient moindres que la difficulté de faire subsister notre dignité, notre honneur sous le règne de la ploutocratie qui s’annonce. Cela ce n’est pas le difficile ; c’est l’impossible. Ainsi exposée à périr sous un nombre victorieux, la qualité intellectuelle ne risque absolument rien à tenter l’effort. Si elle s’aime, si elle aime nos derniers reliquats d’influence et de liberté, si elle a des vues d’avenirs et quelque ambition pour la France, il lui appartient de mener la réaction du désespoir. Devant cet horizon sinistre, l’Intelligence nationale doit se lier à ceux qui essayent de faire quelque chose de beau avant de sombrer. Au nom de la raison et de la nature, conformément aux vieilles lois de l’univers, pour le salut de l’ordre, pour la durée d’une civilisation menacée toutes les espérances flottent sur le navire d’une contreRévolution. »
Cet appel pathétique et corroboré d’arguments vitaux cadrait trop avec mes propres préoccupations pour que je n’y répondisse pas. Aussi, je puis dire que, dès 1912, c’est-à-dire dès ma lecture de l’Avenir de l’Intelligence, faite, comme je l’ai rapporté, en même temps que celle des livres apologétiques consacrés par Maurras à la tradition catholique, je servis les idées de l’Action française. Je ne mis pas de fracas à les répandre. Mais je puis me rendre cette justice que, pour être discrète, ma propagande n’en fut pas moins assez souvent efficace.
Je lus aussi, à la même époque, Troisidéespolitiques, œuvre de la jeunesse de Maurras, mais où s’affirment déjà, avec une rare maturité de pensées un don critique qui trouvait matière à s’exercer à propos de trois figures significatives du XIXe siècle : Chateaubriand, Michelet, Sainte-Beuve.
Pour Maurras, comme pour quiconque se montre capable de se hausser à des idées générales, de se former un ensemble de convictions politiques et sociales, d’adopter une doctrine vérifiée par l’expérience et de s’y tenir, l’étude d’un écrivain n’implique pas seulement l’analyse de ses procédés littéraires. Il aime à le situer dans le temps et à relever les qualités et les défauts par lesquels cet écrivain s’adapta au milieu ou réagit contre ses tendances.
Maurras applique donc cette méthode à Chateaubriand. Il note tout de suite que, né « dans l’État français de 1789, monarchique, hiérarchique, syndicaliste et communautaire », le Père du romantisme « fut des premiers après Jean-Jacques, qui firent admettre et aimer un personnage isolé et comme perclus dans l’orgueil et dans l’ennui de sa liberté. »
De là, un individualisme imaginatif qui lui fait transmuer le catholicisme traditionnel en une sorte de déisme sentimental à la manière des Allemands ou des Suisses. Ce pourquoi Maurras le définit fort bien : « Un protestant honteux, vêtu de la pourpre de Rome » et qui « a contribué, presque autant que Lamennais, à notre anarchie religieuse ».
Il le montre aussi amoureux des ruines et de la mort, versant de la rhétorique éplorée sur l’Ancien Régime et sur la monarchie bourbonienne et tellement habitué à jouer l’ordonnateur des funérailles qu’il lui était fort désagréable de modifier son attitude.
Maurras, avec une fine ironie, signale ce qu’il y eut de néfaste et de comique à la fois dans cette « pose » perpétuellement endeuillée : « Il fallait que son sujet fût frappé au cœur. Mais qu’une des victimes, roulées, cousues, chantées par lui dans le linceul de pourpre fît quelque mouvement, ce n’était plus de jeu ; ressuscitant, elles le désobligeaient pour toujours. »
De là, son humeur tracassière, vaniteuse et mesquine sous la Restauration. « Louis XVIII n’eut pas de plus incommode sujet ni ses meilleurs ministres de collègue plus dangereux. » Aussi, sous Charles X, s’empressa-t-on de l’éloigner en des ambassades, ostracisme très doré, très honorable qui pourtant suscitait en lui de violentes rancunes.
Tout en se proclamant conservateur, il ne cessait de marivauder avec la Révolution. C’est sans doute pour cela que tant de libéraux le réclament comme un ancêtre.
Après 1830, « la monarchie légitime a cessé de vivre. Tel est le sujet ordinaire de ses méditations ; l’évidence de cette vérité provisoire lui rend la sécurité. Mais, toutefois, de temps à autre, il se transporte à la sépulture royale, lève le drap, et palpe les beaux membres inanimés. Pour les mieux préserver des réviviscences possibles, cet ancien soldat de Condé les accable de bénédictions acérées et d’éloges perfides pareils à des coups de stylet ».
En somme, Chateaubriand est semblable en cela à ceux des conservateurs qui estiment que la Révolution n’a pas tous les torts et qu’il serait sage, pour subsister, de revêtir sa carmagnole, de chausser ses sabots et de coiffer son bonnet rouge.
En une demi-douzaine de pages, que je tiens pour irréfutables, Maurras a su fixer cette physionomie si représentative d’une race d’esprits condamnés à détruire, par impuissance à sortir d’euxmêmes pour regarder le Réel en face et pour y conformer leur intelligence. Réaliste avant tout, il a donc raison de placer Chateaubriand en tête des fabricants d’illusions dont il faut se garder avec soin parce que les breuvages de rêve qu’ils nous offrent sont à base de morphine.
Autre sentimental, aussi énervé qu’énervant, voici Michelet. Maurras le définit fort bien :
« Cette brillante intelligence ne se posséda point elle-même. Il fallait toujours qu’elle pliât sous quelque joug, obéît à quelque aiguillon. Un esprit pur et libre se décide par des raisons et en d’autres mots par lui-même ; le sien cédait pour l’ordinaire, à ce
ramassis d’impressions et d’imaginations qui se forment sous l’influence des nerfs, du sang, du foie et des autres glandes. Ces humeurs naturelles le menaient comme un alcool. Son procédé le plus familier consiste à élever jusqu’à la dignité de Dieu chaque rudiment d’idée générale qui passe à sa portée… Ces divinités temporaires se succèdent au gré de sa mobilité ; c’est, tour à tour, la Vie, l’Homme, l’Amour, le Droit, la Justice, le Peuple, la Révolution.
Quelquefois ces abstractions variées se fondent les unes dans les autres, car Michelet manquait à un rare degré de l’art de distinguer. »
Toutes ces entités, filles d’une métaphysique humanitaire dont on ne compte plus les méfaits, Maurras remarque qu’elles constituent le Panthéon de la Démocratie. C’est pour cela que l’État laïque préconise Michelet comme un éducateur sans pareil. « Partout où il le peut, sans se mettre dans l’embarras ni causer de plaintes publiques, l’État introduit Michelet. Voyez, notamment, dans les écoles primaires, les traités d’histoire de France, les manuels d’instruction civique et morale, ces petits livres ne respirent que les « idées » de Michelet… L’État part de cette conjecture ingénue que l’auteur de la Bible de l’Humanité « émancipe », introduit les jeunes esprits à la liberté de penser. Michelet s’en vante beaucoup. Mais au son que rendent chez lui ces vanteries, je crois entendre un vieil esclave halluciné prendre ses lourdes chaînes pour le myrte d’Harmodius. »
Ce que Maurras aurait pu ajouter c’est qu’une des raisons qui font choisir Michelet pour former les intelligences juvéniles, c’est sa haine invariable de l’Église et de la Royauté.
Comment ce choix s’accommode-t-il avec la prétendue neutralité de l’école laïque ? Je crois qu’on embarrasserait quelque peu nos maîtres provisoires, si on les pressait sur ce point.
En tout cas, l’action de Michelet sur les cervelles sans défense qu’on lui livre ne peut être que désastreuse. Aussi approuve-t-on Maurras quand il conclut comme suit :
« Tout ce bouillonnant Michelet, déversé dans des milliers d’écoles, sur des millions d’écoliers, portera son fruit naturel : il multiplie, il accumule sur nos têtes les chances de prochain obscurcissement, les menaces d’orage, de discorde et de confusion. Si nos fils réussissent à paraître plus sots que nous, plus grossiers, plus proches voisins de la bête, la dégénérescence trouvera son excuse dans les leçons qu’on leur fit apprendre de Michelet. »
Cela fut publié en 1898. Constatons, une fois de plus, que Maurras s’est montré bon prophète.
Maurras écrit, aux premières lignes de son étude sur SainteBeuve, que celui-ci, « sur ses derniers jours, tenait à peu près la vérité ».
Au point de vue strictement catholique, c’est le contraire qui est exact. Car Sainte-Beuve ne montra de velléités religieuses qu’à l’orée de son âge mûr. Mais dès la publication des derniers volumes de son Port Royal, on s’aperçut qu’il inclinait de plus en plus vers le matérialisme. Cette disposition alla toujours s’accentuant, et aboutit à un sensualisme grossier de sorte que son existence terrestre se conclut par un enterrement civil.
Cette réserve faite, et en souscrivant au dire de Maurras qu’il « ne brille point par le caractère » et qu’il « laisse assez vite entrevoir les basses parties de son âme », en ajoutant qu’il fut un ami déloyal, un détestable poète et un romancier médiocre, on doit reconnaître que Sainte-Beuve fut, par contre, un critique hors-ligne.
Analyste perspicace, intuitif et grandement doué pour noter les nuances, il portait sa curiosité sur les intelligences les plus diverses ; en toutes il savait démêler les traits caractéristiques. Comme le dit fort bien Maurras : « Qu’il s’agisse de la correspondance d’un préfet, des écrits de Napoléon ou des recherches sur Le Play (ce Le Play qu’il appelle un Bonald rajeuni, progressif et scientifique), une diligente induction permet à Sainte-Beuve d’entrevoir et de dessiner, entre deux purs constats de fait, la figure d’une vérité générale. Cette vérité contredit souvent les idées reçues de son temps. »
C’est ainsi qu’il a souvent jugé, avec une clairvoyance totale, la Révolution et ses apologistes. Et c’est pourquoi je l’ai cité deux fois au cours du présent volume.
L’homme, cependant, restait révolutionnaire au tréfonds, mais, relève Nietzsche, « contenu par la crainte ». Ce Germain latinisé a raison de signaler, en outre, que « ses instincts inférieurs sont plébéiens, qu’il erre çà et là, raffiné, curieux, aux écoutes » et qu’en somme, c’est un être de complexion presque féminine.
Cela est vrai, répond Maurras, « mais à cette sensibilité anarchique s’alliait l’esprit le plus sain et le plus organique. C’était un esprit, c’était une raison… La révolution est toujours un soulèvement de l’humeur. Toutes les fois qu’intervint son intelligence, SainteBeuve étouffa ce soulèvement : si bien que c’est peut-être dans la suite de ses études que se rencontreraient les premiers indices de la résistance aux idées de 1789. »
Maurras, en conclusion, tire de ses observations sur Sainte-Beuve une théorie de l’empirisme organisateur qui appelle, à mon avis, autant d’objections que d’approbations partielles. Mais ce n’est point le lieu de développer les unes ni les autres.
Disons simplement, et en résumé, que, dans ses Trois idées politiques, Maurras a lucidement démontré que Chateaubriand fut un anarchiste par orgueil, Michelet un anarchiste par détraquement nerveux, Sainte-Beuve, un être mi-parti dont l’anarchisme foncier fut contrebalancé par une raison classique. Les deux premiers sont à écarter d’un plan de reconstruction sociale. Chez le troisième, on découvre quelques matériaux utilisables.
Un des plus grands services que Maurras ait rendu à notre pays, c’est l’institution de cette Enquête sur la Monarchie (1900-1909), dont je vais maintenant dire quelques mots.
Présenter, sous son vrai jour, la Monarchie légitime, niveler la montagne de préjugés et d’ignorances qui en séparaient, depuis plus d’un siècle, nombre d’esprits plus ou moins formés à l’école de la
Révolution, c’était une besogne ardue. Maurras n’hésita pas à l’entreprendre. Et, tant par la qualité des témoignages qu’il réunit que par les commentaires vivants, pressants, dont il les accompagna, il produisit un effet de lumière dont il faut lui savoir un gré extrême.
Ce n’est point ici un de ces recueils où s’entassent les investigations réunies, avec négligence, par un journaliste hâtif. Cette enquête, une en sa conception, réfléchie et mûrie à loisir, intéresse autant que le ferait une œuvre d’imagination bien ordonnée.
Sans l’analyser dans le détail, — ce qui demanderait un volume — j’en veux extraire quelques-uns des arguments les plus décisifs ; je les choisirai aussi bien chez les correspondants de Maurras que chez lui-même. Et, de préférence, je citerai ceux qui impliquent de la façon la plus décisive la critique du régime actuel.
Parlant de la centralisation excessive, œuvre des Jacobins, aggravée par Napoléon et qui étouffa la vie des provinces au bénéfice de la capitale, si bien que Taine a pu comparer le système actuel à un hydrocéphale dont la tête énorme pèse sur un corps atrophié, le comte de Lur-Saluces dit :
« Tantôt sous prétexte de sauvegarder la liberté, tantôt sous celui de rendre au pays l’ordre et la sécurité, on n’a jamais cherché qu’à compliquer, d’une façon plus ou moins habile, les rouages du pouvoir central, soit qu’on voulût gêner son action, soit, au contraire, qu’on cherchât à la rendre plus puissante. C’est ainsi que, dans un état de perpétuelle instabilité, on n’a pas cessé d’osciller entre l’anarchie et la tyrannie. On n’a pas compris qu’il s’agissait moins de déployer les talents du subtil horloger dans la confection du mécanisme de ce pouvoir central que de le décharger du poids formidable des responsabilités qu’il restait seul à porter et sous lesquelles il finissait toujours par succomber.
« On n’a pas vu qu’il fallait lui laisser la part qui devait lui revenir et répartir le reste sur d’autres épaules. Il faut bien le remarquer : la durée de l’ancien régime était due à la décentralisation : la féodalité,
les communes ensuite, puis les corporations religieuses, ouvrières et autres, les universités, les parlements étaient autant d’organismes qui s’interposaient entre le pouvoir central et l’individu et prenaient leur part de responsabilité et de liberté. On dira, peut-être, que je demande à revenir à cet ordre de choses aujourd’hui disparu. Il faut aller au-devant des objections les plus saugrenues. Sans doute les anciennes institutions ont eu jadis leur raison d’être ; elles ont jadis joué un rôle utile parce qu’elles correspondaient aux conditions d’existence sociale, aux idées et aux besoins de leur temps. Mais parce qu’une chose a bien fonctionné jadis, ce n’est pas une raison pour vouloir la rétablir. » Il faut donc « à la place des anciens organismes qui permettaient la décentralisation, en laisser se former d’autres appropriés aux besoins actuels et qui la permettront à leur tour ». Ce sera la tâche de la Monarchie qui, seule, peut la mener à bien.
Voici maintenant une constatation profonde de M. Paul Bourget. Je prie qu’on la médite, car elle est des plus essentielles à retenir pour ceux qui, las de l’aberration démocratique, cherchent à se former une conviction d’après des données positives :
« Votre enquête, c’est une démonstration après tant d’autres de cette vérité : lasolutionmonarchiqueestlaseulequisoitconforme aux enseignements les plus récents de la science. Il est bien remarquable, en effet, que toutes les hypothèses sur lesquelles s’est faite la Révolution se trouvent absolument contraires aux conditions que notre philosophie de la nature, appuyée sur l’expérience, nous indique aujourd’hui comme les lois les plus probables de la santé politique. Pour ne citer que quelques exemples de première évidence : la science nous donne, comme une des lois les plus constamment vérifiées, que tous les développements de la vie se font par continuité. Appliquant ce principe au corps social, on trouvera qu’il est exactement l’inverse de cette loi du nombre, de cette souveraineté du peuple qui place l’origine du pouvoir dans la majorité actuelle et, par suite, interdit au pays toute activité prolongée. Que dit encore la science ? Qu’une autre loi du développement de la vie est lasélection, c’est-à-dire l’héréditéfixée.