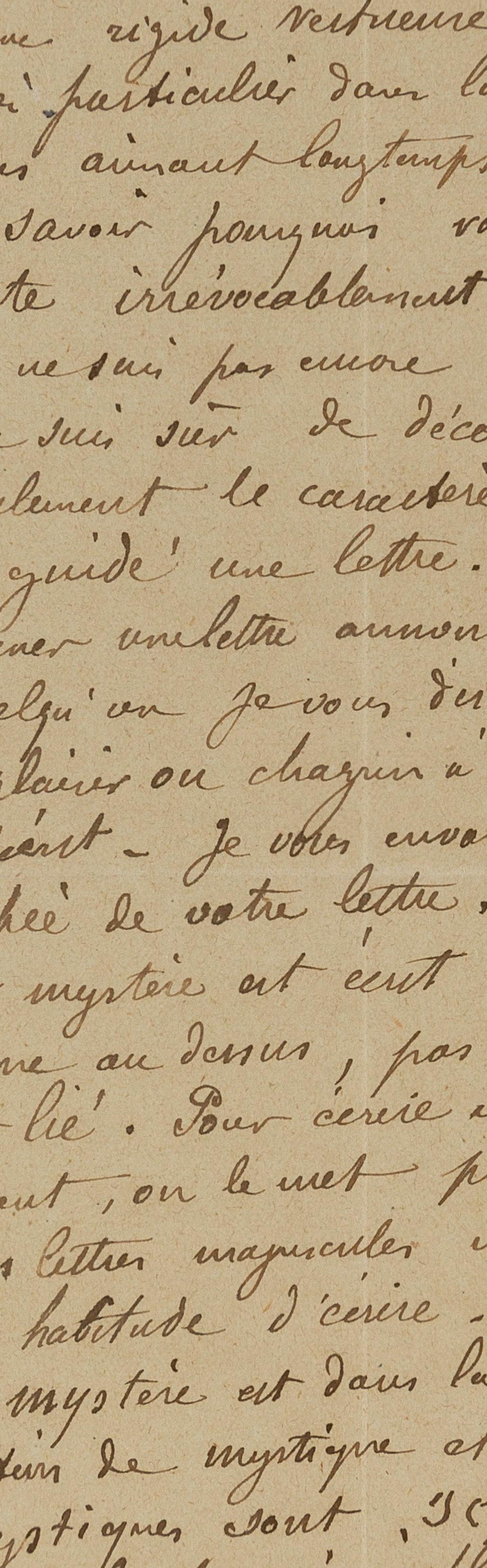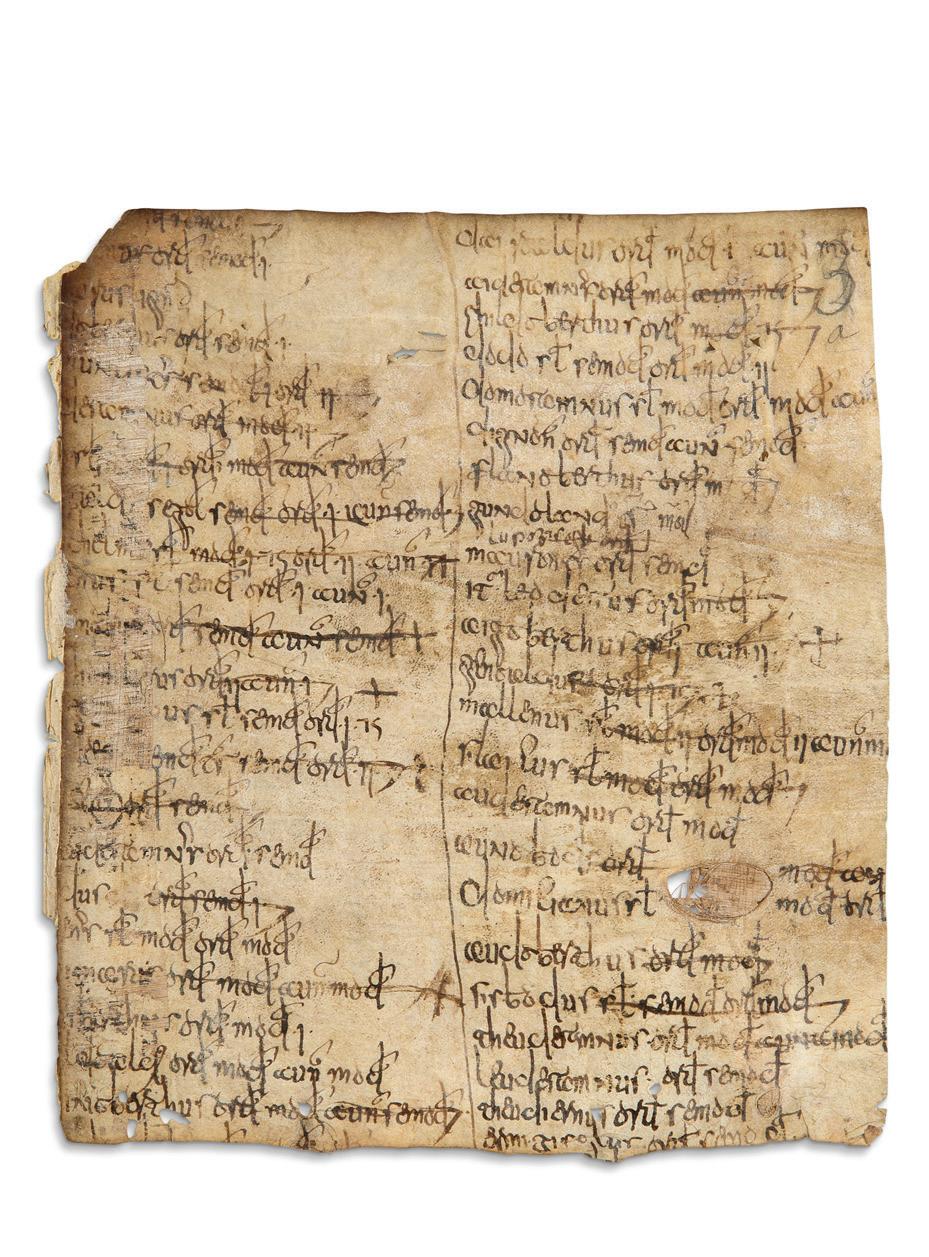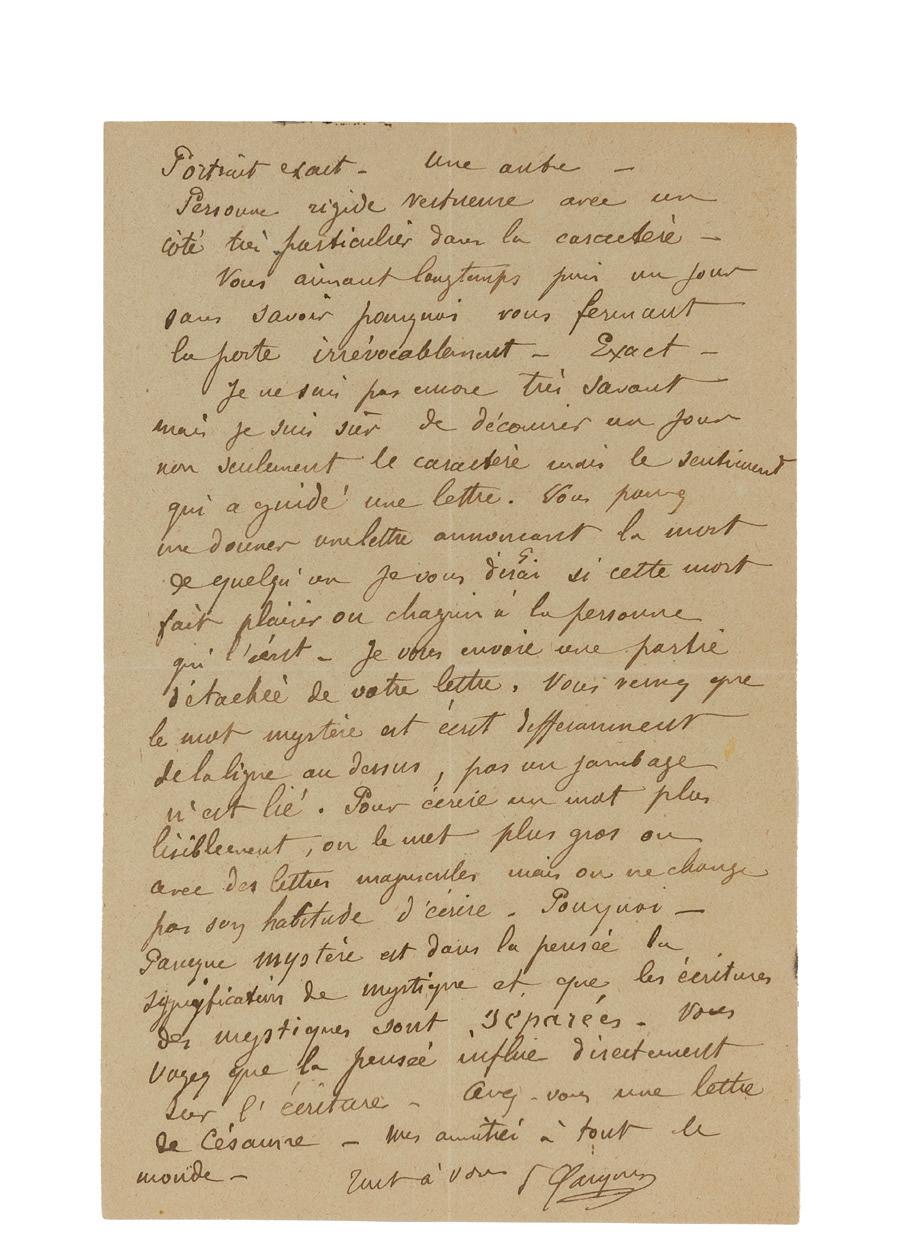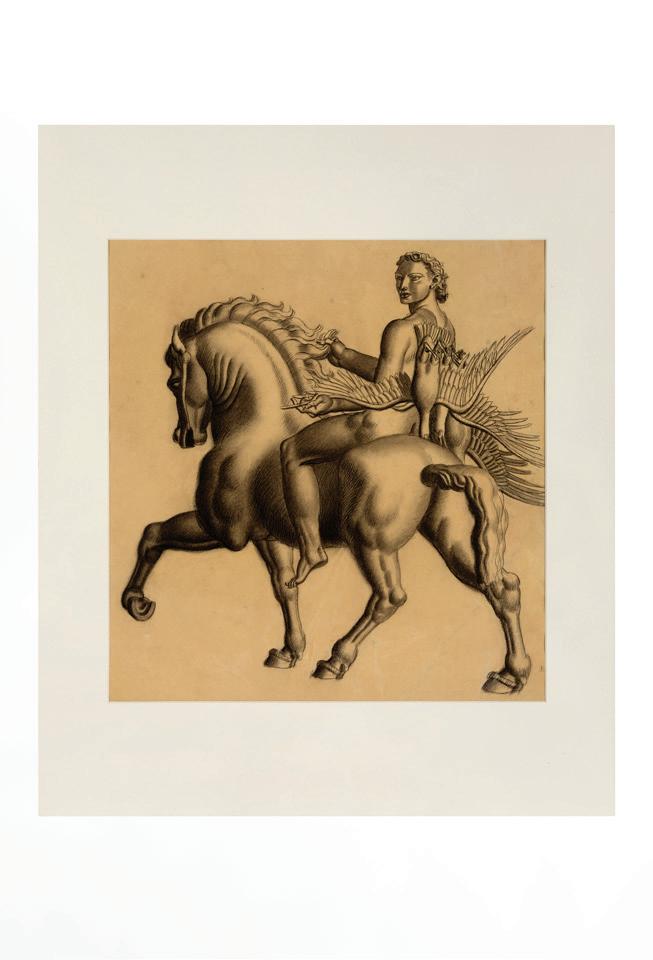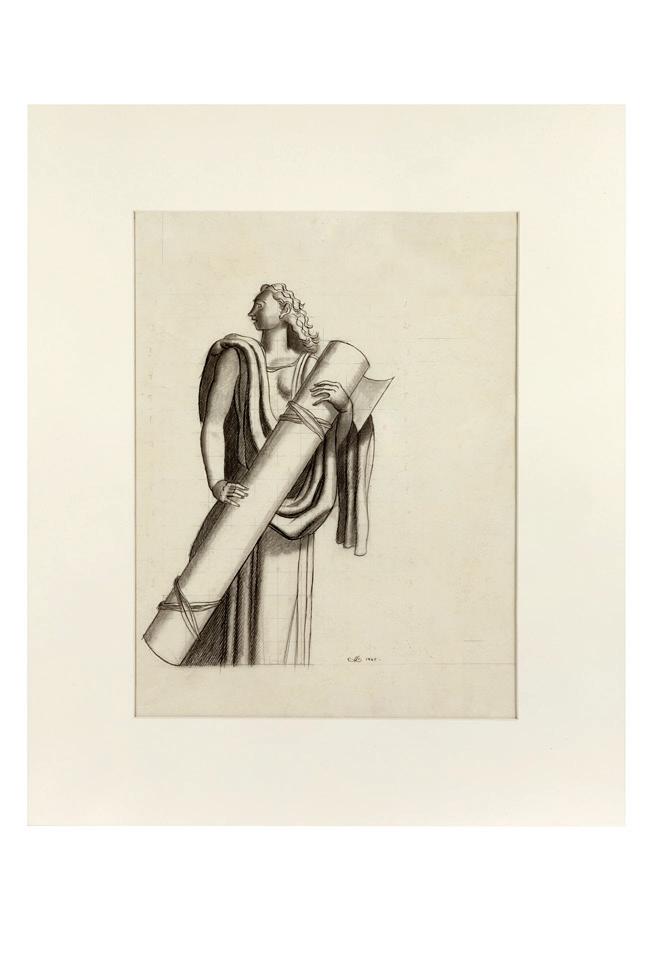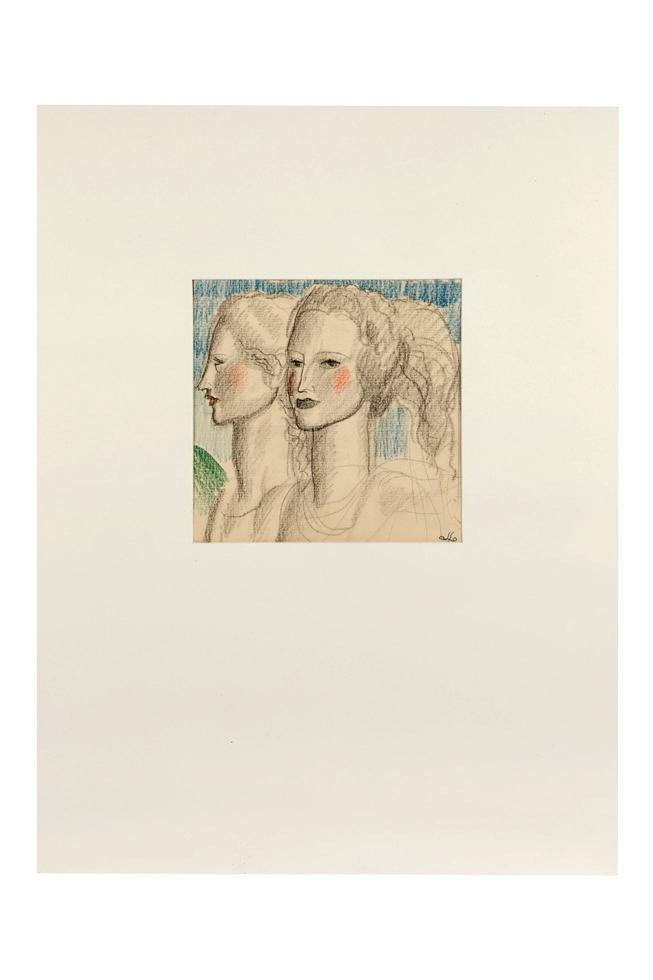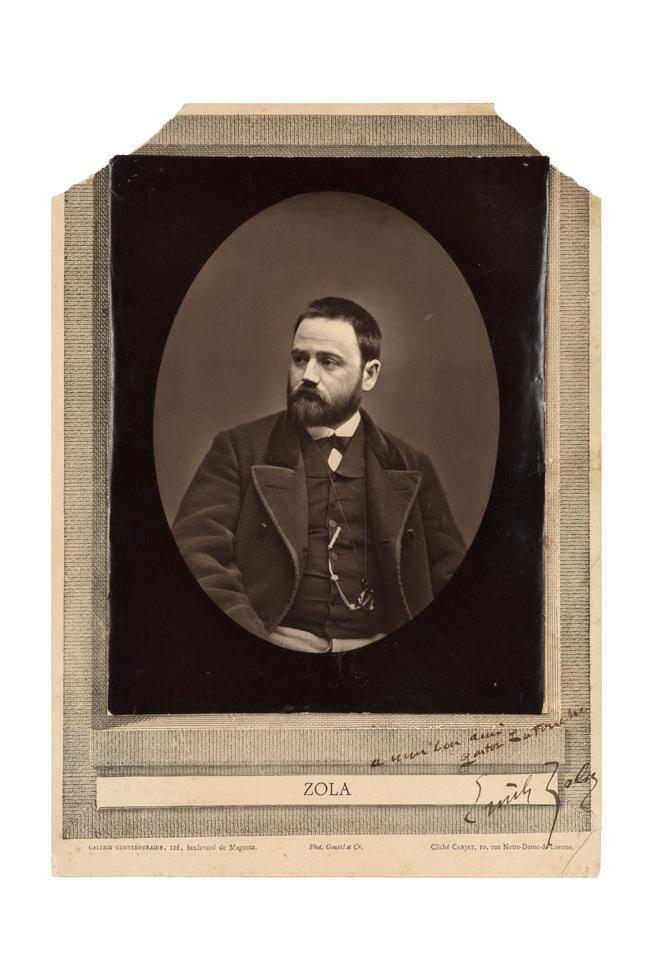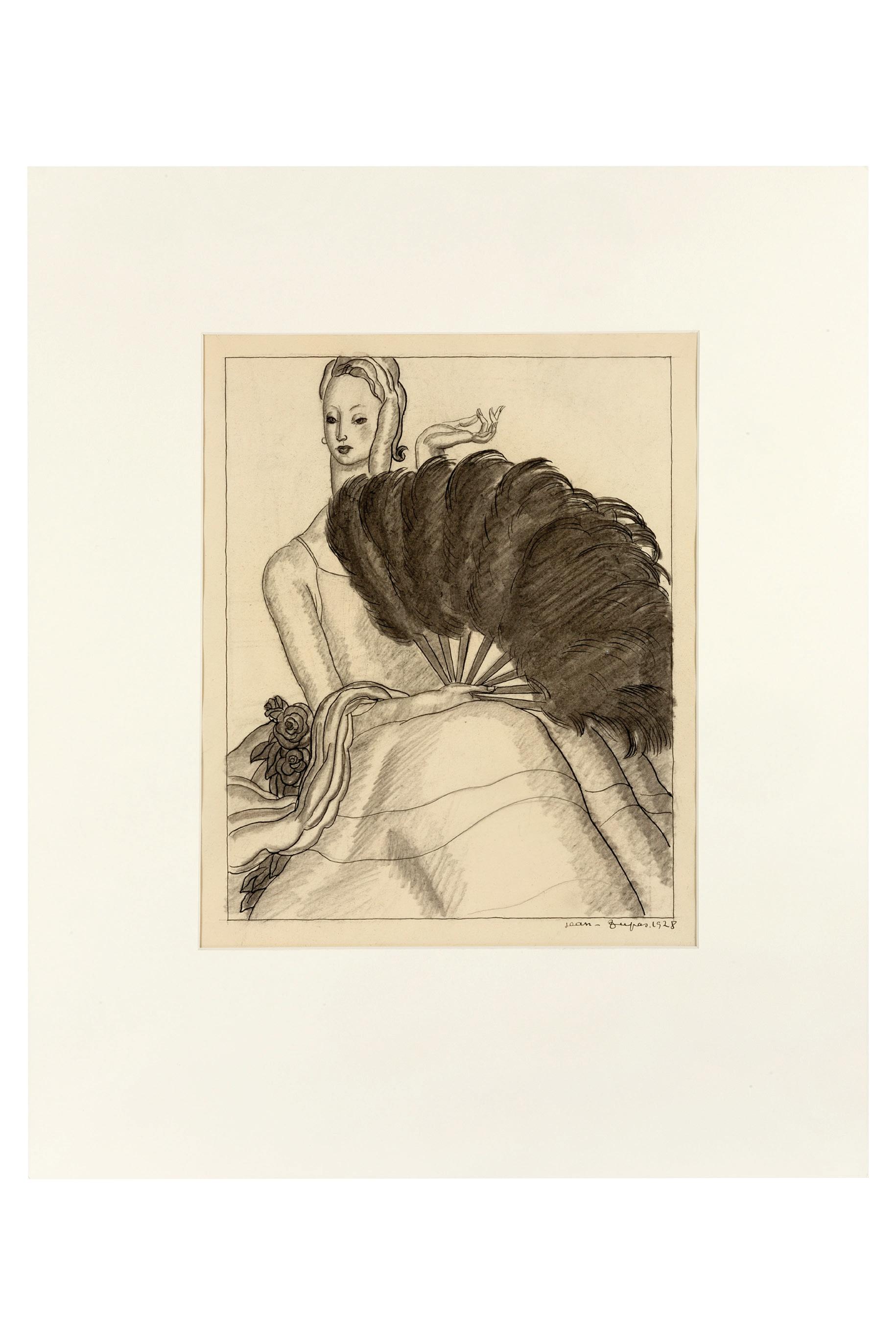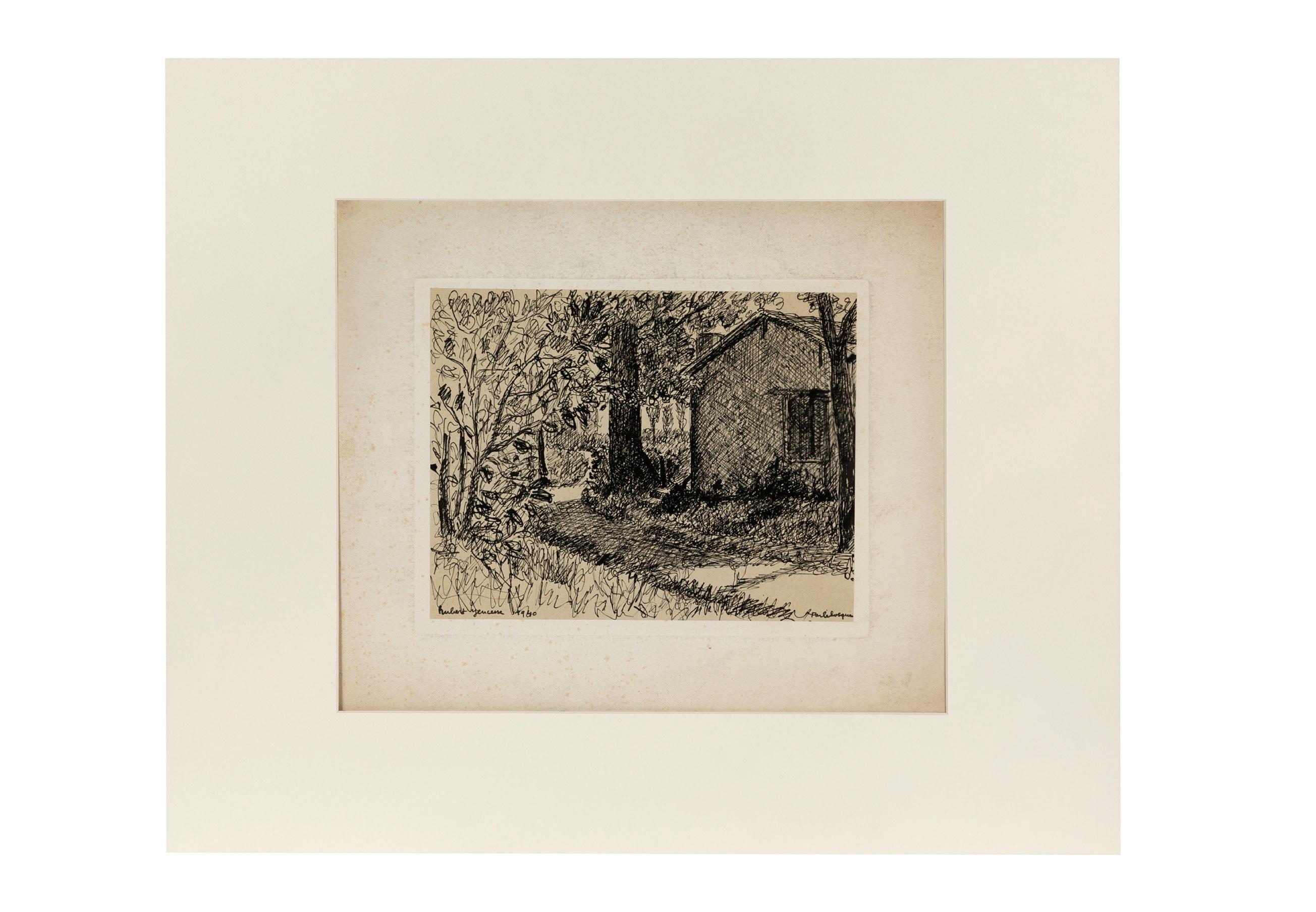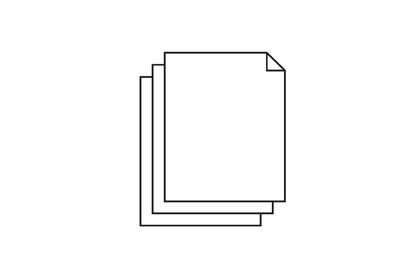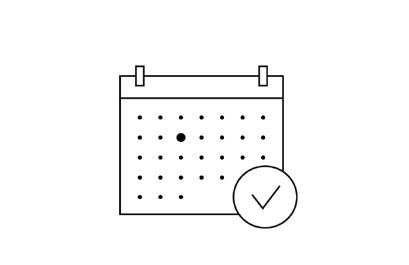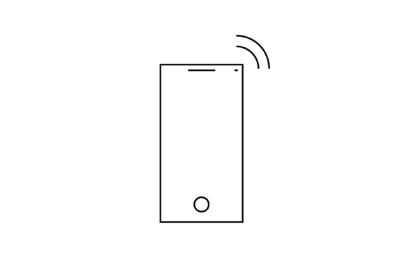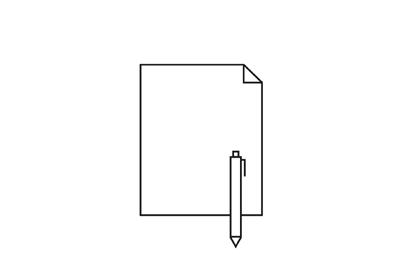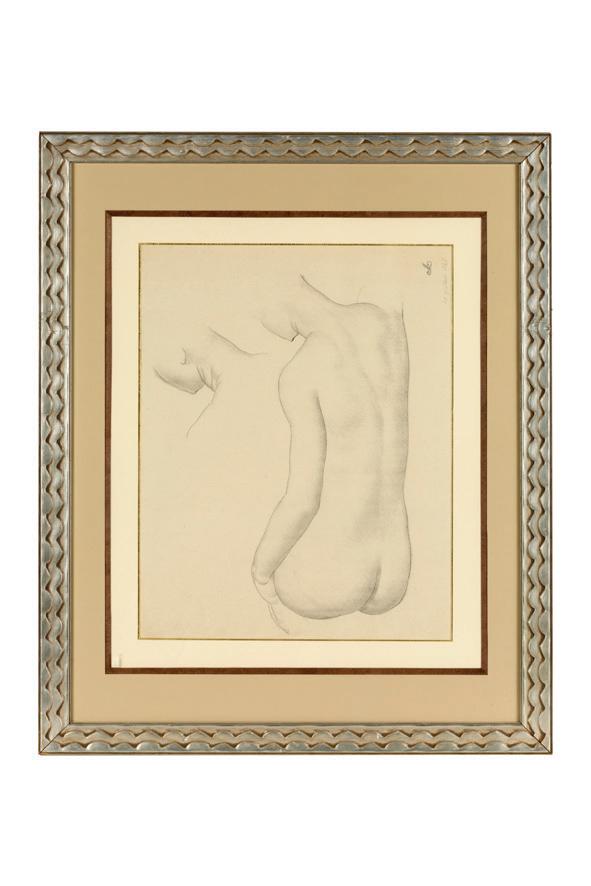LETTRES & MANUSCRITS AUTOGRAPHES, LIVRES & PHOTOGRAPHIES
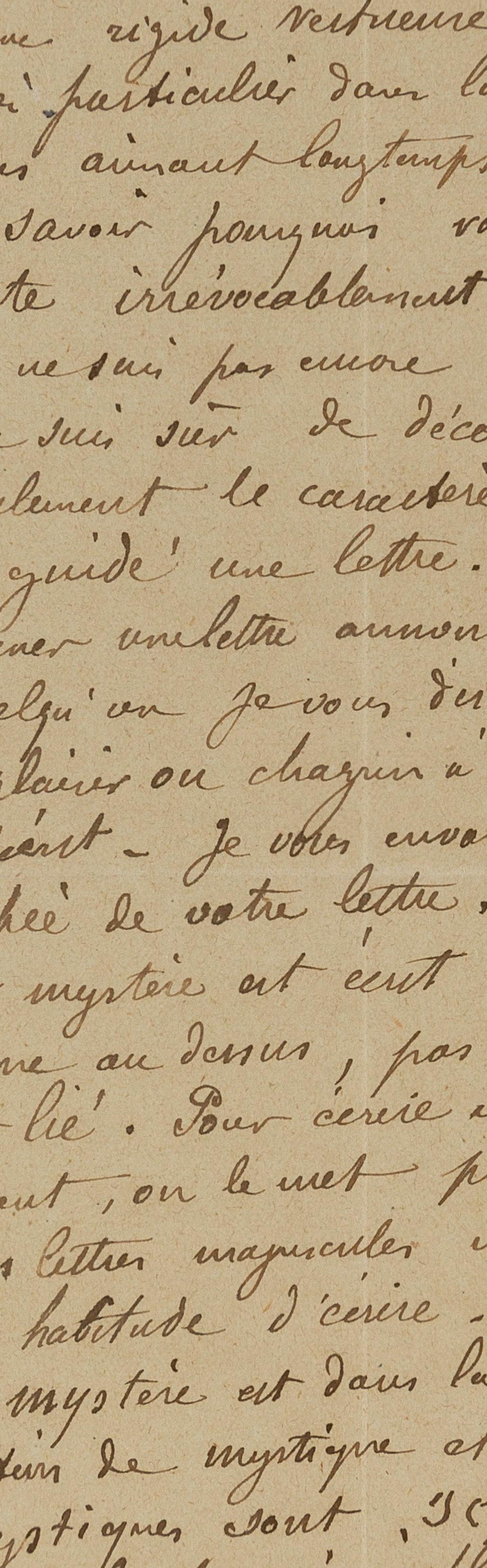
Vente aux enchères
Aguttes Neuilly
164 bis, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine
10 octobre 2023, 14h30
Exposition publique
Jeudi 5 octobre : 10h-13h et 14h-18h
Vendredi 6 octobre : 10h-13h et 14h-17h30
Lundi 9 octobre : 10h-13h et 14h-18h
Mardi 10 octobre : 10h-12h
La vente se continue le 11 octobre à 14h30 par un important ensemble de manuscrits vendus en lots. Consultation obligatoire pour enchérir.
Les conditions et termes régissant la vente des lots figurant dans le catalogue sont fixés dans les conditions générales de vente figurant en fin de catalogue dont chaque enchérisseur doit prendre connaissance. Ces CGV prévoient notamment que tous les lots sont vendus « en l’état », c’est-à-dire dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections et leurs défauts. Une exposition publique préalable à la vente se déroulant sur plusieurs jours permettra aux acquéreurs d’examiner personnellement les lots et de s’assurer qu’ils en acceptent l’état avant d’enchérir. Les rapports de condition, ainsi que les documents afférents à chaque lot sont disponibles sur demande.
The terms and conditions governing the sale of the lots appearing in the catalogue are set out in the general terms and conditions of sale appearing at the end of the catalogue, which each bidder must read. These GTC provide in particular that all the lots are sold “as is”, i.e. in the condition in which they are found at the time of sale with their imperfections and defects. A public display prior to the sale taking place over several days will allow buyers to personally examine the lots and ensure that they accept their condition before bidding. Condition reports, as well as documents relating to each vehicle, are available on request.
Aguttes Neuilly
164 bis, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine
3
detail lot 67
Rendez-vous dès à présent sur aguttes.com pour découvrir la liste complète des lots, les photos et les conditions de vente. Pour toute demande concernant cette vente ou pour laisser vos ordres d’achat, merci de prendre contact avec : Maud Vignon

+33 (0)1 47 45 91 59 • vignon@aguttes.com

4
99
Lot 30 Lot
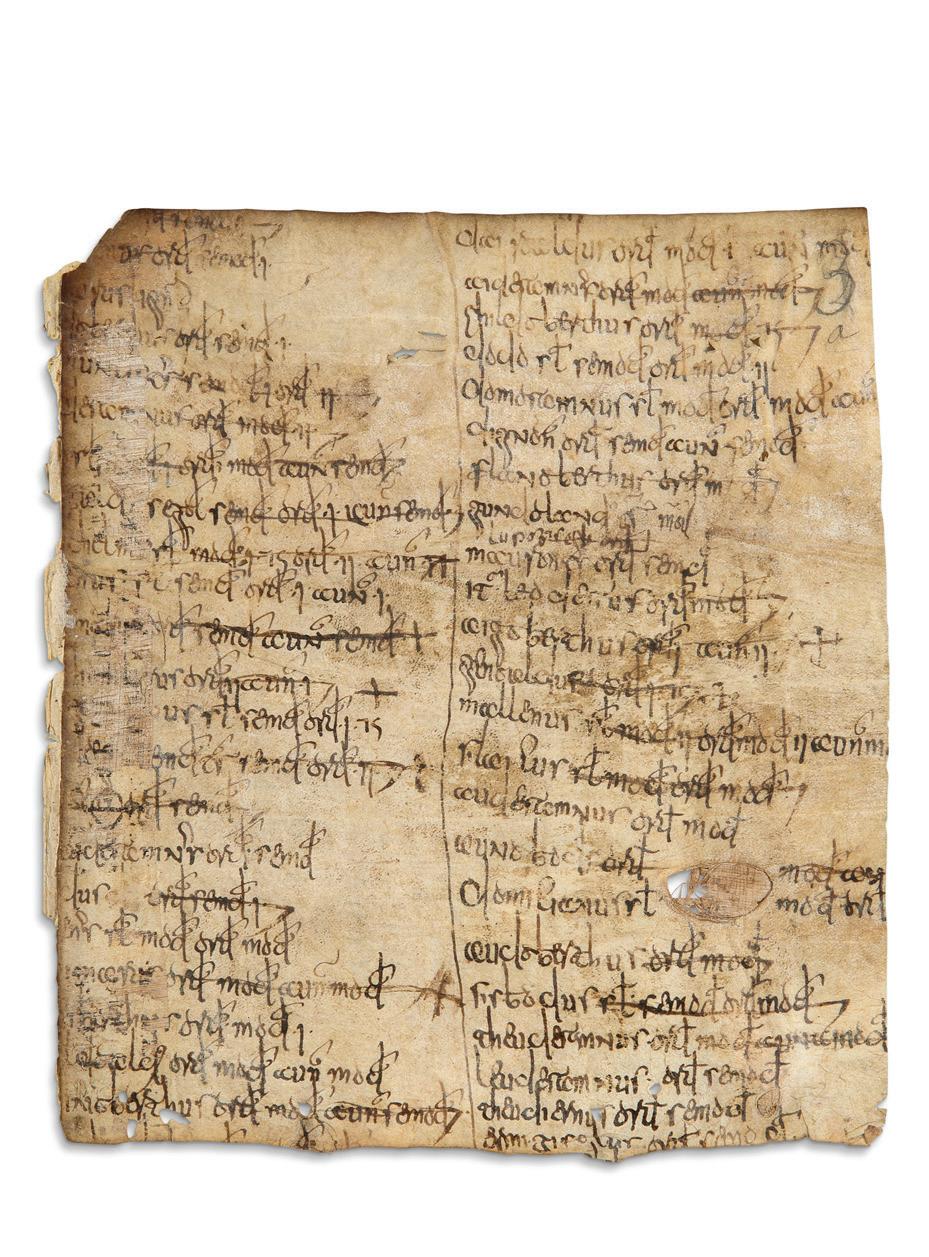

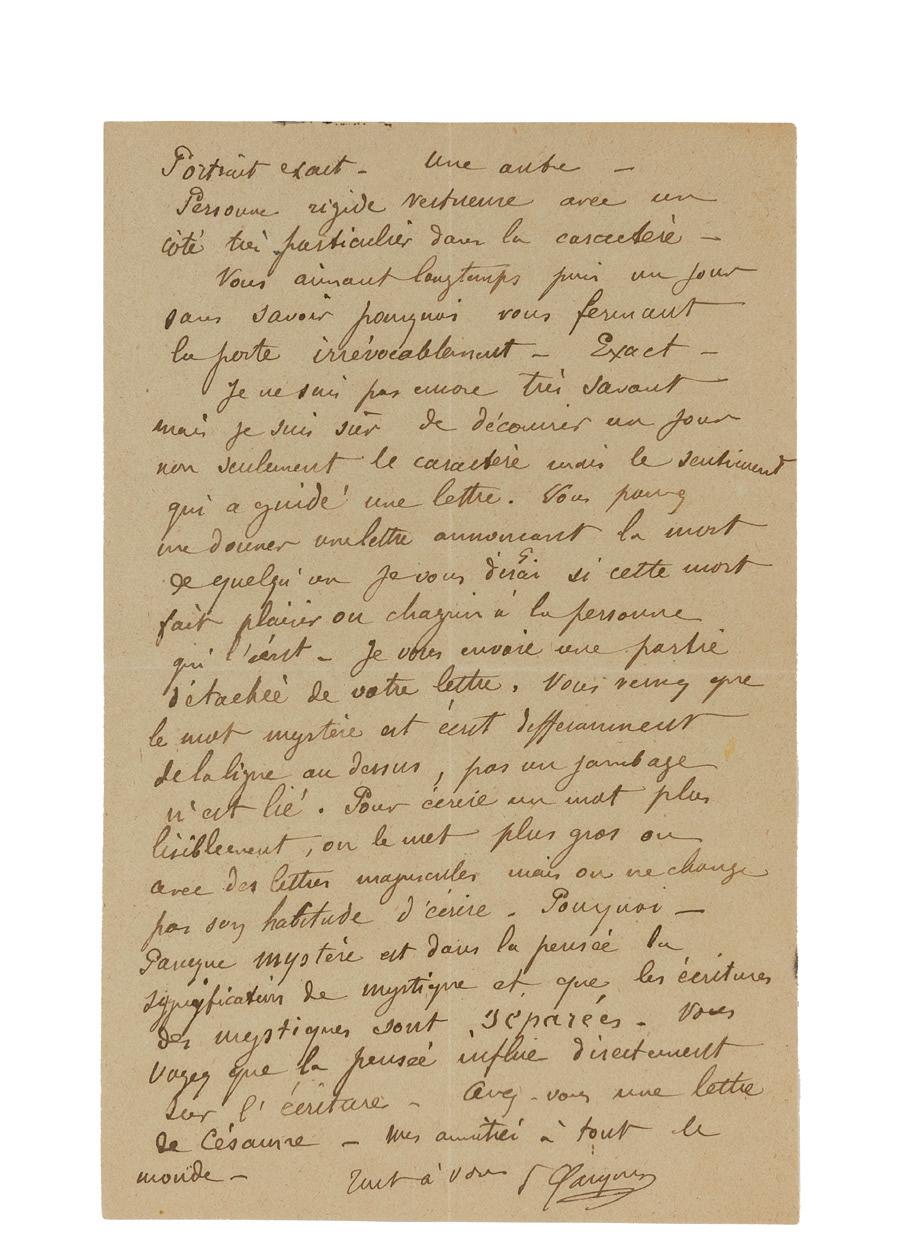

5 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 Lot 127 Lot 156 Lot 55 Lot 67
1
ACADÉMIE FRANÇAISE, XVII e siècle.
CHAPELAIN Jean. 6 L.A.S., Paris 1664 - 1670, à Carlo DATI, à Florence (11 p. in-8 ou in-4). Bel ensemble au secrétaire de l’Accademia della Crusca que Chapelain nomme « Primo Umanista nello Studio Fiorentino ».
PELLISSON-FONTANIER Paul. L.A.S., Saint-Germain en Laye 20 novembre 1670, à l’évêque d’Angers Henri ARNAULD (3 p. in-8). Sur son abjuration du protestantisme et sa conversion au catholicisme. Plus une autre L.A.S. (1675) et un manuscrit autographe
2
ACADÉMIE FRANÇAISE, XVIII e siècle.
LEFRANC, marquis de POMPIGNAN Jean-Jacques. L.A.S., Paris 27 novembre 1760 (4 p. in4). Belle et longue lettre sur la campagne menée contre lui par VOLTAIRE, et sur sa décision de démissionner de l’Académie Française. On joint un manuscrit autographe, Les Travaux et les Jours (cahier de 19 p. in-4), manuscrit de travail d’une traduction d’Hésiode en vers.
THOMAS Antoine-Léonard. 6 L.A.S., 2 L.A. et 1 L.S., Paris 1770 - 1779, au président Antoine Bonnier d’Alco, à Montpellier (10 p. in-4, adresses). Belle correspondance littéraire.
MONTESQUIOU-FÉZENSAC Anne-Pierre, marquis de. 4 manuscrits autographes de poèmes, et une L.A.S., 1771 et s.d. (8 p. in-8 ou petit in-4). On joint 2 lettres de l’abbé de Montesquiou.
DUCIS Jean-François. Poème autographe signé et 7 L.A.S., Paris et Versailles 1786 - 1814 (2 et 14 p. in-4). »… Plus 10 lettres ou pièces relatives à Ducis.
LEBRUN Ponce-Denis Écouchard (1729 - 1807). 7 manuscrits autographes de poèmes (8 p. in-4 ou in-8), dont un sur la suppression de l’Académie. Plus une L.A.S (1763).
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU Nicolas-Louis. 5 L.A.S., 1792 - 1824 (9 p. formats divers, portrait joint), à Dumouriez, Raynouard, N. Lemercier, etc.
GARAT Dominique-Joseph. 10 L.A.S. et 4 L.S., 1793 - 1825 et s.d., à Marmontel, Jarente, Raynouard, Lacretelle, son neveu Maillia-Garat, etc. ; plus une P.S. cosignée par Pache et un décret portant sa griffe (1792), une lettre de son frère Garat aîné, et 2 décrets impr. de la Convention.
DEVAINES Jean. 5 L.A.S., 2 L.S. et un ms autogr., 1771 - 1803.
On joint 8 L.A.S. de Jean-Baptiste DELISLE de SALES, 1807 - 1816, plus un ms autogr. et une note jointe.
ACADÉMIE FRANÇAISE. – GUIBERT Jacques-Antoine-Hippolyte, comte de (1743 - 1790) officier, tacticien et écrivain.
MANUSCRITS autographes pour son Histoire de la constitution militaire de la France depuis la fondation de la monarchie jusqu’à nos jours, [vers 1780] ; 145 pages in-fol. ou in-4.
Important ensemble de manuscrits pour son Histoire de la constitution militaire de la France restée inachevée De cet ouvrage, Guibert n’a écrit que la « Préface » et une « Introduction », recueillies dans les Œuvres militaires publiées par sa veuve, tome V, Œuvres diverses (Magimel, 1803). Les présents manuscrits correspondent aux pages 3 à 176 de ce volume. * Préface (titre et 26 pages en un cahier in-fol.), abondamment raturée et corrigée. Guibert y explique l’histoire de la conception de son ouvrage, et son projet de remonter jusqu’aux Gaules et à la fondation de la monarchie française, pour aller jusqu’à l’administration du prince de Montbarey (1777 - 1780). « Qui je suis ? Un militaire citoÿen, ces deux titres […] doivent supposer de la hardiesse et du courage »... Etc.
* Introduction. Tableau de la décadence de l’empire romain en Occident. Invasion des Gaules. Commencements de la monarchie françoise. 5 cahiers : 2 cahiers in-fol. numérotés « 4 » et « 5 », un cahier in-4 numéroté « 2 et 3 », plus 2 petits cahiers in-4, formant un manuscrit de premier jet de 42 pages in-fol. et 77 pages in-4, abondamment raturé et corrigé. Sur l’Empire romain, admirable par sa constitution, ses routes, ses monuments, son juste partage entre les autorités civile et militaire, sa législation, l’universalité de sa langue, son système militaire, ses soldats aguerris, disciplinés et ayant le sens de l’honneur, quoi qu’en dise Montesquieu… * Plus un dossier de pièces utilisées par Guibert pour sa documentation, et de pièces historiques diverses.
On joint 2 autres manuscrits autographes : * Testament militaire d’un vieux officier général, [vers 1789 ?] ; cahier de 16 pages in-fol. Projet de préface pour un ouvrage militaire, avec de nombreuses corrections et additions.
* Compte rendu à l’assemblée generale par Mrs les commissaires ; 8 pages in-fol. Projet de réforme et de règlement d’une société littéraire, « le Sallon ».
Provenance : Archives du comte de GUIBERT (vente 14 octobre 1993, n° 64, 62 et 68).
400 - 500
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 6
400 - 500 3
-
500
700
4 ACADÉMIE FRANÇAISE. – LAMARTINE Alphonse de (1790 - 1869).
2 L.A.S. « Lamartine », 16 et 27 octobre 1829, à Abel VILLEMAIN ; 3 et 4 pages in-8 (quelques petites fentes).
Lamartine prépare son élection à l’Académie française (il sera élu le 5 novembre 1829).
Au château de Montculot, 16 octobre : « il y a plus que l’admiration dans mes sentiments envers vous. […] Je sens que je devrais être à Paris, aider au moins mes amis dans ce qui me concerne moi-même. Je le sens, je le dis, j’en rougis et je ne puis prendre sur moi d’y aller. L’amour-propre est plus fort que la convenance, je songe au lendemain d’une élection malheureuse, aux condoléances de mes amis, au rire mal voilé de mes adversaires, à la peine de mon père et de ma mère, au ridicule d’aller deux fois avec assurance chercher et raporter un désapointement. […] Mais je prie du moins sur la montagne ». On lui dit que CHATEAUBRIAND ne votera pas pour lui, et que CUVIER votera le duc de Bassano…
27 octobre. « Je crois que si je ne suis pas admis vos quatre lettres me consoleront. Mes descendants diront à l’avenir : regardez il ne fut pas reçu parmi l’élite des hommes de son époque mais M. Villemain jugea leur jugement et le trouva digne d’être son collègue autant que son ami. N’ayez donc pas de souci trop fort de mon élection, si j’ai un échec j’en suis consolé d’avance. [...] La tristesse et l’ennui sont mes deux muses. Qui les connaît mieux que moi ? L’âme se replie en elle-même et ses tortures sont ce qu’on appelle du génie »...
On joint 2 autres L.A.S. , château de Montculot 20 octobre 1829 et s.d., à un duc et à Amédée de Pastoret, sur sa candidature à l’Académie. Plus 3 L.A.S., une lettre dictée et la copie d’une lettre (28 mai 1848).
On joint aussi 2 L.A.S. de Jules SIMON concernant l’Académie, 1861 et 1875 (plus 9 L.A.S. à divers).
5 ACADÉMIE FRANÇAISE. – TROYAT Henri (1911 - 2007).
MANUSCRIT autographe signé « Henri Troyat », Discours de réception à l’Académie Française, 1960 ; 2-127 feuillets petit in-fol. montés sur onglets et reliés en un volume petit in-fol. carré demi-chagrin bordeaux à coins. Manuscrit de travail de son discours de réception à l’Académie française au fauteuil de Claude Farrère
Lev Aslanovitch Tarassov, dit Henri Troyat, a été élu le 21 mai 1959 à l’Académie au fauteuil de Claude Farrère (décédé le 21 juin 1957) ; né à Moscou, il était le premier écrivain d’origine étrangère admis dans cette institution.
La réception eut lieu le 25 février 1960 ; Henri Troyat fut reçu par le maréchal Juin.
Troyat fait part de son émotion en songeant à sa Russie natale, « à la distance qui sépare mon lieu de naissance du lieu où me voici », aux coupoles du Kremlin bien différentes de celle-ci, au petit garçon enfin qu’il était et qui, « fuyant avec ses parents son pays déchiré par la guerre, débarqua à Paris au début de l’année 1920 », pensant qu’il n’y resterait que quelques mois. Il évoque la force qu’eurent bientôt la culture et l’art français sur le jeune immigré qu’il était : « Bientôt la France le saisit tout entier ». Puis il retrace, avec son talent de biographe, la vie et l’œuvre de son prédécesseur Claude FARRÈRE (1876 - 1957), pour conclure : « Pareil aux vieux conteurs arabes qu’il avait rencontrés, Claude Farrère a voulu, jusqu’à son dernier souffle, imaginer des fables et les répandre autour de lui pour notre délassement. À une époque où trop d’écrivains croiraient déchoir s’ils n’apportaient au monde un message politique, mystique, esthétique ou social, il a eu le naïf courage de n’être qu’un romancier. Si certains de ses héros manquent de poids, si une psychologie sommaire les anime, si des péripéties invraisemblables les poussent d’un chapitre à l’autre, l’espèce d’entrain chaleureux que met l’auteur à écrire ses livres lui gagne plus d’une fois la sympathie du lecteur. Que ceux qui jugent sévèrement la littérature dite d’évasion interrogent bien leur mémoire : il n’est personne, ou presque, qui, à un moment de sa vie, n’ait été charmé par un roman, par un conte de Claude Farrère, personne qui, à l’âge des vocations hésitantes, ne lui soit redevable d’une envie de voyage, d’un rêve japonais, turc ou indochinois, d’un élan d’héroïsme ou d’amour, personne dont l’univers intérieur ne porte sa marque, à l’étage des belles illusions de l’adolescence »...
Le manuscrit, de premier jet, à l’encre bleue au recto des pages de bifeuillets, comporte de nombreuses ratures, des passages entiers biffés (souvent au crayon rouge), des renvois et des ajouts sur le verso de la page en regard, et des variantes avec le texte publié (Plon, 1960). Il a été offert au grand bibliophile Jean DAVRAY (1914 - 1985), ami très intime de Troyat, comme en témoigne cette belle dédicace (sur le feuillet suivant la page de titre) : « Pour Jean Davray. Mon cher Jean, tu fus si près de moi tandis que j’écrivais ce discours ! Nous en avons tellement parlé ensemble ! Reçois-en le manuscrit comme gage de mon amitié fraternelle ! Henri le 19 mars 1960 ». Jean Davray a fait relier en tête une belle photo de Troyat jeune, le bulletin de souscription pour son épée d’académicien et 4 cartons d’invitations.
On joint 3 L.A.S., 1954 - 1959, à André MAUROIS ; et une L.A.S. à André Lasseray, 1959 (avec brouillons de Lasseray).
Plus 2 L.A.S. de Paul CLAUDEL relatives à une éventuelle candidature à l’Académie (1927 - 1932).
7 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
300 - 400
500 - 600
ALBUM AMICORUM.
Ensemble de 25 feuillets avec poèmes et P.A.S. de divers écrivains ; 25 feuillets oblong in-4 tirés d’un album, tranches dorées.
Poèmes par Jacques ANCELOT ( Adieux de Lord Byron à Venise, annoté par J. Janin), Émile BARATEAU (Pour Marie, quand elle aura trois ans), Hippolyte BIS (Fragment du Cimetière en vente), Louis BOULANGER (« Il est au fond des forêts sombres »…), Edmond COTTINET (Octobre), Antoni DESCHAMPS (« Dans ce temps d’égoïsme »…), Alexandre DUMAS père (« Vierge à qui le calice à la liqueur amère »…, avec note de Jules Janin), Charles DUPEUTY (« Excusez-moi, je ne vous connais pas »…), Charles-Guillaume ÉTIENNE (extrait de la comédie des Deux Gendres), Ernest FOUINET (Sonnet écrit pour la loterie tirée à l’opéra, au profit des pauvres), Jean-Baptiste de PONGERVILLE (« Si tout périt en nous »…), SAINTE-BEUVE (Sonnet à Madame xxx), Eugène de PLANARD (Prologue inédit de La Belle au Bois dormant, opéra-comique), J.B.A. SOULIÉ ( À la Lune), Alexandre SOUMET (fragment de l’Enfer racheté ), Alfred de VIGNY (L’Esprit Parisien, Sonnet pour la fête de la mi-carême à l’Opéra, au bénéfice des pauvres), Jean-Charles VIAL (« Monsieur de Castignac »… sizain)…
Textes divers par Virginie ANCELOT, Antoine JAY, P.F. TISSOT (Sur la jeunesse de notre temps), Joseph MICHAUD, etc.
7 ALBUM AMICORUM.
Environ 25 lettres, cartes, dessins ou inscriptions autographes ou autographes signés (plus qqs photos), 1911 - 1927, au poète Roger de NEREŸS et aux siens ; in-8, reliure maroquin bordeaux, tranches dorées, étui (qqs mouill.). R. de NEREŸS, Jules MASSENET, Henri de RÉGNIER (quatrain), Louis BARTHOU, Jean RICHEPIN (poème), Édouard SCHURÉ (vers), Sarah BERNHARDT (avec fleur séchée), Henri BERGSON (maxime), Antoine CALBET (dessin), Vincent d’INDY (extrait de Fervaal ), Pierre CARRIER-BELLEUSE (dessin), CAROL-BÉRARD (9 mesures de sa Symphonie des forces mécaniques), Han RYNER, Jean de BONNEFON, H. de CALLIAS (dessin aquarellé), Jean de GOURMONT, Émile BOURDELLE (belle L.A.S. ornée de 2 aquarelles, 1921, au sujet de ses Peintures pour la Reine de Saba), Francis VIELÉ-GRIFFIN (poème, Transposition), Raoul GUNSBOURG, J.-C. MARDRUS, etc.
8 ALEXANDRE I er (1777 - 1825) Tsar de Russie.
L.S. « Alexandre », Sarskoe Selo 8 octobre 1821, à « Votre Altesse Royale » (le Prince EUGÈNE DE BEAUHARNAIS) ; 2 pages in-4 ; en français.
Le Tsar n’a pu répondre à la lettre du 26 juillet (lui parlant sans doute de la mort de Napoléon qui fut connue seulement à cette époque en Europe). Alexandrevoue à Eugène « un trop sincère attachement pour ne pas ressentir une vive peine de son affliction [...] Le vœu dont Votre Altesse Royale m’entretient [...] honore Ses sentimens, et il seroit impossible de n’y pas trouver une nouvelle preuve des qualités de Son cœur. Il me semble néanmoins que dans cette occasion les affections, quelques vives qu’elles soient [...] devraient céder aux calculs de cette prudence qui a toujours marqué la conduite de Votre Altesse Royale. Je crois donc que sous tous les rapports il seroit préférable qu’elle renonçât à Son désir. Dans les temps où nous vivons, la malveillance est si active, ses interprétations sont si perfides et si fausses, qu’on ne saurait mettre trop de soins à s’abstenir de toute démarche dont elle pourrait s’emparer »...
9 ALEXANDRE II (1818 - 1881) Tsar de Russie.
L.A., S.P. [Saint Petersbourg] 7/19 janvier 1868, à Catherine DOLGOROUKI, « Katia » ; 4 pages in8. Lettre d’amour à sa maîtresse
Il lui reproche de lui faire une scène, et il a la mort dans l’âme. Il cite longuement la lettre de Katia, et ajoute : « Après tout cela je te laisse juger toi même ta conduite, envers l’être qui vit et ne respire que par toi ». Il ne peut lui en garder rancune, car il l’aime « plus que la vie […] je veux que tu viennes, car ce serait par trop vilain de ta part de me priver du bonheur de te revoir et comme preuve, que tu ne gardes rien sur le cœur, je te supplie, quand tu m’apperceveras, de toucher de ta main ton médaillon au cou et moi en réponse je toucherai ma croix de St George. Tu me rendras la vie par là »…
10
ANDERSEN Hans Christian (1805 - 1875).
POÈME autographe signé « H. C. Andersen », Stuttgart 2 octobre 1860 ; 1 page oblong in-8 (montée sur carte ; un peu jaunie, avec traces de montage) ; en allemand.
Tercet en allemand
« Die Vernunft in der Vernunf[t] ist das Wahre. Die Vernunft in den Willen ist das Gute, Die Vernunft in der Phantasie ist das Schöne ! »
Ce qui compte c’est la raison dans la raison. Ce qui est bien c’est la raison dans la volonté, Ce qui est beau c’est la raison dans la fantaisie !
1 000 - 1 500
1 500 - 2 000
1 500 - 2 000
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 8 6
800 - 1 000
800 - 1 000
11 ART CANANÉEN.
Plaquette (élément de mobilier) sculptée en léger relief dans un encadrement.
« Dame à sa fenêtre » : tête féminine parée d’une lourde perruque égyptisante dégageant les oreilles et surmontant une balustrade soutenue par quatre colonnettes. Il s’agit probablement d’une représentation de la déesse Astarté-hor. Ivoire.
Dépôt calcaire. Restaurations.
Art Cananéen, IXe -VIII e s. av. J.C. 7,3 x 5,8 cm.
Des plaquettes similaires sont conservées au Musée du Louvre et au British Museum, provenant des sites d’Arslan Tash et Nimrud.
Provenance : vente Piasa 17 mars 2003.
CITES N°FR2309200222-K
12 ARTS.
6 L.A.S. de peintres adressées à Jacques LASSAIGNE, par André BEAUDIN (2), Geneviève CLAISSE, François DESNOYER, Jean LE MOAL, Francis TAILLEUX ; plus un tapuscrit corrigé, Francis Gruber vu par Francis Tailleux
Robert DOISNEAU. « La voiture de Tabou décolant devant l’église Saint Germain », photographie de Robert DOISNEAU. Exceptionnel tirage argentique d’époque, photomontage représentant le peintre Yves CORBASSIERE au volant de la célèbre voiture du Tabou. Signé au dos du cachet timbre humide de l’artiste, titré au crayon par sa main et daté de 1947 (23,5 x 27 cm). Probablement un tirage unique. Photo originale pièce N° 2494. Plus un dessin de danseuse par Hubert YENCESSE (31,5 x 23,5 cm).
13 APOLLINAIRE Guillaume (1880 - 1918).
L.A.S. « Guillaume Apollinaire », Paris « 15 rue Gros » 5 septembre 1910, à Pierre LAFITTE ; 3 pages in-8.
Belle lettre au directeur de la revue Excelsior
Il rappelle sa « qualité d’ancien collaborateur de la Revue Blanche », et pense qu’il n’est pas un inconnu pour l’éditeur. « Depuis la Revue Blanche, j’ai beaucoup travaillé et je crois avoir fait des progrès sensibles. C’est pourquoi je pense pouvoir être utile à un journal qui consentirait à insérer régulièrement mes productions littéraires ». La réussite de sa démarche auprès de Lafitte « est pour moi de la dernière importance et me délivrerait de mille soucis, de toutes les difficultés qui embarassent ma vie » ; et il attend avec confiance une réponse favorable. Il annonce la parution à la fin de septembre chez Stock d’un « livre [L’Hérésiarque et Cie] où vous retrouverez les nouvelles qui ont eu l’honneur de paraître dans la Revue Blanche. C’est M. Élémir Bourges qu a eu l’extrême bonté de chercher un éditeur pour ce livre et obtenir des conditions excellentes »…
14 APOLLINAIRE Guillaume (1880 - 1918).
MANUSCRIT autographe, Avertissement ; 2 pages in-12, sur des bulletins de demande de livres à une bibliothèque [Bibliothèque Mazarine], quelques ratures et corrections.
Notice pour une édition du « roman célèbre de Bernard de Trévies », L’histoire de Pierre de Provence et de la belle Maguelonne : « L’édition que nous avons suivie est une des plus anciennes et peut-être même la plus ancienne. C’est un petit in-folio gothique », probablement antérieur à 1490… « on ne doute pas que le lecteur instruit ne trouve un délicat plaisir à lire l’histoire des amours de Pierre, fils du comte de Provence et de la belle Maguelonne, fille du roi de Naples. Ces deux parfaits amants dont les aventures ont été traduites en flamand, en grec vulgaire, en castillan, en catalan, en allemand, en danois et en polonais, méritent encore aujourd’hui de retenir l’intérêt des gens de goût ».
9 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
800 - 1000
200 - 300
1 000 -
1 200
1 000 - 1 500
ARAGON Louis (1897 - 1982).
MANUSCRIT autographe signé « Aragon », Une histoire contemporaine : Claude-André Puget, [1947] ; 22 pages et demie in-4 (quelques bords légèrement effrangés).
Préface pour le recueil de poèmes de Claude-André PUGET (1900 - 1975), La Nuit des temps (Clairefontaine, 1947).
« D’où naît le chant, et qui est le chanteur ? Qu’est-ce que c’est que cette murmurante folie dans un jeune homme, qui s’éveille... Qu’est-ce que c’est que cette musique en lui, ce besoin de la communiquer aux autres par des arrangements de mots, arbitraires sûrement, arbitraires... On dit c’est un poète ; il fait des vers... […] Ce siècle est un puits profond et noir, et si je me penche à la margelle, que de choses inexplicables au tréfond ! […] Un poète aussi est la créature du temps. [...] Il se croit libre, il invente sa romance, il avance et se met à chanter. [...] comment sont les poètes cingalais, ou ceux de Carcassonne ? Les uns écrivent pour les yeux, et d’autres ne sont que voix, et j’ai connu des poètes de l’absence, qui prenaient leur grandeur de ce qu’ils ne disaient pas. […] C’est vers 1920, à dix-sept ans, à Nice, […] que Claude-André Puget écrivit les premiers poèmes qui nous sont parvenus de lui ! ».... Arago parcourt alors l’œuvre poétique de Puget, depuis son premier livre Pente sur la mer… « C’est une poésie de la chute. C’est pourquoi elle méprise les tambours, la rime. Chose extraordinaire qu’un chant qui n’est chant que d’être retenu. Ce jeune homme que nous entendons encore, quel trouble exprimait-il donc, quel trouble à ces poèmes commun, quelle tristesse si différente des plaintes du temps de la Pléiade ou de cette nostalgie de Lamartine qu’on aurait cru, le prenant au mot, même à vingt ans, toujours sur le point de mourir ? […] Je ne parle pas d’influence : je constate les analogies du chant sur une assez courte période de la poésie française, comme si dans un temps donné les chanteurs ne pouvaient sortir de certaines règles informulées, d’un certain cadre vocal, où le chant se plie à des traditions neuves, aussi exigeantes que celles du sonnet ou de la sextine. J’aime ces premiers livres où les hommes très jeunes livrent d’eux-mêmes plus qu’il ne paraît »… Etc. Aragon continue à explorer et commenter les divers recueils de Puget, faisant de nombreuses citations, pour terminer par La Nuit des temps : « Oui, nous sommes à une charnière du siècle, à un seuil de l’aventure humaine, et à ce lieu de passage il faut savoir lire aux variations de la poésie les variations de l’homme. J’ai suivi pas à pas ce poète pendant vingt années, et il pouvait ne sembler suivre que sa rêverie, mais je sais cependant que comme les reflets d’un incendie sur les nuages, ces variations du rouge au noir par le rose venaient d’un brasier extérieur et lointain. Rien n’est arbitraire dans la poésie, bien qu’on en pense. Et c’est à ce moment seul où la voix du poète semble dans la réalité se perdre, qu’elle chante enfin, qu’elle emplit le cœur de sa musique, et les yeux de larmes, à ce moment où la poésie avec le destin de l’homme se confond, dans La Nuit des Temps »…
16 AUERBACH Berthold (1812 - 1882) écrivain allemand.
MANUSCRIT autographe signé, Lederherz ; et 26 L.A.S., 1862 - 1881, à Ignaz ELLISSEN ; 13 pages in-4 (plus un feuillet de dédicace ; qqs légers défauts), et 49 pages in-8, plusieurs à son chiffre ou à son nom, qqs enveloppes ; en allemand.
Très bel ensemble de l’auteur des Schwarzwälder Dorfgeschichten ( Récits villageois de la Forêt Noire) Le manuscrit, sur papier bleuté, sans autre correction qu’une addition marginale, est daté en fin de Berlin 6 février 1862. Il est dédié sur un feuillet liminaire à son ami Ignaz Ellissen. Lederherz (Cœur de cuir) est sous-titré « Aus den Erinnerungen des Pfarrers vom Berge » (des souvenirs du pasteur des montagnes), et a été publié anonymement par Auerbach dans ses Deutsche Blätter. Beilage zur Gartenlaube (N° 261, p. 81-85), éditées par Auerbach de 1862 à 1864, comme a bien voulu nous l’indiquer M. Eberhard Koestler. Lederherz (Cœur de cuir) est l’histoire d’un pauvre colporteur juif en Alsace, qui vend du cuir ; son surnom vient des pièces de cuir qui couvrent les coudes de sa redingote ; il est l’ami du cordonnier Lipp, très versé dans l’étude de la Bible, qui l’aidera à mourir religieusement. Ce texte est marqué par les idées de tolérance politique et religieuse, et par l’amour de l’humanité. Nous en citons le début : « Wahre Menschenfreundlichkeit zeigt sich darin, dass wir jedem Mitlebenden, der uns ungekannt und flüchtig begegnet, die gemeinsam gegebenen Augenblicke mit Gutem zu erfüllen trachten. Die wahre Menschenliebe bethätigt sich darin, dass wir den Gedanken der Zusammengehörigkeit festhalten, auch da, wo wir den Widerspruch und Gegensatz vor Augen haben. Nur wenn wir uns liebevoll gegen Menschen anderen Glaubens, anderer Überzeugung bewähren, nur dann haben wir das Recht, uns Bekenner der Religion der Liebe zu nennen »...
C’est à Ignaz ELLISSEN, habitant Frankfurt am Main, qu’est adressée l’importante correspondance littéraire et amicale, commençant le 9 janvier 1862 pour s’achever le 8 mars 1881. La plupart des lettres sont écrites de Berlin ; pendant les vacances de 1863, Auerbach séjourne à Cannstatt près Stuttgart (août), à Heiden dans le canton d’Appenzell (septembre)… Auerbach a joint à deux de ses lettres de 1862 des lettres reçues des professeurs B. Frankfurter et Russ. Cette correspondance est complétée par la copie ancienne de 5 lettres manquant à l’ensemble, comme l’explique une lettre jointe de l’exécuteur testamentaire d’Ellissen, transmettant l’ensemble en 1884.
3000 - 3500
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 10 15
1 500 - 2 000
17 BALZAC Honoré de (1799 - 1850).
L.A.S. « de Balzac », 8 octobre [1831], à l’imprimeur-lithographe Charles MOTTE ; 2 pages in-8, adresse (pli central du bifeuillet fendu).
Belle lettre accompagnant l’envoi des Romans et contes philosophiques
« Mon cher Monsieur Motte, je n’ai pas perdu le souvenir des obligations que j’ai contractées envers vous. Vous m’avez donné de charmantes lithographies et je vous promis de vous faire des articles. Ils n’ont point été faits et cette conduite constituerait une sorte d’indélicatesse très éloignée de mon caractère ; mais la Mode a changé de maîtres à cette époque ; je me suis brouillé avec le Tems ; et les occasions de vous servir n’ont pas répondu au désir que j’en avais. Voilà l’histoire de mon manque de soin apparent ; perdonate mi ». Il n’a pas osé demander le prix de l’album (de lithographies) qu’il a reçu de Motte : « voulez-vous me permettre de vous offrir un échange de nos productions ; échange auquel vous perdrez ; mais au moins avec le tems, la quantité de mes produits finira peut-être par équivaloir à la qualité des vôtres et ma conscience sera plus tranquille. Maintenant permettez-moi d’ajouter sérieusement que je vous offre mon livre comme un témoignage de notre ancien voisinage, et comme une marque de profonde estime pour vous qui n’êtes pas le moindre artiste parmi ceux dont vous traduisez les œuvres »... [Motte avait son atelier rue des Marais-Saint-Germain (actuelle rue Visconti), où Balzac avait aussi son imprimerie, de 1826 à 1828.] Balzac ajoute en post-scriptum : « Il va sans dire, qu’aussitôt que par une position journalistique je pourrai vous être utile, vous n’aurez qu’à demander. Pour le moment, je serais en mesure à l’Artiste et j’ai des amis au Messager ».
18
BALZAC Honoré de (1799 - 1850).
L.A.S. « de Balzac », 22 mai [1833, à Émile DESCHAMPS] ; 1 pages et demie in-8 sur papier fin. Belle lettre, en partie inédite, sur les Contes drolatiques
[Le « premier dixain » des Contes drolatiques avait paru chez Gosselin en avril 1832, et le second allait paraître chez le même éditeur en juillet 1833. Balzac complimente Deschamps sur son conte « physiologique » René-Paul et Paul-René qui venait de paraître dans le tome III du Livre des conteurs.]
Il envoie ses remerciements à Deschamps « pour la bonne fortune que vous m’avez donnée. J’avais déjà lu, en voyage, alléché par votre nom, les Deux Frères que je viens de relire en rentrant dans mon bouge parisien – et cette ravissante aventure, pleine de poësie m’avait si fort frappé que je désirais la relire. Par le déluge de contes dont nous sommes inondés, votre Paul, cet être double, est une de ces créations destinées à demeurer dans toutes les mémoires artistes. Mais j’aurais voulu plus de détails, non pas un conte, mais une histoire, un livre, comme Paul et Virginie, gourmand que je suis ! mais vous êtes parti pour faire un conte et sans le savoir ou le sachant sans doute, vous avez été plus loin, comme tous les esprits qui (passez moi cette trivialité,) agrandissent toujours le trou par lequel ils passent parce qu’ils sont grands. […]
Pour n’être pas insolvable moi-même j’espère pouvoir vous envoyer d’ici à qlq. jours le 1er et le 2e dixain des Contes drolatiques, et si, par hazard, je vous avais envoyé le 1er dixain, faites le moi savoir, car Gosselin est avare comme un libraire, et me mesure l’exemplaire comme Dieu mesure le vent aux brebis tondues. Je voudrais que cet échange de nos produits coloniaux me valût encore un livre de vous, trop paresseux poëte qui rêvez sans doute vos livres et ne les écrivez pas, en sultan jaloux de votre sérail intellectuel ».
[Émile Deschamps répondit à Balzac le lendemain : « Je garderai toute ma vie de ce monde votre lettre qui est une lettre de noblesse pour moi. C’est un titre de famille dont j’ai le cœur et le front triomphants »…
19
BALZAC Honoré de (1799 - 1850).
L.A.S. « Honoré », [Sèvres, aux Jardies 3 juin 1839], à Madame DELANNOY ; 1 page in-8, adresse.
Balzac raconte sa chute dans sa propriété des Jardies
« Ma chère madame Delannoi, il vient de m’arriver un petit accident assez déplorable, je me suis foulé le tendon d’Achille et les nerfs qui envellopent la cheville, dans une chute sur un terrain glissant et je suis condamné à demeurer au moins dix jours au lit, à la campagne sans pouvoir bouger sous peine d’être blessé pour le reste de mes jours, ainsi point de mercredi ! pardonnez moi d’être si malheureux, c’est arrivé bien à contretemps pour mes affaires. un de vos enfants Honoré ».
3 000 -
2 500 - 3 000
1 000 - 1 200
11 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
Correspondance (Bibl. de la Pléiade), t. I, p. 413, n° 31-103. 4 000
Correspondance (Pléiade), t. I, n° 33-84, p. 796.
Correspondance (Pléiade), t. II, n° 39-103, p. 493.
20
BARRE Auguste et Albert (1811 - 1896 et 1818 - 1878).
9 CARNETS de DESSINS ; 9 carnets oblong in-12 (8 x 12 à 8,5 x 14,5 cm), couvertures cartonnées, toilées ou maroquinées, les carnets inégalement remplis, principalement à la mine de plomb.
Carnets de croquis et dessins des deux frères, sculpteurs, dessinateurs, graveurs et médailleurs . Des archives de la dynastie BARRE, derniers graveurs généraux et indépendants à l’Hôtel des Monnaies de Paris et en France à statut privé.
3 carnets d’Auguste. – Groupe « 1832 Mme Tremyn et sa fille », ornements et éléments décoratifs, têtes de femmes et de Cérès, projet de médaille de la République française, esquisses d’orateurs (dont Odilon Barrot), bijou… – Tête de pape, esquisse de la statuette de Rachel, mère donnant la bouillie à un enfant, broderie, poignées de glaive… – Feuilles de vigne, amours, barque en construction, enclume et outils, emblèmes pontificaux…
6 carnets d’Albert . – Notes autographes (scènes historiques, recette de fixatif), esquisses de vignettes ou tableaux (sujets antiques ou religieux, scène de jeunesse de Diderot, Jean-Jacques Rousseau…), aigle impériale, une femme dans un intérieur, mobilier… – Esquisse de femme à la sanguine, plans d’un appartement. – Brèves notes de voyage en Italie (côte amalfitaine, 1844) ; têtes et statues antiques ; signes du zodiaque ; vues de Paestum et Sorrente… – Notes de voyage à Gand et Bruges, comptes (1847) ; sujets de tableau ; un fauteuil ; études de têtes et de costumes ; paysage ; ornements et éléments décoratifs… – Vues de Saint-Malo et de rochers, croquis au Mont Saint-Michel… – Recettes pour bronzer le cuivre, souder l’étain ou l’acier, faire « la colle au fromage » (3 photos de statues jointes, dont la princesse Mathilde).
On joint 21 lettres adressées à Albert BARRE, 1858 - 1880, par José de Araújo Ribeiro, A. Brochon (avec d’autres membres de la Société de progrès de l’Art industriel), le général Malherbe, Ch. Masset, Natalis Rondot (3), JeanLouis Ruau, Henry Uhlhorn (3), F.G. Wagner jeune, Bronislaw Zaleski, etc. ; la minute a.s. d’une lettre d’Albert Barre à Hainol, directeur de la Monnaie de Munich ; plus la minute d’une lettre de son père Jean-Jacques Barre (et 4 lettres à lui adressées).
21
BAUDELAIRE
Charles (1821 - 1867).
L.A.S. « Ch. Baudelaire », [Paris, vers le 16 février 1860, à l’écrivain Philoxène BOYER] ; 1 page in-8 avec ratures et corrections.
« Ayez l’obligeance, cher ami, de laisser ici pour moi une note-catalogue des différents ouvrages écrits sur la Vénus de Milo. GUYS m’écrit de Londres à ce sujet. Je crois qu’il veut écrire une brochure, un article, illustré de dessins représentant les hypothèses, c’est-à-dire la Vénus restaurée selon les différentes imaginations des auteurs »…
[Baudelaire éprouvait une vive admiration pour le talent du peintre Constantin GUYS dont il fit l’éloge dans Le Peintre de la vie moderne. Il mit en contact Guys avec plusieurs auteurs au sujet de ce projet autour de la Vénus de Milo, mais aucun ne convint à l’artiste. Baudelaire appréciait également Philoxène BOYER, auteur de pièces dramatiques et de vers, pour sa grande culture et les banquets littéraires qu’il organisait.]
Correspondance, Pléiade, t. I, pp. 671 - 672.
22 BAUDELAIRE Charles (1821 - 1867).
L.A.S. « CB », 6 janvier 1863, à POULET-MALASSIS à la maison d’arrêt des Madelonnettes ; 1 page et demie in-8, adresse, marque postale, trace de cachet cire rouge. Lettre à son éditeur emprisonné
[Poulet-Malassis est alors détenu et en attente de procès pour ses agissements républicains.]
Baudelaire vient de dîner avec un ami [probablement Charles Asselineau] dont la jambe va mieux et qui pense, comme lui, que le fameux cadeau de Poulet-Malassis est une idée tout à fait absurde... Puis il donne quelques nouvelles de la vie artistique et littéraire parisienne : Théophile GAUTIER quitterait Le Moniteur et recevrait des fonctions aux Beaux-Arts, le comte de Nieuwerkerke [alors directeur des Musées impériaux] irait au Sénat « et M. DELACROIX prendrait la direction des Musées. [...] Enfin, pour comble d’absurdité, F. Desnoyers prétendait hériter de d’AUREVILLY au Pays. Mais son ami Ulysse Pic, devenu directeur du Pays, n’a pas cru pouvoir oser cela »...
BEETHOVEN Ludwig van (1770 - 1827).
Cinq éditions anciennes de Sonates pour piano.
Grande Sonate pour le Clavecin, ou Fortepiano… Œuvre XXVI [Op.26] (Leipzig, Bureau de musique, [ca 1802]),
19 pages, cotage 118 [Hoboken 136]. Première édition allemande, quasiment contemporaine de la première édition à Vienne chez Cappi.– Sonata quasi una Fantasia… Op.27 n° 2 [« Clair de lune »] (Vienna, Cappi, [ca 1806]), 15 pages, cotage 879 [Hoboken 144] (sous chemise verte toilée, marges un peu froissées et déchirées). – Trois Sonates pour le Piano-forte, Op. 31, n os 1-3, « Edition tres Correcte. Prix 6 francs » (Bonn, Simrock, [1803 - 1804]), 65 pages (renumérotées à l’encre, coin réparé au dernier f.), cotage 345 [cf Hoboken 171 - 172]. – Sonate für das Piano-Forte, Op.110 (Wien, Cappi & Czerny, [ca1826]), 15 pages, cotage N° 2500. – Deux Sonates pour le Pianoforté et Violoncell... Op.102 Liv[raison] 1 [Sonate pour violoncelle op.102, n° 1] (Bonn: Simrock, [1817]), cotage 1337, en partition, sans la partie séparée de violoncelle, première édition [Hoboken 423]
1 000 - 1 500
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 12
300 - 400
1
23
1 200 -
500
600 - 800
24
BEETHOVEN Ludwig van (1770 - 1827).
Messa a quattro Voci coll’ accompagnamento dell’ Orchestra… Drey Hymnen für vier Singstimmen mit Begleitung des Orchesters… 86 s Werk (Leipzig, Breitkopf & Härtel, [1812]) ; un volume oblong in-fol. (26,5 x 35 cm) de 107[1] pages, couverture d’origine sur papier bleu-gris (le plat sup. imprimé Messe von L. v. Beethoven, avec prix ms), sous cartonnage ancien (petites déchirures marginales réparées p. 71-74, tache d’encre marginale à partir de la p. 59, quelques trous infimes, fente marginale à la p. 106 ; cachets de possession ; cartonnage usagé et dos usé).
Rare première édition de la Messe en ut, la première des deux Messes de Beethoven Édition gravée, chaque planche portant le n° de cotage 1667. [Hoboken 374]. Dédiée au Prince von Kinsky, elle est divisée en trois parties titrées « Erster [Zweyter, Dritter] Hymnus » (pp. 3, 39, 71).
État original des pp. 92-93 (début de l’Agnus Dei ) ; « Anmerkung » pour la p. 71 au verso de la p. 107.
25 BEETHOVEN Ludwig van (1770 - 1827).
[Ouverturen]. Recueil de cinq premières éditions, [1823 - 1838] ; 5 partitions in-fol. (32,5 x 24,5 cm) reliées en un volume, reliure ancienne dos percaline vert bronze avec titre doré et orné.
Premières éditions de cinq Ouvertures en partition d’orchestre
Musique gravée. Cachets encre sur les pages de titre A. Le Lièvre et Musis Sacrum 1828
Ouverture zu Aug: v: Kotzebue’s Ruinen von Athen, Op. 113 (Wien, S.A. Steiner und Comp., [1823]) ; 26 pages, cotage S: u. C: 3951, [Hoboken 469]. – Grosse Ouverture in C. dur [ut], Op. 115 [« Jour de fête »] (Wien, S.A. Steiner & Comp., [1825]) ; 43 pages, cotage S: u. C: 4682, [Hoboken 475]. – Grosse Ouverture (in Es) zu König Stephan, Op. 117, 2e éd. (Wien, Tobias Haslinger, [1828]), 48 pages, cotage S: u. C: 4691, [Hoboken 479]. – Ouverture en Ut à grand orchestre, Op. 124 [« Die Weihe des Hauses »] (Mayence, B. Schott Fils, [1825]), 60 pages, cotage 2262 (manque la liste des souscripteurs) [Hoboken 498]. – Ouverture in C. componiert im Jahre 1805 zur Oper Leonore, Op. 138 [Leonore I] (Wien, Tobias Haslinger, [1838]), titre gravé décoré, 48 pages, cotage T.H. 5141 [Hoboken 537].
26 BELLMER Hans (1902 - 1975).
L.A.S. « Bellmer », Revel [vers 1946], à René MAGRITTE ; 2 pages in-4. Longue lettre dans laquelle Bellmer évoque les pamphlets de Magritte « Votre lettre et celle qui m’est parvenue parallèlement d’Eliane m’ont fait un plaisir immense : si je ne vous ai pas répondu de suite [...] c’est que ma vie a subi une modification totale et bouleversante. Ceci et, encore, un travail pour lequel je n’étais pas outillé (eaux-fortes) – déménagement etc. ne m’ont pas laissé de répit [...] Parmi vos tracts et publications qui me sont parvenus par l’un ou par l’autre chemin, c’est particulièrement celui qui porte le titre l’enculeur qui me paraît efficace et essentiel comme une bonne potion d’acide nitrique »… [La plupart de ces pamphlets particulièrement virulents, dirigés contre le gouvernement belge, avaient été confisqués par la poste]. « Dès la “libération”, j’avais proposé à un ami fidèle Brun de faire imprimer des feuilles qui, pliées en quatre, rentreraient facilement dans les enveloppes habituelles. Nous étions trop isolés, trop emmerdés et trop chargés de travail quelconque pour les réaliser ». Mais il ajoute avoir « l’intention de faire un petit tract de ce modèle sur ce que l’on a pas dit pendant et depuis cette guerre : la glorification froide et nette de celui qui n’a pas marché (déserteurs, objecteurs de conscience, résistants etc.) – et il y en a qui ont payé cher le maintien de cette position [...] Brun vient de me dire que vous insérez mes “lettres d’amour” dans ce “savoir vivre” [...] Ces lettres d’amour sont extraites d’un livre : Petite anatomie de l’inconscient physique qui doit paraître – comme suite des Jeux de la Poupée mais il en manquent deux, dont une sera une lettre de haine »…
27 BIZET Georges (1838 - 1875).
Carmen. Opéra Comique en 4 actes Tiré de la nouvelle de Prosper Mérimée. Poème de H. Meilhac et L. Halévy. Musique de Georges Bizet (Paris, Choudens Père et Fils, s.d. [1875]). In-4 de (4)-351 pp. (titre lithographié, catalogue des morceaux et musique imprimés) ; reliure demi-basane fauve à coins (fortes rousseurs, accidents aux premier et dernier feuillets, réparations, plats frottés).
Rare édition originale de Carmen (partition pour chant et piano)
Bibl. : James Fuld, The Book of World Famous Music, 4 e éd (New York, 1995, p. 585) ; Hugh Macdonald, The Bizet Catalogue (en ligne).
13 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
600 - 800
600 - 800
500 - 600
1 000 - 1 200
29
BLANC Louis (1811 - 1882).
L.A.S. « Louis Blanc l’un des deux rédacteurs en chef du Bon Sens », Paris 10 février 1836 : 2 pages in-4 à en-tête
Le Bon Sens, journal de la démocratie
« Nous n’accordons à personne le droit de révoquer en doute notre sincérité et de nier notre patriotisme. Celui qui vous répond écrit dans le Bon Sens depuis plus de deux ans. Et il sait le cas qu’on doit faire des reproches qui portent sur la versatilité de ce journal demeuré scrupuleusement fidèle à son origine. […] le Bon Sens est celui de tous les journaux qui s’est imposé pour le peuple le plus de sacrifices et qui a apporté le plus d’abnégation dans son œuvre de propagande ». Il rejette comme une insulte l’accusation de patriotisme de la Bourse, alors qu’il reçoit des lettres de soutien « de patriotes qui sont ouvriers aussi […] Et certes au lieu des travaux, des fatigues, des chagrins de tout genre auxquels nous expose la défense d’une cause sainte, il est consolant pour nous d’acquérir de plus en plus cette conviction : qu’il n’en est pas de la reconnaissance des Peuples comme de la reconnaissance des rois »…
On joint 3 L.A.S. par E.X. Poisson de LA CHABEAUSSIÈRE (1811, à Stanislas Champein), LAMOTHE-LANGON (1830, à M. Sclesinger) et SULLY-PRUDHOMME (1896).
BONAPARTE Joseph (1768 - 1844) frère aîné de Napoléon, Roi de Naples puis d’Espagne.
MANUSCRIT autographe, Mon Brouillon de la lettre sur l’histoire de M. de Norvins. – Réponse à M. de Norvins, Philadelphie janvier 1829 ; 25 pages in-4
Brouillon d’un article adressé aux rédacteurs du Courrier des États-Unis pour réfuter les erreurs de l’Histoire de Napoléon du baron de Norvins
Sous couvert de l’anonymat, l’auteur se donne comme l’interlocuteur privilégié du comte de Survilliers, ayant consulté des pièces originales inédites… Il défend notamment le bilan politique et militaire de Joseph en Espagne. On joint une copie avec une nouvelle conclusion, et des corrections, feuillet intercalaire et couverture autographes ; et une autre copie avec qqs corrections et des compliments autographes ; plus le numéro du 31 janvier 1829 du journal new-yorkais avec qqs notes autographes.
30
BOULEZ Pierre (1925 - 2016).
MANUSCRIT MUSICAL autographe signé, Deuxième Sonate pour piano (1948) ; 1 feuillet de titre et 23 pages in-fol. Précieux manucrit de la Deuxième Sonate pour piano, œuvre majeure de la production du premier Boulez et du répertoire pianistique du vingtième siècle
Composée d’octobre 1947 à mai 1948, elle fut créée par Yvette Grimaud à l’École Normale de Musique, au Concert des éditeurs, le 29 avril 1950, et publiée la même année chez Heugel.
Le manuscrit est tracé avec précision à l’encre noire sur papier à 26 lignes Il est signé et daté en fin : « mai 48 / octobre-novembre 47 février 48 ». Il porte cette note en tête : « Remarque générale : Pour l’interprétation des nuances, éviter absolument, surtout dans les tempos lents, ce que l’on convient d’appeler les “nuances expressives” ».
La Sonate est divisée en quatre mouvements :
I. Extrêmement rapide ;
II. Lent ;
III. Modéré, presque vif (page 15 : 22 mesures biffées et insertion d’un feuillet avec 9 mesures nouvelles) ;
IV. Très librement, avec de brusques oppositions de mouvement et de nuance
Citons le beau commentaire de cette Deuxième Sonate par André Boucourechliev : « Dans cette œuvre, le système dodécaphonique se transforme en une conception sérielle – beaucoup plus élargie – du langage musical, qui régit non plus les sons mais les rapports sonores, et fait entrer le rythme, sous une forme extrêmement développée et une organisation autonome, dans ses nouvelles structures. Boulez procède ici par cellules rythmiques brèves, constituées en véritables thèmes rythmiques indépendants, et développées selon des principes mis en valeur et enseignés par Messiaen : rythmes non rétrogradables, canons rythmiques, transformations, augmentation et diminutions proportionnelles des valeurs, etc. L’autonomie rythmique des contrepoints dans la Sonate de Boulez (où, comme l’indique le compositeur, toutes les voix sont également importantes), l’abolition totale de toute pulsation régulière (la barre de mesure n’est plus qu’un repère visuel pour l’exécutant), créent un temps musical nouveau, d’une totale discontinuité, qui exige de la part de l’auditeur une écoute nouvelle car, évidemment, c’est tout le contraire d’une évasion que nous propose l’œuvre de Boulez ; elle fait appel à notre participation, à notre propre inquiétude : alors seulement – et bien plus vite qu’il ne semble au premier abord – elle se révèle, avec ses violences rythmiques discontinues et imprévisibles, étonnamment proche de nous, de notre sensibilité d’hommes modernes ».
On a joint les épreuves corrigées (Heugel 1950) tirées en bleu par le graveur Buchardt (48 pages chaque) : la première épreuve (8 décembre 1949) est surchargée de corrections autographes ; la 2e épreuve porte la commande du tirage (datée 21-2-50).
Plus une L.A.S. de Pierre Boulez (1 p. in-8), avec une page in-4 de corrections autographes pour l’Errata ; plus le feuillet d’épreuve de l’Errata.
Bibliographie : Dominique Jameux, Pierre Boulez (Fayard 1984), p. 298 - 315 (analyse détaillée de la Deuxième Sonate).
Discographie : Maurizio Pollini (Deutsche Grammophon, enr. 1976).
1 200 - 1 500
30 000 - 40 000
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 14 28
100 - 150
31 BRAHMS Johannes (1833 - 1897).
Sonate… für das Pianoforte, Op. 1, 2 et 5 (Leipzig, [1853 - 1854] ; 3 partitions gravées ; in-fol. Premières éditions des trois Sonates pour piano de Brahms
Sonate (C Dur) für das Pianoforte .... Joseph Joachim zugeeignet, Op.1 (Leipzig, Breitkopf & Härtel, [1853]) ; 31 pages in-fol. (34 x 27 cm), musique gravée, cotage 8833, couverture originale d’éditeur jaune (brunissure) avec le catalogue des œuvres de Beethoven au verso [Hofmann p. 3 ; Hoboken n° 1].
Sonate Fis moll für das Pianoforte ... Frau Clara Schumann verehrend zugeeignet, Op.2 (id., [1854]) ; 27 pages in-fol. (32,2 x 26 cm), musique gravée, cotage 8834, sans la couv., signature du possesseur « Rheinthaler » sur le titre, sous chemise à rabats percaline verte, pièce de titre sur le plat sup. [Hofmann p. 5 ; Hoboken 2].
Sonate (F moll) für das Pianoforte... der Frau Gräfin Ida von Hohenthal gb. Gräfin von Scherr-Thoss zugeiegnet…
Op.5 (Leipzig, Bartholf Senff, [1854]) ; 39 pages in-fol. (32,5 x 26 cm), musique gravée, cotage n° 101, cartonnage moderne avec couverture d’éditeur impr. collée sur le plat sup., dos de veau fauve titré [Hofmann, p. 11 ; Hoboken 5].
On joint : Variationen für das Pianoforte über ein Thema von Robert Schumann, Frau Clara Schumann zugeeignet…
Op.9 (Leipzig, Breitkopf & Härtel, [1854]) ; 19 pages in-fol. (33 x 26 cm), musique gravée, cotage n°9001, couvertures d’éditeur impr. sur papier vert, la couv. sup. (avec la dédicace à Clara Schumann) montée sur cartonnage de l’époque à dos toilé, la couv. inf. avec le catalogue des « Robert Schumann’s Werke im Verlage von Breitkopf & Hærtel in Leipzig » (quelques notes musicologiques au crayon, léger manque dans le coin sup. de la couv.) [Hofmann, p. 21 ; Hoboken 10].
32 BRASSAÏ Gyula Halasz dit (1899 - 1984) photographe.
Tapuscrit signé « Brassaï » avec corrections autographes, Marie, [ca 1948] 47 pages in-4 sous chemise titrée. Le dossier comprend également le tapuscrit corrigé des Nouveaux propos de Marie (5 pages in-4), reprenant certains passages de Marie avec des variantes
On joint l’édition originale : Histoire de Marie, avec une introduction par Henry Miller (Paris, Éditions du Point du jour, 1949), in-8, broché.
33 BRETON André (1896 - 1966).
MANUSCRIT autographe signé « André Breton », Magie quotidienne, avec 2 dessins à la plume, Paris 1955 ;
1 page in-4 sur papier vert.
Curieux texte, relatant un cas de hasard surréaliste
Ce beau manuscrit, illustré de deux dessins, est déidé à Lise DEHARME : « Pour Lise ». Magie quotidienne a paru dans la revue La Tour Saint Jacques en novembre 1955.
« Lundi 21 février. – 20 heures. À mon retour chez moi, mon chien, Uli, m’accueille par des transports de joie tout à fait inhabituels. […] c’est comme s’il avait à m’avertir d’un événement exceptionnellement heureux. » Breton retrouve ensuite dans son courrier une enveloppe qui « contient une plaquette intitulée Salades, par Robert-Guy, qui porte cette dédicace : “A M.A.B., en souvenir du chien qui faillit nous rapprocher” ». L’avocat Robert- Guy l’avait en effet aidé auprès du gérant de l’immeuble pour qu’il puisse garder son chien. Le manuscrit est agrémenté de deux dessins faisant écho au contenu du texte.
34 BROSSOLETTE Pierre (1903 - 1944) journaliste, homme politique ; héros de la Résistance, il se suicida pour ne pas parler.
L.A.S. « Pierre Brossolette », Royan 27 août 1930, [à G. PELLETIER, de l’Agence économique de Madagascar] ; 1 page in-8.
Très rare lettre du grand résistant, au début de sa carrière journalistique
« J’ai fait beaucoup de copie pour une foule de revues, achevé un bouquin pour POMARET, assuré la permanence rue Oudinot. L’amitié a souffert de tout cela – et je m’en excuse. L’activité “ministérielle” demeure toujours aussi vague et incoordonnée. Il “tient” plus que jamais aux projets qui nous sont chers. Nous savons tout cela. Et ça devient plutôt exaspérant. Serez-vous à Paris au début de septembre. J’y passerai, après quelques jours de mer (il fait beau par hasard) et avant quelques jours de campagne… hélas quasi électorale. Je serais heureux de vous voir »…
15 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
800 - 1 000
1 000
1 200
-
1 000 - 1 500
1 000 - 1 200
36
CALDER Alexander (1898 - 1976).
L.A.S. « Alexander Calder », Roxbury 2 novembre 1949, à Mr & Mrs. Bressler ; 1 page in-4 à son cachet en-tête (traces d’adhésif) ; en anglais.
Sur ses mobiles
Il vend souvent ses mobiles lui-même en direct, les prix allant de 100 $ pour les petits à plusieurs milliers. Il aimerait savoir ce que les Bressler ont dans l’idée, où ils veulent le placer, la couleur des murs, afin qu’il puisse travailler pour eux..
« I often sell my “mobiles” myself – (direct). Perhaps that is what you would like. Prices range from $ 100 – for very minute affairs – up to several thousands. If you will let me know what you had in mind, i.e., where you wanted to put it, surroundings, etc, color of walls, etc., and, perhaps, what you had thought of spending on it, I will let you know what I would make for you »…
CAMBRONNE Pierre (1770 - 1842) général.
L.A.S. « C A », [Boulogne vers 1804], à Augustine CORBISEZ, chez le général Joba à Nieuport ; 1 page in-fol., adresse au verso avec marque postale Boulogne-sur -Mer (petite déchirure en tête par bris de cachet). Magnifique lettre amoureuse et érotique à une maîtresse
« Ma chère Augustine Mon amour, on attachement pour toi, sont si grands, que je ne puis m’cmpecher de vouloir ce qui te fait plaisir ». Il approuve donc ce qu’elle a « fait faire à mon portrait », et elle a bien fait de suivre son caprice : « Ta lettre est si jolie touchant ce vestige que je voudrois tous les jours que tu aies de pareilless occupations et encore en ton lit que de délicieux moments sont venus se retracer à ma mémoire, je te croyois tenir dans mes bras étant dans les instants delicieux malheureusement passés ou tes beaux bras me faisoient jouir de si douces étreintes, ma chere si je ne craignois d’être traité de polison comme tu me fis une fois, cette lettre seroit couverte du sperme que je verse tous les jours pour toi et plus particulièrement à cette minute où la seule pensée de ton amour inviolable me le fait répandre naturellement. Tu m’avois promis de ne me rien faire cadeau à la foire, d’après ce que je t’écrivois, tu n’as pas tenu parole, tu m’as donné un habit neuf et tu ne veux rien recevoir de moi, j’espère que tu reviendras de cette décision et que tu me diras que tu acceptes aussi le mien […] Sais tu que tu agis un peu militairement dans tes actions, tu fais ce que tu veux […] c’est assez montrer ta force et ma foiblesse elle est trop naturelle, mon amie, c’est pour une jolie aimable adorable enfin parfaite femme, je n’en rougis donc pas et me trouve trop heureux de pouvoir conserver une aussi chère maîtresse que toi à ce prix. Je t’embrasse et suis pour la vie non seulement ton constant mais même fidèle amant ».
37 CAMPAGNE DE RUSSIE.
L.A.S. « Delbois », Moscou 6 octobre 1812, à ses parents, « Monsieur Delbois, cultivateur à Chamant près Senlis » ; 2 pages in-4, adresse avec marque postale N°11 Grande Armée (quelques défauts, mouillure dans la marge inf.). Rare lettre de soldat racontant l’incendie de Moscou
Il écrit à ses parents « d’une ville qui a été la proie des flammes ; l’incendie de cette ville, belle, riche, la plus vaste & la plus commerçante de l’Europe, nous offrait un spectacle aussi magestueux qu’effrayant. Plusieurs milliers de forçats lachés par l’ennemi, et à qui on avait promis le pillage, attendirent que nous fussions tous entrés dans Moscou, et espérant nous trouver dans l’ivresse & dans la joie, et nous faire périr par les flammes, ils mirent le feu à plus de vingt endroits ; en un moment un vent impétueux porta la flamme dans presque tous les faubourgs, et dans une grande partie des quartiers de la ville ; de sorte que les deux tiers d’une cité qui devait faire l’admiration des voyageurs ont été brûlés. Personne ne fut victime des mauvais desseins de ces scélérats, et le mal qu’ils voulaient nous faire retomba sur leur tête ; car on en fusille autant qu’on en trouve. On aura bien de la peine à rétablir Moscou dans sa première beauté, & l’Empire de Russie fait une perte irréparable dans la ruine de cette ville qui pouvait passer pour la plus commerçante de l’univers, puisque toutes les marchandises de l’Asie y abondaient »…
38
CAMUS Albert (1913 - 1960).
L.A.S. « Albert Camus », Le Panelier (Haute-Loire) 6 septembre [1942], à Raymond QUENEAU aux éditions Gallimard ; 1 page oblong in-12 sur carte postale avec adresses au dos. Belle lettre littéraire sur Pierrot mon ami
Il remercie Queneau de son livre, qu’il a lu d’un trait avant de le reprendre avec plaisir... « Je crois que vous avez raison de vouloir appeler votre livre un poème. Il fait penser aussi aux compositions admirables des Flamands ou, plus près de nous, aux mascarades de James Ensor. Vous excellez dans le “fantastique naturel” : personnages lunaires, foires, belluaires, monstres et fakirs, le tout jeté dans les arrondissements de Paris. Parce qu’il y a aussi Paris et sans lui on ne comprendrait pas votre œuvre. Je pense ici à Odile que j’ai beaucoup aimé. Est-ce encore à cause de Paris ? Vos livres, malgré les apparences, ne sont pas gais. Ils racontent presque tous des échecs. Ce sont des féeries vraies et mélancoliques »...
1 000 - 1 500
1500 - 2000
1 000 - 1 200
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 16
35
800 - 1 000
39 CASSATT Mary (1844 - 1926).
2 L.A.S., [Paris 1911], au critique d’art Achille SEGARD ; 3 et 2 pages in-8 à son adresse 10 rue de Marignan (deuil). Au futur auteur de Mary Cassatt, un peintre des enfants et des mères (Ollendorff, 1913).
18 octobre [1911]. Elle le prie d’excuser son retard à lui répondre : « La vérité est que je suis en ce moment une pauvre femme malade, incapable de m’occuper de rien. Après un hiver passé en Egypt j’ai eu la grande douleur de perdre le dernier membre de ma famille à Paris au printemps dernier [son frère Gardner]. La chose a été trop pour moi et je ne commence que maintenant à sortir d’une dépression nerveuse qui m’a enlevé toute force »… Elle ne fait que passer à Paris pour voir un médecin, et remet à plus tard le plaisir de le voir. « Quant à ce que Monsieur Destrées vous a dit, il y a erreur je ne possède qu’un seul de mes tableaux, et je ne crois pas que ce soit parmi les meilleurs. Mess. DURAND-RUEL savent beaucoup mieux que moi où sont mes tableaux, aussi chez M. VOLLARD
6 rue Lafitte il y a des pastels »… Elle le charge de répondre au souvenir de CLEMENCEAU « J’espère qu’il garde toujours sa grande vitalité et son bel énergie. Les hommes en Amérique s’en vont de si bon heur terrassé par la lutte à soixante ans. Combien on est plus sage ici »… Jeudi. Elle est rentrée mardi et aura plaisir à le voir, en début d’après-midi, « car je suis obligée de prendre l’air quand le temps est beau »…
40 CASSATT Mary (1844 - 1926).
L.A.S., Mesnil-Breaufresne par Mesnil-Theribus (Oise) Samedi [automne 1911], au critique d’art Achille SEGARD ; 4 pages in-8 à son adresse (petit deuil).
« J’étais à Paris cette semaine pour deux jours, mais je n’aurais pas eu la force de causer art, je suis en convalescence mais c’est long et je ne travaille pas encore. Je suis obligée de vous demander de venir ici puisque je ne puis retourner de suite à Paris ». Sa nièce, qui va repartir pour l’Amérique, doit venir la voir… « Mon auto est en réparation mais j’ai une petite voiture en location, je serai obligée de vous demander de venir jusqu’à Chaumont en Vexin. Je serais heureuse de vous dire de vive voix combien j’admire votre beau livre sur le SODOMA [Giov. Antonio Bazzi detto Sodoma et la fin de l’école de Sienne au XVI e siècle]. Je l’ai lue avec un grand plaisir. Quand au livre que vous me dédiez, il me semble que mon bagage artistique est bien léger. Il y a bien longtemps que je n’ai vue de mes tableaux, on me dit qu’il y a deux très anciennes choses au salon d’Automne de moi. Comment trouvez-vous ce procédée, d’exposer des tableaux d’un peintre sans lui en demander l’autorisation ? »…
41 CÉLINE Louis-Ferdinand (1894 - 1961).
L.A.S. « Destouches », [Prison de Copenhague] Jeudi 1er août 1946, à son avocat danois Thorvald MIKKELSEN et à SA FEMME Lucette DESTOUCHES ; 2 pages in-4 au crayon sur papier rose à en-tête de la prison Københavns
Fængsler, Vestre Foengsel
Belle lettre de prison, en grande partie à sa femme Lucette , publiée dans les Lettres de prison à Lucette Destouches et à Maître Mikkelsen (Gallimard, 1998, n° 103).
« VOLTAIRE caractérise la France comme une nation “légère et dure”. Rien hélas n’est plus exact » ; il est vain d’attendre une amnistie : « Je n’attends rien de la magnanimité française ! ». Quant à CHARBONNIERE, « ce petit roquet foireux enragé représente ma pauvre Patrie »…
À sa femme : il ne faut plus compter sur une libération prochaine, il en a pour des années : « L’impatience est le vinaigre des supplices ». Il est vain d’attendre de l’aide de BIDAULT, « un pauvre petit merdeux éclos dans la mascarade de la résistance où tout petit merdeux capable de dévaliser un bureau de tabac s’est pris pour un nouveau Clemenceau », de TEITGEN et autres nabots, « poux de catastrophe ». Il fait des recommandations pour l’hiver à Lucette, et pour le chat BÉBERT. Il regrette : « J’ai manqué de réflexe, de vivacité, d’instinct de conservation. […] Plus éveillé je filais en Espagne 1 an plus tôt et tout était dit. […] Ce sont les vieux sangliers qui tombent les premiers à la chasse ».
42 CÉLINE Louis-Ferdinand (1894 - 1961).
L.A.S. « LFC », [Kørsør] Le 31 [décembre 1947], à son ami Georges GEOFFROY ; 3 pages in-fol., enveloppe. Il lui souhaite une bonne année, et l’encourage à venir le voir... « je te vois encore bien mélancolique avec ton Hélène ! Et foutre elle rigole bien, baise bien, bouffe bien. Elle te ménage pardi dans le cas où… Si tu es assez cave pour te laisser mettre au placard, en pot de confiture éventuel ! » Qu’il fasse comme Popol [Gen-Paul] qui « jouit seconde par seconde. Fais en autant bordel ! Demain quand [les] Chinois seront Place de la Concorde, ce n’est pas le souvenir d’Hélène qui te rattrapera le moment perdu ! […] quand on est condamné à mort on va tout de suite à l’essentiel on ne le quitte plus. 4 ans de misère infecte de supplice sans nom vous ôtent le goût des vains chichis. […] L’homme libre est celui qui a de l’argent en poche. Alors la vie, les filles, la liberté, l’amour, et nom de Dieu la jeunesse ! »...
17 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
1 200 - 1 500
1 000 - 1 500
1 000 - 1 500
800 - 1 000
43 CÉLINE Louis-Ferdinand (1894 - 1961).
L.A.S. « LF Céline », Meudon 28 juin [1957], à Pascal PIA ; 3 pages in-4 à son cachet en-tête, enveloppe. Il a pris connaissance de son article dans Carrefour [à propos de son roman D’un Château l’autre] et est très heureux « d’être si bien compris et si justement commenté […] Que les autres critiques en prennent de la graine ! avant que j’expire !... et eux aussi !... Petit détail… si je suis encore à peu près en vie et capable de vous remercier c’est que j’ai quitté la France en Août 44… où pouvais-je aller ?... en Espagne ? C’était signer ma condamnation… restait le Danemark neutre où j’avais déposé tous mes droits d’auteurs, qui nous servirent à vivre moi et ma femme, en prison et hors prison, pendant sept ans… Mais le Danemark via l’Allemagne, pas d’autres chemins !... Il faut se reporter aux époques et aux faits, pour se mettre à ma place… En France je n’aurais même pas vu la Cour de Justice, j’étais écharpé bien avant d’être jugé ! À mesure que les années passent tout devient conforme à une certaine vérité “convenable” et complètement déraillée…abracadabrant… »… Il termine en l’invitant à venir le voir : « en deux mots, vous en saurez plus que cent équipes de jaseurs à vide »…
44 CHAMFORT Sébastien Roch Nicolas de (1740 - 1794) écrivain et moraliste.
L.A.S. « de Chamfort », Paris 16 septembre [1770, à Jean-François de LA HARPE] ; 3 pages et demie in-4. Il se dit inconsolable de n’avoir pu lui répondre plus tôt, mais une fièvre l’a forcé à prolonger son séjour à la campagne... Son ami connaissait les raisons qui l’ont « privé du plaisir de passer quelque tems auprès de vous et de M e de Marnesia », mais le silence lui faisait craindre d’avoir perdu sa si précieuse amitié : « Je suis charmé […] d’être rassuré par vous même et j’attribue tout à cette mauvaise goute dont vous parlez ». Il serait ravi « si je pouvois me dedomager cet hyver du tems perdu », mais il est retenu à Paris par sa santé et toutes sortes d’engagements, dont sa comédie Le Marchand de Smyrne « qui sera peut-être joué cet hyver, une autre bagatelle qui le sera à la cour au commencement de novembre, une tragédie qui doit être prête au printems prochain, voila plus de besogne qu’il n’en faut à une tête et à une santé comme la mienne. Ainsi Monsieur je suis obligé de remettre à un autre tems le projet d’aller partager votre solitude »… Il est enchanté de le voir songer à un Éloge de Fénelon : « Ce sujet vous convient de toutes les manières et son âme est digne d’être louée par la votre. Des occupations d’un autre genre m’empêcheront d’être votre concurrent et mes vœux sont sans réserve pour l’amitié »…
45 CHATEAUBRIAND François-René de (1768 - 1848).
L.A., Lausanne 26 juin 1826, à son amie la duchesse de DURAS ; 2 pages et quart in-4. Lettre évoquant la censure et la publication du Dernier Abencérage
Il annonce leur retour à Paris; Mme de Chateaubriand va bien et l’infirmerie la rappelle. « Moi, j’ai mis au net la plus difficile besogne et je souffre tant que ces deux raisons me déterminent à abréger. Enfin, imaginez que dans cette république on vient d’établir la censure. Je fuis cette peste au risque de la retrouver à Paris ». Il va faire un bref voyage à Genève, avant de revenir pour une douzaine de jours à Lausanne, et de rentrer à Paris. « Je ne sais rien de ce monde, ni de la politique après la session, ni même de mon édition et du destin d’Aben-Hamet. Je n’écris à personne, personne ne m’écrit, et je serois dans le repos le plus complet si vous n’étiez pas malade, si je ne travaillois pas trop et si je n’étois pas boîteux. J’ai dormi la nuit dernière quatre heures pour la première fois depuis trois semaines : je plains bien à présent les insomnies du pauvre Frisel. Je vais voir à Genève une autre malade M de de CUSTINE. Elle me fait grand’pitié. Astolphe est venu me voir. [...] Que devenez-vous ? Restez-vous dans votre forêt ? Allez-vous à la mer ? Enfin avant un mois je vous verrai. Dieu soit loué de tout ».
46 CHRISTINE DE SUÈDE (1626 - 1689) Reine de Suède.
L.A. (minute), [Rome 1669 ?], à Franz Egon von FÜRSTENBERG, évêque de Strasbourg ; 4 pages in-4 avec ratures et corrections.
Belle lettre d’exil à Rome sur sa situation financière difficile, et ses relations avec la Cour de France au sujet de l’argent promis lors de son abdication
Elle remercie l’évêque de sa lettre pour la nouvelle année, « vous priant de croire que ces marques de vostre amitie ont este agreablement receus de moy et je veux bien aussi vous asseurer qu’on ne vous a pas trompé en vous persuadant que je suis sincerement vostre amye a vous et a Mr le Prince vostre frere ». Elle le remercie de son offre « de me servir a la cour de France », et lui expose « lestat des choses »…
« Il y a longtemps qu’on me doit un reste de subsides des gens passes d’Allemange que je me suis reserve a mon Abdication », et qu’elle a sollicité à la Cour de France « en personne lorsque j’y estoy. Lon me promit de me satisfaire et on me paya mesme quelque peu dargent que je receus a ce conte differant le reste a un temps plus comode », qu’elle n’a pas réclamé. « Mais les malheurs du temps et la perte de tous ce que possedois en Suede et en Allemange mont forcé de remettre sur le tapis cette ancienne pretension, qui est lunique ressource qui me reste dans lestat present […] Cest pourquoy jescrivis sur ce sujet en France pour tacher den tirer quelque chose ou du capital ou de linterest ». Le cardinal d’ESTE a été chargé de lui porter la réponse, où elle comprit « quon nestoit pas dispose a me rendre justice la dessus a present, et je ne men estonnoy pas trop sachant tres bien que je ne suis pas la seulle au monde a qui largent manque »… Le cardinal d’Este est retourné en France, et elle attend son retour avec espoir… « Vous ne me persuaderez pas aysement que les dispositions de la Cour de France se treuvent favorables pour moy car je say les bons offices quon my rendt touts les jours dycy qui ne manqueront pas de produire leurs effets ordinaires comme ils les ont produits autrefois. Par bonheur je me suis accoustume depuis que jay lage de la rayson a me passer de tout ce qui nest pas Dieu, ainsi vous voyez que je nauray pas de poine a me consoler de tous les malheurs qui marrive »…
1 000 - 1 500
1 000 - 1 200
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 18
1 500 - 2 000
2 500 - 3 000
47 COCTEAU Jean (1889 - 1963).
6 POÈMES autographes, dont 3 signés ; 12 pages in-4 et 1 page in-fol. Bel ensemble de poèmes de jeunesse, la plupart inédits
La Trahison, 6 quatrains (2 ff.) : « A seize ans on n ’a pas une attache profonde »…
Petite chanson plaisante pour la dame inconnue, 8 quatrains, signé « Jean Cocteau » (3 ff. sur papier bleu) :
« Nul prestige ne te décore / (Et sur quel sol ? Et sous quel toit ?) »…
Éloge d ’une tranche de pastèque, 4 quatrains, signé (3 ff.), publ. dans les « Poèmes de jeunesse inédits », Œuvres poétiques complètes, Bibl. de la Pléiade, p. 1522) : « Verte gondole où gèle et vogue un sorbet au palais de Doges »…
« Pourtant ce n ’est plus l’âge où je devais bientôt / Sentir couler en moi l ’adolescence émue »…. 6 quatrains (1 p. in-fol.), signé « JC ».
« Peut-être un grand vapeur qui fait escale aux rives / Mènera-t-il un jour mon tumulte enfin las »…., sonnet signé « JC » (1 p.).
« Tu seras sur ma bouche et contre mon oreille »…, , 7 quatrains, signé « JC » (3 ff.).
48 COLETTE (1873 - 1954).
L.A.S. « Colette et Maurice », La Treille Muscate, à Misz MARCHAND ; 2 pages in-4 sur papier bleu à en-tête de La Treille Muscate
« Ma-Misz, le beau temps, la mer tiède ne m’empêchent pas de regretter Costaérès et mes Léo. [...] J’ai déjà accompli mille travaux, trouvé une grenouille verte adorable dans mon fauteuil et sauvé un beau lézard tombé dans un petit bassin. Il levait les bras pour appeler au secours ! Je suis arrivée à temps. La couleuvre de la cuisine s’est établie dans le garage. Beaucoup d’oiseaux, à cause de la sécheresse environnante. Et des fleurs. Et tout. Tout, mais pas mes Léo »…
49 COURTELINE Georges (1858 - 1929).
MANUSCRIT autographe signé « Georges Courteline », Un mec ; 12 pages in-8 ou in-12..
Amusant conte, où Courteline, apprenant que son ami d’enfance Lagrillade est devenu maquereau, évoque ses années de collège, le projet de son livre Les Leçons de la Vie, puis trace avec humour les 4 types d’« Incorrects » : le Poseur de lapins, le Gigolo, le Gigolo appointé et le Mec proprement dit... Le manuscrit, de l’écriture du jeune Courteline, présente des ratures et corrections. Il a été découpé pour l’impression, et remonté.
Ancienne collection Daniel SICKLES (XIII, 5253).
50 DAUDET Alphonse (1840 - 1897).
MANUSCRIT en partie autographe, Bompard et Tartarin, aventures de deux alpinistes, [ Tartarin sur les Alpes, 1884] ; 239 feuillets petit in-4 (21,5 x 17 cm), foliotés 1 à 241 (83-84 et 93-94 sur un feuillet) ; reliure maroquin bleu nuit, dos à nerfs, doublure de maroquin havane, encadrement de feuillages mosaïqués de maroquin vert et rouge, gardes de faille havane, doubles gardes de papier jaspé, étui.
Manuscrit complet du roman Tartarin sur les Alpes
Suite des aventures de Tartarin de Tarascon, le roman raconte le nouvel exploit du chasseur de fauves, parti à l’assaut des sommets alpins, la Jungfrau et le Mont Blanc…
Le manuscrit porte le titre primitif : Bompard et Tartarin, aventures de deux alpinistes. Seul le premier chapitre est autographe (16 feuillets) est autographe. Le reste du manuscrit est de la main de son secrétaire Jules Ebner, à qui Daudet dictait, et porte de nombreuses corrections autographes de Daudet. Le manuscrit est rédigé à l’encre brune au recto des feuillets ; il présente de nombreuses ratures et corrections ; il a servi pour l’impression de l’édition originale, publiée sous le titre Tartarin sur les Alpes. Nouveaux exploits du héros tarasconnais (Calmann-Lévy, « Collection Guillaume », 1885), et porte des indications du typographe au crayon bleu. Il est divisé en 14 chapitres, le dernier, XIV, intitulé Épilogue
On a relié en tête : – un portrait de Daudet gravé par Adrien Nargeot ; – 2 L.A.S. d’Alphonse Daudet à l’éditeur Édouard Guillaume : Champrosay 25 juillet 1884 (1 p.in-8) : « Décidément votre offre me séduit et je suis prêt à m’engager avec vous et vos associés pour un roman inédit à illustrer. Comme vous avez plus la pratique des affaires que moi, veuillez faire un traité que nous lirons et débattrons ensemble. Mes conditions sont celles-ci : une prime de 25.000 francs me sera payée quand je livrerai la première moitié de mon manuscrit. Je toucherai 3 fr. 50 par exemplaire sur le volume à 20 francs [...] Titre provisoire : Bompard et Tartarin, ou le Voyage en Suisse »… 10 mars 1885 (1 p. in-12) : « Tartarin est à Interlaken, il veut aller à Montreux. Quel chemin de fer prend-il, par où passe-t-il pour arriver vite ? » – Un reçu autographe signé de Daudet, Paris 30 décembre 1885 : « Reçu de MM.Guillaume la somme de vingt mille francs »…
Provenance : Alain de Suzannet (ex-libris armorié ; vente 1936, n° 44) ; Pierre Guérin (ex libris) ; Du Bourg de Bozas Chaix d’Est Ange (ex-libris armorié, vente 27-28 juin 1990, n° 170).
1 000 - 1 500
19 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
800
600 -
1 000 - 1 200
4 000 - 5 000
51 DICKENS Charles (1812 - 1870).
L.A.S. « Charles Dickens », [Londres] « 48 Doughty Street » mercredi matin [1837 ?], à William B. ARCHER Esquire ; 4 pages in-8 (légères traces d’encadrement) ; en anglais. Belle lettre de conseils littéraires, et sur la présence des morts bien-aimés dans les pensées et les rêves des vivants
Il a lu avec plaisir et intérêt le récit d’Archer, et lui fait des suggestions, notamment de fortement condenser la scène d’ouverture avec le prêtre, et même de supprimer complètement la visite au château, en ajoutant quelques mots sur les rapports que nos esprits entretiennent couramment avec ceux des morts bien-aimés dans des pensées éveillées et dans des rêves dans lesquels nous les voyons (les sachant ne plus être de ce monde) sans crainte ni douleur…. [À cette période, Dickens est hanté par le fantôme de sa belle-sœur, Mary Hogarth (décédée le 7 mai 1837), dont on trouvera la trace peu après dans Nicholas Nickleby.]
« I would condense – greatly condense – the opening scene with the priest […] But to my mind you would make the tale a much better one if you wholly omitted the visit of the Priest and yourself to the castle, […] adding a few words to the effect that our spirits commonly hold intercourse with those of the beloved dead in waking thoughts and dreams in which we see them (knowing them to be no longer of this world) without fear or pain, tender might come to the story. I would materially shorten the commencement of the story itself, and I would describe a little more forcibly the Heros holdness when he sees the shade and mokes after it […] I reserve my final suggestion for a fresh paragraph, because it is a sweeping one. I beg you to understand that I leave it entirely to yourself, and if you prefer the paper in its present and that if there be any case in which strong and blameless sympathy could be supposed to bring the dead and living together, it would be such a case as you describe »…
52 DIVERS
Environ 95 lettres ou pièces, la plupart L.A.S. d’hommes politiques ou militaires.
Joseph Barthélemy, Louis Barthou, R. Bérenger, V. de Broglie, F. Buisson, Émile Combes, Ad. Crémieux, Élie duc Decazes (1884), Th. Delcassé, Paul Deschanel, Eug. Étienne, Fabvier (à Gourgaud), C. de Freycinet, Galliffet, Yves Guyot, Ed. Herriot, Anatole de La Forge, amiral Mornet, g al Négrier, Paul Painlevé, Louis Passy, G. Payelle, R. Poincaré, Antonin Proust, Th. Ribot, g al Rolin, Léon Say (4), Jules Simon, Édouard Vaillant, m al Vaillant, René Viviani, R. Waldeck-Rousseau, etc.
Plus un registre de signatures pendant la maladie d’Élie Le Royer et lors son décès (1897).
53 EINSTEIN Albert (1879 - 1955).
L.S. « Albert Einstein », Le Coq que mer 14 juillet 1933, à Édouard GUILLAUME ; 1 page in-4 dactylographiée (traduction anglaise jointe).
Il soutient chaudement l’initiative de Lisa Einstein pour obtenit la permission d’un éjour en Angleterre. Lisa Einstein est la fille d’un des meilleurs docteurs de Stuttgart. Elle a étudié la médecine pendant deux ans mais est forcée, à cause des mesures contre les juifs allemands (« durh die gegen die deutschen Juden gerichteten Massnahmen ») d’abandonner ses études. Elle souhaite devenir infirmière, carrière qui lui est également interdite en Allemagne à la suite des nouveaux réglements. Le Guys Hospital de Londres serait prêt à l’accueillir…
54
EINSTEIN Albert (1879 - 1955).
L.A.S. « Albert », [Berlin] 27 mars 1931, à Mileva EINSTEIN-MARIC ; 1 page in-4 ; en allemand. À sa première femme
Il est, Dieu merci, de retour du tourbillon des États-Unis (« Wieder zurück von dem Strudel von Amerika – gottseidank »). Il y a cherché en vain les cactus demandés par Mileva ; mais il a appris que des cactus rares sont élevés par une pépinière d’Erfurt.
Il aimerait contribuer financièrement au déménagement de son fils Albert, mais préfère confier l’argent à Mileva, ayant toute confiance en ses capacités financières (« weil ich zu Deinen wirtschaftlichen Fähigkeiten besonderes Vertrauen habe »).
Il profite de la tranquillité (relative !) de Berlin et travaille d’arrache-pied sur l’espace à structure parallèle : « Ich arbeite fest und geniesse die (relative !) Ruhe von Berlin. Es geht immer noch um den Raum mit Parallelstruktur ».
Il est très content des messages qu’il a reçus de Tetel (Eduard son second fils), dont Toni lui a parlé avec beaucoup d’enthousiasme…
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 20
1 200 - 1 500
200 - 300
1 000 - 1 200
2 000 - 2 500
55 EINSTEIN Albert (1879 - 1955).
L.A.S. « A.E. », 11 mai 1950, à Ernst Gabor STRAUS ; 2 pages in-4 très remplies d’une écriture serrée ; en allemand. Belle lettre scientifique sur la question de la compatibilité dans la théorie de la relativité, avec calculs, équations et tableau
[Ernst Gabor STRAUS (1922 - 1983), né à Munich, avait fui les persécutions nazies et fait ses études de mathématiques en Palestine à l’université de Jérusalem, puis aux États-Unis ; en 1944, devenu l’assistant d’Einstein à l’Institute of Advanced Study de Princeton, il apporta comme mathématicien une aide importante au physicien, Straus formulant un cadre mathématique pour les concepts d’Einstein. Ils cosignèrent trois communications et remirent à jour ensemble de nombreuses publications anciennes d’Einstein. C’est pendant leur collaboration que fut conçue une idée nouvelle dans la recherche d’une théorie du champ unifié, qu’ils appelèrent « Théorie complexe ». La Théorie complexe se distinguait d’approches antérieures, par l’utilisation d’un tenseur métrique à valeurs complexes plutôt que le tenseur réel de relativité générale. Des communications furent ébauchées, rejetées ou retravaillées et publiées. En 1948, Straus partit comme professeur à UCLA, mais les échanges scientifiques entre les deux savants continuèrent, sur la Théorie.]
Correspondre est une chose fastidieuse. Mais comme il s’agit d’une question intéressante, Einstein aimerait qu’ils parviennent à un accord total. Il ne trouve pas l’objection de Straus justifiée, et maintient que son calcul est correct. Il reprend diverses équations, dans le cas de la gravitation pure, et dresse une liste d’équations d’intersection… Cependant, le nombre d’équations dans chaque ligne est limité par les identités de Bianchi. Et c’est sur ce point qu’ils ne sont pas d’accord, notamment au sujet des g ik. Plus loin, Eistein dresse un tableau donnant le schéma des équations F, S et Bianchi…Ce qui reste sans réponse dans cette considération est la question du nombre de fonctions librement sélectionnables de moins de 3 variables. Mais cela n’a pas d’importance pour juger de la multiplicité des solutions. Puis il est gêné par un paradoxe qui ne le laisse pas en paix : le paradoxe réside dans le fait que le choix particulier des coordonnées requis pour la dérivation s’évapore en moyenne, car on arrive à un système dans lequel il n’y a pas de choix spécial de coordonnées. Il serait bien entendu plus satisfaisant si l’on pouvait trouver un état de surface indépendant d’une spécialisation des coordonnées…
« Es ist eine langwierige Sache, das Korrespondieren. Da es sich aber um eine interessante Frage handelt, sollten wir es zu einer vollen Einigung bringen. Also muss ich sagen, dass ich Ihren Einwand nicht gerechtfertigt finde, sondern immer noch daran festhalte, dass meine Abzählung richtig ist. Worin wir übereinstimmen, ist folgendes. (zunächst im Falle der reinen Gravitation) Die Gleichungen Rik = 0 können nicht nach gik 144 aufgelöst werden. Sonst waren alle gik,144, gik,444 etc. in einem Schnitte aus den gik und gik,4 (als gegebene Funktionen der x, x 2 x 3) berechnet worden, was nicht mit der Freiheit der Koordinatenwahl (ausserhalb des Schnittes) vereinbar wäre. Die Gleichungen können also gespalten werden in vier F = 0 und sechs S = 0
wobei F die gik,44 nicht enthält (sondern nur die gik,4, etc), während S auch die gik,44 (linear) enthält. […] Dies lässt sich zwar in einem Punkte durch die Koordinatenwahl gik = nik erreichen, aber nicht für ein endliches Gebiet der Fläche x4 = konst, Das oben angegebene Argument für diese Spaltbarkeit von Rik im F und S ist aber von jeglicher speziellen Darstellung unabhängig.
Die Schnittgleichungen sind also zunächst. [tableau]
Die Zahl der Gleichungen in den einzelnen Zeilen wird aber durch die Bianchi-Identitäten eingeschränkt. Hier ist nun der Punkt, in dem wir nicht übereinstimmen. Sie sagen nämlich, dass die Bianchi-Id. die gik,444 nicht enthalten. Dies ist zwar richtig für eine Normierung gik =nik. Eine solche Normierung ist aber für eine endliche Ausdehnung der Schnittfläche nicht erzielbar ; deshalb ist die Behauptung nicht zutreffend, dass in den Bianchi-Identitäten die gik,444 nicht auftreten. Die vier Bianchi-Identitäten treten deshalb erst in der vierten Zeile auf. In diesen Zeile gibt es 4+6-4 also 6 unabhängige Gleichungen für die gik,444. Für die dritte Zeile gibt es keine Bianchi-Identität. Die 4+6 Gleichungen sind also voneinander unabhängig. […]
In der dritte Zeile hat man dann 4 Bedingungen zu viel für die gik,44. Durch Elimination (unter Verwendung von Differentiation nach x, x2 x3) entstehen vier weitere Gleichungen die gik, 4.
Vor der Koordinatenwahl hat man also für die Gleichungen der Schema [tableau F/S/Bianchi].
Die Zeilen liefern also 0,4,10,6,6… Gleichungen also 10,6,0,4,4… frei bleibende Grössen. Nach vollständiger Koordinatenwahl 6,2,-4,0,0 frei bleibende Grössen, im Ganzen also 4.
Was bei dieser Betrachtung unbeantwortet bleibt, ist die Frage nach der Zahl der frei wählbaren Funktionen von weniger als 3 Variabeln. Dies ist aber unwichtig für das Beurteilen der Mannigfaltigkeit der Lösungen. […]
Es ist aber hierbei eine Paradoxie, dir mir keine Ruhe lässt. Ich adjungiere zu dem Gleich. System (Ia) die KoordinatenBedingungen […]
Um nun von hier zum System I zu gelangen, hat man nur die einzige Flächenbedingung in der ernsten Zeile zu erfüllen […]
Dadurch vermindert sich ja die Zahl der freien Funktionen von 3 Variabeln nur um 1. Das Paradoxe aber liegt darin, dass die für die Ableitung erforderliche besondere Koordinatenwahl durch das Hinzufügen von M4=0 im Schnitt sozusagen “verdampft”, indem man zu einem System gelangt, in dem es keine besondere Koordinatenwahl M1=M2=M3=0 gibt. Es wäre natürlich befriedigender, wenn man eine Flächenbedingung unabhängig von einer Spezialisierung der Koordinaten finden könnte, die den Übergang von (Ia) zu (I) leistet »…
21 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
10 000 - 15 000
56 ÉLUARD Paul (1895 - 1952).
POÈME autographe signé « Paul Eluard », Les amis II, 1937 ; 1 page in-4.
Poème en prose recueilli en 1947 dans Le Livre ouvert. Éluard a inscrit la date sous sa signature : « chez René Char le 19-1-37 ». Le manuscrit, sur papier jaune, présente des ratures et corrections.
« Entre la porte et le sommeil de ceux qui, tout à l’heure, ne voulaient pas dormir »…
On joint une L.A.S. de René CHAR , Cannet 29 mars 1937, à Irène HAMOIR et à son mari Jean SCUTENAIRE (1 page in-8), leur envoyant le poème d’Eluard : « Toujours à deux pas de la mer, mais le “printemps” a tendance à faire lever de multiples hypothèques. […] Et voici pour prétexter le sommeil un petit poème […] avec toute mon amitié – elle plus grande et meilleure que lui ».
57 ÉLUARD Paul (1895 - 1952).
POÈME autographe signé « Paul Eluard », Critique de la poésie, [1944] ; 1 page et demie in-4 sur papier à bordure décorative gaufrée dorée et M doré.
Très beau poème en hommage aux poètes martyrs, qui conclut le recueil Le lit la table, publié en Suisse au début de 1944 ; il a été également publié dans Poésie 44 (n° 20).
Éluard y évoque les morts de Garcia LORCA, de SAINT-POL ROUX (et le supplice de sa fille Divine), et de Jacques DECOUR.
Le poème, de 25 vers, est soigneusement écrit à l’encre noire sur ce joli papier décoré.
« Le feu réveille la forêt
Les troncs les cœurs les mains les feuilles
Le bonheur en un seul bouquet
Confus léger fondant sucré
C’est toute une forêt d’amis
Qui s’assemble aux fontaines vertes
Du bon soleil du bois flambant
FABRE D’ÉGLANTINE François-Nazare (1750 - guillotiné 1794) acteur, poète et auteur dramatique ; conventionnel (Paris), il prépara le calendrier républicain.
MANUSCRIT autographe (fragments) ; 12 pages petit in-4.
Éloge de MARAT, après son assassinat (14 juillet 1793).
Fabre fait valoir toutes les qualités de son collègue : sa bonhomie, sa simplicité, son amour du vrai, sa pudeur...
Il parlait à la tribune de façon précise et lumineuse, frappant ses adversaires par sa sagesse. Mais alors « son amour pour la justice et pour la vérité lui fesait illusion, il en croyait toute l’assemblée pénétrée comme lui, il se figurait l’occasion excellente pour faire triompher la patrie et le voilà soudain qui remontant à la tribune venait avec confiance présenter ses moyens d’utilité, et de regime politique », et l’apparente exagération de ses propos stupéfiait ses auditeurs... Ses adversaires apprirent à se servir de sa franchise abondante et impétueuse... Par ailleurs, Marat était naïf, sensible et faible, donc crédule, ce qui ne l’empêcha pas de prétendre au machiavélisme... Homme de génie, d’esprit, d’érudition et de goût, il avait de grandes vertus, quelques défauts, point de vices. « Il fut patriote excellent, révolutionnaire intrépide. S’il est arrivé quelque mal par lui, la faute en est à ses ennemis et aux traîtres, nul n’a voulu plus que lui le salut et la prospérité de la patrie, peu lui ont rendu de plus grands services. [...] Marat a bien mérité de la patrie et la postérité se souviendra religieusement de lui partout ou l’amour de la liberté sera une passion »...
On joint deux autres pages autographes, où Fabre parle avec admiration d’une accusée digne et fière, et rappelle les deux vertus essentielles du peuple : la pitié et la pudeur de conscience.
1 800 - 2 000
1 000 -
1 500
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 22
1 000 - 1 500
Garcia Lorca a été mis à mort »… 58
59 FEYDEAU Ernest (1821 - 1873).
MANUSCRIT autographe, [La Comtesse de Chalis, ou les Mœurs du jour], 1867 ; 160 pages in-fol montées sur onglets, reliure de l’époque maroquin janséniste rouge, dos à 6 nerfs, dentelle intérieure (Belz-Niédrée ; reliure un peu frottée).
Manuscrit de travail complet de ce roman
Ce roman à grand succès fut donné en prime, en novembre 1867, par le journal La Liberté, puis publié en décembre en librairie par Michel Lévy frères. Le 13 décembre, Flaubert félicite ainsi Feydeau : « Je suis enchanté. […] C’est leste et bien fait et amusant et vrai. Par ci par là des mots exquis. La comtesse de Châlis m’excite démesurément, moi qui ai comme elle “la plus inconcevable des dépravations”. Ce qui me plaît là-dedans, c’est le sentiment de la Modernité ». Et le 15 décembre, il écrit à son ami Duplan : « l’artiste Feydeau a un vrai succès avec La Comtesse de Châlis ».
De l’aveu de l’auteur, La Comtesse de Châlis fit « un bruit du diable ainsi que de beaucoup d’autres choses », car on croyait y reconnaître beaucoup de personnages de la haute société contemporaine. Ce récit à la première personne raconte l’aventure de Charles Kérouan, fils d’une excellente famille, qui devient professeur d’histoire. Il rencontre la comtesse de Châlis avec son amant le prince Titiane. La comtesse le charge de récupérer des lettres compromettantes et son portrait ; après le départ du prince, Charles devient l’amant de la comtesse. Puis il quitte l’enseignement, perd au jeu, sombre dans la misère. Le comte de Châlis le retrouve et l’engage comme précepteur de ses enfants, mais le charge aussi d’espionner sa femme. Charles surprend une scène sado-masochiste où la comtesse se fait battre par Titiane. Il provoque en duel Titiane, qui le blesse ; il quitte alors Paris et se réfugie chez son père. Il apprendra plus tard que le comte de Châlis, excédé de la conduite scandaleuse de sa femme, la surprit au lit se livrant à la débauche entre Florence et Titiane, étrangla Titiane, et fit interner la comtesse dans la maison de santé du Docteur Blanche. Avant de mourir, le comte écrit à Charles en le chargeant, pour expier son adultère, de raconter, sans en rien atténuer, la triste histoire dont il fut le témoin. Le manuscrit, daté à la fin « Trouville 15 octobre 1867 », est écrit sur de grandes feuilles de papier réglé à l’encre brune ou bleue. Il est complet, bien que paginé de 2 à 160. Il est surchargé de ratures et corrections, avec des passages biffés, de nombreuses additions dans les marges, et d’importantes nouvelles rédactions collées sur la version primitive.
23 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
700 - 900
60
FLAUBERT Gustave (1821 - 1880).
MANUSCRIT autographe signé « G ve Flaubert », Loys XI , drame, 1838 ; 88 feuillets in-fol. (31,5 x 22, 5 cm) montés sur onglets en un volume in-fol., relié demi-maroquin havane à coins, dos lisse avec titre doré en long, non rogné (Canape et Corriez).
Unique manuscrit de cette première tentative théâtrale du jeune Flaubert « Ce drame achevé, cette représentation étendue et dominée d’un moment important de l’histoire, est l’œuvre d’un collégien de seize ans et demi », comme l’indique Guy Sagnes, qui ajoute que ce drame est « incontestablement supérieur aux récits historiques que Flaubert avait composés deux ans plus tôt en empruntant à la manière de Dumas. Une documentation sérieuse et prolongée a fourni à l’imagination toujours puissante une matière sûre tandis que son intelligence passionnée avait acquis le sens de l’histoire ».
Caroline Franklin-Grout, nièce et héritière de Flaubert, a résumé ce drame, dont elle possédait le manuscrit, dans un article de 1906 : « C’est une peinture du roi, de sa cour, de sa lutte contre le duc de Bourgogne, de son entrevue avec saint François de Paule et de sa mort à Plessis-les-Tours. Olivier, Tristan, Commines, Coictier sont les principaux personnages ; il y a une scène de tendresse entre le duc de Bourgogne et sa fille Marie, peu d’instants avant qu’il soit vaincu et tué sous les murs de Nancy ». L’édition originale a paru chez Conard en 1910. Le manuscrit est resté inconnu des éditeurs des Œuvres de jeunesse dans la Pléiade.
La page de titre est datée « Février 1838 ». Le drame est précédé d’une préface datée « Samedi soir 3 mars 1838 ». Le manuscrit, d’une écriture cursive à l’encre brune au recto et verso de feuillets numérotés par Flaubert ([1] à 85, avec deux ff. 66), présente des ratures et corrections, ainsi que quelques passages biffés. La pièce comprend un Prologue (5 scènes), et cinq actes, le quatrième étant divisé en deux tableaux. Citons le texte de présentation rédigé par Flaubert en tête de son manuscrit : « Je viens enfin de finir mes 85 pages, et j’éprouve maintenant le besoin de résumer les impressions que j’ai subies pendant ces quinze jours de travail et d’enfantement. – J’avais été vivement épris de la physionomie de Louis XI, placée comme Janus entre deux moitiés de l’histoire, il en reflétait les couleurs et en indiquait les horizons. Mélange de tragique et de grotesque, de trivialité et de hauteur, cette tête-là mise en face de celle de Charles le Téméraire était tentante, vous l’avouerez, pour une imagination de seize ans amoureuse des sévères formes de l’histoire et du drame. […] À mesure que j’étudiais son histoire le drame s’y fondait naturellement, l’œuvre d’imagination se trouva faite dans la sienne elle-même, et quand je crus avoir assez travaillé c’est-à-dire avoir lu pendant deux mois je me mis à l’œuvre. Voilà l’histoire de mon enfant. – Il n’a pas été 9 mois à germer et n’a pas suivi toutes les phases fatales depuis le molusque jusqu’à l’embryon. Mais je crains bien aussi, pour cet avorté, qu’il n’ait pas vie d’homme et qu’il meure avant peu d’une fluxion de poitrine faute de chaleur.
Chose bizarre que d’écrire un drame, pleine de difficultés et d’obstacles, – un drame historique surtout. Resserrez donc une grande figure dans les limites de 5 actes, vous la rapetissez et vous ferez rire »…
Provenance : Caroline Franklin-Grout-Flaubert (nièce de Flaubert) ; Docteur Lucien-Graux (ex-libris ; vente VIII, 11 décembre 1958, n° 117 bis).
Bibliographie : Flaubert, Œuvres de jeunesse, Bibl. de la Pléiade, t. I, notice par Guy Sagnes, p. 1306 - 1310.
61
FLAUBERT Gustave (1821 - 1880).
L.A.S. « Gve », [Croisset] 12 décembre 1872, à Philippe LEPARFAIT ; 1 page in-8 (deuil).
Au sujet de sa brouille avec l’éditeur Michel Lévy pour l’édition des œuvres posthumes de Louis Bouilhet [Philippe Leparfait est le fils adoptif de Louis BOUILHET, dont Flaubert avait confié à Michel Lévy l’édition des Dernières Chansons.]
Flaubert a su que Leparfait avait vu Lévy : « Je suis curieux de connaître le résultat de la visite. Je te dirai pourquoi je n’ai pas été à Paris. Mon voyage est remis au milieu de janvier. Mais je peux payer l’enfant de Jacob [Lévy] dès maintenant. M me Sand veut qu’il me fasse des excuses pour nous réconcilier. – Vas y voir ! » Il a appris, à « l’enterrement du père Pouchet », qu’il y avait un terrain libre [pour élever un monument à la mémoire de Bouilhet]…
Correspondance (Pléiade), t. IV, p. 623.
62 FLAUBERT Gustave (1821 - 1880).
L.A.S. « Gve Flaubert », Paris Lundi soir [février 1874, à Jules ROHAUT] ; 1 page in-8. « Je suis pour le moment dans les dernières retouches du Candidat. Mon ms est à la Censure, on copie les rôles & j’entre en répétition vers la fin de cette semaine, donc votre serviteur est fort occupé »... Il aurait cependant besoin de Rohaut pour un renseignement, et il l’invite à venir chez lui un matin. « Il s’agit (mystère :) de me découvrir un amoureux. – Jeune, beau et romantique ! »…
Correspondance (Pléiade), t. V, p. 1077.
600 - 800
600 - 800
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 24
6 000 - 8 000
63 FORT Paul (1812 - 1960).
Manuscrit autographe signé, Chansons à la Gauloise…, 1918 ; 311 pages in-8, montées dans un volume in-fol., reliure janséniste maroquin bronze, dos à 5 nerfs, double filet sur les coupes, large dentelle intérieure, doublure et garde de papier marbré, étui bordé et doublé (Lortic).
Manuscrit complet de ce recueil de Ballades françaises (25 e série, Eugène Fasquelle, 1919), soigneusement mis au net et calligraphié en vue de l’édition : mise en page calligraphiée, aucun détail n’est omis, la dédicace, les filets, les paginations, les titre-courant, ce qui doit être souligné, le justificatif de tirage, la table... le tout à l’encre noire. Paul Fort a, en outre, ajouté sur chaque page, à la mine de plomb, les indications typographiques de corps, de caractères, de tailles, de blanc.
Le titre primitif était Écoutez la Caille ! ; il a été remplacé par Chansons à la Gauloise sur la vie, le rêve, l’amour, avec Écoutez la Caille ! en épigraphe. Les titres de ces cinquante chansons sont évocateurs : Les Amoureux, Les Parents abandonnés, La Ronde joyeuse, La Valse de l’oursin, Sur les jolis ponts de Paris, Le Coucou, L’If, Le Dit du Crapaud, La Mégère apprivoisée, Volupté, L’Ombre interminable
Une carte de visite a été montée en tête, adressée à Pierre GOMPEL : »Mon cher ami, je vous remets le manuscrit d’un livre qui va paraître chez Fasquelle, et dont je voulais vous montrer les épreuves : Chansons à la Gauloise
Vous trouverez aussi sur votre table Barbe Bleue avec grande quantité de brouillons et de premiers jets »…
Provenance : Pierre GOMPEL (dédicace), puis Vicomte CLAIR (ex-libris).
64 FRANCE Anatole (1844 - 1924).
MANUSCRIT autographe, [Discours prononcé à la Ligue des Droits de l’Homme, 1904] ; 8 pages in-4 en un volume demi-maroquin rouge à coins. Discours en faveur de la séparation de l’Église et de l’État
Ce vibrant discours politique, prononcé le 18 décembre 1904 lors de la « Journée laïque pour la séparation des Églises et de l’État » organisée par la Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen au Trocadéro, a été publié dans le Bulletin officiel de la Ligue des Droits de l’Homme du 16 janvier 1905 ; recueilli en 1906 dans Vers les temps meilleurs (Pelletan, 1906, t. II, p. 89), il a été réutilisé et développé dans plusieurs chapitres de L’Église et la République (Pelletan, 1904). Anatole France a inséré dans son manuscrit, de premier jet, à l’encre noire ou violette, quelques coupures de presse.
France expose « le véritable sens du Concordat et les raisons pour lesquelles l’église veut maintenir à tout prix cette convention détestable »… Attaquant vivement le pouvoir temporel que l’Église de Rome veut établir en France, il conclut : « Mais les forces qu’elle tourne contre vous, de qui les tient-elle ? De vous. C’est vous qui, par le Concordat, maintenez son organisation, son unité. C’est vous qui la constituez en puissance temporelle. […] Administrée par vous, elle domine toutes vos administrations. Rompez les liens par lesquels vous l’attachez à l’État, brisez les formes par lesquelles vous lui donnez la contenance et la figure d’un grand corps politique. Et vous la verrez bientôt se dissoudre dans la liberté ».
25 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
1 000 - 1 200
300 - 400
65 GANCE Abel (1889 - 1981).
Environ 300 L.A.S., 1954 - 1979, à Nelly KAPLAN ; environ 400 pages formats divers, la plupart in-4. au stylo à bille rouge, bleu, plus rarement au crayon, de différents formats souvent in-4. Importante correspondance amoureuse et artistique du cinéaste à Nelly Kaplan, qui fut sa maîtresse et sa collaboratrice
Correspondance amoureuse et passionnée, voire érotique, souvent dévorée par la jalousie, elle est aussi évocatrice du travail du cinéaste avec celle qui fut sa Muse dans ses dernières années.
C’est en 1954, lors d’une réception en hommage à Georges Méliès qu’Henri Langlois, directeur de la Cinémathèque, présente Nelly Kaplan à Abel Gance ; la beauté de la jeune femme éblouit le vieux cinéaste dont elle deviendra l’assistante ; à ses côtés, elle se passionne pour la Polyvision. Elle l’assiste dans le tournage de La Tour de Nesle (1954, où elle tient un petit rôle sous le pseudonyme de Nelly Dominique). Elle l’assiste également pour le projet de Magirama (1956) et dans le scénario et le tournage d’Austerlitz (1960).
Le 19 décembre 1956, au Studio 28, le Magirama concrétise les recherches du génial cinéaste sur la Polyvision (dont Nelly Kaplan écrira le Manifeste). Composé avec Nelly Kaplan, le dispositif comprend quatre courts métrages : Auprès de ma blonde, Châteaux de nuages, Fête foraine, et le dessin animé Begone Dull Care de Norman MacLaren, ainsi qu’une version d’une heure du J’accuse ! de 1937 en polyvision. Conçu pour « sauver le cinéma qui se meurt », Magirama quitte l’affiche au bout de huit semaines.
En 1959 - 1960, Nelly Kaplan publie sous le pseudonyme de Belen des nouvelles érotiques sous forme de plaquettes à tirage limité : La Géométrie dans les spasmes, Délivrez nous du mâle, Le Réservoir des sens... Son premier court métrage est consacré au peintre Gustave Moreau (1961) ; plus tard, en 1969, elle réalisera La Fiancée du pirate Nous ne pouvons donner ici qu’un bref aperçu de cette abondante correspondance (accompagnée de petits papiers de NK datant ou résumant les lettres), adressée à « Mon Phénix enflammé », « Mon étoile australe », « Mon SCygne », « Ma fontaine d’Aréthuse », « Diamant noir », « Cygne noir », « Ma chère Source », « Amanelly », « Ma magicienne étoilée », « Ma chère petite sirène », « Mon cher petit Hamlet féminin », etc. Des pages couvertes de « Je t’aime », dont une répartie en « Polyvision »où se mêlent tous le éléments du blason féminin (15 août 1955).
On relève aussi une note ancienne sur les « Essais-inventions Ab. Gance à faire en 1928 » : « Projeter avec triptyque : une bande avec écran bleu », une avec écran rouge, une avec écran jaune « superposées. On doit avoir ainsi la COULEUR et le RELIEF »… Ainsi qu’une liste de brevets (de 1926 à 1954) : Pictographe, Protérama, perspective sonore, etc. ; des extraits recopiés par Gance de son livre Prisme ; des poèmes : « Princesse aux yeux couleur d’abeille »… (23 mars 1957) ; quelques dessins sur des nappes de restaurant….
1954 Août. Jalousie après un dîner de NK avec Michel Boisrond (assistant dans La Tour de Nesle) : « Travaille. Soigne ta santé. Couche toi tôt. Respire. […] Ne te laisse pas envahir par les sens »… 9 septembre (après une scène terrible avec Mme Gance qui veut faire expulser de France NK), il la rassure : « Courage. Persévérance. Élévation. Optimisme. Je suis malade de dépression nerveuse et cependant je réagis ». Septembre : jugement du caractère de NK : « passivité et indolence, dues à ses origines argentines » ; récriminations ; il cite Nietzsche ; il ne fera pas de raccords avec NK sur La Tour de Nesle… En octobre, NK, se considérant comme trahie, s’enfuit seule à Juan-les-Pins, Gance s’inquiète (9 octobre) : « Travailles-tu au Cinéma de l’Avenir ? Tu me parais bien silencieuse sur la direction nouvelle de tes idées. La flèche de l’enthousiasme fait-elle boomerang ? En vérité je te reconnais mal depuis que le sel te lave de nos nuits. Es-tu descendue du train ? Me laisses-tu seule à poser les rails parce qu’il y a eu un heurt ? Où est ton visage ? Où est ta vraie force ? Ma naïveté t’interroge mon Cygne adorable. Chaque silence de toit est un aveu d’éloignement ». Il commente la Lyrosophie de Jean EPSTEIN, puis revient à ses jalousies… 18 octobre : « Le feu s’éteignait lorsque le CSygne pour la seconde fois est entré dans ma vie. Ton haleine de grand oiseau solitaire s’est complu à souffler sur la cendre chaude que le vent s’apprêtait à disperser, et la flamme s’est rallumée plus brillante qu’elle ne le fut jamais. Les embra ss ements d’un monde meilleur dans les embra s ements de demain : c’est à toi que je le devrai ». Ailleurs, au milieu d’obsessions érotiques, il s’écrie : « Aide-moi à me retrouver ». Il est ébloui par la beauté physique de NK, mais son psychisme lui échappe ; et cela le déstabilise… 15 novembre : « Pourquoi n’es-tu pas plus libre et plus indécente avec moi ? […] Je sens que tu n’as pas confiance dans ce que je t’ai dit une fois pour toutes, que loin de tirer fiel ou jalousie de tes prouesses ou de tes recherches érotiques elles ne faisaient qu’enflammer et amplifier mes propres ardeurs. L’érotisme pour moi, c’est le surréalisme de l’amour. Nous le cherchons tous deux en art. Et nous le frénerions en amour ? Cela n’est explicable que par une méconnaissance de ta part des rouages de mon cerveau. […] La belle inconnue de l’Orient-Express ne doit plus avoir aucun secret de cet ordre pour l’homme qu’elle reçoit de nuit dans sa cabine, même si fatigué il s’endort dans ses bras ! »…
1955. Il est beaucoup question cette année de leur travail en commun sur la Polyvision. 8 janvier : « Je n’ai pas à accepter de suggestion sur ce qu’il convient de faire dans la Polyvision. En étroit accord avec ma collaboratrice Nelly Kaplan je ne veux pas servir de cobaye pour des expériences qui, entreprises dans un esprit différent du nôtre, se tourneraient certainement à notre désavantage, par exemple collaborer ou rafistoler des films d’autres metteurs en scène ». 20 mars. Il se demande si NK l’aime ou seulement l’admire… « Tu mérites mieux que moi »… Lettre métaphysique où Gance explique a eu la vision des jours qui lui restaient à vivre ; le pont entre la Vie et la Mort… 17 avril Il déplore le retard pour le Royaume. Il a pleuré, il a besoin d’elle… 26 avril. Problèmes financiers de la Polyvision.
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 26
1 500 - 2 000
Projet du Bal interrompu, qu’il juge trop froid : « Nous n’avons pas assez souffert en l’écrivant »… 29 avril. Il revient sur l’affaire des photos de La Tour de Nesle, parle du tournage de la Fête foraine 6 mai. Le programme de Polyvision se met en route. Il parle de films divers et des complots contre la Polyvision…7 ou 8 mai. UGC et CNC se renvoient la balle pour payer… Il a une intuition de graves dangers. Il ne vit que pour NK. 9 mai. Il ira la chercher à la gare à son retour de Cannes. Il se désole du « pépin » de santé (elle est enceinte de Gance). Le paiement d’UGC arrive. Il aurait primé French Cancan. Orages chez lui…. 21 juin, longue analyse en 3 parties (A, B, C) du caractère de NK. Ailleurs, il cite les lignes prophétiques d’Apollinaire qui font entrer de plain-pied dans le cinéma tel que Gance le voit.. Il transcrit et commente un éloge de la sodomie par le chevalier de Nerciat….
1956. Préparation du programme de Magirama (29 avril) ; les locaux de montage de GTC à Joinville. Orages chez lui. Il faut retravailler le Bal interrompu. Reproches : si NK n’entretient pas sa flamme, le pire arrivera. Soucis d’argent, mais il est fou d’espoir tant que NK sera là. Les théories d’Einstein et les siennes. 25 novembre, très beau texte sur NK destiné au programme de Magirama au Studio 28 : Un nom à retenir : « Inconnue d’hier, elle sera célèbre demain. Elle est venue intuitivement à la Polyvision comme Mozart jeune était venu à la musique, pressentant avec une sorte de géniale prémonition que les ondes visuelles du Cinéma devaient posséder elles aussi leur musique, dont personne encore ne savait jouer faute d’un langage technique pour la rendre sensible »… Etc.
1957. Récit d’un rêve dans la nuit du 12 au 13 janvier, avec André BRETON dans son atelier…Dessin sur une nappe de restaurant, tête de femme : « La fée assassinée ». Crises de jalousie à l’égard de Philippe Soupault et André Breton. Carton jouant le « douanier » pour essayer d’empêcher les amis de NK de jouer aux contrebandiers de l’amour… 1958. Belle lettre d’amour (6 mai ) : « Je ne t’écris pas mon oiseau d’or aux ailes invisibles parce que je ne trouve pas de mots assez beaux pour toi. Le parfum qui n’existe pas, la fleur inconnue, la couleur que personne ne perçoit, c’est toi. […] Tu fabriques de l’infini comme les nébuleuses, et je ne puis suivre ton essor que parce que tes ailes me recouvrent »… 9 mai. Travail laborieux sur le son et lumière du château de Chenonceau ; Gance est déçu du résultat… Problèmes avec les producteurs d’Austerlitz. Lettre à Henri LANGLOIS interdisant de projeter la mauvaise copie de La Roue. Réunion à Évian avec les Salkind, producteurs d’Austerlitz ; les discussions vont commencer… Brigitte Friang et André MALRAUX s’occupent de ses problèmes. Il n’aime pas La Soif du Mal. Problèmes fiscaux. Dépression et ennuis de santé. Il part se reposer au château du Rondon (26 août). Il décline l’offre de NK de lui prêter de l’argent… Il a vu un médecin : arthrose cervicale. Soucis de travail, il avance mal, mélancolie (27 août). Crise de larmes à la lecture du Napoléon de Joseph DELTEIL : « C’est un poète du mot qui parle d’un poète de l’action »… Coup de fil de Brigitte Friang qui le rassure quant au soutien de Malraux : « M ne me laissera pas tomber »… (28 août). Jalousie : il craint que NK ne lui échappe… Il se remet au travail : idée d’un film comique avec un personnage genre de Funès en opposition à un Soldat Chveik (29 août). Risque de saisie par le Fisc. Malraux n’a pas tenu sa promesse et lui propose de faire un documentaire sur les constructions de la Défense ! Il n’est pas dupe de la ruse de NK qui a inventé d’avoir gagné à la loterie pour qu’il accepte un prêt d’argent (30 août). Lettre officielle pour confirmer l’engagement de NK comme sa collaboratrice et assistante « dans la préparation, l’exécution, et le montage de cette grande œuvre historique », louant son apport intellectuel et son dévouement (1er octobre). Il a enfin trouvé le ton du film : « Je joue beaucoup sur le côté “intime” je dirai même “comique” : l’envers de la gloire, les pantoufles. Je crois que j’ai trouvé ce ton, pour éviter ce côté “compassé” qu’on attend » (2 septembre). Longue lettre détaillée sur l’écriture du scénario d’Austerlitz (3 septembre). Il ne veut pas lâcher Austerlitz après les échecs de la Polyvision, du Royaume et du Vampire de Dusseldorf. Il remercie NK de lui avoir donné de l’argent pour payer ses impôts.
1959. La distribution d’Austerlitz : Jean Marais, Annie Girardot pour Joséphine… Le 22 mai, il menace de casser l’affaire s’il n’a pas les contrats pour lui et NK. Lors du tournage d’Austerlitz à Zagreb, Gance est inquiet, il craint que NK s’éloigne de lui, il sait qu’il n’est souvent que l’ombre de lui-même (11 octobre) ; il accuse NK de vivre dans l’alcool et les nuits blanches, et de négliger son travail (14 novembre). Reproches : NK lui prend ses pensées, « Nelly triomphe et Belen pleure »…
1960. Il commente un poème d’Apollinaire en le comparant à ses sentiments. Commentaires sur les contes de Belen :
d’où NK tient-elle cette « connaissance » des abymes de l’érotisme ? Mais elle est sauvée car elle a repris le goût du travail… Il n’est plus jaloux ; il va écrire la préface (pour Le Sunlight d’Austerlitz de NK, 9 mai). Reproches et jalousie ; il Se plaint du peu de « faveurs » qu’on lui octroie. Il signe « Ton vampire qui a perdu son groupe sanguin » (4 juillet).
NK n’a qu’une seule amie : elle-même. « Ne laisse pas ton cœur dans le chaudron du sabbat » (13 juillet)… NK étant à Venise, Gance fantasme dans un miroir magique. Problèmes avec le fisc. Austerlitz a dépassé les 300.000 entrées, et ses forces lui reviennent. Introspection : il voit en lui trois êtres différents…. (15 septembre).
1961. NK est à New York pour son film sur Gustave Moreau. Lettre sur un étrange phénomène métapsychique. Sonorisation de J’Accuse. Soucis matériels. Mais l’Au-delà s’intéresse à lui (2 juillet)…. Problèmes d’argent. Début du projet de Cyrano. Gance rend les avances à Lux, qui n’aime pas le scénario... Il s’inquiète de l’avenir du Cinérama (qui a tout pris à ses inventions) et envisage des salles ambulantes. Il se sent trahi. Découragé, il se remet au projet de Cyrano (11 décembre). Pourparlers avec les gens de Cinérama…
27 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
Le film perd sa base. Comment tiendra-t-il en équilibre ? » Il termine en couvrant NK de « baisers fantômes » et juge
Le Procès de Jeanne d’Arc de Robert Bresson « aussi barbant que Bérénice, mais c’est superbe de sobriété. À force de supprimer le cinéma, on arrive à un autre langage idéographique »…
1963. Il est « harcelé par les mille soucis de la préparation de Cyrano » (lettre signée du dessin d’un petit oiseau « bleu ! »).
1964. Lettres de Grèce (après l’épuisement du tournage de Cyrano et d’Artagnan, NK avait offert à Gance un voyage en Grèce). Son voyage le rend encore plus voyant. Il voit Belen dans chaque statue, dans chaque paysage… (9 avril). Difficultés avec le remontage de Cyrano et les sous-titres… 26 août. Enthousiasme à la lecture du Manifeste d’un art nouveau la Polyvision de NK : « chargé d’une Bombe H abstraite d’une puissance incalculable. On ne dira pas mieux dans 50 ans, sur l’époque, sur le cinéma, sur la Polyvision » ; il faut le faire traduire en chinois, NK est une prophétesse… Projets d’un voyage en Chine, avec rencontre de Mao ; liste des projets à monter avec les Chinois…
1965 1er janvier. Longue lettre démoralisée : « je pense avec effroi à cette date limite de 77 ans que je m’étais assignée […] On ne ravale pas l’amour comme une maison. Aucune des taches d’ombre ou de soleil qu’il a laissé ne s’efface. Je n’ai pas pu oublier ces trois dernières années où je t’ai senti couler entre mes bras comme un sauveteur qui n’a plus la force d’atteindre la rive. Mais tu es sirène et tu sais vivre sous l’eau de la vie mieux que moi. […] Je me bats sur tous les fronts mais je n’ai plus aucune illusion – ma “phosphorescence” est mouillée par des larmes internes, et je n’ai jamais si bien compris l’absurdité totale de la Vie »… Il songe à un Marie Tudor… Etc.
66
GAUGUIN Paul (1848 - 1903).
L.A.S. « Gauguin », [Rouen vers la mi-août 1884], à Camille PISSARRO ; 2 pages in-8 à l’encre violette. Gauguin à Pissarro
Il s’inquiète d’être sans nouvelles de son ami, et craint qu’il ne soit fâché contre lui ; mais il n’a peut-être pas reçu sa lettre d’il y a 15 jours « avec 2 photographies de mes enfants »…
Il a reçu la visite de Paul LAFOND, « un ami à DEGAS qui vient assez souvent à Rouen ; depuis deux mois il me cherchait »...
Quant à Eugène MURER, « il est à Paris depuis pas mal de temps ; je crois que son affaire de l’hôtel ne va pas tout à fait bien. J’ai lu dans le journal un jugement qui le condamnait pour cette affaire avec la faillite. Maintenant je ne sais de quelle importance est ce jugement »…
Correspondance (éd. V. Merlhès), t. I, p. 67 (n° 51).
10
000
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 28
Provenance : Archives Camille PISSARRO (vente 21 novembre 1975, n° 66). - 12
000
1962 3 janvier, longue lettre aux encres de différentes couleurs faisant le point sur leur relation : « Ami, Amant, Associé ? Les mois qui viennent en décideront. […] Il nous faut donc signer un contrat moral d’ami et d’associé, sans faille, et au-dessus des vagues passionnelles quelles qu’elles soient si nous voulons regagner le temps perdu. Tous les petits problèmes personnels me semblent dépassés. Mais il faut que tu arrives à avoir le poids de ton or, moi aussi d’ailleurs ! »…19 mai, autre longue lettre sur l’éloignement de NK, l’écriture de Cyrano : « je dois couper 180 pages !
67 GAUGUIN Paul (1848 - 1903).
L.A.S. « P. Gauguin », [Copenhague fin novembre-début décembre 1884], à Camille PISSARRO ; 4 pages in-8. Belle et longue lettre de Gauguin sur son arrivée au Danemark et ses nouvelles peintures
Il a à peine fini son « qui a été fort difficile, vu que les propriétaires sont dans ce pays excessivement méticuleux ; la plupart ne veulent pas d’enfants, si cela continue ce sera un crime d’avoir des descendants »...
Il remercie Pissarro de ses observations sur son tableau... « Dans ma nouvelle recherche les ciels sont difficiles.
Je cherche à faire très simple et cependant très divisé de tons : ma nouvelle facture qui est peu croisée répond à cela avec de grands points d’arrêt. Le ciel est toujours très lumineux sans grands écarts ; par suite de son essence limpide et humide il ne peut comme un mur avoir des rudesses de grain quoique mat. Je sais bien que la grande justesse de ton doit donner cela. Il me faut de l’exercice et j’en ai encore très peu par rapport à vous tous. Nous verrons par la suite.
Copenhague est extraordinairement pittoresque et où je demeure on peut peindre des choses très caractéristiques et très jolies. En ce moment il gèle à 10 degrés et les traîneaux circulent dans la rue.
J’enrage de ne pouvoir peindre en ce moment, dans quelque temps j’espère envoyer à Paris plusieurs choses intéressantes. En Danemarck c’est très facile ou très difficile d’être un peintre fort. Très facile parce que ce que l’on voit est tellement mauvais, de si mauvais goût, que la moindre chose d’art doit éclater au milieu de cela. D’un autre côté c’est très difficile parce que ce courant mauvais est tellement dans le caractère national que c’est presque une impolitesse de faire autrement ».
Il décrit à son ami l’intérieur d’un salon danois, avec « des meubles en noyer verni toujours neufs », des bustes de poètes « avec des fleurs et des rubans autour », des photographies partout, et « quelques paysages à l’huile comme des chromo ».
Il attend les eaux-fortes de Pissarro. sa femme a trouvé des leçons de français… « les Danois sont gens méticuleux aigre doux mesquins et d’un schoking extravagant. Un enfant de 2 ans ne pisse pas dans la rue, cela choquerait les mœurs. Un ménage illégal est défendu par la loi et peut être puni. Par contre les fiancés peuvent se promener n’importe où deux à deux. Que dites-vous de cela »…
Puis il parle longuement de ses talents de graphologue, qui lui permettent de découvrir le caractère des gens d’après leur écriture : « Je ne suis pas encore très savant mais je suis sûr de découvrir un jour non seulement le caractère mais le sentiment qui a guidé une lettre. […] la pensée influe directement sur l’écriture ».
Il demande si Pissarro a reçu une lettre de CÉZANNE. Mette, la femme de Gauguin, ajoute quelques mots pour Mme Pissarro. Correspondance (éd. V. Merlhès), t. I, p. 76-77 (n° 57).
Provenance : Archives Camille PISSARRO (vente 21 novembre 1975, n° 59).
68 GAULLE Charles de (1890 - 1970).
L.A.S. « C. de Gaulle », 24 novembre 1946, à Michel DEBRÉ ;1 page in-8 à son en-tête Le Général de Gaulle, enveloppe autographe.
Réponse à des vœux pour son anniversaire (22 novembre).
« Très touché de vos vœux, mon cher ami, je prends l’occasion de mes remerciements pour vous dire qu’étant donné le cours des événements je m’affecte peu de ne pas vous voir élu. Venez me voir au début de décembre »…
[La Constitution de la IVe République avait été adoptée par référendum le 13 octobre 1946, contre l’avis du général de Gaulle, et, le 10 novembre, les élections législatives virent l’échec presque total de l’Union gaulliste. Michel Debré, qui avait adhéré au parti radical sur le conseil du général, échoua à conquérir un mandat de député en Indre-et-Loire, mais, devenu secrétaire général au secrétariat aux Affaires allemandes et autrichiennes, continua d’être un fidèle soutien de de Gaulle.]
69 [Charles de GAULLE (1890 - 1970)].
Edgard PILLET (1912 - 1996)
Buste de Charles de Gaulle, Alger 1943. Épreuve en bronze patiné à cire perdue. Signée du monogramme, justifiée épreuve d’artiste 2/4. Cachet du fondeur J. Cappelli Cire perdue. Marqué sur la terrasse : « Alger 43 ». Hauteur : 47 cm. Ce buste a été réalisé à Alger en 1943, à l’instigation de Gaston Palewski et Georges Gorse du cabinet du Général. Edgar PILLET, titulaire d’une bourse de séjour à la villa Abd el Tiff en tant que lauréat de l’École supérieure des Beaux-arts de Paris, se trouvait depuis 1939 à Alger.
Provenance : vente Ader, 3 décembre 2010, n° 110.
29 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
8 000 - 10 000
1 000 - 1 200
600 - 800
70
GAUTIER Théophile (1811 - 1872).
POÈME autographe signé « Théophile Gautier », Ghazel ; 1 page oblong in-fol. (papier un peu jauni).
Belle page d’album
Ce poème de 4 quatrains conte l’histoire d’un sultan fou de jalousie qui tue sa favorite, qu’un nuage a pu contempler nue. Il parut en 1838 sous le titre Le Nuage dans le recueil La Comédie de la mort
« Dans son jardin la Sultane se baigne
Elle a quitté son dernier vêtement
Et délivrés des morsures du peigne
Ses grands cheveux baisent son dos charmant »...
Au verso de cette page d’album, trois trois autres poèmes, autographes signés.
Sophie GAY : À un exilé, par (quatrain) : « En dépit des regrets où l’absence vous livre »…
Antoni DESCHAMPS, 2 poèmes : – À Jules Janin, 6 vers, début de la pièce XXIII de son recueil Résignation (1839) :
« Il est sous le soleil deux adorables choses »… ; – À Monrose, 15 vers, pièce XCI de Résignation : « Hier je rencontrai sur le bord d’un chemin / Thalie assise en pleurs, la tête dans sa main »...
GLEIZES Albert (1881 - 1953).
MANUSCRIT autographe signé « Albert Gleizes », La Peinture et ses lois. La nouvelle conception du naturalisme, 1922 ; 28 feuillets in-4 sous chemise autographe (bords effrangés à quelques feuillets).
Important texte théorique
La chemise présente un sous-titre différent de celui placé en tête du manuscrit : « ou Du cubisme à une nouvelle application du naturalisme dans l’œuvre plastique », avec la date : « Commencé le Lundi 5 Juin 1922 », et un petit croquis à la plume.
Le manuscrit est rédigé à l’encre violette, d’une petite écriture serrée emplissant le recto des feuillets ; il présente de nombreuses ratures et corrections. Le début est en deux versions différentes ; le manuscrit est inachevé, et a servi à établir un dactylogramme Un feuillet, intitulé L’œuvre peinte, présente un sommaire en 9 chapitres :1. Le Moyen âge au point de vue renaissant et actuel. 2. La Peinture et la Religion. […] 9. Début du XXe, intellectualité ».
Ce manuscrit donne une version primitive du début de l’essai de Gleizes, La peinture et ses lois : ce qui devait sortir du Cubisme, publié dans la revue La Vie des Lettres et des Arts en mars 1923, et en plaquette en 1924 « Nous vivons une époque extraordinairement émouvante. Il semble que nous soyons entraînés par un courant d’une puissance inouie qui projette contre une muraille les hommes et les ouvrages sortis d’eux comme pour en annuler l’apparence et effacer le souvenir »… Ainsi commence Gleizes, avant d’entamer un long développement sur l’histoire de l’art, qui s’interrompt ici avec l’Empire ; le dernier feuillet, dont un quart seulement est écrit, est l’ébauche d’un développement sur le XIXe siècle.
72 GONCOURT Edmond de (1822 - 1896).
12 L.A.S. « Edmond de Goncourt », 1891 - 1894,à Henry SIMOND ; 15 pages in-8 ou in-12. Au rédacteur de L’Écho de Paris Edmond de Goncourt évoque la publication du Journal, dont il a donné la Préface au Figaro, la correction des placards…Il demande (18 décembre 1891) d’annoncer « La Guimard ou la Terpsichore de l’Opéra, une biographie de la célèbre danseuses d’après des documents inédits »… 17 avril 1893, envoi d’une article « du plus haut intérêt au point de vue du bon marché de la vie dans les premières années du 18 ème siècle, comparé à la cherté de la vie d’à présent »… 16 juin 1893, en cure à Vichy (en-tête Casino de l’Établissement thermal de Vichy ), il envoie, pour publication dans le journal, le texte de sa ferme réponse à l’armateur Georges Faustin, qui lui interdisait d’intituler sa pièce La Faustin
800 - 1 000
1 000 - 1 500
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 30
1 000 - 1 500
71
73 GOUNOD Charles (1818 - 1893).
L.A.S. « Charles Gounod », Vienne 17 août 1842, à Jean-Dominique INGRES ; 3 pages et demiein-8 avec adresse. Très belle et longue lettre du jeune compositeur au peintre Ingres, unis dans l’amour de la musique de Beethoven
Gounod est allé en pèlerinage sur le tombeau « de l’Immortel BEETHOVEN […] vous savez avec quel culte je prononçais ce nom à Rome […] Je ne sais quelle impérieuse influence l’idée de Beethoven a toujours exercée sur moi, mais je ne puis m’y soustraire ; il me tient, et je l’aime comme on aime le Soleil : or, on n’a qu’une manière d’aimer son soleil, parce que l’on en a qu’un. Oui je crois toujours que Beethoven est l’Astre le plus beau le plus splendide que le firmament musical ait encore vu luire. […] Ici, à Vienne, où cet homme sublime a tant vécu, où chacun sait encore et peut vous montrer les promenades qu’il fréquentait, je recueille avec avidité le moindre mot que j’en puis entendre dire. Quoique l’état actuel de la musique à Vienne souffre aussi de la gangrène de l’Italie, cependant le nom de Beethoven s’y prononce encore avec une solennité qui vous va droit au cœur, et on se sent tout ému et une bonne grosse envie de pleurer comme un enfant, en voyant que le souvenir au moins conserve l’empreinte de cette majesté que la marche momentanée de l’Art a malheureusement désavouée. Pour moi le soutien le plus fort en musique c’est lui : c’est toujours à lui que je pense et je l’aime avec un amour infini. Je me fais raconter ici les moindres détails de sa vie […] si bizarre, si inquiète, si capricieuse […] Si comme forme d’art il s’est élevé à des hauteurs immenses cette infatigable et errante méditation qui fait la Base et on peut dire l’Abime infini de ses œuvres n’est elle pas là dans cette vie agitée, nomade, qu’il menait à Vienne et autour de Vienne ? »… On peut rire de lui, mais moi je suis heureux de cette tendresse fanatique pour le moindre trait qui touche à Beethoven […] je sais si bien votre chaleureuse et intelligente admiration pour ce géant de le musique que je vous associais en pensée » devant sa tombe, qu’il décrit, ainsi que la pauvre tombe de SCHUBERT… « Moi pauvre aspirant en fait de gloire, j’ai aussi cueilli un souvenir de Schubert : mais c’est pour moi : je ne vous envoie, cher Monsieur Ingres, qu’un brin d’herbe pris à Beethoven. […] j’ai donc pu malgré ma profonde et unique vénération pour l’Empereur de toute les musiques, m’incliner aussi avec respect devant le Roi de la Ballade et des chansons : c’est une petite province, mais il en était le n°I, et jusqu’à présent il conserve cette suprématie »… Est jointe une enveloppe contenant une feuille séchée, avec l’inscription : « Feuille cueillie sur le tombeau de Beethoven par Ch. Gounod le 16 Août 1842 ».
31 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
600 - 800
74
GOUNOD Charles (1818 - 1893).
MANUSCRIT MUSICAL autographe signé, [37 cantiques et motets, vers 1843 - 1846] ; carnet oblong petit in-4 de [1-33] feuillets la plupart recto-verso, plus des ff. vierges, reliure de l’époque basane noire, cadre de filets dorés et à froid sur les plats, titre au dos Saluts
Important recueil de 37 chœurs religieux, motets et cantiques en latin, du jeune compositeur au début de sa carrière, alors qu’il songe à entrer dans les ordres.
Ces compositions sont notées avec soin dans un carnet de papier musique à 16 lignes, à l’encre brune ou parfois bleue, probablement directement, comme en témoignent plusieurs pages où une esquisse au crayon a été ensuite repassée à l’encre. Gounod a utilisé ce carnet alors qu’il était maître de chapelle à l’église des Missions étrangères, où il prit ses fonctions le 1er novembre 1843. L’effectif requis dans ces motets correspond à celui de la maîtrise qu’il avait sous ses ordres. Le carnet est divisé en trois parties, séparées par plusieurs feuillets vierges. Gounod a organisé ces compositions en « Saluts », fêtes solennelles réservées à certaines dates, comprenant, outre les chants traditionnels, un motet au Saint-Sacrement et une antienne à la Sainte Vierge, et parfois une prière pour la paix (Da pacem). Certaines antiennes à la Vierge pouvaient également être chantées à l’office des Complies. Ce carnet a été cédé vers 1858 à l’éditeur Alfred Lebeau (18355 - 1906), comme en témoigne cette note autographe signée de Gounod sur le feuillet de garde :
« Moyennant que Mr Lebeau ainé, éd. de musique, 4, rue Ste Anne, s’engage à graver :
1° Les Sept paroles de N.S.J.C. (dédié à Mgr Sibour)
2° La Symphonie en mi b, partition orchestre ; Je reconnais comme étant sa propriété, les susdits morceaux, ainsi que tous ceux contenus dans ce volume ; sauf ceux paraphés de ma signature, et qui sont gravés ailleurs.
Je reconnais en outre que ma Messe solennelle de Ste Cécile, en sol majeur, gravée chez Mr Lebeau, est également sa propriété.
Ch. Gounod
[Une note de Lebeau renvoie au 2° :] La symphonie est passée entre les mains de Mr Choudens par un traité d’un commun accord, le 28 octobre 1862. Lebeau aîné.
Certifié – Ch. Gounod ».
Trois de ces motets avaient en effet paru, rassemblés en un « Salut », à la suite de la Messe brève en ut mineur publiée par Richault en 1846, un autre dans le journal La Maîtrise (15 avril 1858) ; la plupart furent publiés par Alfred Lebeau dans son journal ou séparément, et recueillis dans les 60 Chants sacrés, Motets avec accompagnement d’orgue ou de piano, pour messes, saluts, mariages, offices divers (Lebeau, 1878).
La première partie du carnet est consacrée à treize Saluts a cappella
– S A lUT I (en fa majeur) : Adoro te Supplex à 4 voix (dessus 1 et 2, ténor et basse, 1 p.) ; Salve Regina à 4 voix, Andante (2 p.) ; Da Pacem à 3 voix (dessus, ténor et basse), Moderato (2 p.). – S A lUT II (en la bémol majeur), à 4 voix d’hommes (2 ténors, 2 basses) : O Salutaris (1 p.) ; Alma Redemptoris mater (Temps de l’Avent), Andante (2 p.) ; Deus meminerit, Très large (1 p.). – S A lUT III, à 4 voix d’hommes (2 ténors, 2 basses) : Ave Verum (en ut), Andante (2 p.) ; Sub tuum præsidium (en mi bémol majeur) (2 p., avec note a.s. en marge : « chez Richault Ch. Gounod »). – S A lUT IV, à 4 voix mixtes (2 dessus et 2 basses) : O Salutaris (en fa majeur, 1 p.) ; Ave Regina, « Depuis la Purification jusqu’au Mardi Saint, inclusivement » (en la majeur, 2 p.). – S A lUT V, à 5 voix : O Salutaris (en ré bémol majeur, soprano, 2xténors, 2 basses, 1 p.) ; Regina Cœli (en la bémol majeur, 2 sopranos, ténor, 2 basses, 2 p.), Allegretto giocoso. La table prévoit aussi un Deus meminerit qui n’a pas été écrit. – S A lUT VI, à 3 voix d’hommes (ténor et 2 basses) : Ave verum (en ut majeur), Andante (2 p.) ; Da Pacem (en fa majeur, 1 p.). La table prévoit entre les deux un Sancta Maria qui n’a pas été écrit. – S A lUT VII, à 4 voix d’hommes (2 ténors, 2 basses) : O Salutaris (en mi bémol majeur, 1 p.) ; Per Sanctissimam Virginitatem (en la bémol majeur), Large (1 p.) ; Da Pacem (en mi bémol majeur, 2 p., avec note a.s. en marge : « chez Richault Ch. Gounod »). – S A lUT VIII, à 4 voix d’hommes (2 ténors, 2 basses) : Qui carne nos pascis (titre seul) ; Virgo Singularis (en la mineur, 1 p.) ; Da Pacem (titre seul). – S A lUT IX : Ecce Panis Angelorum (en fa majeur, 2 dessus, ténors, basses, 1 p.) ; Sancta Maria (en fa majeur, 2 dessus, ténors, basses), Andante (1 p.) ; « Le même (à 4 voix d’hommes) » (en la bémol majeur, 2 ténors, 2 basses), Andante (1 p.). – S A lUT X : Adoramus te Christe (en fa majeur, à 4 voix : soprano, alto, ténor et basse, 1 p.). La table prévoit aussi un Deus meminerit qui n’a pas été écrit. – S A l UT XI, voix d’hommes : Ave verum (en ut majeur, 2 ténors, 2 basses, 2 p.) ; Ave Regina cœlorum (en ut majeur, 2 ténors, 2 basses, 1 p.) ; Da Pacem (en sol majeur, ténor et basse). – S A lUT XII, à 4 voix d’hommes (2 ténors, 2 basses) : Ave Verum (en ré majeur, 2 p.) ; Inviolata (en ut majeur), Moderato quasi allegretto (2 p.) ; Deus meminerit (en ut mineur, 1 p.). – S A lUT XIII, à 2 voix (ténor et basse) : Panis Angelicus (titre seul) ; Sancta Maria, succurre miseris (en sol majeur, 1 p.). La table prévoit aussi un Deus meminerit qui n’a pas été écrit.
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 32
1 000 - 1 500
75
Après plusieurs feuillets vierges, viennent trois Saluts avec accompagnement d’orgue. – S A lUT n° 1 : Ave verum (en si bémol majeur, pour ténor solo et orgue), Andante sostenuto (2 p.) ; Sub tuum Præsidium (en si bémol majeur, pour ténor et basse, partie d’orgue non écrite, sur 3 p.) ; Da pacem (en si bémol majeur, pour ténor, basse et continuo, 2 p., note a.s. en marge : « Journal la Maîtrise Gounod »). – S A lUT n° 2 (en fa majeur) : Ave verum (pour ténor et basse, partie d’orgue non écrite, 2 p.) ; Salve Regina (pour ténor, hautbois, cor et orgue, seules les 4 premières mesures du hautbois solo sont écrites). – SA lUT n° 3 : Ave Verum (en mi bémol mineur, pour basse et orgue), Large (2 p.) ; Ave Regina cœlorum (en la bémol majeur, pour dessus, ténor et orgue, 2 p.) ; Panis Angelicus (titre seul, 4 mesures gommées).
À la fin du volume, un motet esquissé au crayon (16 mesures), une Oraison à la Très Sainte Vierge Marie à 4 voix en français (2 dessus, ténor et basse, en fa majeur), Lent (1 p.) ; et un Pater Noster (en fa majeur, pour 2 ténors et 2 basses), Très large (2 p.).
À la fin : « Table des morceaux contenus dans ce volume » (en fait, les seuls 13 premiers Saluts).
Bibliographie : sur l’importance de ces pièces dans l’œuvre de Gounod, et leur analyse détaillée, voir Gérard Condé, Charles Gounod (Fayard, 2009), p.760 - 823.
MANUSCRIT MUSICAL autographe signé « Ch. Gounod », Suite concertante en 4 parties pour piano-pédalier et orchestre, arrangement pour piano-pédalier et piano (1886) ; 1 feuillet de titre et 32 pages in-fol., relié en un volume demi-basane grenat.
Manuscrit de la transcription par Gounod de sa Suite concertante pour piano-pédalier et piano
Le 14 janvier 1886, Gounod cédait à Alphonse Leduc, pour 7.000 francs, la propriété d’une Suite concertante avec piano-pédalier, dont il devait donner le manuscrit le 7 avril, puis une réduction pour piano de la partie d’orchestre et une transcription pour deux pianos (qui sera finalement réalisée par Saint-Saëns). C’est la rencontre de la jeune et jolie Lucie Palicot, virtuose du piano-pédalier, qui incita Gounod à écrire une œuvre concertante pour ce rare instrument, pour lequel il composa trois autres œuvres, et dont elle est la dédicataire.
Paul Landormy se souvenait de Lucie Palicot jouant : « l’impression fut étrange de cette toute gracieuse et mignonne personne juchée sur une immense caisse contenant les cordes graves du pédalier sous un piano de concert reposant sur ladite caisse ; et surtout, ce qui nous surprit, assez agréablement d’ailleurs, ce fut de voir madame Palicot vêtue d’une jupe courte, au genou, bien nécessaire, mais étonnante en ce temps-là et s’escrimant fort adroitement de ses jolies jambes pour atteindre successivement les différentes touches du clavier qu’elle avait sous ses pieds, tout semblable à un pédalier d’orgue ».
Cette Suite concertante [CG 526] fut créée à Bordeaux le 22 mars 1887, lors d’un concert dirigé par Gounod, avec Lucie Palicot au piano-pédalier : « Je suis charmé de l’avoir enfin fait entendre », dira-t-il ; elle fut redonnée à Anvers le 8 décembre, puis à Angers le 6 février 1888.
Les quatre parties de cette Suite concertante recevront des titres, qui ne figurent pas sur le manuscrit : Entrée de fête, Chasse, Romance et Tarentelle
Le manuscrit est à l’encre noire sur papier à 12 lignes, annoté et corrigé au crayon noir et au crayon bleu ; il est signé à la fin. La page de titre porte la dédicace « à Madame Lucie Palicot », et la mention : « Arrangée pour PianoPédalier et Piano par l’auteur ». La partie de piano-pédalier n’est pas toujours notée, avec renvois pour le graveur à la partition. Cette transcription avec réduction de l’orchestre pour « piano d’accompagnement » a été éditée chez Alphonse Leduc en 1888 (l’éditeur a porté sa signature sur la page de garde, avec son cachet encre).
Le manuscrit est divisé en 4 parties (les mouvements ont été notés au crayon bleu par Gounod) : Moderato maestoso ; Allegro con fuoco, puis Andante con moto ; Andante cantabile ;
Vivace
On joint le manuscrit autographe par Camille SAINT-SAËNS de la transcription de la partie de piano-pédalier pour piano, qui servira à la publication de la transcription de la Suite concertante pour piano et orchestre chez Alphonse Leduc (cahier de 24 pages in-fol. d’une écriture très soignée à l’encre noire sur papier Lard-Esnault à 16 lignes).
76
GOURMONT Remy de (1858 - 1915).
MANUSCRIT autographe signé « Remy de Gourmont », Revue des deux mondes, [1894] ; 3 pages et demie in-8, montées sur onglets en un volume demi-percaline bronze.
Commentaire ironique d’un article de René DOUMIC (« Littérature et dégénérescence », Revue des deux mondes, 15 janvier 1894) attaquant la littérature symboliste et Stéphane MALLARMÉ ; Gourmont conclut : « les Doumic –comme d’autres – ne comprennent jamais ; c’est leur raison d’être et leur ouvrir les yeux, ce serait les tuer, – par l’horreur que leur causerait la vue de la Beauté (je parle de la Poésie de M. Mallarmé) ».
Le manuscrit présente des ratures et corrections ; il a servi pour l’impression, avec des variantes, dans la rubrique « Journaux et revues » du Mercure de France du 1er février 1894 (p. 185 - 187).
On a relié en tête une L.A.S. (1903) et un portrait de R. de Gourmont ; plus une carte postale de Jean de Gourmont.
800 - 1 000
33 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
GOUNOD Charles (1818 - 1893).
600 -
800
77 GRIMM Wilhelm (1786 - 1859).
L.A.S. « Wilh. Grimm », [Kassel février 1838], à la Dieterichsche Buchhandlung, librairie de Göttingen ; 1 page in-4 ; en allemand.
À l’éditeur de son adaptation de la Chanson de Roland ( Rolandeslied )
Il prie de faire le nécessaire pour envoyer en son nom des exemplaires du Rolandslied à onze personnalités, dont il fait la liste, parmi lesquelles Moritz Haupt, le professeur Hoffmann von Fallersleben à Breslau, „le directeur des archives Mone à Karlsruhe, le professeur Uhland à Stuttgart, le professeur et bibliothécaire Schmeller à Munich, le romaniste Ferdinand Wolf… [La version de Grimm de la Chanson de Roland était parue à la fin de l’année précédente chez Dieterich à Göttingen ; cette année-là les frères Grimm, qui faisaient partie des « Sept de Göttingen », avaient été relevés de leurs fonctions et étaient partis pour Kassel.]
Au verso, cachet de la collection Gottfried Doehler (1863 - 1943).
78
GUERRE DE 1870.
L.A.S. par Alfred MAINGAUD, Passy 24 janvier 1871, à sa tante Mme Maréchal à Brest (Finistère) ; 1 page in-8 sur la 3 e page de la Gazette des Absents du 21 janvier 1871, adresse avec mention Par ballon monté et cachets postaux Paris 27 janv. 71 et Brest 31 [janv. 1871]
Lettre par ballon monté, portée par le Général Cambronne Nouvelles de parents et voisins ; prix du bois à Paris ; le général VINOY a pris la tête de l’armée et le général TROCHU reste à la tête du gouvernement. « La population est calme malgré les tentatives de quelques rares énergumènes ». Au dos, il ajoute, le 26 janvier : « On prépare une sortie, les journaux Prussiens nous donnent de très mauvaises nouvelles de province ».
1 000 - 1 200
300 - 400
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 34
79 GUEZ DE BALZAC Jean-Louis (1597 - 1654) littérateur et épistolier, membre fondateur de l’Académie française.
MANUSCRIT (copie d’époque) du Discours à la Reyne Par le Sr de Balzac 1643 ; cahier in-fol. avec titre-couverture et 22 feuillets soit 43 pages in-4 (env. 22 x 175 cm), enmargés à l’époque et mis au format in-fol. (31 x 21 cm), paginé 26-[48] (les derniers numéros cachés par les marges ; galeries de ver dans la marge intérieure).
Version intégrale inconnue, avant la censure, de ce plaidoyer pour la paix adressé à la Reine Régente Anne d’Autriche
Le Discours à la Reyne est publié pour la première fois, sous le titre de Harangue faite à la Reyne sur sa Régence, en 1649 chez Toussaint Quinet (plaquette in-4), mais dans une version censurée. Cinq ans avant la Fronde, Guez de Balzac rédige ce magnifique plaidoyer pour la paix, et l’adresse à la Reine Régente ANNE D’AUTRICHE. Le poète politique implore la Régente de s’appliquer à préserver la paix, qui détruira les abus. Il commence : « Madame Nous ne desesperons plus du salut de nostre Estat. Nous ne croyons plus que les maux de nostre siecle soient incurables. Si le premier jour de vostre Regence nous a apris d’esperer un advenir bien heureux : Et si le peuple chrétien chastié si longtemps et si exemplairement par la Justice du Ciel doit enfin avoir la Grace de Dieu irrité, vraysemblablement il la recevra par des mains si pures et si innocentes que les vostres »….
Et il conclut : « Je ne finirois jamais si je voulois compter tous les avantages qui doivent naistre de cette bienheureuse Paix. Il faut conclure par le plus grand et plus considerable, Madame, qu’elle fournira à vostre Majesté des journées tranquilles et un beau loisir pour l’employer à la bonne nourriture du Roy vostre Fils. Vos pensées qui se divisent aujourdhuy en autant d’endroits que la Chrétienté a besouin, et qui embrassent a mesme temps plusieurs Provinces et plusieurs Royaumes seront alors toutes recueillies et arrestées à ce seul objet. Apres nous avoir donné un Prince vostre Majesté nous fera un second present de ce mesme Prince, et par une excellente Institution, elle nous le redonnera le meilleur et le plus vertueux de son siecle ».
En 1643, date de rédaction de ce manuscrit, Richelieu est mort depuis quelques mois, Louis XIII meurt le 14 mai, Louis XIV est mineur, Anne d’Autriche règne à sa place. MAZARIN domine. Guez de Balzac se range du côté du pouvoir royal : il soutient le pouvoir légitime contre « les corps estrangers ». S’il avance avec prudence lorsqu’il mentionne les « abus de l’authorité », il conseille courageusement le rétablissement du Parlement, et dénonce les favoris « domestiqués » dont la France eut déjà à souffrir. Les Princes sont un danger, cependant les éloigner tous serait un désastre. Balzac fait notamment, parmi les Princes, l’éloge de GASTON, duc d’Orléans, qui « fera à jamais taire la calomnie ». Il dresse également un beau portrait du Grand CONDÉ qui sera supprimé avant la parution de sa Harangue
Ce manuscrit donne la version originale du texte avec le plaidoyer pour Condé : la Paix « scaura separer de tous ceux qui s’apellent Princes Monseigneur le Prince de Condé, et reconnoistre par des marques singulieres, et des honneurs choisis, le sacré caractere de sa naissance, son affection au bien de l’Estat, l’assiduité, le mérite et la necessité dud[it] Seigneur »... En 1649, lorsque le texte est publié pour la première fois, sous le titre de Harangue faite à la Reyne sur sa Régence, cette belle recommandation aura disparu : si le Grand Condé était en cette année 1643 le vainqueur de Rocroi, après quelques années au service de Mazarin, il a pris la tête de la Fronde des Princes contre la toute-puissance du ministre, et est depuis en disgrâce ; ce n’est qu’en 1659 que Condé se ralliera à Louis XIV.
On ne connaît qu’un seul autre manuscrit de ce plaidoyer. Il est conservé à la Bibliothèque nationale de France, dans un recueil de mélanges provenant des Du Bouchet et légué à l’abbaye de Saint-Victor (Ms Français 23024, fol. 271).
En 1651, au plus fort de la Fronde, le Discours n’est pas publié dans les Œuvres diverses de Guez de Balzac imprimées par les Elzevier. Il paraît dans la deuxième édition qu’ils donnent des Œuvres diverses, en 1658, mais amputé de l’éloge de Condé, comme dans l’édition Quinet de 1649. Il faudra attendre l’édition in-folio de Billaine en 1665, pour lire enfin le portrait élogieux de Condé (tome II, p. 466 - 482), rallié depuis au Roi.
35 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
800 - 1 000
80 GUITRY Sacha (1885 - 1957).
15 lettres ou cartes autographes, la plupart signées (« Sacha » ou « S »), 1938 - 1944, à Geneviève de SÉRÉVILLE (puis Madame Sacha GUITRY) ; 20 pages formats divers, 9 enveloppes, la plupart au crayon. Charmante et tendre correspondance à Geneviève de Séréville (1914 - 1963), qui va devenir sa quatrième femme
21 Février [1938], charmant quatrain : « Ginette chaque jour que j’aime davantage / Nul ne sait mieux que moi le plaisir de donner ! / Mais en outre je sais que quand on a mon âge / Il faut se faire pardonner ! »… [1938 ?] : « Mon amour, Bon pour une robe du soir ! Voilà pour ce matin ! Je t’aime »… Mont Pèlerin sur Vevey [début mai 1938], billet en anglais le priant de lui dire comment elle se porte ce matin, en attendant de la voir à midi et demi… Salzburg [août 1938], poème de 12 vers : « Petit Chéri, Petit Coco, / je suis enchanté qu’ils te plaisent, / Tous ces vieux meubles Rococo. / Nos sentiments y sont à l’aise/ Et notre amour s’en accommode ! »… 18 avenue Élisée-Reclus [1939], récapitulatif de huit robes et manteaux qu’il lui offre pour « souhaiter ce premier anniversaire que tu passes contre mon cœur, Petit Être chéri que j’aime »… [Vevey 28 avril 1939], carte postale : « Vevey – 38 ! Vevey – 39 ! La fièvre monte !!! Je t’aime »… [4 ? juillet 1939], dans une enveloppe où « Mademoiselle » est biffé et corrigé en « Madame » : « Bavardez toutes les trois. Vous avez mille choses à vous dire »… [Décembre 1939], à l’occasion de sa série d’émissions radiophoniques consacrées aux Lettres d’amour, il remercie son « adorée » de sa lettre qui est « le reflet de ton visage aimé » ; il adore ses doigts pour « le mépris qu’ils ont des choses qui sont laides. Ils sont armés pour se défendre. Ils sont précis et familiers quand ils caressent. Ils sont hautains et dédaigneux quand il le faut. […] tes mains sont adorablement françaises […] et ce sont des mains qui sont faites pour retenir entre leurs doigts des Fleurs de Lys. Ce sont des mains comme on en voit dans les missels, ce sont des mains comme on en voit dans les peintures de Clouet, mains qui sont faites pour prier – étrangères à toute besogne vile – et c’est précisément ce qui les rend si chères à celui qui t’adore car ce qu’elles touchent, elles l’ennoblissent. Oui, caressé par elles on se gonfle d’orgueil, on relève la tête, et l’on se sent grandi dans des proportions qu’on ne soupçonnait pas – et va-t-on s’étonner d’une certaine raideur, bon signe en somme de noblesse – et témoignage aussi d’une vigueur qu’elles vous donnent – et qu’on leur donne aussi, car les voilà soudain devenues vigoureuses – elles ont un but – que veulent-elles de moi ? Le meilleur de moi-même »… [Juillet 1940 ?], à Madame Sacha Guitry « quelque part dans son lit ». « Il est à toi d’un bout à l’autre, mon amour. Il te dira que je t’adore. Il te demandera d’excuser sa tenue – mais n’est-il pas normal que par une chaleur pareille on soit à poil ? Je t’aime – bien plus qu’il y a 2 ans ! »… 5 juillet [1941 ?]. « Je t’offre la moitié de ce tableau que tu aimes – oui, la moitié pour que ce soit une petite raison de plus de ne jamais nous séparer ! »… 1er janvier 1944 : désormais « tes appointements au Théâtre de la Madeleine seront de cinq cents francs par jour pendant toute la durée des représentations de la pièce en cours. Ces appointements reprendront avec les représentations de Marie se marie »…
« Mademoiselle G. Guitry actrice » : « A Toi ma chérie, Bravo de tout mon cœur »… – « Merci Gin, de tout mon cœur – qui n’est pas bien fameux ! – et tous mes vœux de bonheur »… – « Pour couvrir les plus jolies mains du monde. À toi mon amour pour te dire merci et bravo du fond de mon cœur ému et aimant »… – « Bon pour une robe chez Molyneux »...
On joint un télégramme ; et le n° de Match du 1er juin 1939.
81 GUITRY Sacha (1885 - 1957).
MANUSCRITS autographes (fragments), [L’Humour] ; 47 pages in-4 au crayon ou à l’encre. Brouillons pour une ou des causeries sur l’humour,et l’humour au théâtre. Brillante causerie truffée de bons mots, mais aussi réflexion sur ce qu’est l’humour : « Ignorant tout de la chimie, je vous aurais peut-être amusé en vous en parlant… tandis que je vais probablement vous ennuyer en vous parlant de l’humour… car je vais en parler sérieusement. Je suis obligé de vous en parler sérieusement car l’humour est une chose qui m’est chère, infiniment. Tandis que la chimie, je m’en passe ! »… « Si la plupart des grands écrivains ont eu le sens et le goût de l’humour, les humoristes, les vrais humoristes, ceux qui n’ont été que des humoristes sont extrêmement rares » ; et de citer Alphonse ALLAIS, « le seul véritable humoriste français », sur lequel il livre quelques souvenirs…
1 000 - 1 200
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 36
5 000 - 6000
82 HAHN Reynaldo (1874 - 1947).
MANUSCRIT MUSICAL autographe, Nausicaa (1919) ; environ 110 et 440 pages in-fol.
Manuscrit de cet opéra dans ses deux versions : chant et piano, et partition d’orchestre
Cet opéra en 2 actes, sur un livret de René Fauchois (le librettiste de Pénélope de Gabriel Fauré), commencé en 1913 et achevé au front en Argonne en 1917, fut créé à l’Opéra de Monte-Carlo le 13 avril 1919, alors dirigé par Raoul Gunsbourg, avec Marthe Davelli (Nausicaa) et Robert Couzinou (Ulysse) dans les principaux rôles, l’orchestre étant dirigé par Albert Wolff. La partition fut publiée chez Heugel en 1919.
« Nausicaa, dont le poème calme et harmonieux est de M. René Fauchois, fait revivre le gracieux épisode de l’Odyssée, quand Ulysse, jeté par la tempête sur le rivage phéacien, et un moment ému par la beauté et la grâce de la princesse Nausicaa, reprend néanmoins sa course fabuleuse vers Ithaque et vers Pénélope, non sans laisser dans les larmes la douce jeune fille qui l’aimait. La musique de M. Reynaldo Hahn est du charme le plus profond, du coloris le plus délicat dans sa vraie et pure richesse, s’élevant parfois à la haute puissance, et parvenant à la plus profonde émotion dans la grande scène finale des adieux et du départ », écrivait J. Darthenay dans Le Figaro du 16 avril 1919.
Le manuscrit chant-piano est à l’encre bleue sur papier Lard-Esnault/Bellamy à 20 lignes, avec de nombreuses ratures et corrections ; c’est le manuscrit de premier jet et de travail. L’Acte I compte 96 pages sous chemise avec titre (les p. 8 bis-11 et 16-17 sont d’une autre main) ; il est daté en fin : « Hambourg, Janv. 1913 ». L’Acte II, sous chemise, est incomplet : 15 pages, chiffrées 80-84, 85/82 (avec feuillet double occulté par épinglage), 86-[93] ; à la fin de la page 91, la note : « Fini le 19 juin 1916 dans le grenier d’Auzéville » a été biffée ainsi que les dernières mesures, et deux pages ont été ajoutées.
La partition d’orchestre est à l’encre bleue sur papier à 24 lignes, et présente de nombreuses corrections, mesures biffées, grattages, et collettes. L’Acte I comprend les pages 23-241 (le début manque, avec une page 55-61, plus de nombreuses pages bis et ter ), daté en fin : « Grenier d’Auzéville 31 juillet minuit ». L’Acte II comprend un feuillet de titre et 207 pages.
On a joint des fragments autographes de la musique de scène d’ Esther (1905, pour Sarah Bernhardt) : 2e Acte (18 pages, pagination discontinue), et 3 e Acte (9 p., incomplet) ; et 2 lettres autographes concernant les corrections d’épreuves.
Bibliographie : Jacques Depaulis, Reynaldo Hahn (Séguier, 2007), p. 95-96 ; texte complet du livret, et articles sur la création et les représentations de l’œuvre : http://reynaldo-hahn.net/Html/operasNausicaa.htm
83 HAHN Reynaldo (1874 - 1947).
MANUSCRIT MUSICAL autographe, La Colombe de Bouddha, [1921] ; un volume in-fol. de 146 pages, relié dos toile noire (reliure usagée).
Partition d’orchestre de cet opéra en un acte La Colombe de Bouddha, « conte lyrique japonais en un acte », sur un livret d’André Alexandre, fut créée au Théâtre du Casino municipal de Cannes le 21 mars 1921, sous la direction du compositeur, qui la dirigea également à Deauville dans l’été. La partition a été éditée par Heugel en 1921 (le manuscrit porte le cachet des Archives Heugel aux premières et dernière pages).
« M. Reynaldo Hahn vient de donner, au Casino, son nouvel ouvrage, La Colombe de Bouddha, conte lyrique japonais, qu’il composa sur une poétique légende de M. André Alexandre. Comment le jardinier Kobé, épris d’une mousmée, mourut d’amour après l’avoir vue s’éloigner pour suivre un chanteur ambulant, c’est là toute la simple histoire qui a inspiré à M. Reynaldo Hahn une très fine partition mélodique, d’instrumentation moderne, colorée, à la façon des images un peu grimaçantes du Japon. Présentée dans un très joli décor par M. Léon Devaux, tendrement interprétée et chantée par la pure voix de Mlle Raymonde Vécart, les basses prenantes de MM. Aquistapace (le jardinier) et Vieuille (le bonze), par le charmant ténor M. Capitaine (le chanteur), La Colombe de Bouddha a valu à tous de nombreux rappels ». (Le Figaro, 20 mars 1921).
Le manuscrit, en partition d’orchestre, est noté à l’encre bleue sur papier à 24 lignes, et présente de nombreuses ratures et corrections, grattages et collettes (dont les p. 47 et 65 entièrement refaites). Il a servi de conducteur pour les représentations et porte des annotations au crayon rouge/bleu et au crayon noir). En tête de la page 1, un titre a été noté d’une autre main : Le Jardinier de la Pagode
L’effectif orchestral comprend : petite flûte, 2 flûtes, un hautbois, un cor anglais, 2 clarinettes en la, un basson, 2 cors en fa, 2 trompettes en ut, timbales, une harpe, piano, percussion (triangle, crotales, cymbales, cloche), 1e et 2e violons solo, alto solo, violons I et II, altos, violoncelles, contrebasse.
Bibliographie : articles sur la création et les représentations de l’œuvre : http://reynaldo-hahn.net/Html/operasBouddha.htm
37 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
1 200 - 1 500
1 000 - 1 500
84 HENRI III (1551 - 1589) Roi de France.
L.A.S. « Henry », [fin 1580 ?], à Nicolas d’ANGENNES, sieur de RAMBOUILLET ; 1 page in-fol., adresse au verso « A Monsieur de Rambouillet » (petite rousseur, fente marginale réparée).
« Msr de Pons estant mort ie vous ai honoré de sa charge de lune de mes Compagnies des Cent jentishomes pour la fiance que jay de vous et bonne estime je ne vous an diray pas davantaige sinon que je suis fort satisfait du service que vous me randez pres de la Reyne ma bonne mere Jespere que vous continuyrez et vous me ferez service tres agreable vous connoitrez tousjours que je vous ayme »…
[Nicolas d’Angennes, seigneur de Rambouillet (1533 - 1611) avait été capitaine des gardes du corps de Charles IX ; il fut souvent cahrgé de missions diplomatiques par Henri II et Catherine de Médicic, et admis en décembre 1580 dans l’ordre des chevaliers du Saint-Esprit.
85 HENRI IV (1553 - 1610) Roi de France.
L.S. avec compliment autographe « Vre plus afectyone & assure amy Henry », au camp devant Fontenay 28 mai 1587, au baron de LAROCHEBEAUCOURT ; 1 page in-fol., adresse au verso.
Lettre comme roi de Navarre, lors du siège de Fontenay (la ville sera prise le 1er juin).
Il est rassuré d’apprendre, par son écuyer Jean de Lambert, que le baron ne s’est pas lié à ses ennemis, contrairement à ce qu’il croyait savoir, et qu’il désire le voir secrètement pour en discuter avec lui.
« Monsieur le Baron, J’ay esté bien ayse d’avoir entendu par Lambert auquel j’avoys commandé de vous voir de ma part, le contraire de ce qu’on m’avoyt dit de vous jusques icy qui estoyt que comme plusieurs autres de mes plus proches vous vous estiez ligué avec les plus grands ennemys de cest estat et les miens, ce qui m’avoyt retenu de vous rechercher comme j’ay faict les personnes qui vous ressemblent. L’ayse que jay donc de ceste bonne affection que vous m’avez gardée, me fera avoir moings de regret au temps de service que j’ay perdu de vous jusques icy, avec l’esperance que Lambert me donne den recevoir comme plus au long il ma faict entendre de vostre part, et de ce dont lui avez discouru que je trouve bon puis quil vous est utille, masseurant que quelque part que vous soyez vous rendrez a temps les effects de vostre parolle. Mais avant que vous allissiez la, je desireroys vous avoir veu une heure seulement, car autrement ny pourriez vous apporter l’utilité que vous desirez. Regardez d’en trouver le moyen, et si secretement que lon ne scache point que vous mayez veu »…
86 HENRI II D’ALBRET (1503 - 1555) Roi de Navarre, beau-frère de François I er et grand-père d’Henri IV. L.S. avec compliment autographe « Vre bon cousin Henry », Lyon 19 janvier [1526 ?], à Mme d’ESTOUTEVILLE ; 1 page in-fol., adresse (quelques réparations au dos).
Intéressante lettre
Il a reçu sa lettre « sur la neutralité de ceulx des cinq villes du costé de Navarre », et le prie de toujours bien l’avertir.
« Au demeurant jescripvay du premier jour au Roy ou il luy plaira ordonner quil soit prins argent pour le payeur des gaiges des cappitaines […] Et quant a ce que mescripvez que noz voisins besoignent à Behobie […] quilz y menent de lartillerye, je ne veoy point qui y ayt moyen de les y empescher veu que cest de leur costé, et que long temps le leur chasteau est fort pour eulx, et de faire quelque fort pour nous de deca vous voyez que ce ne pourroit estre sans une bien grande despence […] le Roy a mandé de ne le mettre en fraiz que le moings quon pourra attandu ses affaires. Au moyen dequoy je suys bien dadvis de ny toucher sans premier len avoir adverty »…
87 HERGÉ Georges Rémi, dit (1907 - 1983).
L.S. « Hergé », Bruxelles 24 mai 1977, à J.P. Verheylewegen à Bruxelles ; 1 page in-4 avec vignette et en-tête
Studios Hergé
Il remercie pour les vœux à l’occasion de son anniversaire, avec l’envoi de « 70 dessins émanant de vos élèves : « Que vous ayez eu cette initiative est une preuve de plus de votre fidélité et de votre extrême délicatesse. J’ai regardé ces dessins un à un et serais bien en peine d’accorder la palme au meilleur d’entre eux, car la plupart porte la marque de l’originalité et de l’esprit créatif. Je voudrais remercier chacun des auteurs. Ne pouvant le faire, j’adresse à l’ensemble des élèves un souvenir collectif, lui aussi sous forme graphique […] à tous ces sympathiques petits amis de Tintin »…
1 500 - 1 800
1 200 - 1 500
1 000 - 1 500
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 38
700 - 800
88 HUGO Victor (1802 - 1885) et MÉRY Joseph (1798 - 1865).
POÈME autographe par les deux, À Victor Hugo ; 1 page in-4. Amusant poème à deux mains
Victor Hugo a complété de sa main le dernier mot de chacun des 24 vers (alexandrins) de Méry, ou a-t-il écrit les rimes, en fonction desquelles Méry a rédigé son poème.
« Nul mieux que vous ne sait mettre en scène une femme, Vous avez inventé la langue de l’amour, Au cœur de vos héros vous infusez votre âme, Des bords du Nil au Rhin, de Moyse à Bauldour.
Pour vous le cœur humain n’a point d’ hiéroglyphe, & le doute mortel qui blanchit nos cheveux , Lorsque nous poursuivons un problème apocryphe, Est une vérité pour vous, selon vos vœux »… Etc.
Ancienne collection Louis BARTHOU (II, 1935, n° 1046-35).
89 HUGO Victor (1802 - 1885).
Manuscrit autographe, Résolution proposée par M. V. Hugo, [16 avril 1849 ?] ; 3/4 page in-8. Résolution comme député lors du vote de l’expédition militaire à Rome
« L’Assemblée nationale, adoptant, pour le maintien de la liberté et des droits du peuple romain, les principes contenus dans la lettre du président de la République et dans les dépêches du gouvernement clot la discussion générale ».
90 HUGO Victor (1802 - 1885).
MANUSCRIT autographe pour Les Misérables , [1860] ;46 x 10 cm au dos d’une bande d’adresse du journal
La Presse du 1er février 1860 (en 2 morceaux, petites déchirures et fentes par corrosion de l’encre).
Brouillon de premier jet pour l’épisode de la barricade dans Les Misérables
Ce brouillon a été biffé après insertion et développement dans le manuscrit des Misérables ; il présente des variantes avec le texte édité. L’épisode se rattache au premier chapitre (La Charybde du faubourg Saint-Antoine et la Scylla du faubourg du Temple) du livre I (La Guerre entre quatre murs) de la cinquième partie (Jean Valjean).
3 000
4 000
L.A.S. « Victor Hugo », H.H. [Hauteville House] 25 juin [1865 ?], à Eugène RASCOL ; 2 pages in-8 sur papier bleu. Contre la peine de mort.
[Eugène RASCOL dirigeait le Courrier de l’Europe, hebdomadaire publié à Londres.]
« Voulez-vous me permettre d’abuser de vous pour deux obligeances. 1° Si vous savez où demeure et vit le Freemasons’ Magazine, lui envoyer ce pli. 2° – gros service à rendre à un jeune et beau talent. M. E. PILOTELL, peintre parisien d’un grand avenir, a fait un très beau dessin sur la peine de mort ; c’est dramatique et saisissant ; mais saisissant jusqu’à pouvoir être saisi. De là, épouvante des éditeurs de Paris qui n’osent publier cette estampe. Connaissez-vous à Londres un éditeur qui serait plus brave ? Acheter ce dessin à M. Pilotell, et le publier, ce serait rendre deux services, l’un au talent, l’autre à la vie humaine. La bonne Angleterre fait terriblement fausse route en ce moment avec ses pendaisons à huis-clos. Rien de plus hideux. Vous avez éloquemment et vaillamment protesté »… Il part pour Bruxelles, et rentrera en octobre à Guernesey, où il attend Rascol : « Votre couvert est toujours mis, vous le savez, à ma table de famille »…
1 000 - 1 500
39 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
1 000
- 1 500
1 000 - 1 500
« On regardait cela et l’on parlait bas. De temps en temps, si quelqu’un se hasardait à traverser la chaussée [...] on entendait un sifflement aigu et faible, et l’on voyait s’enfoncer dans un volet fermé ou dans le plâtre d’un mur, une balle, quelquefois un biscayen. Car les hommes de la barricade s’étaient fait de deux tronçons de tuyaux de fonte du gaz bouchés à un bout avec de la terre à poële, deux petits canons. Je me souviens d’un tranquille blessé qui allait et venait dans la rue. [...] Le c[olonel] M[onteynard] admirait cette barricade avec un frémissement. – Comme c’est bâti ! disait-il à un représentant. [...] Pas un pavé ne déborde l’autre. C’est de la porcelaine. – En ce moment une balle lui brisa sa croix sur sa poitrine, et il tomba. [...] La barricade St Antoine était le tumulte ; la barricade du Temple était le silence. Il y avait entre ces deux redoutes la différence du formidable au sinistre »... -
91 HUGO Victor (1802 - 1885).
[Le peintre et caricaturiste de presse Georges Labadie, dit PILOTELL (1844 - 1918), remplaça André Gill à L’Éclipse et fonda sans succès Le Gamin de Paris (1866) et La Feuille (1867). Très actif aux côtés des insurgés durant la Commune, fondant La Caricature politique, il dut vivre ensuite en exil et mourut à Londres.]
HUGO Victor (1802 - 1885).
L.A.S. « Victor Hugo », Paris 26 mars 1877, à Alice HUGO ; 1 page in-fol. (légère fente au pli). Très belle lettre à sa bru qui va se remarier
[Alice Lehaene, veuve de Charles Hugo (mort le 13 mars 1871), et mère des petits Georges et Jeanne, va se remarier le 3 avril avec l’homme politique Édouard Lockroy.]
« Chère Alice, En vous remariant, vous cessez d’être tutrice de vos enfants, mais vous ne cessez pas d’être la mère ; c’est-à-dire que ce que vous perdez du côté de la loi, vous le retrouvez du côté de Dieu ; vous continuez d’avoir pour vous la loi naturelle, la loi des lois ; ce titre de mère est le plus sacré et le plus vénérable de tous ; le titre d’aïeul, qui est le mien, ne vient qu’après. Vous êtes donc pour moi, en dehors et au dessus de toutes les restrictions légales, la mère, c’est-à-dire ce qu’il y a de plus auguste sur la terre. Georges et Jeanne nous appartiennent ; à vous d’abord, à moi ensuite. Qu’ajouter à cela ? Je vous appartiens. Je bénis Georges et Jeanne, et je vous bénis. Venez dans mes bras »…
On joint 2 autres L.A.S. de Victor HUGO et une L.A.S. de Juliette DROUET.
L.A.S. « Victor Hugo », H[auteville] H[ouse] 5 avril [1867, à M. Richard (2 p. in-12), le félicitant pour son charmant album, avec ce conseil : « soyez de plus en plus ce que vous êtes. C’est-à-dire affirmez de plus en plus l’art, le progrès, l’idéal, la liberté, et le grand dix-neuvième siècle »…
L.A.S. « V.H. », 2 janvier [1874], à Richard Lesclide (1 page in-8 contrecollée, avec grande fente), invitant son confrère (et futur secrétaire) à dîner : « Mon deuil aura la force de vous sourire. Il est éternel, mais tranquille »...
L.A.S. « Juliette », 28 novembre [1844 ?], à Victor Hugo (4 p. in-8). Belle lettre amoureuse et de reproches à l’amant infidèle : « Je t’aime, je t’aime trop hélas ! puisque cela va jusqu’à l’obsession, jusqu’au ridicule et jusqu’à la folie. […] tu t’acoquines au décolleté de Mlle Ozy. Je souffre et je pleure dans ma sollitude […] je subis la loi fatale d’un amour trop persistant. [...] c’est odieux et j’aime mieux mille fois la mort qu’une pareille vie »…
93 HUGO Léopold (1773 - 1828) général, père de Victor Hugo.
L.A.S. « Le Général Hugo », Blois 28 avril 1820, au Doyen de la faculté de droit de Paris, Étienne-Claude DELVINCOURT ; 2 pages in-4, adresse. Interrogations du père de Victor et Eugène Hugo sur le sérieux des études de ses fils « Je paye depuis deux ans à mes jeunes fils Eugène et Victor une pension pour qu’ils étudient en droit à l’université de Paris, mais je n’ai jamais pu apprendre d’eux s’ils suivent leurs cours avec exactitude et quelque distinction. J’ignore même si une entreprise littéraire [la revue Le Conservateur littéraire] que les journaux seuls m’ont apprise, et des motifs de laquelle l’un d’eux a fait l’éloge le plus touchant et le plus mensonger (puisque je paye régulièrement une autre pension à la personne [son ex-épouse Sophie Trébuchet, mère de ses fils], pour le prétendu soutien de laquelle cette entreprise aurait lieu) ; j’ignore, dis-je, si l’entreprise dont je parle n’a pas entièrement arraché mes fils à leurs études. Aurez-vous l’obligeance, Monsieur le Doyen, de me faire connaître le nombre des inscriptions déjà prises et celles encore à prendre par eux, ainsi que votre opinion sur la manière dont ils se disposent à subir les premiers examens qui auront lieu »…
Provenance : collection Noilly. – Bibliothèque de Louis Barthou (II, 1935, n° 1046-9).
94 HUGO Adèle Foucher, Madame Victor (1803 - 1868).
L.A., Samedi 25 [décembre 1852], à Victor HUGO ; 8 pages in-8. Longue lettre intime d’Adèle Hugo à son mari au sujet de leur fils François-Victor et de ses amours François-Victor Hugo (1828 - 1873) a pris pour maîtresse l’actrice Anaïs Liévenne, laquelle, ayant récemment quitté Alexandre Dumas fils, dépense des sommes folles au jeu et entraîne son amant vers la ruine. Adèle est venue à Paris pour chercher son fils et le ramener au foyer paternel. Elle rend compte ici de sa mission. « Cher ami, je suis en retard pour t’écrire, j’attendais une bonne résolution de la part de Toto pour le faire. Le premier jour il m’a dit je partirai avec toi, il a dit cela avec une telle facilité que j’ai vu qu’il n’avait aucune intention de tenir sa promesse. En effet le soir il a été dire à la personne que j’étais venue le chercher, disant que tu allais pester mais que les preuves que je lui avais données pour justifier ce départ ne prouvaient rien. Il a donné sa parole à cette personne qu’il ne partirait pas. Cependant nous avons ce progrès des choses qui m’ont fait lui parler si vertement qu’il s’est aperçu que ma volonté de l’emmener était absolue et que je m’accrocherais à lui jusqu’à ce qu’il s’accrochât à moi. Son grand cheval de bataille est toujours que la personne s’est ruinée pour lui, qu’il serait un lâche s’il ne se dévouait pas à elle, et que si il la quitte elle fera quelque malheur […] je lui ai dit que je lui offrais d’emmener la personne, qu’il vivrait dans un lieu de St Hélier avec elle, ou bien que je lui proposais de me remuer pour la faire engager aux Variétés, ce qui le liquiderait vis-à-vis d’elle. Elle prétend que Toto lui a fait perdre une position et lui en doit une autre, mais Toto ne doit plus rien. Je vois Toto tous les jours, dans certains moments la personne veut venir, dans d’autres elle ne le veut pas, et menace sans cesse Toto de quelque malheur »… Etc.
La fin de la lettre est consacrée à des questions d’argent : ce qu’elle doit à sa sœur Julie, à Meurice ; l’argent qu’elle avait prêté à ses fils pour leur journal L’Événement ; la diminution du budget que lui allouait son mari en 1848, et les soucis consécutifs au coup d’État et au départ à Bruxelles, etc.
2 500 - 3 000
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 40
92
800 - 1 000
1 000 - 1 500
95 HUGO Charles (1826 - 1871).
MANUSCRIT autographe, [vers 1845] ; cahier petit in-4 (19 x 15 cm) de 22 pages plus ff. blancs, cartonnage d’origine de papier gaufré noir à motifs végétaux, dos de basane noire (découpage au premier plat de la couverture, petite découpe en haut du 1er f., quelques ff. arrachés au début du cahier), chemise demi-maroquin bleu nuit, étui. Curieux document inédit, rapportant des propos de Victor Hugo, et une causerie au sujet de Mme de Staël Charles Hugo, dont l’écriture imite celle de son père, rapporte dans la première partie des propos de Victor Hugo. Le texte (incomplet de son début) passe de la fin d’une histoire de montre volée, au récit d’un crime commis par des brigands basques, dits « traboucaires », le 21 février 1845 : vol de passagers d’une diligence, et enlèvement, séquestration, mutilation et assassinat de l’un d’entre eux. À ce récit émaillé de détails cocasses, s’ajoutent plusieurs anecdotes de voyageurs face aux brigands, recueillies au Pays basque (où Hugo s’était rendu en 1843) ; puis le souvenir du bagne de Brest (que Victor Hugo a visité en 1834), où Hugo rencontre l’homme « qui arrêta à lui tout seul la diligence de Toulouse. Il avait affublé d’habits et de chapeaux des échalas qui bordaient la route. Puis il avait mis d’autres échalas en travers, comme des fusils faisant le mouvement de coucher en joue. […] Il fut condamné aux galères à perpétuité. Je l’ai vu au bagne de Brest. Il avait l’air intelligent et fin. Je m’approchai de lui et je lui dis : “Il y avait de l’esprit dans votre idée.” Il me répondit : “Et de la bêtise aussi puisque c’est ce qui fait que je suis ici.” » La seconde partie, intitulée M. de Lacretelle et Mme de Staël, est en quelque sorte le procès-verbal d’une causerie entre Hugo et LACRETELLE jeune, et leurs épouses au sujet de Mme de STAËL, à qui l’on attribue du charme, des boutons et l’inconvenance de recevoir des personnages haut placés pendant sa toilette : « Victor Hugo. C’est incroyable. Toujours entre deux chemises ? M. de Lacretelle. Toujours. Elle appuya nonchalamment son bras nu sur mon épaule. Je restai interdit. J’avoue qu’en ce moment je fus le garçon plus sot du monde »… Et Lacretelle de multiplier des souvenirs de Corinne, Benjamin Constant, Soumet, M. de ***, M. de Rocca, Mme Tallien… « Victor Hugo – On ne se figure pas une impudence pareille à celle de M me de Staël. Un jour, l’empereur était au bain ; elle voulut entrer malgré la consigne ; elle entra de force en s’écriant : le génie ne connaît point de sexe ! L’Empereur la reçut comme elle méritait, avec sévérité. J’avoue que je me sentirais pour une telle femme une répugnance inexprimable. Je comprends parfaitement les dédains de M. de Lacretelle. D’ailleurs, elle n’avait aucun talent.
C’est un préjugé que M me de Staël. Elle a écrit des ouvrages empire, et elle a inventé des héros style-pendule »…
96 HUYSMANS Joris-Karl (1848 - 1907).
MANUSCRIT autographe signé « J.K. Huysmans », Les frères Le Nain, [1899] ; 4 pages in-fol., avec ratures et corrections, découpées pour l’impression et remontées.
R emarquable article de critique d’art sur les frères LE NAIN , publié dans L’ Écho de Paris du 5 juillet 1899, et recueilli dans De tout (Stock, 1902).
Huysmans dénonce le chauvinisme qui a présidé à l’accrochage des tableaux au Louvre, les Primitifs de l’école dite française étant mis en valeur dans la Grande Galerie et le Salon carré, ceux de l’école dite flamande étant relégués dans de petites pièces de débarras. C’est d’autant plus bête et injuste que les « Français » sont souvent des pasticheurs ou des élèves des maîtres flamands, voire des Flamands venus en France… Huysmans passe rapidement sur le XVIII e siècle, où il ne trouve que deux artistes, Watteau et Chardin, pour le consoler, mais il trouve dans la salle réservée au XVII e, une famille d’artistes qui, par extraordinaire, s’est intéressée aux humbles, les frères Le Nain. Il résume le peu que l’on sait de la vie des trois frères originaires de Laon, puis décrit longuement leur Repos de paysans, voyant dans cette scène un souvenir des Évangiles ; il cite aussi les appréciations de Burger, Saint-Victor et Champfleury. Le plus singulier, c’est que les Le Nain ont témoigné d’un sens religieux dans une œuvre qui ne l’exigeait point, mais se sont révélés dénués de ce même sens dans la Nativité de Saint-Étiennedu-Mont que Huÿsmans juge « prévenante, et un peu lâche, d’une saveur pieuse, nulle ». Il résume l’apport des Le Nain : « l’on peut dire que s’ils ont brossé, ainsi que les maîtres des Flandres, des scènes de mœurs, ils les ont conçues d’une façon autre, ne prenant point, de même que Steen ou Brauwer, que Teniers ou qu’Ostade, le paysan et l’ouvrier, au moment où ils se réjouissent dans les cabarets et se grisent dans les bouges. Eux ne les ont pas connus joyeux ; ils n’ont pas été les peintres des dimanches et des lundis, mais ceux des autres jours, des jours où l’on besogne, à la forge, à la ferme, aux champs, et où l’on trime. En peinture, ils furent les seuls au XVIIe siècle, que la misère du peuple toucha, car Callot et Valentin ne s’occupèrent que de nippes arrangées et d’indigences bouffonnes. Ils ont été, en un mot, les peintres des pauvres gens et ce titre me paraît vraiment noble, car il fallait une certaine audace pour oser représenter de véritables manants à une époque où ils étaient considérés un peu moins que les animaux domestiques, que les chiens surtout qu’il était de bon ton alors de faire portraiturer par les artistes à la mode, par Jean-Baptiste Oudry et par Desportes »…
41 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
1 200 - 1 500
2 000 - 3 000
97
IBERT Jacques (1890 - 1962).
MANUSCRIT MUSICAL autographe signé, La Ballade de la Geôle de Reading (1921) ; 1 feuillet de titre et 98 pages in-fol., sous couverture illustrée de l’édition (déchirure réparée au 1er feuillet, cachets de l’éditeur). Partition d’orchestre de la première œuvre symphonique de Jacques Ibert, inspirée par Oscar Wilde Ayant remporté le Premier Grand Prix de Rome en 1919, Jacques Ibert part pour Rome en 1920, et c’est à la Villa Médicis qu’il compose son premier envoi de Rome qui est aussi sa première grande œuvre, terminée en 1921, l’impressionnante Ballade de la Geôle de Reading pour orchestre, inspirée du poème d’Oscar WILDE, qui sera créée le 22 octobre 1922 aux Concerts Colonne sous la direction de Gabriel PIERNÉ, à qui elle est dédiée. L’œuvre sera publiée en 1923 aux éditions Alphonse Leduc, et mise en ballet en 1947 par le chorégraphe Jean-Jacques Etcheverry.
Ce poème symphonique est directement inspiré du fameux poème d’Oscar Wilde (1898), La Ballade de la Geôle de Reading, évoquant les derniers moments d’un condamné à mort ; Jacques Ibert en reproduira en tête de sa partition trois extraits qui ont inspiré les trois mouvements de sa musique (nous n’en citons que les incipit) : « Il n’avait plus sa tunique écarlate, car le sang et le vin sont rouges et sur ses mains il y avait du sang et du vin quand on le trouva avec la morte, la pauvre morte qu’il aimait et qu’il avait tuée dans son lit »… « Cette nuit-là, les corridors vides furent pleins de formes effrayantes, et du haut en bas de la Ville de Fer, on sentait des pas furtifs qu’on ne pouvait entendre, et à travers les barreaux qui cachaient les étoiles, des faces blanches semblaient regarder curieusement »... « Le vent frais du matin commença à gémir, le vent frémissant vint errer à l’entour de la prison. Lentement, lourdement, l’horloge de la prison ébranla l’air et de la geôle entière s’éleva un gémissement de désespoir comme le cri, qu’entendent les marécages effrayés, de quelque lépreux dans son repaire »...
L’effectif requiert : 3 grandes flûtes (et petite flûte), 2 hautbois, cor anglais, 2 clarinettes en la, clarinette basse, bassons, sarrussophone, 4 cors en fa, 3 trompettes en ut, 3 trombones (et tuba), 4 timbales, percussions (triangle et tambour militaire, tam-tam, grosse caisse, cymbales), xylophone, celesta, 2 harpes, et les cordes. « En trois mouvements enchaînés, cette page symphonique atteint une puissance émotive stupéfiante et décèle un sens aigu du coloris par les jeux de timbres et de contrastes qu’elle met en œuvre, ainsi que par son langage modal élargi par quelques touches polytonales. Le premier volet alterne les expressions d’angoisse morbide et d’espoir lumineux contenues dans le poème, par l’opposition entre, d’une part, un discours haché constitué de bribes thématiques essentiellement rythmiques que se déchirent les différents pupitres, et d’autre part, des élans lyriques généreux intensifiés par une pleine pâte orchestrale chaleureuse. La seconde partie mêle de manière quasi alchimique, fantasque et fantastique par l’exploitation de deux mouvements esquissés, l’un dans l’esprit du Scherzo (3/4 et 3/8), l’autre, de la sarabande (5/4 sic), véritables spectres hantés de modalité et enveloppés d’une orchestration qui n’est pas sans rappeler celle de L’Apprenti Sorcier de Dukas. Traités en un formidable crescendo, les deux éléments se défient avant de se retrouver en un 6/8 débridé qui conclue l’épisode en contrastant avec l’introduction ( pianissimo) sombre et plaintive de la dernière section. Celle-ci fait entendre une mélopée tortueuse énoncée d’emblée par les violoncelles et les contrebasses, avant que les éléments thématiques des mouvements précédents ne réapparaissent par fragments, pour atteindre un nouveau sommet lyrique intense en un tutti orchestral fortissimo. Interrompue brusquement, cette ultime envolée fait place à un mouvement très calme qui clôt la partition dans une sorte de halo crépusculaire et la ramène dans le ton initial de fa dièse » (Bruno Berenguer). Le manuscrit est à l’encre noire sur papier à 26 lignes ; il présente quelques corrections, grattages et collettes. En tête de la première page, figure la dédicace : « à M. Gabriel Pierné ». Il est signé en fin et daté : « Roma MCM xx I ». Il est conservé sous la couverture de l’édition portant une note au crayon : « Tirage le 27 mai 1924 ». Discographie : Adriano, Orchestre Symphonique de la Radio Slovaque (Naxos 1993).
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 42
5 000 - 6 000
98 IBERT Jacques (1890 - 1962).
5 000 - 6 000
MANUSCRIT
MUSICAL autographe signé, Concerto pour flûte et orchestre (1933) ; 1 feuillet et 90 pages in-fol. montés sur onglets en un volume broché sous couverture jaune (projet de maquette).
Partition d’orchestre de ce célèbre concerto pour flûte
Jacques Ibert a composé son Concerto pour flûte en 1932 - 1933, en partie dans sa propriété de Longuemare près des Andelys, pour le grand flûtiste français Marcel MOYSE (1889 - 1984), qui en est le dédicataire et qui en assura la création le 25 février 1934 à la Société des Concerts sous la direction de Philippe Gaubert. Il fut publié en 1934 aux éditions Alphonse Leduc (cachets de l’éditeur). Ce Concerto s’est vite imposé au répertoire des grands flûtistes comme une des grandes pages de leur répertoire.
« Il y a trois mouvements, vif – lent – vif. L’Allegro initial, tout de grâce légère, est à deux thèmes, – le premier en notes égales et vives sur les ponctuations des cordes, le second plus lyrique. L’Andante est bâti sur l’ambiguïté modale majeur/mineur, – selon des alternances ou des fondus créant un précieux climat harmonique. Longue mélodie de la flûte épousant des contours incertains, – tandis que les premiers violons s’épanchent en un commentaire élégiaque. Reprise par le soliste, plus dégagé, avant une conclusion en majeur. Enfin, avec l’Allegro scherzando, la flûte se lance en une suite de variations infinies, – bondissante, tourbillonnante, intarissable. L’orchestre n’est d’ailleurs pas en reste. Cependant la mélancolie, un moment, s’insinue, – avant qu’une reprise du thème initial amène une cadence extraordinairement virtuose, quelques trilles, puis, sur les accords en tutti du début du mouvement, une conclusion assez acérée » (François-René Tranchefort).
L’effectif requiert, outre le soliste : 2 grandes flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors, une trompette, 2 timbales, et les cordes.
Le manuscrit est soigneusement noté à l’encre noire sur papier Lard-Esnault à 26 lignes ; il est daté en fin « ParisLonguemare 1932-33 ». Il est ainsi divisé :
I. Allegro (p. 1-29) ;
II. Andante (p. 30-44) ;
III. Allegro scherzando (p. 45-90) ; la cadence (p. 86-87) est notée à l’encre rouge.
Jacques Ibert a calligraphié lui-même la maquette de couverture, au dos de laquelle il a dressé la nomenclature des instruments, et noté la durée de l’œuvre : « 18 min. 30 sec. »
Discographie : Emmanuel Pahud, Orchestre de la Tonhalle de Zurich, David Zinman (EMI 2004).
43 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
99
IBERT Jacques (1890 - 1962).
MANUSCRIT MUSICAL autographe, Golgotha (1935). ; 1 feuillet de titre et 130 pages in-fol. sous dossier toile noire avec étiquette de titre (un feuillet réparé au scotch ; cachets de l’éditeur). Importante musique pour le film Golgotha de Julien Duvivier.
Le film de Julien DUVIVIER (1896 - 1967), tourné en 1934 et sorti sur les écrans le 10 avril 1935, retrace les derniers jours et la mort du Christ, sur un scénario du chanoine Joseph Reymond. Une distribution prestigieuse réunit l’extraordinaire Robert Le Vigan dans le rôle de Jésus, Harry Baur (Hérode), Charles Granval (Caïphe), Jean Gabin (Ponce Pilate), Lucas Gridoux (Judas), Edwige Feuillère (Claudia Procula), Juliette Verneuil (Marie), etc. Pour ce film, Jacques Ibert conçut une importante partition, qui fut enregistrée par l’orchestre Walther Staram sous la direction de Maurice Jaubert.
La musique de Jacques Ibert, très dramatique, joue un grand rôle dans le film, qui contient de longues séquences presque sans dialogues, avec un grand usage des vents, des percussions et des ondes Martenot. L’effectif requiert : 2 flûtes, hautbois, clarinette, saxophone, basson, 2 cors, 2 trompettes, tuba, trombone, percussions, 2 ondes Martenot, piano, harpe, et les cordes.
Le manuscrit est à l’encre noire sur papier à 26 lignes ; il porte les cachets de la SACEM en date du 8 septembre 1938. Il présente de nombreuses ratures et corrections, avec des collettes ; il a servi de conducteur, et est couvert d’annotations au crayon bleu ou rouge, avec des notes et corrections crayon faisant référence au découpage et aux séquences du film. Il semble avoir été réorganisé en suite d’orchestre.
Après un titre : « Golgotha / N° II. Bob. – Scène des vendeurs du Temple », un premier ensemble paginé 1-56 donne les numéros A à C ter, avec le découpage suivant : A . Sanhédrin (int. scène parlée) – Plan oliviers – Plan gens (Hosannah) – Bords Cédron – Grand Plan ensemble Porte Sion (1ère fois) – Gens jettent tapis – Ensemble porte Sion (2e fois) – Plan chameliers – Litière – Haut de la tour – Bords Cédron (lointain) – B. Guetteur « le voilà » – Porte ogive Jérusalem – Porte fer forgé Temple – C. Chez Pilate – C bis. Ensemble porte Sion – Plan gens criant Hosannah –Plan Jean et Pierre – Foule dans parvis – C ter. Christ sommet parvis – Apôtres dans cour du Temple – Gros plan Judas – Sortie Judas – Porte Sion ».
Pages 1-18. G. Marchands du temple – I bis. Marchands jet de pierres – Grand ensemble foule – Christ monte marche ; plus 1 feuillet « pour finir ».
Pages 1-49, séquences J à M. J. Escalier Antonia –Pinacle du Temple – Gros plan Christ – Femmes et enfants –Christ avec croix – Stes Femmes – Ruelle – Plan rue et escalier – Plan visages – Christ croix – Foule Christ chute. K Ruelle – Plan Jean dans rue – 2e chute Christ – Gros plan Sanhédrin – Centurion – Gros plan Christ – Stes Femmes « Mon fils » – Vue Jérusalem (maquette) – Porte de Sion – Collines moutons – Cortège sous la voute – Campement sortie du Christ – Golgotha – L . Pendaison de Judas – Nuages, vue sur Golgotha – Crucifixion condamné – Maquette, nuages sur Jérusalem – Christ attaché en croix – Foule – Jean et mère Christ – Croix condamné qu’on dresse –Centurion avec croix au fond – Soldats jouant tunique – Stes Femmes, Jean et Christ groupe – Caïphe – M. Colline des oliviers – Maquette Jérusalem nuages – Groupe Sanhédrites foule qui commence à fuir – Gens qui regardent et fuient – Mort du Christ – Centurion arc en ciel – Temple (voile déchiré).
8 000
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 44
Pages 1-6. N. Cortège funèbre – Tombeau – Entrée du Temple Sanhédrites (scène parlée) – fin dialogue soldats. Discographie : Adriano, Orchestre Symphonique de la Radio Slovaque (Naxos 2005). - 10 000
100 IBERT Jacques (1890 - 1962).
MANUSCRIT MUSICAL autographe signé, Le Chevalier errant (1936) ; titre et 239 pages in-fol. montés sur onglets, en un volume relié toile noire à coins.
Importante musique d’un ballet sur Don Quichotte, composé pour Ida Rubinstein et monté par Serge Lifar Jacques Ibert confiait : « le personnage de Don Quichotte m’a toujours poursuivi, à moins que ce ne soit moi qui l’ai recherché. Mais il ne faut pas en conclure que j’aime me battre contre les moulins ou faire figure de redresseur de torts. Don Quichotte représente pour moi un homme à la poursuite d’un idéal qu’il ne rencontre jamais. Peut-être y a-t-il là une mystérieuse et secrète correspondance avec mon propre tempérament ». Ibert composa successivement en effet en 1932 pour Chaliapine les chansons du film Don Quichotte de Georg Wilhelm Pabst ; en 1935 - 1936 le « choréodrame » Le Chevalier errant ; et en 1947 la musique de Don Quichotte de la Manche, une évocation radiophonique de William Aguet.
C’est à la demande de la danseuse Ida RUBINSTEIN, qui en sera la dédicataire, que Jacques Ibert a écrit Le Chevalier errant, « épopée chorégraphique en 4 tableaux d’après Cervantès », sur un scénario d’Élisabeth de Gramont et des textes d’Alexandre Arnoux. Un contrat fut signé en décembre 1937 par Ida Rubinstein avec le directeur de l’Opéra de Paris, Jacques Rouché, pour une série de représentations où elle devait monter et danser ce « choréodrame » ; mais ce projet n’aboutit pas. C’est Serge LIFAR qui monta enfin le ballet à l’Opéra de Paris le 26 avril 1950, dans des décors de Pedro Florès ; Serge Lifar, en Don Quichotte, était entouré par les meilleures étoiles de l’Opéra : Lycette Darsonval, Christiane Vaussard, Micheline Bardin. La musique était dirigée par Louis Fourestier. La partition avait paru l’année précédente aux éditions Alphonse Leduc (cachets de l’éditeur). Jacques Ibert en tirera une suite symphonique.
Le Prologue s’ouvre deux ans après la mort de Don Quichotte : sa nièce Antonia et Carrasco s’interrogent sur l’homme, qui va être évoqué au fil des tableaux ; les récitants et les chœurs, assis en gradins sur un des côtés de la scène, commentent le récit chorégraphique ; le « chevalier errant » apparaîtra comme un homme de foi, une âme pure, un chevalier de l’Absolu.
Le manuscrit est à l’encre noire sur papier à 32 lignes, avec des corrections, grattages et collettes ; il a servi de conducteur pour les représentations, et est annoté au crayon noir ou rouge. Il est signé et daté en fin « ParisHoulgate 1935/36 ». Il porte en tête la nomenclature des instruments : 3 flûtes (dont petite flûte), 2 hautbois, cor anglais, 2 clarinettes, clarinette basse, saxo alto, 3 bassons, contrebasson, 6 cors, 4 trompettes, 3 trombones, tuba, 4 timbales, batterie (tam-tam, cymbales, tambour de basque, caisse claire, wood block, triangle, grosse caisse, tom-tom, glockenspiel, tambourin, cloches), xylophone, célesta, 4 guitares, 2 harpes, quintette à cordes. Il est ainsi découpé :
1. Prélude (p. I-IV), Moderato molto ;
2. Les Moulins (p. 1-33), Larghetto avec chœurs « Toutes les fois que l’homme fabrique un outil »… ; Apparition de Dulcinée (p. 1-12), Andante grazioso ;
3. Les Galères (p. 34-90) ;
4. L’Âge d ’Or (p. 91-137) ;
5. Les Comédiens (138 - 178), Animato assai ; Enchaînement du III e au IVe tableau (14 p., la p. 14 est intitulée Entrée des Géants ; plus une page par copiste) ; puis pages 179 - 209.
Discographie : Georges Tzipine, Chœurs et Orchestre National de l’ORTF, 1955 (L’Empreinte digitale 2000).
101 JAMMES Francis (1868 - 1938).
L.A.S. « Francis Jammes », Orthez mai 1901, à Téodor de WYZEWA ; 3 pages in-fol. (petites fentes réparées). Longue et belle lettre. Jammes remercie d’abord Wyzewa pour sa lettre , qui lui a donné « la plus pure sensation de gloire ». Il lui écrit « devant la chaude prairie, dans une mansarde où je m ’isole au-dessus de la chambre que ma mère occupe. Ma vieille chienne est là, harassée. Ma pipe est allumée. J’écoute mon cœur pour vous écrire ». Il évoque « ce mystère de l ’inspiration », et ses œuvres qui plaisent tant à Mme de Wyzewa, à qui il enverra l’épruve d’Almaïde d’Entremont, refusée par la Revue de Paris
45 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
6 000 - 8 000
400
500
-
102
JEAN CHRYSOSTOME (c. 347 - 407).
Manuscrit grec (fragment) sur parchemin, XI e - XII e s. ; un feuillet recto-verso sur parchemin, 299 x 215 mm ; 35 lignes sur deux colonnes ; encre carbone ; réglures à la pointe sèche, foliotation grecque « ΙΘ/I » (19/1) ; minuscule grecque cursive légèrement italique, quelques ligatures calligraphiées ; initiales rubriquées, bandeau à l’encre noire avec un travail d’entrelacs, frise à l’encre rouge et noire orné en fin d’un motif trifolié à la fin du recto du feuillet, guillemets rubriqués marginaux au verso du feuillet ; le feuillet porte les marques d’un ancien réemploi de reliure, marge intérieure rognée avec léger manque de texte (2 ou 3 lettres manquantes).
Fragment d’un manuscrit grec du plus célèbre commentaire biblique du début de la chrétienté provenant de la bibliothèque d’un des fondateurs de la Renaissance florentine, Niccolò Niccoli Chrysostomus Johannes, in epistulam I ad Timotheum argumentum et homiliæ 1-18. Les homélies de Jean de Constantinople, célèbre orateur grec du Ve siècle qui reçut le surnom posthume de Chrysostome, « Bouche d’or », rassemble plus de 900 prédications. Notre feuillet commence sur les six dernières lignes du sixième chapitre de la dix-septième Homélie sur les Épîtres de S. Paul à Timothée I (Pat. Graec. 62:600) et la seconde colonne ouvre sur deux lignes de Timothée II 1:1-2 et l’incipit du premier chapitre de la première homélie sur Timothée II qui continue au verso du feuillet (Pat. Graec. 62:599 - 600 ou Clavis Patrum Graecorum 4436 et 4437 ). Il provient de la célèbre bibliothèque du précurseur des humanistes florentins, Niccolò NICCOLI (c.1364/5-1437), inspirateur de la cursive humanistique et qui « built up a magnificent library, notable for the rarity and quality of the texts that it contained » (A. C. de la Mare, The Handwriting of Italian Humanists, I, i, 1973, p.46). Poggio Bracciolini (dit en français Le Pogge), célèbre philologue et proche de Niccoli, décrit la bibliothèque de son ami comme admirable car elle contenait plus de 800 manuscrits. Cette somme importante pour l’époque a même été confirmée par un libraire et biographe de la période, Vespasiano da Bisticci. Cette bibliothèque était d’autant plus remarquable qu’elle contenait plus de 146 volumes en grecs ; fait rare pour l’époque, car les érudits grecs après la chute de Constantinople (1453) n’étaient pas encore arrivés avec leurs manuscrits pour nourrir les publications de la Renaissance (B. L. Ullman and P. A. Stadter, The Public Library of Renaissance Florence, Niccolò Niccoli, Cosimo de’ Medici and the Library of San Marco, 1972, pp. 59-60). Niccoli apprit le grec auprès de Manuel Chrysoloras qui enseignait alors à Florence (c.1497 - 1400), cependant il ne le ma î trisa probablement jamais parfaitement. Ce manuscrit pourrait bien provenir de Chrysoloras lui-même. Entre 1429 et 32, le volume d’où provient le feuillet a été prêté à Ambrogio Traversari, qui le traduisit en latin ( Vite, ed. A. Greco, 1970, I, p. 451). La version latine de cette traduction écrite de la main de Niccoli, datée de 1432, est aujourd’hui conservée à Florence (Bib. Naz. Conv. Sopp. J.VI.6).
La bibliothèque de Niccoli fut transmise à seize héritiers ; c’est auprès d’eux que Cosme de Medicis (1389 - 1464) se tourna pour acquérir les plus beaux volumes de ce qui formera le noyau de la nouvelle bibliothèque publique du couvent de San Marco à Florence. La provenance de Niccoli « ex hereditate Nicolai de Niccolis » avec l ’exlibris de San Marco fut inscrite sur ces volumes par le bibliothécaire du couvent, Zanobi Acciaiuoli (actif de 1497 à 1513). Il indique à la suite que le volume contenait également les Homélies des Épîtres aux Philippiens. Une note manuscrite en marge supérieure attribuée au même bibliothécaire par le chercheur Xavier van Binnebeke (voir art. p.30), indique que le feuillet isolé était à la fin d’un autre volume : « ‹propter or ob› ignorationem avulsa est ab alio volumine quod desinit in quaternione / ‹ Ι›h et in prima ad Thimoteum, cum ligari simul debuissent ». Les chercheurs Ullman and Stadter rattachent le feuillet à l’entrée 1098 de l’inventaire de la bibliothèque daté de 1499/1500 « Iohannes Chrysostomus in epistolas ad Timotheum secundam et in eph’as [sic for «epl’am »] ad Philippenses, in membranis » ( Ullman and Stadter, p. 253). Xavier van Binnebeke explique plus en détail l’identification : « At least one further leaf can be added to the group of identified Chrysostom manuscripts with links to Niccoli and San Marco. This is London-Oslo, Schøyen Coll. Ms. 1571/1 (PL. VII), transmitting the end of Chrysostom, In Epist. Pauli I ad Timotheum, and the beginning of II ad Timotheum. As becomes clear from partly cut off inscriptions by Zanobi Acciaiuoli, Ms. 1571/1 served as a (?temporary) flyleaf to a volume of the convent library that came “ex hereditate Nicolai de Niccolis” and contained Chrysostom’s “expositio in epistolam S Pauli ad Timotheum secundam per homilias .X.” and “expositio eiusdem in espitolam ad Philippenses per homilias .XVI.m”1. This lanuscript is still identifiable in the inventory of 1499/1500 at no. 1098, but remains in hiding. The single leaf may originally also have belonged to a Chrysostom from San Marco but I haven’t yet been able to securely identify it ». Durant les guerres et l’occupation napol é onienne (1808) la majorit é de la bibliothèque de San Marco fut saisie pour être transmise à la Bibliothèque nationale de Florence. La confusion du déménagement de la bibliothèque permit s û rement à quelques personnes, probablement les moines eux-mêmes, de cacher certains volumes. Les marchands londoniens Payne and Foss en achetèrent quelques-uns entre 1829 et 1832 qu’ils proposèrent ensuite dans une lettre datée du 16 mars 1833 au célèbre bibliophile Sir Thomas Phillipps. La liste des seize manuscrits qui accompagnait la lettre des marchands à Phillipps était dans la collection Sch ø yen (Ms. 1571/2, voir Ullman and Stadter). Cependant notre manuscrit ne fut pas acquis par Phillipps. On le retrouve ensuite dans la collection de Mark Lansburgh, « The Illuminated Manuscript Collection at Colorado », The Art Journa l, XXVIII, 1968, p.6. Son cachet à l’encre bleue se trouve au verso du feuillet. Le libraire Jorn Gunther vendit ensuite le feuillet en 1992 à Martin Schøyen (MS 1571/1).
Bibliographie : Van Binnebeke, 2010, « Payne & Foss, Sir Thomas Phillipps, and the Manuscripts of San Marco », 30-31 (et n. 5, p. 30, n. 1-3, p. 31), pl. VII. – B. L. Ullman and P. A. Stadter, « The Public Library of the Renaissance: Niccolo Niccoli, Cosimo de’ Medici and the Library of San Marco », Medioevo e Umanesimo 10 (Padua, 1972). –Sotheby’s, Londres, 10 juillet 2012, lot 4. – Pinakes 46875.
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 46
3 000 - 4 000
103 JOSÉPHINE (1761 - 1814) Impératrice des Français, première femme de Napoléon.
P.S. « Tascher Lapagerie Bonaparte », Malmaison 1er prairial IX (21 mai 1801) ; demi-page in-4 (rousseurs).
« Marie Josephine Tascher La Pagerie épouse de Napoleon Bonaparte premier Consul au nom & comme Mere & Tutrice de Eugene Rose & Hortense Eugenie Beauharnais » certifie que leur aïeul feu François Beauharnais n’a joui d’aucun traitement d’activité à partir du 1er janvier 1790, et qu’il ne touchait qu’une pension réduite à 3 000 francs. Rare forme de signature
104 KAFKA Franz (1883 - 1924).
The Metamorphosis (Paris, Didier Mutel, 1996). 3 volumes in- 4, reliés box gris, ponçage de réserve sur une composition typographique, formes en relief biseautées sur le premier plat (François Brindeau, 2001).
Livre conçu et illustré par Didier MUTEL, tiré à 60 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci n° 1 Signé par D. Mutel et numéroté 1 au justificatif.
Illustré de 24 gravures originales sur cuivre par Didier Mutel, l’ouvrage, traduit en anglais par Wille et Edwin Muir, est une réalisation originale, par son concept, sa typographie et sa mise en pages. La police de caractères a été créée spécialement pour Metamorphosis par Didier Mutel, à partir de lettres fragmentées, comme une métaphore du récit de Kafka sur Gregor Samsa transformé en insecte géant. Dans le tome 1, des marques verticales remplacent des mots du roman. Dans les volumes 1 et 2, on peut voir plusieurs images abstraites de Samsa, mais dans le volume 3, seules des marques abstraites sont représentées. Les mots du volume 2 sont imprimés avec des marques verticales combinées à des lettres en Métamorphosis. Selon D. Mutel, « c’est l’histoire de deux mondes. Le monde de Samsa, qui ne peut pas rencontrer sa famille ou le monde extérieur [car] il n’y a pas de communication. Quand on peut lire les gravures, on ne peut pas lire le texte et vice versa ».
105 KESSEL Joseph (1898 - 1979).
MANUSCRIT autographe, Notice sur J. Kessel et sur son roman l’Équipage, [1924] ; 6 pages petit in-4. Intéressante notice autobiographique et présentation du roman L’Équipage Cette notice, rédigée à la troisième personne, après la publication de L’Équipage (Éditions de la Nouvelle Revue française, 1923), présente de nombreuses ratures et corrections. Kessel y trace en quelques pages son enfance et sa jeunesse, insistant sur son caractère nomade : « J. Kessel est né le 10 février 1898 en République Argentine.
[…] J. Kessel n’a jamais vécu plus de trois années de suite dans la même ville. Il semble que le hasard favorable à ses goûts le pousse toujours à travers les grandes routes du monde »… Plus loin il évoque son premier livre La Steppe rouge qui « réunit des nouvelles sur le bolchevisme », puis L’Équipage qui « a été l’année dernière un des plus vivement discutés à la grande saison des prix littéraires ».
Kessel expose sa conception de la littérature : « Il n’a en littérature qu’une théorie : c’est qu’il ne faut pas en avoir.
Il a le goût des livres vigoureusement charpentés, animés de péripéties violentes, où l’intérêt ne languisse pas un instant ». Exigence que l’auteur pense avoir tenue puisque La Steppe rouge est « une suite d’histoires terribles, où le lecteur palpite sans arrêt » ; quant à L’Équipage : « c’est la vie d’escadrille qu’a retracée J. Kessel. Il a su en peindre la camaraderie merveilleuse [...] une intrigue naît de ce milieu et se développe, une intrigue dont la hardiesse et la nouveauté mènent aux situations les plus dramatiques et les plus douloureuses »...
106 LACLOS Pierre Choderlos de (1741 - 1803).
P.A.S. « P. Choderlos » (dans le texte), 15 décembre 1791 ; 4 pages in-4 (petite répar.). Rare projet autographe, qui semble inédit, d’une association pour la manufacture et le commerce de drap feutré
« Ce jourdhuy quinze decembre 1791, entre M rs J.H. Mouton, P. Choderlos, et … Antheaume, ce dernier inventeur d’une nouvelle étoffe denommée drap feutré, il a été convenu ce qui suit. Savoir : 1° Le S r P. Choderlos s’occupera des moyens de tirer un parti utile de la susditte invention, tant auprès du gouvernement et que par les relations commerciales, soit a l’intérieur soit à l’extérieur ; et nottament aupres de la comp. des Indes angloise »… Il est également chargé de surveiller les expériences pour s’assurer de la qualité et du prix des étoffes, et éventuellement de l’établissement et du régime de la manufacture… Le sieur MOUTON s’engage à y placer 100.000 livres, et le sieur ANTHEAUME, à fabriquer les étoffes pour échantillons, à se pourvoir d’une patente d’inventeur en France et éventuellement en Angleterre, et à ne former aucun autre traité relatif à la fabrication du drap feutré dans l’espace de 6 mois… Sont aussi précisées les conditions de distribution de bénéfices, Antheaume recevant un cinquième comme « inventeur et fabricateur », « P. Choderlos comme inspecteur, un cinquième », et Mouton trois cinquièmes « comme bailleur de fonds »…
1 500 - 2 000
47 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
1 000 - 1 500
2 000 - 2 500
1 500 - 2 000
107
LAMARTINE Alphonse de (1790 - 1869).
MANUSCRIT autographe signé « Lamartine », Vie de Périclès ; 108 pages in-4, sur 108 feuillets chiffrés 1-108. Manuscrit complet de cette biographie
Cette vie de PÉRICLÈS, le grand homme d’État athénien, forme le deuxième chapitre du tome I des Civilisateurs et Conquérants (Paris, Libraire internationale, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1865, p. 41-147), où il succède à Solon et précède Michel-Ange.
Le graphisme du manuscrit laisse penser que cette biographie fut rédigée pour son journal mensuel Le Civilisateur, histoire de l’humanité par les grands hommes (1852 - 1854).
Le manuscrit, à l’encre brune sur beau papier vergé filigrané de Lacroix & Frères, présente de nombreuses corrections et additions, avec quelques passages biffés. Lamartine a collé dans son manuscrit trois courts extraits imprimés tirés d’une édition ancienne de Plutarque (p. 33 et 105) ; on relève p. 91 quelques lignes (en partie biffées) de la main d’un copiste. Le manuscrit est divisé en 38 chapitres numérotés ; le découpage sera différent dans l’édition. Lamartine commence ainsi : « Le génie des grands hommes politiques est en eux-mêmes, mais leur gloire est dans les circonstances heureuses et dans les autres grands hommes, dont ils sont comme par une prodigalité de la nature ou de la civilisation entourés escortés suivis devant la postérité. Avoir son nom inséparable dans l’histoire d’une foule d’individualités éminentes qui se groupent autour de votre nom et qui rejaillissant en splendeur réciproque les uns sur les autres forment un éblouissement historique au milieu duquel vous resplendissait comme l’axe au centre des rayons c’est être plus qu’un grand homme, c’est être un siècle. Périclès eut ce bonheur en Grèce, comme Auguste à Rome, comme les Médicis en Italie, comme Louis XIV en France »...
Et il conclut par un parallèle avec William PITT : « Un seul homme dans les temps modernes de l’Europe nous semble avoir été l’émule et la ressemblance historique de Périclès, cet homme est le grand ministre anglais William Pitt ; comme Périclès il naquit homme d’État ; comme Périclès il fut le premier orateur politique de son temps ; comme Périclès […] il prit son point d’appui dans la liberté et non dans la tyrannie et il ne demanda à son pays le sacrifice d’aucune des libertés de sa constitution sous prétexte du Salut Public ; comme Périclès il aima mieux persuader qu’opprimer et tomber du pouvoir quand l’opinion lui faillit que d’y rester en faisant violence à sa Patrie. Comme Périclès enfin il resta honnête homme, probe et désintéressé au milieu des tentations de la domination presque absolue qu’il exerça sur sa nation et sur la couronne. Il ne fit qu’une guerre défensive ce devoir douloureux du grand patriote et il mourut sans avoir fait prendre pour sa cause le deuil d’un seul citoyen. Périclès fut donc selon nous dans des conditions de constitution diverse le Pitt de l’Antiquité et Pitt fut le Périclès de l’Angleterre ».
108
LAMARTINE Alphonse de (1790 - 1869).
MANUSCRIT autographe signé « Lamartine », Histoire de la Russie, [1855] ; environ 820 pages in-4 (27 x 20,5 cm).
Important manuscrit complet de cette Histoire de la Russie
Lamartine a publié son Histoire de la Russie en 1855 chez Perrotin, en deux volumes ; elle avait été annoncée comme un complément de son Histoire de la Turquie (1854), ce que confirme le manuscrit. Il l’a reprise en un volume au tome XXXI de ses Œuvres complètes (Paris, chez l’auteur, 1863).
Le manuscrit, à l’encre brune sur beau papier vergé, présente de nombreuses ratures et corrections, et des additions interlinéaires ; quelques corrections supplémentaires ont été portées au crayon lors d’une relecture. Il est divisé en deux volumes, dont la pagination est parfois incohérente (Lamartine allant jusqu’à se tromper de centaine !).
Lamartine a inséré dans son manuscrit une quarantaine de feuillets imprimés extraits d’ouvrages historiques (dont le Congrès de Vérone de Chateaubriand, et l’Histoire intime de la Russie de Schnitzler), sur lesquels il a porté des corrections.
L’ouvrage est divisé en dix livres non titrés, les derniers non numérotés (« mettez le chiffre », note-t-il), eux-mêmes divisés en chapitres en chiffres romains.
La page de titre porte : « Histoire de Russie – Suite et complément de l’Histoire de Turquie – Par Lamartine » (au bas une série d’initiales qui restent pour nous mystérieuses). Le 1er volume comprend les livres suivants : I sur la Russie avant Pierre le Grand (p. 1-98) ;II consacré au règne de Pierre le Grand (p. 99-169) ; III de Catherine I re à Élisabeth (p. 169 - 239) ; IV sur Pierre III (p. 239 - 345). Le 2e volume comprend les livres suivants : [V] (« Livre 6 ème ») sur Catherine II (p. 1-124) [qui sera divisé en deux livres V-VI dans l’édition (ici 1-12 et 62-124)] ; [VII] (« Livre VI ») sur Paul I er (p. 125 - 203) ; [VIII] consacré à Alexandre I er (p. 204 - 285), ainsi que le livre [IX] (p. 286 - 386) ; [X] sur l’avènement de Nicolas I er (p. 387 - 454) ; à la fin, Lamartine a noté : « Fin du 2e et dernier volume ». Citons les dernières lignes, après la cérémonie de prestation de serment : « Le règne politique de Nicolas commença à dater de jour. Il est trop près de nous pour être aujourd’hui raconté. Avant de l’entreprendre il faut avoir jeté dans son tombeau à peine ouvert les partialités, les ressentiments et les sévérités légitimes que ses dernières années de règne ont accumulés avec tant de sang sur son nom. Même pour accuser l’histoire a besoin de justice et la justice a besoin de tems ».
Suit un « Épilogue de l’histoire de Russie ou Réflexions sur la guerre présente » (23 pages, ch. 1-23), qui semble être resté inédit . Lamartine réfléchit sur la guerre de Crimée. Nous en citons le début : « Le caractère général du règne de l’empereur Nicolas fut baigné la dernière année de sa vie l’immobilité du monde, non seulement en Occident mais en Orient. L’immobilité du monde pendant une certaine période de tems était pour la Russie non seulement un système mais un orgueil »..
3 000 - 4 000
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 48
800 - 1 000
108 bis LOUISE DE SAVOIE (1476 - 1536) mère de François Ier, Régente de France pendant la captivité de son fils.
P.S. « Loyse », Lyon 17 mai 1525; contresignée par BRETON; vélin oblong in-fol. (déchirure marginale sans perte de texte, brunissures).
Régente de France, elle donne ordre de payer à Jehan LE SIEUR, conseiller au Parlement de Rouen, la somme de 663 livres, pour le « parfaict payement de ses voyages sallaires et vaccacions »...
Provenance: ancienne collection MONMERQUÉ
109 Félicité de LAMENNAIS (1782 - 1854).
L.A.S. « L’abbé de la Mennais », Paris 25 avril 1820, au baron de SYON à Turin ; 1 page et quart in-8, adresse. Il lui recommande M. DELPLAN, « jeune architecte qui se rend à Rome […] Ce jeune artiste est l’ami d’une des personnes pour qui j’ai le plus d’attachement et d’estime »…
110 LAMENNAIS Félicité de (1782 - 1854).
7 L.A.S., 1827 - 1841, au marquis ou au comte de CORIOLIS D’ESPINOUSSE (5), et au baron de VITROLLES (2) ; 13 pages in-8 ou in-12, adresses et une enveloppe.
25 septembre [1827], après une grave maladie : « Ma tête est encore très peu capable d’application, mais je n’ai besoin que de suivre le mouvement naturel de mon cœur pour vous parler de la tendre et respectueuse affection que je conserverai pour vous jusqu’à la fin d’une vie dont j’ai vu le terme de bien près »…
25 novembre [1840 ?], apprenant la maladie du marquis : « Dès que les soins de mon procès me laisseront deux heures dont je puisse disposer, j’irai m’informer de vos nouvelles, si toutefois je ne suis pas en prison. On a si grande envie de m’y mettre, et tant de moyens pour se passer cette envie, qu’il me paraît assez difficile qu’on n’y réussisse pas »…
Deux lettres sont écrites de la prison de Sainte-Pélagie au comte de Coriolis, fils du marquis. 19 janvier, après la mort du marquis : « Si j’avais pu concevoir une crainte de ce genre, j’aurais certainement essayé, malgré les embarras de mon procès, de revoir encore une fois l’ami si constant et si bon que je ne cesserai jamais de regretter »…
8 avril, au sujet de la visite que le comte veut lui rendre dans sa prison.
Au baron de VITROLLES. 10 septembre 1836 : de retour d’un petit voyage à Fontainebleau, il a trouvé son neveu et sa sœur, qu’il ne peut quitter jusqu’à leur départ. Dimanche 12 avril [1835 ?], au sujet d’un achat de bon vin, et d’un billet de George Sand.
111 LARGUIER Léo (1878 - 1950).
MANUSCRIT autographe d’un journal intime, 15 mai-novembre 1940 ; 52 pages in-fol. Chronique de la débâcle et du début de l’Occupation
Alertes fréquentes, cafés vides, amis absents (Dorgelès, Carco, René Benjamin) : Larguier se sauve à Chevreuse : « Je n’ai emporté qu’une valise et le manuscrit du Temps passé, mon asile, ma chartreuse, mon seul refuge »… Quelques jours plus tard, un train bondé l’emmène à Viales en Lozère (500 habitants)… Larguier a collé dans son manuscrit des L.A.S. de la princesse Ernest d’ARENBERG et de René BENJAMIN, des coupures de presse concernant l’armistice et Paris occupé… La vie quotidienne à Viales sous l’ombre de la guerre… Souvenirs d’enfance et de jeunesse… Nouvelles de Vichy… En novembre, il retrouve à Nîmes René Benjamin, qui lui rapporte les confidences du maréchal Pétain sur l’entrevue de Montoire… Larguier relit le journal des Goncourt…
On joint quelques notes autographes, plus une coupure de presse sur l’arrestation d’Abel Hermant à la Libération.
112 Romain Thomas dit LHÉRITIER (1809 - 1885) acteur.
ALBUM de 23 aquarelles originales, dont 6 signées « Lh », [1860 - 1873] ; montées sur 12 feuillets de carton bleu oblong in-fol. dans un album en reliure d’époque demi-basane brune (rel. usagée).
Bel ensemble de caricatures des acteurs du Palais-Royal
Dans Le Roi Candaule (de Meilhac et Halévy, créé au Palais-Royal en 1873) : Romain Lhéritier, Jean-Marie-Michel
GEOFFROY, et René LUGUET.
Dans Le Plus Heureux des trois (de Labiche et Gondinet, Palais-Royal 1870), sur une même feuille : Jules BRASSEUR, GEOFFROY, LHÉRITIER et GIL-PÉRÈS.
Dans L’Homme masqué (des frères Cogniard et Choler, Palais-Royal 1867) : Hyacinthe, Lhéritier, Désiré, Paul, Lassouche, Kalkaire, Gobin.
Dans La Sensitive (de Labiche, Palais-Royal 1860) : Amand, Arnal, Hyacinthe, Gil-Pérès, Brasseur et René Luguet. Autres portraits de LASSOUCHE, BRASSEUR, PELLERIN, GIL-PÉRÈS, PRISTON, FITZELIER, HYACINTHE, LHÉRITIER (dans La Cagnotte de Labiche, 1864), ACHARD, LEVASSOR, RAVEL, Félicia THIERRET, DÉSIRÉ ; Paul GRASSOT dans trois de ses rôles (Le Célèbre Vergeot, Le Terrible Savoyard et Dansorès Españolas ; une page est également consacrée aux « Esclaves » du Palais-Royal : le garçon d’accessoires, le 1er et le 2e régisseurs.
49 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
750
1 000
-
80
100
-
800 - 1 000
1 000 - 1 200
800 - 1 000
113 LINCOLN Abraham (1809 - 1865).
L.A.S. « A. Lincoln », 17 août 1861, au général Lorenzo THOMAS (1804 - 1875) ; 1 page in-8, avec L.A.S. de Lorenzo Thomas et du général FRANKLIN sur 3 pages ; en anglais.
En répnse à une lettre des généraux Thomas et Franklin du 13 août 1861 concernant le capitaine DALLAS.
« I repeat that if Adjutant Genl. Thomas is reasonably well satisfied that Capt. Dallas was rejected by the Senate through misappre[hen]sion of facts, he is to be re-appointed. It is the opinion of the Adjutant General, and of Genl. Franklin, as shown by what they have written written [sic] within, that he is a good officer »….
114 LISZT Franz (1811 - 1886).
L.A.S. « F. Liszt », Weymar 7 août 1852, à Joseph AUTRAN ; 4 pages in-8. Belle lettre sur son cycle choral Les Quatre Éléments et sur son poème symphonique Les Préludes [Ces deux œuvres sont inspirées de poèmes de Joseph AUTRAN (1813 - 1877). Lors de la venue de Liszt à Marseille, Joseph Autran lui offrit une suite de quatre poèmes, La terre, Les aquilon, Les flots et Les astres. Liszt conçut alors l’idée d’une cycle de choeurs pour voix d’hommes avec accompagnement de piano, Les Quatre Éléments, et composa immédiatement la musique pour Les aquilons ; il en dirigea au piano la création à Marseille même lors de son dernier concert le 6 août 1844. Il compléta jusqu’en 1845 cette suite musicale avec les chœurs des trois autres parties, mais il ne la publia ni ne la fit interpréter de son vivant. En revanche, il y ajouta en 1848 une ouverture symphonique qui utilise le thème principal du chœur Les Aquilons, mais cette ouverture devint une œuvre symphonique indépendante, Les Préludes, qui fut créée à Weimar le 23 février 1854. Liszt évoque également ici le recueil d’Autran Les Poèmes de la mer (Michel Lévy, 1852), qui recueille les poèmes offerts à Liszt et une pièce intitulée À Franz Liszt
« Votre lettre et le beau volume de vos Poèmes de la Mer m’ont fait un très grand plaisir, et je vous remercie bien cordialement de cette aimable preuve de votre bon souvenir. Il semble que vous ayez deviné que la mer devait me manquer beaucoup ici et que vous ayez voulu y suppléer par une de ces généreuses libéralités dont les poètes sont seuls capables. En effet vos vers me tiendront lieu de cette sublime société, de ces infinis horizons, de ces irrétrouvables harmonies, qui m’étaient devenues familières durant mes voyages, et c’est avec vous que je les évoquerai désormais ! Dès la première feuille j’ai été charmé de retrouver plusieurs strophes que j’avais composé autrefois et que je compte vous faire entendre lorsque je reviendrai à Paris. Vous vous souvenezpeut-être m’avoir confié à Marseille quatre textes – Les Flots – Les Bois – Les Astres – Les Autans. J’en ai achevé la musique il y a longtemps, et en les orchestrant, l’idée me prit d’y joindre une assez longue ouverture. Nous en ferons quelque chose à quelque beau jour ; malheureusement la musique ne prend vie que par l’exécution et il n’est pas toujours aisé de disposer d’un personnel suffisant pour ce genre de composition qui ne s’adapte qu’à des programmes de concerts peu fréquents ». Puis il félicité Autran pour son mariage avec Mme Fitch qu’il sera heureux de revoir, lors d’un voyage des Autran en Allemagne : « Tout aux portes de Weymar vous trouveriezla forêt de Thuringe, renommée pour ses beaux points de vue, et la Wartbourg qui conserve ses traditions de combats de Poètes. Peut-être vous laisserez-vous tenter un jour de visiter ces contrées et me ferez-vous l’amitié de venir passer quelques jours avec moi et causer tout à l’aise de nos Flots »…
115
LISZT Franz (1811 - 1886).
L.A.S. « F. Liszt », [Paris] Jeudi matin ; 1 page in-12. « Merci de votre beau zçle, cher vaillant collaborateur. Je me mets complètement à votre disposition demain et après demain dans l’après-midi, soit chez Érard soit chez vous »…
116 LIVRES.
Ensemble de 3 ouvrages en 2 volumes.
BUNGUS Petrus (†1601). Mysticae numerorum significationis (Bergame, C. Venturae, ). 2 tomes en 1 vol. in-folio (32 x 20,5 cm) demi-veau brun à petits coins, dos à nerfs orné (remboîtage XIXe s.)
Rare édition originale de cet important traité de numérologie qui étudie cette discipline au travers de plusieurs centaines d’auteurs et sur une période s’étendant de l’Antiquité à la Renaissance. Ancienne coll. René Alleau. (Mouillures, forte brunissure aux derniers feuillets, quelques rousseurs, galerie de ver aux premiers feuillets, déchirures marginales, étiquette scotchée au premier contreplat, remboîtage malhabile du XIXe siècle très défraîchi.
COCLES Bartolomeo (1467 - 1504). La Geomantia, [suivi de :] GEBER Gioanni , De la Geomantia (Venise, G. Rapirio, 1550 et 1552). Ens. 2 ouvrages en 1 vol. petit in-8 (14,8 x 9,7 cm), maroquin vert, cadre intérieur de même peau orné de dentelles, dos à nerfs orné (reliure postérieure). Réunion de deux traités abondamment illustrés dans le texte. Ex-libris manuscrit « Gaspard de Ronnat » sur le titre ; ancienne coll. Guy Bechtel (ex-libris gravé). Taches et mouillures, annotations à l’encre, dernier cahier partiellement débroché.
6 000 - 8 000
800 - 1 000
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 50
800 - 1 000
1 200 - 1 500
117 LOMAZZO Giovanni Paolo (1538 - 1592).
Traicté de la proportion naturelle et artificielle des choses par Ian Pol Lomazzo peintre milanois. Ouvrage necessaire aux Peintres, Sculpteurs, Graveurs, & à tous ceux qui pretendent à la perfection du Dessein (Toulouse, Arnaud Colomiez, 1649) ; grand in-4 (32,7 x 22,5 cm), [f. bl.]-[f.de titre]-[13 ff.]-[6 ff.]-91 pp. (erreur de numérotation à la p.61 indiquée 81)-[6 pp.] ; cartonnage bradel bleu, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin brun, tranches jaunies, emboîtage de toile bleu (reliure vers 1800).
Livre de peintre majeur, d’une extrême rareté
Première édition de la traduction française, partielle, du Trattato dell’arte della pittura de Lomazzo par Hilaire PADER, illustrée de bandeaux, lettres ornées et culs de lampe gravés sur bois, marque d’imprimeur gravée sur bois, 50 illustrations gravées sur cuivre, sur des planches hors-texte ou dans le texte (certaines signées H. Pader), et un portrait de Giovanni Paolo Lomazzo gravé à l’eau-forte.
Traduction du premier des sept livres de cet ouvrage publié à Milan en 1584. Celui-ci concerne uniquement la science des proportions, mais occupe une place de premier ordre dans la littérature artistique de l’époque : « par sa date, puisque précédant de deux ans la traduction du Traité de la peinture de Léonard de Vinci par Roland Fréart de Chambray, elle constitue le premier ouvrage académique publié en France à être spécialement consacré à la théorie de la peinture ; par son influence, puisqu’elle aida notamment Poussin à formuler l’interprétation néoplatonicienne de l’art de peindre à laquelle il resta ensuite attaché ; enfin par la qualité de son illustration, où les eaux-fortes de Pader offrent le paradoxal témoignage de figures maniéristes tracées de la main d’un maître du dessin classique » (Des livres rares depuis l’invention de l’imprimerie, BnF, 1998, p. 175).
Certains exemplaires contiennent une gravure au verso de la gravure n°5 ; sur d’autres, comme celui-ci, le verso est resté vierge. Un lecteur de l’époque a souligné à l’encre noire certains passages du texte.
Provenance : Theo Dobbelmann, 1941 (ex-libris collé sur le contreplat) ; ex-libris du XIXe siècle non identifié (collé au verso du feuillet de titre).
Références : Cicognara, n°332. - Robert-Dumesnil, t. VIII, pp. 262 - 270, n°2-53. (Mouillure répétée sur plusieurs feuillets, petits trous sans manques au titre ; reliure en état d’usage, frottements et dos abîmé).
118 LOUŸS Pierre (1870 - 1925) et BATAILLE Henry (1872 - 1922).
MANUSCRIT autographe signé de Pierre LOUŸS, 1894, illustré d’un DESSIN signé et légendé par Henry BATAILLE, 1908 ; 1 page oblong in-4 (17 x 21,5 cm).
Belle page à propos des Chansons de Bilitis
En haut à gauche, Louÿs a inscrit les deux dernières strophes de La Jongleuse des Chansons de Bilitis (CXXI) : « Louez la, car elle fut adroite et fit des tours difficiles. Elle jonglait avec des cerceaux sans rien casser dans la salle et se glissallit au travers comme une sauterelle. Parfois elle faisait la roue sur les mains et sur les pieds. Ou bien, les deux jambes en l’air et les genoux écartés, elle se courbait à la renverse et touchait la terre en riant ». Henry BATAILLE a dessiné, à la mine de plomb et à l’encre noire, une contorsionniste nue simulant une décapitation, légendée : « Salomé dansant devant Hérode la danse de la “Décollation de S. J. Baptiste” Henry Bataille 1908 ».
On joint un ensemble de 19 lettres ou pièces, la plupart L.A.S.
Paul ADAM, Henri BARBUSSE, Julien BENDA, Pierre BENOIT, Henry BERNSTEIN, Maurice DEKOBRA, Lucie DELARUE-MARDRUS, Georges DUHAMEL, Claude FARRÈRE, Jean-Jacques GAUTIER, Bernard GAVOTY, André LEBEY, Marius-Ary LEBLOND, Georges LECOMTE, Francis DE MIOMANDRE, Robert SABATIER…
51 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
-
1 000
1 500
600 - 800
119
[LOWE Hudson (1769 - 1844) général anglais, geôlier de Napoléon à Sainte-Hélène.]
4 lettres et documents, Sainte-Hélène 1816 - 1821 ; sur 14 pages in-fol., avec analyse au dos des documents ; en anglais.
L.A.S. du major Gideon GORREQUER (1781 - 1841), aide de camp d’Hudson Lowe, Sainte-Helène 1er août 1817, à Denzil IBBETSON, commissaire général à Sainte-Hélène (3 p. in-fol.). Hudson Lowe fait part de son opposition au transfert d’Ibbetson demandé par l’East India Company, notamment en raison de la demande accrue de fournitures causée par l’augmentation de la population de l’île causée par la présence de Napoléon. Le magasinier par qui la délivrance des provisions était faite autrefois, s’est révélé incompétent, mais s’est défendu des irrégularités relevées par Lowe en arguant qu’il n’a pas eu d’assistant supplémentaire après l’arrivée du général Bonaparte et l’augmentation de la population sur l’île... Il a été jugé opportun, même par principe d’économie ainsi que pour assurer un approvisionnement régulier et bon, de faire fournir par le Commissariat les viandes et les fourrages pour les établissements du général Bonaparte. Lowe propose qu’Ibbetson soit commissaire aux comptes des établissements de Napoléon, ce qui devrait inciter le Trésor à l’autoriser à rester sur l’île. [Ibbetson, arrivé sur l’île avec Napoléon sur le Northumberland en 1815, y resta en effet jusqu’en juin 1823.] « The storekeeper by whom the issue of Provisions was formerly made, has been found incompetent to the complete discharge of all duties in other branches and having had no additional assistant in consequence of the arrival of General Bonaparte and of the increase in population on the island, has assigned this as a cause to the Court of Directors for some irregularities which the governor has represented to them. ... It has been found expedient, even from principles of economy as well as to ensure a regular and good supply, to have meats and forage for General Bonaparte’s establishments furnished from the Commissary »… On y a joint des extraits d’une lettre de LOWE à l’East Company of India (2 juin 1816), et de la réponse de la Company (6 décembre 1816) (ensemble 3 p. in-fol.).
Copie par Thomas READE (adjudant général adjoint) du General Order d’Hudson Lowe le 25 juillet 1821 (6 pages et demie in-fol.). Ordre général rédigé par Lowe lors de son départ de Sainte-Hélène, remerciant avec gratitude les militaires (dont un certain nombre sont nommés), le corps médical, le Révérend Vernon (aumônier militaire) et Denzil Ibbetson, qui a eu des tâches diverses et délicates à accomplir….
120 MAGRITTE René (1898 - 1967).
L.A.S. « RM », Bruxelles 8 septembre 1964, à son ami André BOSMANS ; 1 page in-8 à son en-tête et adresse. À propos de l’affaire des fausses Cartes d’après nature éditées par le groupe de la revue Vendonah Il ne croit pas souhaitable de reproduire les cartes dans la revue Rhétorique. Il suffirait d’en donner la description suivante sous le chapeau Variétés : « De fausses “Cartes d’après Nature” ont été mises en circulation. Elles portent les n os 11 et 12. Le n° 11 ne contient aucun texte, ni illustration. Le n° 12 : ”Ceci n’est pas un Magritte-Magritte” et le mot “Réponse” et rien de plus. La discrétion du ou des auteurs anonymes de ces fausses “cartes d’après nature” est tout juste bonne à les faire s’imiter eux-mêmes »...
121
MAINTENON Françoise d’Aubigné, marquise de (1635 - 1719) épouse secrète de Louis XIV, fondatrice de la maison de Saint-Cyr pour les jeunes filles.
L.A.S. « Maintenon », 6 octobre, à Mme du MARETZ à Paris ; 1 page et demie in-4, adresse avec fragments de cachet cire aux armes (brunissures aux bords).
Mme de Maintenon voit avec peine la mauvaise santé de Mme du Maretz, et ne sait comment la remercier de sa peine : « Vous menvoyés bien promptement largent de M e Dillon, vous nen rabattés rien. Mr d’Arche paye avant davoir jouy du revenu de son Evesché une pension que le Roy a donné à un curé de mes amis, qui ne devoit toucher que dans un an, il nen diminue rien a vostre exemple et comble d’honnestetés un pauvre religieux qui nen peut revenir destonnement. Mr de Bercy a des attantions particulieres pour ce qui regarde Maintenon et qui depend de luy. Vous voyés Madame, que tout ce qui vous est proche me traitte assez bien, et que j’ay raison de faire passer par vous la regnoissance que j’en ay »...
122
MALLARMÉ Stéphane (1842 - 1898)
L.A.S. « Stéphane Mallarmé », Tournon samedi soir [automne 1864, à Henri HERLUISON] ; 3 pages in-8 à l’encre bleue su papier à son en-tête gravé
Réclamation à un bibliophile indélicat [Henri HERLUISON (1835 - 1905) était un libraire-éditeur d’Orléans, et historien d’art ; il fut conservateur des musées d’Orléans.]
« Mon ami Albert GLATIGNY, qui était au commencement de l’année à Orléans, m’a dit vous avoir prêté un exemplaire, fort rare et au quel je tiens beaucoup, du Tragaldabas de VACQUERIE. Depuis, soit qu’il ait négligé de vous le redemander, soit que vous ayez oublié de le lui renvoyer, à chacune de mes très pressantes réclamations, Glatigny a invariablement répondu que vous ne le lui remettiez pas, et à la fin m’a fait part de votre adresse.
Mon ami est maintenant en Allemagne, et c’est parce qu’il se trouve trop loin pour que vous lui fissiez parvenir cette brochure que je me permets de m’adresser directement à vous.
Voici longtemps que j’ai infiniment besoin de cette comédie, et je vous serais, Monsieur, très obligé de me la faire parvenir de suite ».
Il donne son adresse à Tournon (Ardèche).
800 - 1 000
1 200 - 1 500
300 - 500
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 52
1 000
- 1 200
123 MALLARMÉ Stéphane (1842 - 1898).
L.A.S. « Stéphane Mallarmé », Valvins 20 août 1887, à Camille de SAINTE-CROIX ; 4 pages in-8 avec vignette à la dernière page (papier bruni, quelques fentes et marques de plis). Beau commentaire de Contempler (Albert Savine, 1887).
« C’est, comme l’autre, un livre particulièrement griffé ! Le genre présomptueux qui a voulu remplacer le poëme et tout, sans les raccourcis de pensée prodigieux et le vers, ou le Roman, se dégonfle et les écrivains clairvoyants ramènent aux Mémoires, qui seuls lui conservent sa grâce et sa force primesautières, leur prose. Vous me paraissez de l’heure même en cela, avec des sons anciens et de terroir littéraire possédés presque par vous seul ! Notamment que de quelque vie vous animiez vos si intéressantes figures, on les sent, les pages finies, dépendre d’un livre, tout en étant jusqu’au miracle ! cela à la plus grande gloire de l’écrit, qu’elles n’ont point l’impudence de nier pour se vautrer à même nous. Voici qui est subtil ! je veux dire qu’on jouit à la fois et selon un dosage excellent, de vos hautes puissances de recréation et de vos qualités rares de style si dans le génie même de la langue et magistralement rythmé, tout cela ne faisant qu’un : cet acte d’écrire, dont vous parlez dans votre préface et qui est l’autre acte humain qu’aimer ! »…
Correspondance (éd. B Marchal), n° 834, p. 651.
124
MALLARMÉ Stéphane (1842 - 1898)
L.A.S. « SM », Valvins Lundi [28 septembre 1896], à Mademoiselle Paule GOBILLARD à Rouen ; 2 pages in-12 (petite fente), enveloppe (déchir. à l’emplacement du timbre).
« Bonjour, les volages. On vous met à part, sur ce carton, vos compliments, pour bien montrer qu’on croit à votre existence particulière, à Paule, à Julie et à Jeannie ; la preuve est qu’on ressent un vrai vide à ne vous avoir pas là. […] Alors amusez-vous bien, dépensez au long de la route et rapportez du rire »... Il explique ensuite qu’on a mis par mégarde à la poste une lettre pour sa fille Geneviève, que ce billet devait accompagner ; une autre lettre attend Geneviève à Rouen, poste restante…
125 MALRAUX André (1901 - 1976).
MANUSCRIT autographe signé « André Malraux ». 1976 ; 1 page in-4.
Un des derniers textes de Malraux, évoquant son ami Galanis
Il a été reproduit en fac-similé en tête du catalogue de l’Hommage à Demetrius Galanis (1897 - 1966), organisé du 1er juin au 18 septembre 1976 par le Centre culturel hellénique de Paris au musée de Montmartre. Malraux est mort le 23 novembre.
« Que sont devenues ces natures mortes d’Anthologie grecque – figues, amandes, flûtes de Pan, raisins – si différentes de l’illustration des Nuits d’Octobre, alors dans sa gloire, qu’en 1922 les jeunes écrivains comparaient aux fruits des Cènes toscanes, à ceux de Derain ? (Plusieurs ont appartenu à Vanili Photiadès) Combien de surprises nous donnerait une exposition, peintures, et gravures, du temps où GALANIS se reposait en décorant d’autres figues et d’autres flûtes, l’harmonium qu’il avait fabriqué patiemment entre 1920 et 1930… »
126 MANET Édouard (1832 - 1883).
P.A.S. « Ed. Manet » au bas d’une reproduction de son tableau Le Bon Bock ; 3 lignes au crayon noir sous une photographie (18,3 x 16 cm) montée sur carton gris de 34 x 18,4 cm (un coin déchiré). Dédicace du fameux tableau Le Bon Bock à son élève Éva Gonzalès.
« à M lle Eva Gonzalès hommage affectueux Ed. Manet ».
[Manet a peint Le Bon Bock en 1873 ; le tableau remporta un grand succès au Salon de 1873. Peintre impressionniste et seule élève de Manet, Éva GONZALÈS (1849 - 1883) lui servit souvent de modèle ; elle connut son premier succès au Salon de 1870, où Manet exposa d’ailleurs un magnifique portrait d’elle (Londres, National Gallery).]
2 000 - 2 500
53 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
1 000 - 1 500
700 - 800
1 000
- 1 200
MANUSCRIT MÉROVINGIEN.
MANUSCRIT de l’abbaye de Saint-Martin de Tours, Tours VII e siècle. Feuillet de parchemin (225 x 195 mm) en latin, contrecollé à des feuillets de papyrus égyptien en grec du VI e ou VII e siècle. Étui de conservation. Rare fragment de la comptabilité domaniale de l’abbaye Saint-Martin de Tours, collé sur un fragment d’un poème grec sur la vie de Saint Joseph par Éphraïm le Syrien sur papyrus
Le feuillet de comptes sur parchemin a été contrecollé à des feuillets de papyrus, probablement afin de le renforcer et de réduire le recourbement des feuillets de parchemin (Sati, ‘Merovingian Accounting Documents ’, pp. 147-51).
Il est écrits sur deux colonnes de 22 et 24 lignes, à l’encre carbone, sans réglure, avec ligne de séparation entre les deux colonnes tracée sans le secours d’une règle, foliotation « 3a » tardive sans rapport avec le texte (témoignant probablement de l’appartenance à un ancien recueil du XIXe s. provenant de la collection d’Amans-Alexis de Monteuil), cursive mérovingienne, notes tironiennes – onciales grecques de type copte, plusieurs mains (?) de la même période sont intervenues dans ce document (des notes tironiennes, croix, notes en marges et biffures). Feuillet rogné de tous côtés, principalement dans les marges gauche, supérieure et inférieure avec manques de texte dans la première colonne.
Un feuillet manuscrit descriptif de la main d’Alexis de Monteuil accompagne le document. Ce feuillet issu d’un manuscrit mérovingien identifié comme provenant du plus grand centre culturel français du septième siècle, l’abbaye Saint Martin de Tours, préserve aussi une partie du seul papyrus témoignant d’un texte classique survivant au nord des Alpes
Document écrit à l’abbaye de Saint-Martin de Tours, fondée au Ve siècle par Saint Brice, devenant bénédictine au VIIe s., puis cathédrale laïque sous Charlemagne en 806. Plusieurs fragments identifiés comme appartenant au même ensemble par Pierre Gasnault se trouvent désormais à Paris (voir art. de Sati) et mentionnent l’abbé Agrycus de Saint-Martin. Il en a conclu que cet ensemble, auquel se rattache sûrement notre feuillet, a certainement été écrit là-bas.
Le document mérovingien contient une liste de noms avec les redevances dues au domaine de Saint-Martin de Tours. Il répertorie les prénoms à consonance principalement germanique des 46 habitants locataires de l’abbaye, avec à leur suite les volumes des différents grains dûs (froment, seigle, orge, …) et leur mesure en muid (modium) ou demi-muid (semodium). La transcription du texte a été publiée par Gasnault (pp. 310-14) ; parmi les 24 noms lisibles qui y figurent, on retrouve Childoberthus (col.2, l.3), Domoramnus (col.2, l.5), Dignon (col.2, l.6), Flanoberthus (col.2, l.7), Lupogisel (col.2, l.9), Genoaldus (col.2, l.13) et Taheuderamnus (col.2, l.21, etc. Pour comprendre la nature exacte de ce document, il faut remonter aux origines de l’administration des biens cléricaux. Les abbayes durant cette période n’avaient pas d’autonomie pour la gestion de leur domaine et devaient se référer directement aux diocèses conformément au concile de Chalcédoine en 451. Il est donc curieux d’observer ici directement un écart aux recommandations papales, est-ce une dérogation ou un document de suivi ? Selon Sati, une étude reste à faire sur le rôle exact de ce document au sein de la l’administration du domaine abbatial car il existe peu de documentation sur la question. L’hypothèse de la provenance du feuillet a été proposée par Pierre Gasnault, dans son article dédié aux deux fragments apparus lors de la vente de Sotheby’s en 1989 (« Deux nouveaux feuillets de la comptabilité domaniale de l’abbaye Saint-Martin de Tours à l’époque mérovingienne »). Selon lui ces feuilles ont été réutilisées pour former la couvrure d’une reliure d’un exemplaire de Philippus sur Job dans la bibliothèque de Saint-Martin, MS 88 dans le catalogue dressé, selon toute apparence, en 1700 du Fonds de Saint-Martin enrichi des observations faites par Chalmel en 1807 (Tours, BM, ms 1296) (voir L. Delisle, « Notice sur les manuscrits disparus de la bibliothèque de Tours », Notices et extraits des manuscrits de la Bibl. Nationale, 31, 1884, Appendice VII). Ils y ont été vus au début du XVIII e siècle in situ par le mauriste Bernard de Montfaucon (1665 - 1741) qui en a publié une description accompagnée d’une gravure du script sur papyrus dans sa Palaeographica graeca, 1708, pp. 214-15, en citant une lettre de Dom Léon Chevalier, c. 1706, sur ces « Nobilia fragmenta inter membranas varias conglutinae » (Papiers de Bréquigny, vol. XXXIV et XXXV). Ce sont les seuls manuscrits sur papyrus que Montfaucon ait jamais vus.
Lors de la révolution, les manuscrits de la cathédrale ont été transférés à la Bibliothèque Municipale de Tours et beaucoup de volumes se sont retrouvés perdus ou vendus vers 1830 à Paris par les marchands comme Techener ou Monteuil. Cet épisode de de la vie des collections françaises est décrit ainsi par Delisle dans sa Notice sur les manuscrits de la ville de Tours : « Il faut déplorer la coupable négligence qui a fatalement amené, pendant les trente premières années de ce siècle, l’aliénation, au poids du papier ou du parchemin, de plusieurs centaines de manuscrits dont beaucoup sont arrivés, vers l’année 1830, chez les brocanteurs de Paris... On ne pourra jamais savoir assez de gré aux établissements et aux particuliers qui ont alors recueilli ces épaves d’un grand naufrage, et sans l’intervention desquels de magnifiques manuscrits du moyen-âge auraient été condamnés aux plus vils usages et abandonnés, comme matière première, aux relieurs, aux batteurs d’or, aux fabricants de colle et épiciers. » Une note de Chalmel en 1807 sur l’état du dépôt et des 272 manuscrits de Saint-Martin laisse à penser qu’un certain nombre étaient déjà jugés « victimes de leur vétusté et du défaut de conservation », dont 150 en mauvais état qui méritaient des réparations.
20 000 - 30 000
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 54 127
Peut-on supposer qu’entre sa visite et l’arrivée chez les brocanteurs de Paris, un tri aurait été fait par certaines personnes de la bibliothèque ? Pierre Gasnault explique que ces feuillets avaient été donnés par le libraire Techener vers 1830 a Amans-Alexis Monteil (1769 - 1850) pour le remercier d’une expertise sur des manuscrits, et il aurait vendu le reste au célèbre collectionneur anglais Phillipps. Le feuillet manuscrit qui accompagne notre fragment, comme ceux qui accompagnaient les autres vu par Pierre Gasnault en 1967, est de la main du fils de Monteil (« Deux nouveaux feuillets », pp. 308-09). Un recueil de fragments réunis dans un volume apparait dans la vente de 1833 de Monteil et le présent feuillet était sans doute parmi eux (une foliotation tardive 3a pourrait correspondre à ce recueil). Vendu chez Sotheby’s Londres le 29 juin 1989, lot 26 (l’autre feuillet réapparaitra ultérieurement [Fogg, cat.16, 1995, n° 14]),
Schøyen MS 570.
Le papyrus copte
L’envers du parchemin, qui porte du papyrus contrecollé, a attiré l’attention du cardinal Giovanni Mercati (1866 - 1957), érudit bibliothécaire du Vatican. Il a travaillé sur le texte d’après les transcriptions de Montfaucon quelque deux siècles plus tard, ne sachant pas que l’original avait survécu. Il a identifié les mots en onciale copte du VI e/VII e siècle, comme faisant partie d’un poème grec sur la vie de Saint Joseph par le théologien syriaque, Ephraïm le Syrien (c. 306 - 373). Ce papyrus est à ce jour le témoin le plus ancien de ce poème. La question de la présence de ce manuscrit grec au sein des murs de l’abbaye tourangelle dès le début du haut moyen-âge peut se poser, car la maîtrise du grec était alors une compétence très rare. L’historien Max Ludwig W. Laistner observe qu’au VIII e et IXe siècle, les personnes pouvant encore le lire se comptaient sur les doigts d’une main (Thought & Letters in Western Europe, 1931, p. 238). L’autre hypothèse probable serait un usage des papyrus non comme témoin textuel mais comme matière première. Les auteurs anciens furent probablement victime du manque d’intérêt pour la culture antique dans l’empire devenu chrétien. Grégoire de Tours raconte que le commerce des papyrus en Europe au VI e siècle résistait encore face à l’arrivée du parchemin, et il fut même utilisé pour les bulles pontificales jusqu’au XI e siècle. Le spécialiste des manuscrits du Haut Moyen Âge, E.A. Lowe, répertorie seulement une poignée de manuscrits sur papyrus pour la période (Codices Latini Antiquiores). Notre fragment d’origine égyptienne est d’autant plus précieux que la destruction de la bibliothèque d’Alexandrie par les troupes arabes était survenue quelques décennies plus tôt, vers 640.
Bibliographie : P. Gasnault, « Deux nouveaux feuillets de la comptabilité domaniale de l’abbaye Saint-Martin de Tours à l’époque mérovingienne », Journal des savants 1995, pp. 307-21 ; S. Sati « The Merovingian Accounting Documents of Tours: form and function », Early Medieval Europe, 9 (2000), pp. 143-61.
128 MARIE LESZCZINSKA(1703 - 1768) Reine de France, femme de Louis XV.
L.A., Versailles 22 août 1745, à son gendre l’Infant Dom PHILIPPE, duc de PARME ; 1 page in-4, adresse « A mon frere, cousin et gendre, l’Infant Dom Phillippe », cachets de cire rouge à ses armes sur soies roses. Belle lettre familiale, après le mariage (23 février 1745) du Dauphin Louis de France avec Marie-Thérèse d’Espagne, fille de Philippe V et sœur de l’Infant Philippe, duc de Parme, qui avait épousé en 1739 la fille aînée de Louis XV, Louise-Élisabeth-Marie.
Elle a eu plaisir à recevoir sa lettre, car elle était fâchée de son silence : « J’avois chargé vostre sœur de vous en gronder. Je luy scait tres bon gré de s’en etre acquitée. Il est juste que je vous instruise de mes sentimens pour elle, je l’aime de tout mon cœur, je desire qu’elle soit heureuse, je tacherois d’i contribuer toute ma vie. Il faut vous parler aussi du principal personage sur ce qui la regarde qui est mon fils cela me paroit tenir plus de l’amour que de l’amitié, et j’en suis enchanté. Dieu veuille que cela dure toujours. De meme je le desire, et l’espere »…
128 bis [MARIE-LOUISE]. – DU ROZOIR Charles.
Éloge de Pie VI, avec l’Histoire religieuse de l’Europe sous son pontificat, accompagné de pièces officielles et de documents authentiques. Paris, Arthus Bertrand, 1825. In-8, demi-cuir de Russie rouge avec coins, chiffre couronné au centre, dos lisse orné (Reliure de l’époque).
Édition originale, ornée d’un portrait lithographié de Pie VI.
Histoire du pape PIE VI (1775 - 1799), martyr de la Révolution française, du Directoire et du Consulat. Après avoir assisté, impuissant, à l’entrée des troupes de Berthier dans Rome en février 1798 et à la proclamation de la République romaine, le souverain pontife fut contraint de renoncer à son pouvoir temporel et de quitter la Ville éternelle. Réfugié en Toscane, il fut capturé par l’armée française et déporté dans la prison de Valence où, après un interminable périple, il succomba d’épuisement.
Un ouvrage éclairant sur l’affrontement que la République française puis Napoléon ont livré, au-delà de la personne de Pie VI, à la Papauté.
Exemplaire provenant de la bibliothèque de Marie-Louise à Parme, relié au chiffre de l’ancienne impératrice des Français.
Quelques rousseurs. Dos un peu noirci.
Provenance : Calvin Bullock (ex-libris).
55 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
1 200 - 1 500
400 - 500
129 MATISSE Henri (1869 - 1954).
L.A.S. « H Matisse », 14 novembre 1946, à Mary HUTCHINSON ; 1 page in-8, enveloppe. Il lui envoie deux invitations : « Vous y verrez que la séance sera très intéressante. Je souhaite que vous puissiez remettre votre rendez-vous pour y assister »…
400
500
1 500 - 2 000
L.A.S. « Giu. Mazarini », Rome 1er décembre 1636, au baron Giuseppe MATTHEI (à Civitavecchia) ; 3 pages in-4, dont le début par un secrétaire (petit trou par corrosion d’encre) ; en italien. Lettre du séjour romain de Mazarin, avant d’entrer au service de Richelieu
Le début de la lettre est écrit par un secrétaire ; puis Mazarin prend la plume pour écrire 17 lignes. Il remercie le baron de son extrême courtoisie, et de bien vouloir prendre soin du transport de ses biens et de deux chevaux, dont un gris que le cardinal BICHI souhaite présenter à Monseigneur GIORI. Il ne manquera pas de servir le baron si l’occasion se présente. Il promet de le rembourser des dépenses occasionnées. Dans le post-scriptum autographe, Mazarin renouvelle ses remerciements et annonce que les chevaux sont bien arrivés. Il a rendez-vous avec le Cardinal [Francesco] BARBERINI...
On joint la fin d’une L.A.S. aux Surintendants (1 page oblong in-12), les priant de « faire payer de bonnes grace » une somme au cardinal Grimaldi.
MANUSCRIT autographe, [fin 1934 ?] ; 16 pages in-4 au crayon, avec ratures et corrections (le début manque). Important exposé sur le développement de la ligne d’Amérique du Sud et la traversée de l’Atlantique pour le service postal et pour des passagers, avec un parallèle entre l’avion et l’hydravion, et le récit de ses traversées
Pour Mermoz, « l’avion et l’hydravion on chacun leur place dans l’avenir des traversées aériennes transatlantiques commerciales :
L’avion au point de vue purement postal
L’hydravion au point de vue purement passagers ».
800 - 1 000
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 56
On joint un télégramme de Matisse à la même (30.XII.1948), remerciements et vœux. -
130 MAZARIN Jules, cardinal (1602 - 1661).
131 MERMOZ Jean (1901 - 1936) aviateur.
Il faut adopter l’avion (et écarter l’hydravion) pour le service postal, pour la vitesse d’abord, « base fondamentale des traversées transatlantiques postales régulières ».... « Le pilotage sans visibilité aux instruments représente un progrès considérable et ses possibilités certes sont immenses tout particulièrement dans la brume, les plafonds bas et même dans un grand nombre de systèmes orageux européens [...], mais il existe des temps dans lesquels je ne m’engagerai pas en pilotage sans visibilité et de nuit ». Quant aux perturbations météorologiques sur l’Atlantique Sud, elles peuvent être très dangereuses, sans compter « le fameux pot-au-noir », notamment lors de la mousson. « Pour ma part, j’ai eu l’occasion d’en rencontrer deux fois entre Natal et le rocher St Paul dans la zone de l’île Fernando de Noronha. La première fois de jour ce n’était pas une succession de grains relativement espacés comme ceux du pot-au-noir mais un véritable système cyclonique avec un front de tornade barrant la route d’Est en Ouest sur une distance inappréciable parce que trop étendue, aux nuages collés à l’eau avec par endroits quelques trombes marines suffisamment caractéristiques par leur forme pour ne pas les reconnaître comme extrêmement dangereuses. La mer était démontée et semblait se soulever comme aspirée. Pour passer au-dessus, il aurait fallu au moins atteindre cinq mille mètres pour trouver le calme. Changeant de route et circulant pendant vingt bonnes minutes vers l’Est, en bordure de ce front sans fissures, j’ai fini par trouver une vague issue qui semblait plus claire et m’y suis engagé. En deux abattées successives, l’appareil engagé à fond est descendu jusqu’à l’eau. De justesse il s’est redressé sous l’effort désespéré des commandes. En même temps nous sommes entrés dans une véritable masse d’eau qui semblait s’écrouler. Pendant un quart d’heure, propulsés par les rafales de vent dans un véritable déluge, à quelques mètres d’une mer démontée, Dabry, Gimié, Collenot (et moi) avons trouvé les minutes longues… Puis peu à peu tout se calma dans une pluie très dense comme celle des queues de tornade. Gimié put passer le fatidique T.V.B. » Mermoz raconte une autre perturbation qui l’obligea, après plusieurs tentatives, à retourner se poser, non sans mal, à Natal. Il n’est pas sûr qu’il aurait réussi à s’en sortir par nuit noire et en pilotage sans visibilité. Il vaut donc mieux, pour ne pas courir au désastre à cause des importantes perturbations atmosphériques, porter l’effort sur les vols transatlantiques de jour. Avec une vitesse de croisière de 300 km à l’heure de croisière, « on ira de Port-Etienne à Porto-Praïa en 3 heures ; de Porto-Praïa à Noronha en 7 heures ; de Noronha à Natal en 1 heure 20 ; de Dakar à Noronha en 8 h 45 ; de Dakar à Natal en 10 h. Je pense que voilà la véritable sécurité. Il est préférable de passer 10 h sur l’eau et de jour que d’y rester vingt ou vingt-trois heures »... Mermoz expose alors le développement des infrastructures des terrains à Praïa, l’île Maio, à Noronha, à Recife : « La plus longue distance transatlantique sans escale ne sera plus que 2.150 km ». Il veut aussi développer les liaisons radio, notamment avec les bateaux, par un accord entre Air-France et les compagnies maritimes...
Il faut d’abord envisager « la question postale sur la ligne d’Amérique du Sud [...] C’est la seule susceptible de faire vivre économiquement cette ligne malgré toutes les réductions de subventions à envisager », le problème des passagers passant au second plan. « Or pour transporter du courrier, le gros tonnage et le confort sont des éléments inutiles et superflus. Il faut tendre simplement sans cesse vers la plus grande vitesse pour une utilisation de puissance et un tonnage limité économique », alors que pour les passagers « la plus grande sécurité, le gros tonnage et le confort » sont essentiels. « L’avion postal doit en principe ne jamais perdre de temps. Il va sans cesse contre la montre, passe aux escales à toutes les heures du jour et de la nuit, tend toujours à gagner sur un horaire plus ou moins bien défini. Le pilote qui voyage avec son radio et le courrier a le droit de risquer davantage, en toute conscience professionnelle et en toute connaissance de son devoir avec une complète liberté d’esprit ». Pour les passagers, au contraire, la sécurité est primordiale, et coûteuse en personnel et en infrastructures. Pour lui, « les nécessités d’une exploitation de ligne postale sont souvent incompatibles avec celle d’une ligne de transports », et il ne croit pas, sur le parcours de la ligne France-Amérique du Sud, aux solutions mixtes « qui diminuent la valeur respective des deux formules d’exploitation, en sacrifiant l’une au profit de l’autre »...
L’autre raison d’adopter l’avion au point de vue postal est la question du tonnage. Prendre des hydravions pour assurer à la fois le service du courrier et celui de passagers présente de gros risques financiers et de sécurité ; la rentabilité ne sera pas assurée, et le moindre accident annulerait tous les efforts. Mermoz donne des chiffres qui montrent l’avantage d’un développement d’un service postal rapide et régulier, qui assurerait un gain de temps d’une vingtaine de jours sur le service normal : « On peut penser que le poids du courrier triplera et quadruplera rapidement. [...] Pour réaliser une exploitation économique il faut des appareils rapides et économiques, avec des appareils du type le Comet de Haviland de la course Londres Melbourne qui peut transporter 160 kgs de poste à 320 km à l’heure sur un parcours de 3600 km et cela avec moins de 500 chevaux consommant 75 litres d’essence et 1 l. d’huile à l’heure, on peut arriver à une exploitation postale hebdomadaire coûtant moins de vingt cinq millions par an. En doublant la fréquence l’augmentation des frais généraux ne dépasse pas 5 à 6 millions. Or si 130 kgs de poste hebdomadaires correspondent à 20 millions de recettes annuelles, si en doublant la fréquence on double le courrier, il est facile de se rendre compte que la ligne France Amérique du Sud peut vivre et peut être assurée d’une existence normale, même si l’on diminue un jour les surtaxes postales »... Cela n’empêchera pas de penser un jour à une ligne de prestige pour les passagers, avec une subvention comme celles accordées aux compagnies de paquebots...
« Pour le moment, il n’y a qu’un effort à faire. Comme je l’ai déjà dit il n’existe en ce moment pour moi ni avion ni hydravion sur l’Atlantique Sud. Je suis prêt à prendre l’un comme l’autre sans m’arrêter à une question de formule. J’ai tenu simplement à mettre certaines choses au point à formuler des idées sur un avenir plus ou moins immédiat ». Puis Mermoz revient sur l’avantage de l’avion qui « a toujours été en tête du progrès aéronautique. L’avion va plus vite plus haut et plus loin que l’hydravion. Il l’a prouvé dans maintes expériences par maints records. À l’heure actuelle il n’y a pas d’hydravion capable de battre l’avion quant à la vitesse, le plafond, la charge utile emportée, le rayon d’action et il faut bien penser que si l’hydravion gagnait en qualités techniques, celles de l’avion augmenteraient proportionnellement dans le même ordre de grandeur ». En cas d’amerrissage forcé, l’avion offre plus de sécurité que l’hydravion... « On peut donc reconnaître à l’avion un rôle important à jouer dans la solution d’un problème qui exige la plus grande charge utile à emporter pour un maximum de rendement économique et de vitesse. [...] Je pense d’abord qu’un avion marchant à 300 km à l’heure grâce à sa finesse, à son hélice à pas variable et d’ici peu à son compresseur a moins de chance de panne et d’incident de vol en 7 ou 10 h. de traversée qu’en 20 ou 23 h. de vol. Quand l’hydravion fera du 300 km à l’heure, l’avion fera du 400 km. Il restera toujours moins longtemps au-dessus de la mer, et cela, c’est déjà la première sécurité. Dès que l’Ile Fernando-de-Noronha va posséder sa piste de départ [...], il faudra sept heures pour aller de Praïa îles du Cap Vert à Noronha. Si un avion terrestre bi ou trimoteur est calculé pour voler à pleine charge avec un des moteurs stoppé, je doute fort qu’il ne puisse rejoindre étant à mi-route l’une ou l’autre de ses escales : au maximum en 3 h 30 de vol. Lorsque les hélices à pas variable seront définitivement au point, pourquoi un trimoteur, ne serait-il pas calculé pour au départ n’être autre chose qu’un bi-moteur emportant son troisième moteur stoppé avec une hélice au pas complètement effacé comme secours ? »...
Et il conclut : « La technique aéronautique fait de tels progrès et les possibilités d’avenir sont si vastes que l’on doit se détacher de plus en plus de la crainte de venir au sol ou à l’eau malgré soi. Il ne faut pas préjuger de garantir une sécurité complète. Il n’y aura des sacrifices à consentir quoi que l’on fasse pour les éviter. Ils sont trop à l’abri des raisonnements et des discussions pour que l’on s’y attarde. Mais avec une infrastructure solidement établie, une organisation météorologique et radio goniométrique solide, si les compagnies de navigation maritime s’intéressent davantage au sort des traversées aériennes transatlantiques, on peut envisager l’avenir avec sérénité ».
Provenance : archives MERMOZ (vente Artcurial 11 octobre 2008, M93).
57 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
132
[MERMOZ Jean (1901 - 1936) aviateur.
30 télégrammes adressés à Jean M ERMOZ, 13-24 janvier 1933 ; la plupart dactylographiés avec en-tête The Western Telegraph Company ou Republica Argentina Telegrafo de la Nacion Vœux et félicitations pour le premier vol transatlantique de l’Arc-en-Ciel (un trimoteur Couzinet 70) du Bourget le 7 janvier 1933 à Istres, Port-Étienne et Saint-Louis du Sénégal, d’où il part au matin du 16 janvier pour rejoindre Natal où il arrive le soir même, et d’où il repart le lendemain matin pour Rio. Il a traversé l’Atlantique en 14 h 32, en compagnie du constructeur Couzinet, du copilote Pierre Carretier, du navigateur Louis Mailloux, du mécanicien Camille Jousse et du radio Jean Manuel.
On relève les noms d’Antoine de SAINT-E xUPÉRY (« Tiens avant votre départ vous redire toute mon amitié mes meilleurs souhaits et regret de n’avoir pu vous dire adieu »..), la marquise de NOAI ll ES , Jacques de SAINT-PIERRE , Edmond
D’O l IVEIRA , le Consul de France GIACHETTI , le Service météorologique d’Uruguay, l’Aéro-Club de France, etc.
On joint 2 télégrammes de Mermoz à sa mère lors de son voyage de retour (Dakar et Saint-Louis du Sénégal 16 et 17 mai 1933), et 4 télégrammes reçus par Mermoz (18-23 mai).
Provenance : Aéronautique, Lettres et manuscrits de Jean Mermoz (Artcurial, 13 octobre 2008, M76).
1 000
133
MESSIAEN Olivier (1908 - 1992).
MANUSCRIT autographe signé « Olivier Messiaen », Vingt Leçons d’harmonie (1940) ; 1 f. de titre + 48 pages de musique in-fol. (sur feuillets doubles), et 1 f. de titre + 6 pages de texte in-4.
Importante contribution en musique à l’histoire de l’harmonie musicale, en hommage de Messiaen aux maîtres qu’il admire
C’est dans l’été 1939 que Messiaen commença à rassembler et ordonner ces exercices écrits les années précédentes pour ses cours à l’École Normale et à la Schola Cantorum, dans des styles allant de Monteverdi à Messiaen lui-même, et dont il avait déjà donné un échantillon dans Le Monde musical en février-mars 1937. La publication eut lieu aux éditions Alphonse Leduc en mai 1940.
Messiaen a composé un projet de page de titre : « Olivier Messiaen / Vingt Leçons d’harmonie / Dans le style de quelques auteurs importants de “l’Histoire Harmonique” de la musique, depuis Monteverdi jusqu’à Ravel. / Précédées d’une note de l’Auteur et de Remarques sur la réalisation de chaque leçon en particulier / Prix majoré : 30 francs / Selon une nouvelle méthode de travail, ce volume sert à la fois au Maître et à l’élève »…
La Note de l’auteur explique : « Ces leçons sont destinées aux élèves ayant déjà terminé “l’apprentissage” du Traité d’harmonie. Leur difficulté est à peu près celle des concours d’harmonie du Conservatoire de Paris. Pour inciter l’élève à lire les œuvres des maîtres anciens et modernes, à y trouver la source des règles qu’on lui impose et des licences qu’on lui tolère, elles ont été conçues dans le style de quelques auteurs importants de “l’histoire harmonique” de la musique, depuis Monteverdi jusqu’à Ravel. Il ne s’agit point de pastiches, mais de l’étude à quatre voix de différents styles »… Etc. Suivent des remarques explicatives sur chacune des 20 leçons… Le manuscrit musical est réalisé à l’encre noire sur papier à 16 lignes. Il comprend :
1. Chant donné (dans le style de Monteverdi) (p. 1-3), Modéré un peu vif. – 2. Chant donné (dans le style d’un Passepied de Rameau) (p. 4-5), Vif et gracieux. – 3. Basse donnée (dans le style des chorals de J.S. Bach) (p. 6), Décidé, un peu vif. – 4. Basse donnée (dans le style d’un Prélude de J.S. Bach) (p. 7-8), Bien modéré. – 5. Basse donnée (à 3 voix, dans le style des sonates et trio pour orgue de J.S. Bach) (p. 9-10), Bien modéré. – 6. Chant donné (dans le style de Gluck) (p. 11), Un peu lent, noble. – 7. Basse donnée (dans le style des quatuors à cordes de Mozart) (p. 12-14), Gai, modéré. – 8. Chant donné (dans le style des quatuors à cordes de Mozart) (p. 15-17), Très lent et tendre. – 9. Basse donnée (dans le style de Schumann) (p. 18-19), Très vif et léger. – 10. Chant donné (dans le style des canons de César Franck) (p. 21-22), Très lent, expressif et recueilli. – 11. Basse donnée (style mi-Schumann, mi-Lalo) (p. 23-24), Vif et léger. [p. 25 faux début gratté]. – 12. Chant donné (style mi-Chabrier, mi-Massenet) (p. 26-27), Passionné, presque vif. – 13. Basse donnée (dans le style de la Sicilienne de Fauré) (p. 28), Modéré. – 14. Chant donné (style très hybride : un peu Schumann, un peu Fauré, un peu Albeniz) (p. 29-31), Presque vif, et léger. – 15. Chant donné (style mi-Franck, mi-Debussy) (p. 32-33), Un peu lent, expressif et recueilli – 16. Chant donné (style mi-Massenet, mi-Debussy) (p.34-35), Lent et tendre. – 17. Chant donné (style mi-Chabrier, mi-Debussy) (p. 35-36), Balancé, un peu vif. – 18. Chant donné (dans le style du Pelléas et Mélisande de Cl. Debussy) (p. 37-39), Modéré, profondément expressif. – 19. Chant donné (à 5 voix, dans le style de Maurice Ravel) (p. 40-43), Presque vif, et caressant. – 20. Chant donné (style très spécial, se rapprochant un peu des cantilènes hindoues) [titre primitif biffé : dans le style des Poèmes pour Mi de l’auteur] (p. 44-47), Modéré, avec charme Bibliographie : Peter Hill et Nigel Simeone, Olivier Messiaen (Fayard, 2008), p. 112 - 113 et 550 - 551.
1 500 - 2 000
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 58
- 1 500
134 MESSIAEN Olivier (1908 - 1992).
MANUSCRIT MUSICAL autographe signé « Olivier Messiaen », Chronochromie pour orchestre (1960). ; un fort volume in-fol. de 4 feuillets et 215 pages (plus 6 titres intermédiaires), interfoliés de serpentes, reliure de toile noire. Manuscrit d’une des œuvres majeures de Messiaen pour l’orchestre
Commande de Heinrich Strobel pour le festival de Donaueschingen en Allemagne, Chronochromie fut écrite en 1959 - 1960. Le titre primitif en était « Postlude », et Messiaen l’avait probablement d’abord conçu comme une conclusion orchestrale au Catalogue d’oiseaux. Sans renoncer à la présence des oiseaux, auxquels il ajoute la transcription des bruits de cascades et torrents des Alpes, avec de grandes violences d’effets, Messiaen fait de son œuvre une sorte de synthèse de ses recherches rythmiques et chromatiques, et pousse aussi loin que possible les lois de l’orchestration. Se libérant des formes classiques, Messiaen adopte les périodes de la triade de la poésie chorale grecque selon une structure libre mais complexe de sept mouvements qui s’enchaînent.
Créée le 16 octobre 1960 au concert de clôture du Festival de Donaueschingen par Hans Rosbaud et l’Orchestre du Südwestfunk, puis au Festival de Besançon par Georges Prêtre avec l’Orchestre National le 13 septembre 1961, et enfin à Paris au Théâtre des Champs-Élysées par le même orchestre sous la direction d’Antal Dorati, Chronochromie suscita, lors de ces premières auditions, un scandale avec de vives réactions d’une partie du public, désorientée par la nouveauté de l’œuvre et choquée par sa violence sonore, et une vigoureuse polémique ; mais elle apparut néanmoins comme « un des sommets de la musique de ce temps, et d’autre part à la fois comme un aboutissement et une synthèse de l’art de Messiaen, et comme un nouveau départ » (Harry Halbreich). Elle fut publiée aux éditions Alphonse Leduc en mai 1963.
Le manuscrit est très soigneusement noté au crayon noir sur des papiers de 18 à 32 lignes. Il est méticuleusement annoté, avec de très nombreuses indications de tempo, de dynamique, de nuance, et les diverses interventions d’oiseaux…
La page de titre (on devine le titre primitif Postlude gommé) porte diverses notes au crayon : une explication du titre adopté, des notes pour la relecture et révision de la partition, et la « durée totale de l’œuvre : environ 35 minutes ».
Suivent deux notes de l’auteur, la première étant une sorte de préface. « Écrite en 1959 - 1960, sur la demande d’Heinrich Strobel et du Südwestfunk, la Chronochromie repose sur un double matériau sonore et temporel. Le matériau temporel en rythmique utilise 32 durées différentes, traitées en interversions symétriques, toujours interverties dans le même ordre. Les 36 permutations ainsi obtenues sont entendues soit seules et fragmentairement, soit superposées 3 par 3. Toutes ne sont pas employées. Celles qui figurent dans la partition sont indiquées par des nombres correspondant à leur place exacte dans le tableau général des 36 permutations. Le matériau sonore ou mélodique utilise des chants d’oiseaux de France, de Suède, du Japon, et du Mexique. Les noms d’oiseaux sont inscrits sur la partition au moment précis où ils entrent en scène musicale. Leur pays d’origine est également indiqué. Les oiseaux n’ayant pas de nom de pays sont des oiseaux de France. On trouve aussi dans le matériau sonore des bruits de torrents de montagne, notés dans les Alpes françaises. Les mélanges de sons et de timbres, très complexes, restent au service des durées, qu’ils doivent souligner en les colorant. La couleur sert donc à manifester les découpages du Temps. D’où le titre : Chronochromie (du grec Khronos = Temps, et Khrôma = Couleur)
– traduction : Couleur du Temps. L’œuvre comporte 7 parties enchaînées : Introduction – Strophe I – Antistrophe I – Strophe II – Antistrophe II – Épôde – Coda ».
La 2e Note est plus technique : « Toute la partition est notée en sons réels et à l’octave réelle, et cela pour tous les instruments. Il n’y a donc pas d’instruments transposés – exemple : les clarinettes en si bémol sonnent comme elles sont écrites, les cors en fa sonnent comme ils sont écrits. Il n’y a pas non plus d’instruments écrits à l’octave inférieure ou supérieure », etc.
Suit la Nomenclature des instruments, classés par familles. « B ois : 1 petite flûte, 3 flûtes, 2 hautbois, 1 cor anglais, 1 petite clarinette en mi bémol, 2 clarinettes en si bémol, 1 clarinette basse en si bémol, 3 bassons. C uivres : 1 petite trompette en ré, 3 trompettes en ut, 4 cors en fa, 3 trombones, 1 tuba. C laviers, 3 exécutants : 1 glockenspiel (à clavier), 1 xylophone (à baguette), 1 marimba ; N.B. : les parties de xylophone et de marimba sont difficiles (surtout dans les 2 Antistrophes) et réclament d’excellents instrumentalistes. C lo C hes : Jeu de 25 cloches donnant tous les degrés chromatiques […] (en 2 rangées de tubes superposées) – joué par un seul exécutant. Per C ussions métalliques : 1er gong (aigu), 2e gong (médium aigu), 3 e gong (médium), joués par un seul exécutant ; cymbale suspendue (médium grave), cymbale chinoise (grave), tam-tam (très grave), joués par un seul exécutant. C ordes : 16 premiers violons, 16 seconds violons, 14 altos, 12 violoncelles, 10 contrebasses. L’Épôde comporte : 6 1ers violons soli, 6 2es violons soli, 4 altos soli, 2 violoncelles soli. Ces parties devront être confiées aux chefs de pupitre, les seconds de pupitres leur tournant les pages ».
La partition d’orchestre est ainsi divisée :
Introduction (p. 1-33) ; Strophe I (p. 34-50) ; Antistrophe I (p. 51-79) ; Strophe II (p. 80-96) ; Antistrophe II (p. 97-152) ; Épôde (p. 153 - 189) ; Coda (p. 190 - 215).
Bibliographie : Peter Hill et Nigel Simeone, Olivier Messiaen (Fayard, 2008), p. 300 - 309, 314 - 316. Discographie : Pierre Boulez, Cleveland Orchestra (DG 1993)
59 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
10 000 - 15 000
135
MILHAUD Darius (1892 - 1974).
MANUSCRIT MUSICAL autographe signé « Darius Milhaud », ‘adame Miroir, ballet (1948) ; 1 feuillet de titre et 15 pages in-fol. (34,5 x 27,5 cm).
Musique de ballet pour Roland Petit sur un livret de Jean Genet
C’est pour les Nouveaux Ballets de Roland PETIT que Milhaud écrivit cette musique, sur un livret de Jean GENET, dont ce fut le seul ballet. La chorégraphie fut confiée à Janine Charrat, dans un décor de Paul Delvaux et des costumes de Léonor Fini. La création eut lieu au Théâtre Marigny le 30 mai 1948. Roland Petit dansait le Matelot, avec son reflet Serge Perrault (l’Image) et le Domino (ou la Mort) dansé en alternance par Volodia Skouratoff et Léo
Auer. Ce fut « monté avec beaucoup de soin et de goût par les Nouveaux ballets de Roland Petit. Un beau décor de Delvaux représentait un labyrinthe tout en glaces, un marin s’y perdait, escorté sans cesse par son double, et il se trouvait subitement en présence de la Mort » (Darius Milhaud, Ma vie heureuse). La critique salua cette œuvre « très charnelle, très trouble, très attachante », comme « le plus puissant ballet que l’on nous ait présenté depuis la Libération ».
C’est l’opus 283 du compositeur ; la partition fut aussitôt publiée chez Heugel.
Ce manuscrit de la « réduction pour piano » est noté à l’encre noire sur papier Parchment Band de Belwin à 20 lignes ; il est signé et daté en fin « Paris 8 Avril 1948 », avec la durée : « Total 18 minutes » ; un minutage détaillé figure au dos de la page de titre. La partition comprend cinq numéros.
I. Entrée et Danses du Matelot devant les Miroirs (p. 1) ;
II. Le Matelot et son Image (Pas de deux), Modéré (p. 6) ;
III. Entrée de la Femme (la Mort) et Danse avec le Matelot (Pas de trois), Modéré (p. 8) ;
IV. Danse de la Mort et du Matelot (p. 10) ;
V. La Mort et l’Image du Matelot (Final), Vif (p. 13).
Bibliographie : Edmund White, Jean Genet (Gallimard, 1993), p. 337 - 338 ; Jean Genet, Théâtre, Bibl. de la Pléiade (Gallimard, 2002), p. 245 - 253.
136 MILITARIA.
9 L.S., 1806 - 1842.
-
300
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 60
- 1 000
800
Maréchal BERTHIER, 2 novembre 1806, à Lannes. CLARKE, duc de Feltre, 13 mai 1808. Maréchal DAVOUT, prince d’Eckmulh, 24 janvier 1812, au général Lefèbvre. GOUVION SAINT CYR, 30 décembre 1818, au Comte Rivard de la Raffinière. Maréchal SOULT, duc de Dalmatie, 21 août 1842. Maréchal VICTOR, duc de Bellune, 10 mai et 2 décembre 1822. Jean-Baptiste FRANCESCHI, copie d’une lettre du maréchal Berthier (sur papier à en-tête d’Oudinot). Maréchal SUCHET duc d’Albufera, copie de lettre à son en-tête. 400
137 MIRABEAU Honoré-Gabriel de Riquetti, comte de (1749 - 1791) le grand orateur des débuts de la Révolution.
L.A.S. « Mirabeau fils », [Londres] 28 décembre 1784, à un ami ; 2 pages in-8.
Belle lettre de son exil à Londres, sur sa situation difficile et sur ses œuvres [Dans sa lettre, datée du même jour que la préface de ses Doutes sur la liberté de l’Escaut, réclamée par l’Empereur (Londres, G. Faden, 1784), Mirabeau parle de son travail, de sa maîtresse Henriette de NEHRA, et d’un pamphlet de Joseph SERVAN, probablement Questions du jeune docteur Rhubarbini de Purgandis, adressées à MM. les docteurs-régens, de toutes les facultés de médecine de l’univers, au sujet de M. Mesmer, & du magnétisme animal (Padoue, dans le cabinet du Docteur, 1784).]
« Je vois bien que lorsqu’il n’y a ni services à rendre à tes amis, ni mémoires balloniques à demander tu te rappelles tout au plus, le nom de ceux qui t’aiment, et tu n’as pas la plus légère démangeaison de leur écrire. Mais moi qui brûle la fievre au coin de mon feu, et dont la poitrine, par sympathie je crois, souffre cruellement, je pense à toi parce que je me porte mal, et que tu te portes bien, ce qui fait dans mon ame compensation de plaisir et de peine, de sorte qu’en y joignant l’aimable convalescence de ma compagne [Henriette de NEHRA] qui reprend sa force et sa beauté, je supporte avec une patience dont je suis moi-même étonné ma situation pénible. Je m’en veux pourtant de ne t’avoir pas écrit depuis plusieurs jours, et je ne m’absous pas en me disant que tu me dois une réponse ; je me dis au contraire que tout autre que le philosophique Toi seroit inquiet de moi ou fâché contre moi. Dans les deux cas je puis te dire : frappe mais écoute. À dater depuis les derniers jours du mois dernier, je suis occupé d’un travail instant, pénible et nécessaire qui a tellement rempli mon temps que mes journées n’y ont pas suffi ; j’ai pris plus de la moitié de mes nuits, ce dont mon Henriette m’auroit bien dispensé, et je me suis tué à ce métier. Je n’ai plus un corps de fer comme autrefois et quoique je sois de la trempe de ceux qu’un sentiment délasse d’un travail, la fatigue d’écrire après avoir écrit m’a toujours fait remettre au lendemain, et le repos absolu après la besogne m’étoit encore plus nécessaire le lendemain que la veille. Cela tient à ce que je sens qu’il m’est impossible de t’écrire brièvement […]. Le Docteur ELLIOT a été tout aussi délicat et généreux que tu l’avois prévu. Nous n’avons pu lui rien faire accepter ; il nous a renvoyé à la mort de mon père. Quelle que soit ma fortune, je ne pourrai pas payer le service qu’il m’a rendu en redonnant la santé à mon ami ; c’est pour moi le retour du bonheur. J’aime je l’avoue, la médecine qui arrive et qui chasse la maladie. Comment veux-tu que ces gens là ne tiennent pas le genre humain bridé à leur service jusqu’à la fin des siecles, quand on voit un d’entr’eux nous rendre avec deux lignes d’écriture l’être chéri pour qui nous venons de trembler. Bien des superstitions se sont établies à moins de frais et sur des raisons plus légères. Servant [Joseph SERVAN] vient de faire un livre contre eux qui me paroîtroit d’une conséquence fâcheuse pour la faculté si quelque chose pouvoit l’être. Il me semble que depuis le chapitre de Montaigne et les sarcasmes de Moliere, ils n’ont guère été plus rudoyés. Je te prêterai cela à ton retour ; à quand ton retour ? Car tes quinze jours se prolongent cruellement »…
138 MIRÓ Joan (1893 - 1983).
L.A.S. « Miró », 24.VII.1975, à Maurice BRUZEAU ; 1 page in-4 à son en-tête, enveloppe. Il le remercie pour son article : « Cet article me parait très juste et avec une claire vision de ma démarche »…
139 MONET Claude (1840 - 1926).
LAS, Argenteuil 30 mai 1875 ; 3 pages in-8.
Il a reçu la lettre de son correspondant annonçant qu’il pouvait lui « donner 150 F espèces […] mais je ne sais où prendre les 250 autres tellement le moment est mauvais pour moi. Bien certainement vous ne voudrez pas faire de frais inutiles. Tâches donc Monsieur de pousser jusqu’au bout l’obligeance ». Il l’engage à aller voir RENOIR chez lui. Il sera quant à lui « toute la semaine à Argenteuil », où on le trouvera entre onze heures et midi…
140 MONET Claude (1840 - 1926).
L.A.S. « Claude Monet », Fresselines 1er mai [1889, à Gustave GEFFROY] ; 4 pages in-8.
Lors de son séjour en Creuse chez Maurice Rollinat
Il le prie d’aller voir à l’Exposition universelle ou regarder dans le catalogue « s’il y a des tableaux de moi, et surtout s’il y en a un appartenant à Faure [le chanteur Jean-Baptiste FAURE]. Croyez-vous que ce misérable m’écrit ce matin qu’il me refuse de me prêter un seul tableau pour chez Petit, sous prétexte qu’il en a envoyé beaucoup au Champ de Mars et qu’il ne veut pas dégarnir son appartement. S’il en a envoyé à l’exposition comme je n’ai été consulté par personne je ferai tout pour les faire retirer »…
Il fait « un temps épouvantable et c’est folie à moi de rester encore mais je ne veux avoir aucun regret ni reproche à me faire et je persiste sans aucune chance de réussite. Jamais je ne me suis tant rongé et donné de mal et dire que ce sera pour rien »…
Il ajoute que ROLLINAT lui a « lu hier soir sa dernière chose en prose (la vieille cheminée) et pour y faire suite (le feu) c’est très très bien ».
61 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
600 - 800
700 - 800
1 000 - 1 200
1 200 - 1 500
140 bis MONET Claude (1840 - 1926).
L.A.S. « Claude Monet », Giverny 10 mai 1893, à Gustave GEFFROY ; ¾ page in-8 à en-tête Giverny par Vernon, enveloppe.
Il lui rappelle qu’il l’attend « samedi comme vous me l’avez promis », et le prie de confirmer l’heure de son arrivée.
141 MONET Claude (1840 - 1926).
L.A.S. « Claude Monet », Christiania 13 février 1895, à SA FEMME ALICE ; 4 pages in-8 à en-tête de Giverny (3 marques au stylo rouge).
Belle lettre sur son travail en Norvège
Il a reçu ses lettres, mais commençait à se tourmenter. « Je vois que vous avez bien froid aussi mais ce n’est rien à côté d’ici ce que vous avez la nuit nous l’avons le jour. Je comprends la joie des patineurs, mais je tremble bien pour le jardin, pour les oignons, pense-t-on bien à surveiller la glace dans le bassin. Ce serait bien malheureux si tout ce qu’il y a de planté allait périr. Je suis du reste aux regrets de m’être absenté à présent, car à part la joie d’être avec Jacques [Hoschedé, fils d’Alice] et de pouvoir t’en donner de bonnes nouvelles, ce voyage ne me sera d’aucune utilité, jusqu’à présent j’avais pensé pouvoir travailler. Hier encore nous avons voyagé toute la journée pour cela et vu des choses de toute beauté, mais je vois la chose trop difficile l’installation matérielle, les pertes de temps d’allées et venues rendent tout travail impossible. Et comme je trouve inutile de couvrir des toiles pour les planter là, j’y renonce, à la grande déception de Jacques. Tout cela me rend d’humeur assez sombre et regrette bien de ne pas être à Giverny où j’aurais pu profiter des belles choses qu’il y a en ce moment, et comme j’ai maintenant assez vu la Norvège il se pourrait que subitement je reprenne le chemin de la France n’ayant aucun goût pour voir des pays que je ne puis peindre. Du reste je suis trop vieux pour m’embarquer désormais pour des pays étrangers, en France tant qu’on voudra où l’on peut se caser et vivre à sa guise et où l’on peut profiter de son temps. Ici manger à une autre heure qu’eux est chose presque impossible, on se couche fort tard et on se lève de même. Enfin malgré l’amabilité des Norvégiens j’en ai presque plein le dos et tout cela parce que je ne peux pas travailler, que c’est chose impossible. Mais en voilà assez même trop tu vas m’en vouloir de me laisser ainsi abattre et décourager. Heureusement nous nous portons à merveille. […] prends garde aussi de prendre froid. […] Dis à Blanche que je l’envie bien de pouvoir de pouvoir travailler qu’elle ne décourage pas, c’est bon pour un vieux comme moi »…
142
MONET Claude (1840 - 1926).
L.A.S. « Claude Monet », Giverny 21 mars 1899, à François DEPEAUX ; 4 pages in-8 (deuil) à en-tête de Giverny Importante lettre rappelant les responsabilités de Monet auprès des enfants de Sisley après la mort de ce dernier
[Monet écrit au collectionneur d’art impressionniste François DEPEAUX (1853 - 1920) pour mettre au point avec lui deux actions en faveur de la postérité d’Alfred SISLEY mort le 29 janvier 1899. Sisley, malade depuis plusieurs années et sentant sa fin proche, avait demandé à Monet de prendre en charge ses deux enfants qui avaient déjà perdu leur mère à la fin de l’année précédente. Claude Monet décida alors d’organiser une souscription pour réunir des fonds nécessaires à l’achat d’une œuvre de Sisley afin d’en faire don au Musée du Luxembourg. Dans cette lettre, Monet tente aussi de se concerter avec Depeaux pour fixer la date d’une vente des œuvres de Sisley et d’œuvres offertes par d’autres artistes de ses amis pour venir en aide financièrement à ses enfants sans ressources. La vente aura bien lieu le 1er mai à la galerie Petit. Deux ans auparavant, Sisley avait proposé 147 de ses toiles dans cette même galerie et avait connu un très cruel insuccès et le critique et collectionneur, Adolphe Tavernier, ici mentionné, y avait été un des rares acheteurs. ]
Monet, ne pouvant quitter Giverny, avertit Depeaux « 1° que la souscription en vue de l’achat d’un tableau de Sisley pour offrir au Luxembourg devant être close sous peu. 2° Que la vente d’un certain nombre de toiles de Sisley et de dons de ses amis et confrères étant chose décidée pour la date des 29 -30 avril et 1er mai, il était urgent avant d’entamer quoi que ce soit d’autre, de choisir d’abord le tableau à offrir au Luxembourg et ensuite les toiles destinées à la vente publique. Cela fait il n’y aurait plus qu’à profiter prudemment des offres qui se présenteront, mais la première chose à mon avis serait de faire définitivement ces deux choix, et puisque vous êtes à Paris vous pourriez vous concerter à ce sujet avec M rs Tavernier et [Georges] Viau, ne voulant aucunement prendre de responsabilité. Bref pour faire de la bonne besogne il faut être bien d’accord et je serais désolé que l’on puisse me reprocher d’avoir fait manquer une occasion profitable aux enfants. C’est cette considération qui me fait désirer qu’avant tout ces deux choix soient faits une fois pour toute. M’occupant actuellement de la vente projetée je voudrais qu’elle soit un succès pour notre cher ami et pour ses enfants j’ai directement écrit aux peintres qui ont montré de sympathie à Sisley. J’ai déjà reçu plusieurs réponses favorables et j’ai tout lieu d’espérer que ça marchera à souhait »…
1 500 - 2 000
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 62
500 - 600
2 000
- 2 500
143 MONET Claude (1840 - 1926).
L.A.S. « Claude Monet », Giverny 12 mai 1899, à François DEPEAUX ; 3 pages et quart in-8(deuil) à en-tête de Giverny
Il invite Depeaux à venir le voir à Giverny avant sa rencontre avec Georges Viau : « je ne compte pas aller à Paris de sitôt voilà plus de 18 mois que je n’ai touché un pinceau. Je viens d’en passer 4 à m’occuper des enfants de SISLEY et à la mémoire de leur père, il est temps que je pense à moi et que je travaille, vous comprendrez donc le désir que j’ai de me confiner à Giverny où j’ai aussi bien des devoirs à remplir ». Il a reçu une réclamation d’un marchand de couleurs « à qui Sisley devait un compte, il serait urgent, il me semble, avant de placer ce qui revient aux enfants, de savoir exactement les quelques dettes restant en souffrance ». Georges VIAU désire être « déchargé de son rôle de trésorier de la souscription », et Monet aimerait savoir comment la somme sera employée…
144 MONET Claude (1840 - 1926).
L.A.S. « Cl. Monet », Giverny 21 février 1921, à Gustave GEFFROY ; 3 pages in-8 au crayon, à en-tête Giverny par Vernon, enveloppe.
Il n’a pas répondu à sa bonne lettre, étant « assez patraque depuis quelques jours […] écrire est pour moi toute une affaire j’y vois de moins en moins ce qui me rend terriblement malheureux et nerveux ». Mais il tient à dire à Geffroy « toute l’amitié que je n’ai cessé d’avoir pour vous, ainsi que le regret de ne pas vous voir plus souvent et qui n’est de la faute ni de vous ni de moi ». Il est à sa disposition pour les questions que Geffroy veut lui poser et auxquelles Mme Jean Monet répondra pour lui. Il a reçu son livre sur Guys, qu’il ne peut lire pour l’instant ; il est curieux de lire aussi le livre sur Firmin Maillard « que j’ai beaucoup connu jadis »…
145 MONGE Gaspard (1746 - 1818).
L.A.S. « Monge Examinateur des élèves de la Marine », Paris 18 juin 1788 ; 1 page in-4. Il est de retour de sa « tournée dans les Colleges de la Marine », et aimerait être payé rapidement des 1800 livres « seconde moitié de mes frais de voyage ».
146 MONTESQUIOU Robert de (1855 - 1921).
26 L.A.S. « Robert de Montesquiou » ou « Robert de M », 1892 - 1913 et s.d., à Adolphe ADERER ; 84 pages in-8 ou in-12.
Échange littéraire évoquant notamment des envois respectifs de livres et le travail de critique d’Aderer au Temps Montesquiou sollicite un article sur son « second volume d’essais, Les Autels privilégiés »… « Vos drames restreints et concentrés, édifiés sur des exceptions sentimentales, sont poignants et palpitants, pleins de pathétique délicat, et de décorative surprise »… Il viendra le voir « en costume de voyage, comme il convient à ceux qui passent, et mû par cette forme supérieure de l’Amitié que le doux latin appelle fiducia »… Il remercie d’un « joli compte rendu bien que vos “gens de lettres un peu crottés et très timides” m’aient valu quelques mouchetures et quelques moues. Mais c’est le succès paraît-il »… Il remercie d’un mot d’amitié « dans mon profond deuil d’amitié » (24 août 1905)…. Il évoque les « fêtes de Douai », ses relations avec les directeur et rédacteur du Temps, Hébrard et Deschamps, des notes à insérer dans le journal… Il regrette l’absence d’Aderer à sa conférence sur Gustave Moreau, etc.
147 MONTHERLANT Henry de (1895 - 1972).
L.A.S., notes et manuscrits autographes, la plupart pour Michel de SAINT-PIERRE ; 12 pages formats divers.
L.A.S. du 23 octobre 1951 : il disait à Daniel-Rops « comme il serait beau que des prières fussent écrites par de grands écrivains, alors que trop souvent elles ont du bla-bla-bla, sinon du véritable galimatias. […] Je n’ai pas souvenir qu’il y ait bcp de prières dans mon œuvre (je ne compte pas les prières de Malatesta, priant Dieu de pouvoir bien tuer le Pape) » ; mais il signale celle de La Relève du matin
Notes et projets divers, souvent écrits au dos de tapuscrits ou lettre reçues : au sujet de ses Carnets ; remarque sur la pièce Les Écrivains de M. de Saint-Pierre ; note concernant une crique de Beigbeder sur Malatesta
On joint divers documents, dont des l.a.s. adressées à M. de Saint-Pierre par Robert Merle, Jeanne Sandelion, etc.
400 - 500
63 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
1 200 - 1 500
800 - 1 000
80 - 100
800
- 1 000
148
MONTHERLANT Henry de (1896 - 1972).
2 L.A.S. « Montherlant », 1950 - 1955, à un journaliste de Montréal ; 2 pages in-8 chaque.
31 août 1950, remerciant d’un article : « Il y a une certaine richesse intérieure qui, en effet, ne pouvant se montrer tout entière à la fois, devra présenter successivement ses différents visages. Et il est très bien que vous ayez mis l’accent là-dessus dans votre article. Je suis content aussi d’y voir cités Tolstoï et Dostoïevsky (je préfère de beaucoup le premier au second) »…
22 septembre 1955 : « J’ai fait ce que j’ai pu pour votre livre. Je n’ai pas réussi ; je ne puis faire plus. C’est chaque semaine que de jeunes gens m’envoient des manuscrits, sans me demander si je n’ai pas autre chose à faire que de les lire, me pressent de les lire, toutes affaires cessantes, me demandent des rendez-vous, des appréciations, des articles, des préfaces. J’ai trouvé votre livre intéressant, surtout la mort du père. Vous avez du talent. Mais 9 sur 10 des inconnus qui m’envoient des manuscrits ont du talent »…
On joint un ensemble de 10 lettres autographes (brouillons) , 1939 - 1959, principalement sur des affaires d’édition, au traducteur allemand Berndorf, à Tournier (sur la Rose de sable), à Hamonic, à son avocat M e Rault, à. Godemart (sur les offres du Seuil et les droits que Grasset prétend détenir sur ses œuvres), à Roland Laudenbach (sur Le Solstice de juin), à Mlle Duvivier (pour une couverture), à G. Govone (pour la traduction en Argentine de son livre sur Mariette Lydis).
149 MONTHERLANT Henry de (1895 - 1972). – TRÉMOIS Pierre-Yves (1921 - 2020).
Le Cardinal d’Espagne. Gravures de TRÉMOIS (Paris, Henri Lefebvre, 1960) ; in-folio, en feuilles sous couverture rempliée, chemise et étui (étui usagé). Édition originale, illustrée de 34 eaux-fortes et burins de TRÉMOIS, tirage limité à 250 exemplaires. Un des 200 exemplaires sur grand vélin d’Arches (ex. n°74), signé par l’auteur, l’illustrateur et l’éditeur ; et enrichi d’un grand dessin original de Pierre-Yves Trémois, à la plume, sur double page, signé et annoté : « En souvenir du Cardinal d’Espagne, Trémois juillet 1960 », ainsi que de deux cuivres rayés : « Le bouffon du cardinal » (p. 59, 41 x 34 cm) et « Cisneros » (p. 159, 27,5 x 24,5 cm), Envoi autographe signé (sur le faux-titre) : « Voici un drame où rien n’est, même le tout, où tout est, même le rien. Les personnages hésitent entre ces deux interprétations de la vie. Montherlant ».
150 MOORE Henry (1898 - 1986).
L.S. « Henry » avec 2 lignes autographes, Much Hadham 13 août 1952, à John ; 1 page in-8 dactyl. à son adresse (trous de classeur en marge) ; en anglais. Sur son travail de sculpteur Il va envoyer les photographies demandées, ainsi que quelques photographies de nouveaux petits bronzes. Il expérimente encore la présentation de ses bronzes : certains sont modelés en cire et présentés sur le sol de son jardin. Sculpter en cire présente l’avantage de pouvoir réaliser facilement des formes filigranes sans avoir l’inconvénient de devoir construire des armatures. Il a beaucoup plus de travail de sculpture qu’à l’accoutumée, et est en train de commencer le projet d’une très grande sculpture pour un bâtiment…
1 500 - 2 000
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 64
120 - 150
300
- 400
151 MOULIN Jean (1889 - 1943) préfet, héros de la Résistance.
L.A.S. « Jean », Chartres 15 janvier 1940, à sa mère Mme Antoine-Émilie MOULIN et sa sœur Laure MOULIN, à Montpellier ; 2 pages oblong in-12 à en-tête Le Préfet, et 1 page et quart in-8 à en-tête Le Cabinet du Préfet d’Eure-et-Loir, enveloppe.
Rare lettre familiale
« Chère maman, chère Laure, J’ai reçu hier la lettre de Laure et j’avais précédemment reçu de vos nouvelles par Marcelle qui, installée à S t Raphaël, m’a tenu au courant ses tribulations et exprimé sa satisfaction d’être dans un beau pays, gratifié d’un climat agréable. Comme elle m’a indiqué également que la Seine et Oise lui avait accordé un congé, je ne suis pas intervenu à nouveau auprès de l’inspecteur d’académie. Enfin, tout est bien qui finit bien ! Je viens, quant à moi, de m’offrir une bonne grippe qui m’a contraint à garder le lit pendant 5 ou 6 jours, avec au début 40 et 3/10 e de fièvre. J’ai été aussitôt énergiquement soigné par l’inspecteur d’hygiène et par Kathleur : ventouses, inhalations, potions, purges, etc… etc…. et je suis maintenant à peu près complètement rétabli. Seulement je vais garder la chambre encore deux ou trois jours, sur les conseils du médecin, pour être absolument à l’abri de toute rechute. D’ailleurs, il fait toujours très froid dehors et aujourd’hui il y a encore, en plein midi, 5 degrés au dessus de zéro. Les cas de grippe sont très nombreux dans la région. Ils ne sont heureusement pas graves. Je pense que vous êtes toutes deux complètement remises des vôtres et que vous prenez toutes les précautions nécessaires, par ces temps de fraicheur. J’ai écrit au maire d’Avignon pour Jeanne Moureu. Envoyé également un mot à Bellessort pour sa nomination comme secrétaire perpétuel »… [André Bellessort avait été nommé le 11 janvier secrétaire perpétuel de l’Académie française.]
152 MOULIN Jean (1889 - 1943) préfet, héros de la Résistance.
L.A.S. « Jean », Chartres 14 juillet 1940, à sa sœur Laure MOULIN, à Montpellier ; 3 pages et demie in-8, enveloppe. Belle et rare lettre de Jean Moulin, moins d’un mois après son arrestation par les Allemands et sa tentative de suicide en juin 1940
« Chère Laure, Triste 14 juillet ! Je suis allé ce matin, avec le maire déposer une gerbe au monument aux morts. Ici, après un reflux en masse de gens qui étaient partis vers le sud, il semble que les retours se fassent maintenant plus rares. Et pourtant tout le monde n’est pas rentré. Il paraît qu’il y aurait des difficultés à passer la Loire. J’ai reçu hier des nouvelles de ma vieille cuisinière, Marie, qui était partie dans l’Indre et Loire et qui voudrait bien revenir à Chartres. Elle est employée là-bas dans un hôtel où les employés de la Santé Publique prennent pension et elle espère rentrer avec ce personnel lorsqu’il sera rapatrié. Je la reprendrai volontiers, quoique Nelly soit très dévouée et se soit donné du mal pour mettre de l’ordre dans la maison. Mais elle a évidemment beaucoup à faire et elle ne demandera pas mieux que d’être remplacée. J’espère que tu as de bonnes nouvelles de maman et qu’elle se plaît toujours à S Jean. Peut-être as-tu pu aller la voir depuis. Je lui envoie d’ailleurs un mot par le même courrier. As-tu de bonnes nouvelles de St Andiol ? Y es-tu retournée ? Le jardin doit être bien joli en ce moment avec les rosiers grimpants. À ce sujet, j’ai oublié de te dire – il y a eu tant d’évènements importants depuis ! – que les graines que je t’avais envoyées, en sacs, ne sont pas pour le jardin de Maguelonne, mais pour celui de SaintAndiol. Peut-être d’ailleurs, avec toute cette tourmente, ne les as-tu pas reçues encore. Je n’ai reçu qu’hier une de tes lettres datées du 13 juin (juste un mois). […] J’ai peur que tu te donnes trop de mal avec tous tes examens, tes hôtes et tes réfugiés »…
65 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
1 500 - 2 000
2 000 - 2 500
153
NADAR Félix Tournachon dit (1820 - 1910)
Photographie avec NOTE autographe signée « N. », 1870 ; papier albuminé, 10,7 x 8,5 cm, monté sur carte à la marque Nadar, 11 x 16,5 cm (quelques légers défauts).
Photographie originale de son ballon Le Neptune, premier ballon à avoir quitté Paris assiégé le 23 septembre 1870. Piloté par Claude-Jules Duruof, l’un des trois signataires de la Convention des aérostiers, il s’envole de la Place Saint-Pierre à Montmartre. Le ballon atterrit à côté d’Évreux, au château de Cracouville, après un vol de 100 kilomètres.
Au verso, légende autographe : « Notre ballon d’observation le Neptune, et notre 1er poste Place S t Pierre Montmartre Siège de Paris 1870. N. »
154 [NAPOLÉON I er].
7 ouvrages en 5 volumes.
REGNAULT WARIN Jean-Joseph Introduction à l’histoire de l’empire Français, ou Essai sur la monarchie de Napoléon. Paris, Paul Domire, 1820. 2 volumes in-8, demi-veau fauve glacé, dos or et à froid (Reliure de l’époque). Édition originale. Portrait de Napoléon ajouté.
Polygraphe, l’auteur est surtout connu pour ses romans populaires, tel Le Cimetière de la Madeleine paru en 1800. Provenance : Dominique de Villepin (ex-libris).
MASSON Frédéric Napoléon à Sainte-Hélène. Paris, Manzi, Joyant, 1912. 2 volumes in-4, demi-maroquin vert empire avec coins, pièces fauve, tête dorée, couverture et dos (Lemardeley-Huser ). Édition originale, richement illustrée et ornée d’un frontispice et de 47 planches. Tirage à 350 exemplaires, celui-ci un des 50 de tête sur japon impérial. Dos passé.
SISMONDI Jean-Charles-Léonard Simonde de Examen de la constitution françoise. Paris, Treuttel et Würtz, 1815. 4 ouvrages en un volume in-8, demi-veau fauve avec coins, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
Édition originale de cette défense de la constitution libérale des Cent-Jours .
On trouve relié avec : – PRADT de. Histoire de l’ambassade dans le grand duché de Varsovie en 1812, par M. de Pradt, archevêque de Malines, alors ambassadeur à Varsovie. Quatrième édition. Paris, Pillet, 1815. – ROCCA
Jean de. Campagne de Walcheren et d’Anvers, en 1809. [Paris, 1815]. Le titre manque. – Considérations sur la constitution morale de la France. Genève, J.J. Paschoud, 1815. Ex-libris autographe de Mariet, avec liste manuscrite des pièces sur le contreplat. Reliure restaurée, dos et coins refaits, le dos ancien réappliqué.
Provenance : Dominique de Villepin (ex-libris, Bibliothèque impériale, 19 mars 2008, n° 274).
155 OTTO Louis-Guillaume (1753 - 1817) diplomate.
13 L.A.S. « Louis » « Otto » ou « O », Vienne février 1810-mai 1812, à SA MÈRE Mme OTTO à Paris (2 à sa femme Fanny) ; 35 pages in-4, 6 adresses.
Belle correspondance familiale comme ambassadeur en Autriche [Otto a été nommé à Vienne pour négocier les conditions du mariage de Napoléon et Marie-Louise.] Nous ne pouvons donner qu’un rapide aperçu de cette intéressante correspondance.
1810 . – 19 février (à sa femme). M. de Narbonne va le remplacer à Munich. Il parle des dispositions des Viennois : « La joie est universelle ici, les gens de tous les partis boivent à la santé de Napoléon, […] l’Ambassadeur est considéré comme un ange de paix »… – 20 février. Il espère « que la paix sera bien durable », car sa mère aura appris le « grand mariage qui unira pour longtems les Empires de France et d’Autriche ». Les neiges ont empêché sa famille de le rejoindre… – 25 février (à sa femme). Description de MARIE-LOUISE : « Notre future Impératrice est pleine de talens, grande musicienne et peintre à l’huile. Elle parle 3 ou 4 langues, a infiniment de douceur et de bonté, une belle taille et de la grace »… – 3 avril. Récit de la brillante fête qu’il a donnée : « tous les archiducs et 400 personnes du premier rang y ont assisté »… – 10 juin. Sur ses propriétés de Sarcelles, sa femme et sa fille Sophie… – 27 juin, sur leurs affaires et Sarcelles. – 23 septembre. Il parle de son installation : « il a fallu remeubler à neuf. J’ai ajouté au grand appartement cinq salons, ce qui me fait une suite de 19 pièces […] je peux faire asseoir à table 400 personnes »… Il a retrouvé avec joie sa femme et sa fille. Il a « 56 ans passés » et songe à se retirer du monde : « Sarcelles m’offrira un doux repos »… – 23 octobre. Nouvelles de sa famille. 1811. – 1er juin. Sur sa maison de campagne de Weinhauss.– 24 juillet. Nouvelles familiales. – 30 août : arrivée de son neveu Alexandre. – 26 décembre. Au sujet du bail de Mosloy. 1er mai 1812. Il se réjouit du mariage de sa fille Sophie…
800 - 1 000
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 66
250 - 300
2 000 - 2 500
156 PIEYRE DE MANDIARGUES André (1909 - 1991).
MANUSCRIT autographe, La Motocyclette, 1960 - 1962 ; 134 pages in-4 montées sur onglets ; reliure de maroquin noir, les plats ornés d’un décor abstrait mosaïqué en veau glacé noir, blanc et rouge et de pièces de veau argentée à la feuille ; doublures, bords à bords, et gardes de veau rouge ; doubles gardes de papier à la main : tranches argentées sur témoin ; chemise et étui (M. de Bellefroid ).
Manuscrit complet de ce roman
Publié en 1963 chez Gallimard, le roman retrace la rêverie érotique de la belle amazone Rébecca, nue sous sa combinaison de cuir, chevauchant sa Harley-Davidson à la poursuite de son amant, quelque part en Allemagne sur les bords du Neckar. Au retour, elle s’écrase avec sa machine sur un camion.
Le roman a été adapté au cinéma en 1968 par Jack Cardiff, avec Marianne Faithfull et Alain Delon dans les rôles principaux.
Commencé le 14 mars 1960 et achevé le 14 mai 1962, le manuscrit, au stylo noir au recto de 134 feuillets de papier bleu, présente de nombreuses ratures et corrections, notamment une première version de la fin qui a été biffée. On a relié en tête le cahier préparatoire, cahier d’écolier autographe signé, contenant les premières ébauches, des plans et notes préparatoires (titre et 10 feuillets).
Plus une L.A.S. de Pieyre de Mandiargues au collectionneur Louis de Sadeleer qui lui acheta directement le manuscrit, accusant réception du paiement, 23 juin 1963. Et une photo de la Harley-Davidson. Belle reliure mosaïquée de Micheline de BELLEFROID
Exposition Les Richesses de la bibliophilie belge, II de la Société des bibliophiles et iconophiles de Belgique, Bruxelles, Bibliothèque Albert I er, octobre-novembre 1966, n° 195. Ancienne collection Louis de SADELEER (ex-libris).
157 PIEYRE DE MANDIARGUES André (1909 - 1991).
MANUSCRIT autographe signé « A.P.M. », [Chagall ], Paris 11 mai 1973 ; 50 feuillets in-4 écrits au recto (quelques rares déchirures sans manque).
Manuscrit complet de son livre sur Marc CHAGALL , publié chez Maeght en 1975. Citant d’emblée des critiques de Léger et Delaunay reprochant à Chagall « d’être un peintre “littéraire’ », Mandiargues donne une longue biographie de Chagall, émaillée de nombreux aperçus sur son style. « Son pinceau devient une sorte de baguette [...], capable d’enchanter et d’ensorceler les paysages urbains ». Il le proclame « peintre poète par excellence » et qualifie sa peinture de « feux d’artifice du langage poétique, feux d’artifice de la peinture poétique ». Il évoque au passage Verlaine, Rimbaud, Cendrars, Germain Nouveau, les surréalistes mais surtout Éluard qui sut si bien sentir l’art de Chagall et « qui l’a transporté en poésie mieux que quiconque, Cendrars excepté. [...] Certains seront-ils étonnés [...] si je dis encore que l’érotisme de la peinture de Chagall me paraît aussi éblouissant que celui de la poésie d’Eluard [...] Bestial et divin à la fois, le sexe selon Chagall, projette l’homme au-dessus de lui-même »… Après avoir décrit de nombreux tableaux, Mandiargues conclut : « l’art de Chagall, à travers le printemps de l’amour universel, s’est identifié avec la vie ».
On joint le tapuscrit (58 feuillets in-4), daté du 11 mai 1973, comportant quelques infimes corrections et ajouts.
158 PREVEL Jacques (1915 - 1951).
L.A.S. « Jacques », 11 août 1948, à « Mon tout petit » ; 2 pages in-8. Il est malade et pris en charge par « l’Office publique d’Hygiène sociale. Je suis toujours bien faible et fatigué avec beaucoup de température. […] ici les repas sont si mauvais que je ne peux rien manger. J’ai beaucoup maigri ». Il demande de venir le voir, et de lui envoyer des fruits, ainsi que « le Rimbaud qu’Artaud m’avait donné et la vie fantastique de Mary Baker Eddy ».
67 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
8 000 - 10 000
1 000 - 1 200
400 - 500
159
PRÉVERT Jacques (1900 - 1977).
L.A.S. « Jacques » avec dessin, à Claudy CARTER ; 4 pages in-4 à l’encre bleue. Longue et belle lettre à l’un des amours de sa vie, l’inspiratrice des Feuilles mortes S’il n’a pas encore écrit à son « cher petit […] c’est que nous avons été plongés nous aussi dans un univers d’une telle vacherie, un des plus sales hivers que j’ai jamais vu de ma vie ». Il attendait pour écrire d’avoir de meilleures nouvelles ; il ne l’oublie pas et pense beaucoup à elle. « Une seule chose heureuse, la petite Michèle qui elle aussi a l’air d’une petite mandarine avec des yeux bleus, ou d’une enfant ogresse et douce, comme dans les contes chinois… et je lui souhaite pour plus tard une petite épée de cristal... et qu’elle vive comme dans ces contes où les amoureux s’aiment et se tuent sans se faire du mal. En attendant elle est très difficile à nourrir… et la seule vue d’un biberon avec du lait la met en transe. Elle n’aime que dormir, se réveiller et rire, elle n’aime pas pleurer, ni crier mais quand elle mange c’est un vrai mélodrame (drame mêlé de musique)… Pas marrant pour Janine, qui est très fatiguée, et même très malade… Pour moi qui n’ai pu me reposer depuis que j’ai été opéré je suis lamentablement surmené, par un travail incessant de cinématographe parlant […] Je suis tombé dans des pièges à con : 1° pas de grands films et autres superproductions 2°….et qui de ce fait ne rapporte même pas d’argent »… Il se plaint de Marcel CARNÉ « qui décidément “a chié dans ma malle jusqu’au cadenas…” […] je ne veux plus travailler avec lui. Quelle fatigue… et quelle tristesse… ce petit homme trépignant sans cesse… et ces incessantes et dérisoires sautillantes petites colères […] si certaines choses s’arrangent je travaillerai pour Monte-Carlo, spectacles et ballet… » Etc.
160
PROUDHON Pierre-Joseph (1809 - 1865).
L.A.S. « P.-J. Proudhon », Sainte-Pélagie 17 décembre 1849, [à Eugène SUE] ; 1 page et demie in-8 à en tête du journal La Voix du Peuple
Très belle lettre de prison à Eugène Sue sur Les Mystères du peuple
Il a reçu ses livraisons, dont la lecture lui donnera « autant d’instruction que d’amusement. Je compare votre genre de Roman au Magasin pittoresque et au Musée des familles, où je trouve des histoires de tous les personnages, de tous les lieux et événements célèbres, plus amusantes à lire que de sèches notices. Je trouve, il est vrai, pour la promptitude des recherches, les Atlas, les Voyages, les Chroniques, les biographies, beaucoup plus commodes : mais cela se place sur des rayons, le plus souvent on n’en lit rien, et quand on a lu, non sans une grande fatigue, on oublie tout. Le public connaît mieux le jésuite par le Juif errant, que par toutes les histoires authentiques. Continuez donc : prêchez-nous, cette fois, la patrie, que nous avons oubliée, que les Romains de 93 ne nous ont pas rendue. Faites-nous connaître notre nationalité, notre esprit indigène, que l’histoire nous montre apparaissant çà et là, depuis l’assaut du Capitole, jusqu’au 24 février, dans nos vieux chroniqueurs, puis dans nos vieux romanciers, de Rabelais, Montaigne, Molière, La Fontaine, Voltaire, – esprit continuellement offusqué par le biblisme, le classicisme, et le romantisme, qui n’est pour moi que du cosmopolitisme, du panthéisme en littérature, quand ce n’est pas du plus misérable éclectisme »…
161 PROUST Marcel (1871 - 1922).
L.A.S. « Marcel Proust », [vers le 25 février 1909, à Robert de MONTESQUIOU] ; 3 pages in-8. Belle lettre remerciant Montesquiou de l’envoi de son livre Assemblée de notables (Félix Juven, 1908). « Pardonnez-moi de proportionner l’expression de ma reconnaissance à mon extrême fatigue. J’ai retrouvé, dès le premier coup d’œil, avec un plaisir sans mélange, cette ravissante comparaison tirée de l’architecte et du jardinier, dans un tout autre genre “celle qui nous a appris à nous raser les sourcils”, tant de choses spirituelles, profondes, merveilleuses d’intelligence et de talent, originales, rien qu’à vous, ne pouvant être que de vous. Comme on voudrait savoir les noms des amatrices de porcelaines (B et LR), de l’académicien qui a dit “aide mémoire” et Ganderax m’a coupé ce passage, et l’autre académicien (sphinge), de la dame qui a vendu 50 fois sa collection. Car c’est en même temps que si fort, si vivant (sans doute est-ce cela qui le rend balzacien) qu’en partageant l’intelligence et en charmant l’inspiration, cela pique encore la curiosité et redonne à ceux qui ne peuvent plus travailler du cerveau, un goût de société, sinon de revoir du moins de resonger à ces Dames d’Automne, depuis longtemps fort bannies de mon souvenir »…
Correspondance, t. IX, n° 17, p. 45.
1 200 - 1 500
500 - 600
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 68
3 000 - 4 000
162 PROUST Marcel (1871 - 1922).
L.A.S. « Bunnnn », Mardi [23 mai 1911, à Reynaldo HAHN ; 4 pages in-8 Belle lettre à son ami, à propos du Martyre de Saint Sébastien dansé par Ida Rubinstein [Proust a assisté le 21 mai à la répétition générale du Martyre de Saint Sébastien de Gabriele D’ANNUNZIO, musique de Claude DEBUSSY, dansé par Ida RUBINSTEIN.]
« Petit Gunimels, Pardonnez-moi monstrueux égoïsme de vous avoir mêlé à mes stupides agitations, mon état de santé était mon excuse. Et hélas, en revoyant votre lettre j’ai vu la nouvelle de cette mort [Leni Falk, née Seligman, nièce de Reynaldo Hahn, morte le 22 mai], faisant évanouir toute cette stérile agitation auprès des chagrins réels, de la vie terrible qu’on oublie trop. Depuis quelques jours je ne cessais de penser à votre pauvre petit neveu [Édouard Seligman, frère de Leni, mort en 1907] le sourd muet, à qui je pense souvent, dont je rêve souvent, un des seuls êtres pour qui je ne puisse pas croire que l’existence est finie et qu’il n’a pas ailleurs une compensation à son incomplète vie. […]
Cher Buncht, mêlé sans interruption à toute ma vie (je vous avais écrit plusieurs lettres hier).
Tout ce qu’il y a d’étranger chez Annunzio s’est réfugié dans l’accent de M e Rubinstein. Mais pour le style, comment croire que c’est d’un étranger. Combien de Français écrivent avec cette précision. Comme je finis toujours par venir à vos opinions j’ai trouvé les jambes de M e Rubinstein (qui ressemble moitié à Clomenil [la courtisane Léonie de Clomesnil], moitié à Maurice de Rothschild) sublimes. Cela a été pour moi, tout. Mais j’ai trouvé la pièce bien ennuyeuse malgré des moments, et la musique agréable mais bien mince, bien insuffisante, bien écrasée par le sujet, la réclame et l’orchestre bien immense pour ces q.q. pets. Dans le temple du 3 e acte, j’étais persuadé que c’était la marche des Petits Joyeux [chanson d’Aristide Bruant] qu’on jouait. Mais tout à la fin, sous le soleil aux rayons raides, après la mort de S t Sébastien, il y a un bel instrument joyeux »… Et il ajoute : « C’est un four noir pour le poète et le musicien. On n’est même pas venu dire les noms ». Correspondance, t. X, n° 139, p. 288.
163
QUENEAU Raymond (1903 - 1976).
MANUSCRIT autographe et TAPUSCRIT corrigé, Les Temps mêlés , [1939 - 1941] ; 188 pages la plupart in-4 ou petit in-4, et 133 pages in-4.
Ensemble des notes et manuscrits préparatoires et du tapuscrit corrigé de ce septième roman de Queneau, suite de Gueule de pierre
Dès août 1938, Queneau songe à écrire une suite à son roman Gueule de pierre (1934), d’abord sous forme d’un poème en 24 chants, auquel il va travailler jusqu’en octobre 1938 à Coye-la-Forêt (Oise). Il se remet au travail en juin-juillet 1939, mais la guerre va l’interrompre ; il reprendra la rédaction du livre en janvier 1941, pour l’achever le 3 juillet. Les Temps mêlés paraîtra chez Gallimard en novembre 1941, avec le sous-titre (Gueule de pierre, II ). Les deux romans seront intégrés avec une suite dans Saint Glinglin en 1948, Les Temps mêlés étant fortement remanié. Pierre Kougard est devenu maire de la Ville Natale ; devant la mairie, se dresse le corps pétrifié de son père. Lors des fêtes de la Saint-Glinglin, des touristes débarquent, dont la vedette de cinéma Cécile Haye, dont Paul (frère de Pierre) va tomber amoureux. Pierre veut introduire des réformes, et il arrête le chasse-nuages de l’inventeur Timothée Worwass, qui maintenait un ciel pur sur la ville. La pluie diluvienne provoque la dissolution et l’effondrement de la statue. La population mécontente chasse Pierre, et son frère Paul lui succède. Le roman est divisé en trois parties : la première est une série de poèmes évoquant divers habitants de la Ville Natale ; la seconde, un monologue de Paul ; la troisième, une pièce en cinq actes ou tableaux. Le manuscrit se compose de :
A. Première partie (en vers) : feuillets détachés (papier ligné ou à grands carreaux) dans 2 cahiers d’écolier (22 x 17 cm) des Comptoirs français ; le 1er à couverture verte, portant la mention « GDP II (pas net) » (28 pages) ; le 2e à couverture rose, portant la mention « GDP II (net) » (23 pages) à l’encre noire, plus 5 feuillets in-4 et un dactylographié.
B. Deuxième et troisième parties (prose et théâtre). 14 pages in-4 dactylographiées et corrigées, suivies de 62 pages autographes à l’encre noire.
C. Un ensemble de 36 pages in-4 à l’encre noire, version primitive de la troisième partie rédigée en style romanesque.
D. « Dialogue de Jean et d’Hélène », 9 pages in-4 sur papier vert accompagnées de 15 feuillets dactylographiés.
E. Ensemble de notes, plans, ébauches diverses : 9 pages in-4 à l’encre noire et au crayon sur papier gris, et 16 pages de formats divers (in-8 ou in-12).
F. 6 feuillets dactylographiés paginés 1-6 (texte sur les « médians »).
G. Tapuscrit complet (133 ff. in-4), ayant servi pour la composition de l’édition. Il semble avoir été rédigé directement à la machine par Queneau lui-même, à partir des diverses ébauches manuscrites. Il présente des ratures et de nombreuses corrections, avec des passages biffés. Il est daté en fin (l’indication a été rayée pour la typographie) : « Neuilly, le 3 juillet 1941 ; midi 25 (à ma montre, avance un peu) ».
H. Tapuscrit des poèmes La Vieille et Le Fantôme (4 ff. in-4), et placard d’épreuve de la revue Mesures (non publiés, la revue ayant disparu après avril 1940).
69 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
6 000 - 8000
4 000 - 5 000
Le dossier des notes et plans est fort intéressant. On y trouve notamment une chronologie, un tableau des personnages, des indications topographiques, etc. Les notes préparatoires montrent aussi les hésitations du romancier lors de l’élaboration de son livre. Ainsi : « Paul convaincu d’inceste. Démissionnera-t-il ou se démariera-t-il ? Hésitations » ; et Queneau ajoute, non sans ironie : « Cornélien. Racinien. Eschylien (au moins) ». On trouve aussi sur ces feuillets des jeux sur le langage comme cette variation à partir du mot insecte : « In-Secte. Insectualité. In-sexualité. Intellectualité.
In-Secte : celui qui n’appartient à aucune secte. In-Sexue : pas de sexualité. In-Texte : ni de texte écrit (intellectualité).
Un Tel est que tu as lité ».
Des douze poèmes de la première partie, onze sont présents dans les cahiers, et dans des versions offrant de très nombreuses et importantes variantes. Le premier poème, Le Veilleur, dont on a dans les notes un plan-graphique, figure ici dans une version primitive intitulée Les Douze Quilles de la nuit, très différente :
« Le tans a renversé les douz quilles de la nui
Plus une mintenan ; que le zéro demeure
Dans les orères des chemins de fer
Jusqu’à la correspondance avec le nombre pi »…
La seconde partie est intitulée L’étoile du nord. Queneau a commencé à taper son texte directement à la machine (sur les 14 premiers feuillets) ; ce qui deviendra un monologue est alors une « Lettre de Paul Kougard à la belle dame ».
Les 14 feuillets dactylographiés sont corrigés à l’encre ; puis Queneau va poursuivre à la main à partir de la page 15.
La troisième partie se présente sous la forme de cinq actes ou tableaux (il manque dans ce manuscrit une partie du 4 e et le 5 e), dont on a une version primitive en manuscrit sous le titre « Dialogue de Jean et d’Hélène ». Mais Queneau avait d’abord songé à l’écrire sous forme romanesque. Le manuscrit offre ainsi la version primitive du « VI e livre » sous le titre :
« Les Touristes » : « Harmonieuse comme un cigare et luisante comme un scarabée, l’auto s’avançait à travers des régions pierrouteuses et cailleuses, plus desséchées que les feuilles de tabac d’un cigare et sans plus de chair qu’un insecte. Les petites collines se succédaient, petits moutons ; et les routes en serpentin se développaient sur les pentes de leurs contours. Et Madame Decrumel s’endormit, avec distinction. Le chauffeur faisait rouler sa voiture avec grâce »… Un autre fragment décrit une excursion à la Source Pétrifiante, un troisième l’arrivée en train dans la Ville Natale d’Édouard Dussouchel.
Au bas d’une des pages de ces feuillets écartés, on lit cette poignante confession : « Au fond je croyais que quand j’aurais une “situation” je serais heureux. Il n’en est rien. Impuissance et difficulté d’écrire » (Queneau avait été embauché aux éditions Gallimard en 1938).
Romans, I, (Œuvres complètes, II), Bibliothèque de la Pléiade, tome II, Gallimard, 2002 (pour Les Temps mêlés, éd. de Jean-Philippe Coen : p. 997 - 1092, 1409 - 1429, 1670 - 1699, 1744 - 1745).
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 70
164 QUENEAU Raymond (1903 - 1976).
MANUSCRIT autographe, Mon associé, Monsieur Davis (1962) ; 90 pages in-4 ; plus tapuscrits et documents joints. Dossier complet de ce scénario inédit d’un film destiné à Bourvil, mais non réalisé Avec le cinéaste Yves CIAMPI (1921 - 1982), Queneau a préparé cette adaptation du roman El Socio du Chilien Jenaro Prieto, et il en a écrit les dialogues. C’est BOURVIL qui avait été pressenti pour interpréter le rôle principal, mais, quand il se désista, les producteurs abandonnèrent le projet ; le film ne fut jamais tourné.
C’est l’histoire du vicomte Louis de Léon, excentrique et amateur de plaisanteries, qui dirige une petite affaire de publicité, l’A.P. F. (Agence de Publicité Familiale). Christian Pratter d’Armon, le nouveau mari de son ex-femme, hommes d’affaires prospère et ambitieux, lui aussi dans la publicité, lui propose de racheter l’A.P. F., qui bat de l’aile. Louis de Léon refuse, au prétexte qu’un richissime Sud-américain, M. Davis, va s’associer à lui. Il avoue à son ex-femme que c’est une blague. Mais entre-temps, il a rencontré une journaliste, Florence, qui pour parachever la plaisanterie écrit un article sur le mystérieux M. Davis. L’affaire prend de telles proportions que Louis de Léon va regagner des clients et imposer toutes ses idées, même les plus loufoques, comme les réclames sur timbre-poste ou la publicité inaudible. Le succès est tel que Pratter d’Armon se retrouve au bord de la faillite. Mais Louis de Léon est de plus en plus mal à l’aise avec ce double si loin de sa personnalité simple et joyeuse. La mystification tourne au cauchemar, et quand il avoue la vérité, on ne le croit pas. À la fin, voulant tuer M. Davis, Louis de Léon se suicide. Les dialogues de Queneau sont brillants, pleins de plaisanteries exigées par le caractère du personnage et destinées explicitement à Bourvil, comme lorsqu’il s’essaye à dire « soutien gorge mes pommes », ou à parler avec l’accent américain. Au fur et à mesure que l’action progresse, le ton devient grinçant, et Louis de Léon sombre dans la folie. L’écrivain rend cette descente aux enfers sans pathos ni grandiloquence, et le suicide final apparaît comme la meilleure plaisanterie de Luis de Léon, faisant passer Davis pour son assassin.
Le manuscrit de travail présente deux versions, l’une en et compte 38 pages autographes, 42 pages en partie dactylographiées avec des béquets et plusieurs pages autographes, plus 10 pages autographes. Il compte 107 séquences
S’y ajoute un dossier de plans et notes de travail autographes (11 p. in-4), avec découpage et minutage.
« Notes Davis » par Yves CIAMPI (10 p. in-4), remarques sur les personnages, modifications à apporter au scénario, etc.
Tapuscrits : le synopsis (22 p.), plus une version corrigée par Yves Ciampi avec béquets et additions (29 p.) ; la liste des séquences (4 p., manque la 1ère) ; scénario de travail (environ 130 p. en désordre avec quelques corrections de Queneau) ; découpage (133 p.).
Copies Compère dactylographiées ou ronéotées (dos toilés) : tapuscrit du synopsis (double carbone, 51 p.) ; ronéo du synopsis (39 p.) ; scénario (115 p., couvertes au verso de notes mathématiques autographes de Queneau) ; autre version du scénario ronéotée (152 p.) ; version anglaise du scénario (163 p. ronéotées, reliure spirale).
Dossier de correspondance et contrat, 19 lettres par Jean Rossignol (chargé des droits cinématographiques chez Gallimard) et le producteur Jacques Simonnet (Sorafilms), 1961 - 1962.
165 QUENEAU Raymond (1903 - 1976).
MANUSCRIT autographe, [ En passant , 1944] ; 48 pages petit in-4 dans un cahier Student Book.
Manuscrit complet de cette pièce en deux actes.
En passant, « un acte plus un acte pour précéder un drame », fut publié en avril 1944 dans le n° 8 de la revue L’Arbalète ; la pièce fut créée en avril 1947 au théâtre Agnès Capri, par la compagnie Masques nus, dans une mise en scène de Pierre Gout, devant un décor photographique de Brassaï, en « lever de rideau » du drame de Luigi Pirandello La vie que je t’ai donnée. La pièce de Queneau, se déroulant dans un couloir de métro, présente deux actes symétriques, dont les personnages et les péripéties se répondent deux à deux. Tonalité poétique dominante, humour verbal qui évoque le théâtre de l’absurde, cette pièce se rattache aux thèmes de l’incommunicabilité et des rêves impossibles.
Le manuscrit, à l’encre noire, comprend 48 pages provenant de deux cahiers, conservé sous une couverture de cahier gris-vert Student Book : le premier acte (25 pages) sur papier ligné (22,5 x 14,6 cm), et le « 2ème tableau » (23 pages) sur papier de cahier d’écolier à grands carreaux (22,5 x 17,6 cm). Il présente de nombreuses et importantes ratures, corrections, suppressions et additions, à l’encre ou au crayon, avec notamment une dizaine de pages biffées ; ainsi que de nombreuses variantes avec la version publiée, notamment le prénom de l’héroïne Irène qui deviendra Odile.
Un feuillet de titre à en-tête de la nrf présente le titre primitif biffé « Un invité », remplacé par Un passant, avec deux couples de personnages : « Joachim / Le Passant » et « Irène / La Mendiante ».
On joint l’invitation à la générale et le programme du Théâtre Agnès Capri ; plus une photocopie de la publication en revue.
600 - 800
71 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
1 000 - 1 200
166 RACINE Jean (1639 - 1699).
La Thebayde ou les Frères ennemis. Tragédie (Paris, Gabriel Quinet, 1664) ; in-12 (147 x 90 mm), [7]-70-[1] pp. Maroquin rouge janséniste, dos à nerfs titré, filet doré sur les coupes, large dentelle intérieure, tranches dorées, signet conservé (Trautz-Bauzonnet ).
Édition originale de la première pièce écrite et publiée par Jean Racine : La Thébaïde, relatant le mythe grec de la querelle fratricide des deux fils maudits d’Œdipe pour le trône de Thèbes. Représentée pour la première fois en 1664 au théâtre du Palais Royal par la troupe de Molière, elle fut écrite en peu de temps et sera remaniée. Ainsi cette édition originale contient-elle une centaine de vers qui furent supprimés dans les éditions suivantes. Très bel exemplaire. (État d’usage de la reliure).
Provenance : Bibliothèque Léon Rattier (1913, n°178, ex-libris) ; bibliothèque Mortimer L. Schiff (1938, n°503, ex-libris).
167 RÉGNIER Henri de (1864 - 1936).
Les Bonheurs perdus (Paris, Mercure de France, 1924) ; in-8, demi-maroquin à coins rouge, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés (Canape).
Édition originale. Un des 25 exemplaires hors commerce sur vergé pur fil Lafuma (n° I). Envoi autographe signé de l’auteur à Armand GODOY : « à M. Armand Godoy / cordial hommage / Henri de Régnier ».
168 RENÉ I er (1409 - 1480) « le bon roi René », duc d’Anjou, de Bar et de Lorraine, roi de Naples et de Sicile, poète.
L.S. « Rene », Aix-en-Provence 10 septembre 1472, à Cicco SIMONETTA ; contresignée « P. Puig » ; 1 page oblong in-4, adresse au verso avec sceau sous papier (quelques légères mouillures) ; en latin.
Rare lettre du bon Roi René
Comme roi d’Aragon, de Jérusalem et de Sicile, il écrit à « Ciccho de Simonetis » [Francisco dit Cicco SIMONETTA (1410 - 1480), diplomate, secrétaire et chancelier du duc de Milan Galeazzo Sforza ; il avait été le conseiller du Roi René à Naples, lors de la lutte entre Aragon et Anjou pour le trône de Naples], pour lui annoncer qu’il a envoyé Hector Scaglioni (SCALIGER) vers le Duc son cousin et ses chers fils : « Uti ab eodem Hectore latique intelligetis est quoque vobis quedam nri pre explicativens. Rogamus vos magnopre ut et sibi in iis que vobis nostro nome referet fidem firma habere, et rem ita ut spes nostra est et necessitas expostulat commendatam nostro amore suscipere…
169 RENOIR Auguste (1841 - 1919).
L.A.S. « Renoir », Essoyes 20 août 1901, à une dame ; 1 page in-8 (2 déchirures réparées au scotch). Il demande à sa correspondante de le « recevoir seul vers le 27 août pour deux jours. Si à cette époque vous ne pouviez pas je pourrais remettre vers le 15 septembre. Et voilà pourquoi. Il faut que j’aille Fontainebleau pour des portraits le 1er septembre. Je quitterais Essoyes un peu plus tôt pour aller vous voir, ou à mon retour de Fontainebleau vers le 15 ou 20 septembre. Tout va bien à la maison mère, mère et enfant, moi bien portant à part les rhumatismes qui ne bougent pas »…
170 RENOIR Auguste (1841 - 1919).
L.A.S. « Renoir », Cagnes 6 mars 1904 à Jeanne BAUDOT ; 2 pages et quart in-8. Belle lettre à son ancienne élève [Jeanne BAUDOT (1877 - 1957) a été l’élève de Renoir, qui a fait plusieurs portraits d’elle. Elle a été la marraine de Jean Renoir, deuxième fils du peintre, le futur cinéaste. Il a eu beaucoup d’occupations ennuyeuses et a dû aller à Paris « pour en finir. Je vais pouvoir je pense avoir le loisir de mettre quelques couleurs sur des toiles ce que je n’ai pu faire depuis longtemps. J’ai su par votre mère tous vos enthousiasmes et je les ai partagés de loin. C’est délicieux quand jeune comme vous l’on peut voir des choses nouvelles et surtout quand comme vous l’on peut les comprendre (je ne dis pas les faire) ne soyons pas trop gourmands. J’étais content de vous voir dans cette Algérie si claire dans ce pays où l’on est si loin et si près, où l’arabe à l’air d’un vieux copain que l’on a toujours connu. Ce roublard gentil, auquel il ne faudrait pas trop se fier cependant, mais tout cela est amusant au possible et rien autre ne peut vous donner les joies de l’Algérie. Pour moi du moins et je vois avec plaisir pour vous aussi. Je suis de retour à Cagnes avec toujours le temps changeant. Quel hiver grands Dieux »…
171 RENOIR Auguste (1841 - 1919).
L.A.S. « Renoir », 21 novembre 1904, à Mlle Paule GOBILLARD ; 1 page in-12, enveloppe. « Voulez-vous dire à votre sœur que quand elle pourra venir elle me prévienne la veille. Demain si elle vient, ou après. […] Je vous envoie ce mot par un modèle gentil ».
800 - 1 000
700 - 800
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 72
1 000 - 1 500
100 - 150
1 000 - 1 500
1 000 - 1 200
172 RENOIR Auguste (1841 - 1919).
L.A.S. « Renoir », Cagnes 8 novembre 1912, [à Mme Maurice GANGNAT] ; 3 pages in-8, en-tête Les Collettes Cagnes (A.-M.)
Il demande des nouvelles de Philippe en espérant « que ce rhume de cerveau ne s’étendra pas davantage malgré cette sale saison que vous avez. Nous nous sommes en pleine douceur de température dont je profite pour sortir souvent ». Mais il a besoin du conseil de Gangnat pour ses affaires : « ce n’est pas la peine d’avoir des amis si ce n’est pour les mettre de temps en temps à contribution. Mon ami Rivière me fait constamment entrevoir monts et merveilles du Crédit Foncier Argentin. Je fais peut-être une bêtise, mais je sais que je lui suis agréable en prenant de ses valeurs. Je lui ai donc écrit à cet égard puisque le hazard fait que je ne puis avoir de rente Suisse c’est peut-être un avis du ciel »..
173 RÉVOLUTION.
Constitution de la République Française (Paris, Imprimerie du Dépôt des lois, [1795]) ; in-4 de 43 pages, suivies de ff. blancs ; reliure de l’époque en maroquin rouge, cadre de filets dorés avec le faisceau de licteur surmonté du bonnet phrygien et la devise Union Force et Liberté sur les plats, et le titre en lettres dorées sur le plat sup., dos orné de faisceaux et de bonnets phrygiens.
Très bel exemplaire dans une reliure en maroquin de l’époque aux armes de la République
La Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) fonde le Directoire. Elle s’ouvre sur la Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen
On joint une médaille en bronze doré (diamètre 6 cm) délivrée à un représentant du Peuple au Conseil des CinqCents, avec le titre Constitution de l’an trois frappé à l’avers.
174 REYNOLDS Joshua (1723 - 1792) peintre anglais.
L.A.S. « Joshua Reynolds », Londres 18 octobre 1783, à John WAMHOPE , « Writer to the Signet » à Edinburgh ; 1 page in-4, adresse avec sceau de cire rouge ; en anglais.
Rare lettre au sujet de portraits impayés
Sir William Forbes l’a invité à adresser au notaire un mémoire des dettes de feu Lord Errol [James Hay (1726 - 1778)
15th Earl of ERROLL], pour des tableaux peints pour lui : portrait en pied de Lord Errol (105£), Lady Errol (25£ 5), réplique de la feue Lady Errol (idem), modification de la draperie d’un tableau (5£ 5), plus une caisse de transport (10 schillings), en tout 163£ 5…22
175 RIMBAUD Arthur (1854 - 1891).
Une saison en enfer (Bruxelles, Alliance typographique, 1873) ; in-8, broché. Édition originale du seul ouvrage dont Rimbaud ait entrepris la publication, à compte d’auteur. Une saison en enfer fut tirée à 500 exemplaires environ, il n’y a pas eu de grand papier. Sur ces quelque 500 exemplaires, 425 restèrent chez l’éditeur Poot, et ne furent pas diffusés, Rimbaud n’ayant pu les récupérer, faute d’argent. Il ne put disposer que d’une dizaine d’exemplaires. Le reste du tirage demeura dans la cave de l’Alliance typographique jusqu’à sa redécouverte en 1901 par Léon Losseau. À partir de 1911, le bibliophile belge dispersa peu à peu l’ouvrage sur le marché. Bel exemplaire, conservé broché et non coupé, tel que paru. Quelques rousseurs.
176 ROLAND Manon Phlipon, Madame (1754-guillotinée 1793) l’égérie des Girondins.
L.A., [Amiens] « Mercredy 21 janvier 1782 » [pour mardi 22 ?, à son mari] ; 4 pages in-4. Belle lettre à son mari
Il y a eu un peu de beau temps pour la fête : « j’ai respiré l’air dans mon jardin avec plaisir et l’air me paroissoit suave et gracieux » ; mais il pleut : « il règne je ne sais quoi de sombre et d’épais qui m’abat : j’ai de la lassitude et presque du dégoût ». Elle se plaint du manque de bois et de la mauvaise qualité de celui qu’on lui a livré. Elle vient d’engager une fille : « elle me plaît par un air très propre et assez doux. [...] Si j’étais vieille comme Sara et que tu fus un patriarche, cela ne serait pas mal choisi ; elle a vingt-cinq ans, de la fraîcheur et d’assez jolis yeux. Si elle est d’ailleurs telle qu’on l’annonce on nous la débauchera quelque jour pour en faire une femme de chambre ». Elle donne des nouvelles de leur fille, qu’elle allaite et qui va mieux... Elle essaie de lire en anglais : « j’y suis autrement perdue que dans l’italien » ; il lui faut le dictionnaire… Le jardin est dans un triste état et nécessite des travaux : « N’est-ce pas une puissante raison de hâter ton retour ? Tu auras aussi de l’exercice à prendre, si tu veux, autour de mon bois […] tu pourras t’amuser dans ton bûcher où j’irai te trouver avec ma petite quand il y aura du soleil ». Elle conclut en l’embrassant « tenerissimamente », ayant sa fille au sein gauche, et veut le rassurer sur sa bonne santé, malgré sa lassitude.
2 000 - 2 500
800 - 1 000
73 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
1 200 - 1 500
800 - 1 000
5 000 - 6 000
177 ROMME Gilbert (1750 - 1795) mathématicien, conventionnel (Puy-de-Dôme), créateur du calendrier républicain ; arrêté aux journées de Prairial et condamné à mort, il se suicida. MANUSCRIT autographe, La commune de Riom département de Pui-de-Dome à l’Assemblée Nationale, [1790] ; 2 pages et demie in-4 avec ratures et corrections. Important discours célébrant l’œuvre régénératrice de la Révolution et la Déclaration des Droits de l’Homme « Messieurs, la commune de Riom qui ne compte son existence politique que depuis qu’elle s’est donnée constitutionnellement une Municipalité patriote, vient vous faire hommage des Prémices de sa Liberté, en adhérant solemnellement à tous vos décrets par ses députés extraordinaires. Elle a tout perdu par les suppressions que votre sagesse a prononcées et que commandoient les malheurs et le salut de la France ; mais cet état de mort ne l’effraye point puisqu’il est une transition inévitable et momentanée d’un régime justement proscrit, à une renaissance que nous recevons tous des Pères de la Patrie, régénérateurs de la Justice et de la liberté. Trop longtems captifs sous l’opinion de quelques personnes, notre raison était obscurcie, nos vœux étouffés, notre patriotisme dissimulé ou égaré, nos espérances et notre confiance trompées ; les bons citoyens gémissoient de ne pouvoir porter jusqu’au Sénat auguste, leurs sentimens particuliers, et de ne pouvoir mêler leur allégresse à celle de toute la France, aussitôt qu’ils l’ont sentie. À ces malheurs immérités la calomnie les preventions et l’intrigue ont ajouté de nouvelles amertumes. Mais votre exemple nous soutient et votre Justice nous console. Vos Décrets ont rétabli le Peuple dans ses droits, il a mis à sa tête des Municipaux citoyens, et tous les liens qui l’attachoient à l’erreur ont été brisés. C’est pour le Peuple et par le Peuple que doit se faire la régénération du corps politique; c’est par lui que la vérité, la justice et la Liberté triomphent ». Puis, après un long passage proclamant l’adhésion de tous les citoyens de Riom aux principes de la Révolution et à la Constitution : « Pour vous, Messieurs, pleins de confiance dans vos travaux, heureux des espérances que vous offrez à la France et fiers des leçons que ses vertueux représentans donnent à l’univers, nous recueillons avec empressement tous vos décrets. Vos Tribunaux et notre corps municipal en ont toujours fidèlement suivi toutes les dispositions; et les loix anciennes ont cédé sans trouble leur empire aux loix nouvelles, qui emanent de votre sagesse. Les bons citoyens se rassemblent pour se pénétrer des lumières qui nous viennent de la capitale, et les répandre autour d’eux. Un établissement patriotique vient de se former et la destination première sera de faciliter l’intelligence de notre nouveau code et d’offrir à tout le monde un cabinet de lecture gratuite et choisie. La déclaration des droits va devenir le premier chapitre du catéchisme politique de la jeunesse. Notre contribution patriotique se monte à plus de 100 000 ll quoique le tableau des citoyens actifs n’aille guère au-delà de 1200 et nous devons dire que la Municipalité de Riom est la première de la province qui ait reçu les déclarations. Les établissemens de charité viennent de recevoir un accroissement considérable, par la générosité d’un vertueux cénobite qui siège parmi vous dont les opinions honnorent la ville de Riom sa patrie et qui prouve par sa conduite, que les vertus du chretien ne diffèrent pas de celles du vrai citoyen. Voila, Messieurs un tableau de nos efforts pour reconquerir notre liberté, et nous rendre dignes de vos regards. »
178 ROUAULT Georges (1871 - 1958).
2 L.A.S. « Georges Rouault », [juin 1907], à Ambroise VOLLARD ; 4 pages in-8, et 1 page in-12 à l’encre rouge avec adresse au verso (carte-lettre).
Sur ses céramiques
Rouault indique tout d’abord au marchand les prix qu’il souhaite pour ses céramiques : « Service à thé 200 f, grand vase 200 f », ainsi que les « plaques moyennes », dont une de Clowns : « il y a encore deux assiettes (sanguine), j’arrive à 1500 f vous les laissant à un prix médiocre pour que vous ayez l’ensemble de mes recherches; je ne vous demande pas cette somme immédiatement, et croyez bien que je ne suis pas disposé à refaire un effort semblable de sitôt, du moins pas dans les mêmes conditions de prix, je préfère de beaucoup faire des aquarelles ou de la peinture, c’est un travail qui n’a plus de prix que j’ai entrepris là (il y a encore un des gros vases que je tiens à refaire passer à un feu... Maurice Denis est venu l’autre jour et il désirait beaucoup mon plat, il a aussi beaucoup aimé l’assiette (sanguine). Comme j’ai fait mes prix à l’avance avec vous (pour les gros vases) et les moyens et le petit, je maintiens les prix que vous m’avez accordés, mais croyez bien que sans trop me gober je sais ce que j’ai fait et que si vous ne les prenez pas j’en ai le placement assuré dans de très bonnes conditions sans oublier que j’aurais été très heureux d’en conserver pour moi. […] Il faudra aussi que les plaques soient présentées encadrées d’un léger filet de cuivre doré. La dépense sera minime mais l’effet sera meilleur »…
[9 juin 1907]. Rouault précise les prix de ses céramiques (réalisées avec André METTHEY) : « les plaques figures 200 f pour moi mais 60 f pour Metthey au lieu de 50 que j’avais marqué [...] Si vous revoyez Methey je crois qu’il serait bon qu’il se mît en rapport avec la section d’art décoratif par lettre au besoin s’il ne peut plus se déplacer de façon à ce qu’il puisse soumettre le plan de ce qu’il désire ».
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 74
2 000 - 2 500
1 000 - 1 200
179 ROUAULT Georges (1871 - 1958).
MANUSCRIT autographe, Berceuses du Faubourg de Longues-Peines ; 42 pages in-4 paginées 1-30 et 47-58 (sur papier pelure, avec effrangeures et déchirures à certains feuillets).
Important ensemble de 35 poèmes, abondamment raturés et corrigés, numérotés I à xx VII et xxxx I à xxxx VIII
L’ensemble porte en tête les dates « 1898 - 1935 », et le sous-titre (ou titre primitif ?) biffé Stella Vespertina. Rouault a considérablement travaillé et corrigé son manuscrit, supprimant des vers entiers, en ajoutant d’autres dans les marges ; quelques-uns sont écrits au pinceau et à l’encre de Chine, dont Rouault se sert également pour faire des suppressions, qui confèrent à ce manuscrit, malheureusement fragile, un graphisme parfois spectaculaire.
Nous citons le début du premier poème :
« Sous le ciel lourd et bas des fortifications léthargiques
Noires cheminées d’usines
Ombre fugitive d’un bastion sur la dune Pelée sombre et aride
Là j’ai erré solitaire
Près de la ville tentaculaire où je naquis Berceuses mélancoliques »…
On joint la transcription de ce manuscrit par l’abbé Maurice Morel, sur laquelle Rouault a fait des suppressions, avec un PO è ME autographe signé (GR) de Rouault en remplacement du premier poème (1 page in-4).
Provenance : ancienne collection de l’abbé Maurice MOREL (vente Ferri, 14 décembre 2005, n° 127).
180 ROUAULT Georges (1871 - 1958).
MANUSCRIT autographe, Art ; 4 pages in-fol., avec ratures et corrections.
« La grandeur du royaume n’en fait pas la beauté ! mais l’amour avec lequel on l’a créé ! Nous sommes des roisfous plus sages que rois et empereurs véritables ! »… Rouault se déchaîne contre Arnold BÖCK l IN : « Modèles pris dans les piscines allemandes ! Des tritons à têtes de douaniers évoluent avec des grosses filles. C’est lourd ! faux ! peint sur du linoléum avec des tons de toile cirée ignifusée ! […] Le moindre soupir de CÉZANNE fait crouler ce Kolossal château de cartes ! »… Il célèbre Chardin, Cézanne ou Corot, vrais créateurs qui ne succombent pas aux « sottes et prétentieuses théories »…
Provenance : ancienne collection de l’abbé Maurice MOREL (vente Ferri, 14 décembre 2005, n° 113).
181 ROUSSEAU Henri, dit le DOUANIER ROUSSEAU (1844 - 1910).
CARNET autographe, signé en tête « Rousseau » ; 10 pages dans un carnet in-12, couverture papier ciré noir (chemise dos vélin et étui).
Rare et précieux carnet de compte de ses tableaux vendus en 1909 et 1910 Sur la première page, Rousseau a noté son nom et son adresse « Paris rue Perrel 2 bis » (tache). Puis il a indiqué les nom et adresse de ses acheteurs, avec le sujet et le prix d’une quarantaine de tableaux. En 1909, VOLLARD (6 rue Laffitte) achète 11 tableaux entre 4à et 230 francs : Composition, Surprise, et des Paysages ; Hudes (en fait Wilhelm UHDE, 21 Quai des Tournelles) achète 6 paysages ; Blamme (6 rue Boissonnade) 2 paysages. En 1910, VOLLARD achète 13 tableaux, dont une Création à 400 francs et des paysages ; d’OETTINGEN (21 Boulevard Berthier) 5 tableaux, dont des Singes (300 fr.) et des Fleurs (400 fr.) ; Soffici (à Naples) 7 tableaux, dont une Vue de Paris ; Uhde 5 tableaux, dont des Fleurs ; HOETZER, sculpteur, 4 tableaux : des Fleurs (40 fr.), et Création (300 fr.), et deux autres Création le 20 août (200 fr.) et le 30 septembre (300 fr.).
Provenance : ancienne collection Tristan TZARA
182 SADE Donatien Alphonse François, marquis de (1740 - 1814).
Justine ou les Malheurs de la Vertu (En Hollande, Chez les Libraires Associés, [Paris, Girouard ?] 1791. 2 tomes réunis en un volume in-12. Reliure moderne dans le style de l’époque, demi-veau glacé moucheté, dos lisse, compartiments ornés, pièce de titre de maroquin rouge, titre doré, frise dorée sur les coupes, tranches rouges, doublures et gardes de papier tourniquet.
Rare seconde édition du premier livre de Sade
Cette édition, imprimée en 1791, soit la même année que l’originale éditée au format in-8 chez Girouard à Paris. Le texte ne diffère avec celui de l’originale que sur le point de l’Avis de l’éditeur. L’ouvrage connut un succès immédiat et sera réimprimé six fois en dix ans. Dans le Mémorial de Sainte-Hélène, Las Cases rapport que Napoléon considérait Justine comme « le livre le plus abominable qu’ait enfanté l’imagination la plus dépravée ». Toutes les éditions premières éditions de cet ouvrage sont recherchées.
Tome I : 2 ff. n. ch., 339 pp. ; 1 frontispice signé (biffé) gravé par G. Texier d’après Philippe Chéry ; tome II : 1 f. n. ch., 228 pp. Exemplaire bien complet des deux feuillets de l’Avis de l’éditeur et l’Explication de l’Estampe, qui manquent à plusieurs exemplaires de l’originale. Sans les figures.
(Frontispice coupé ras, restauration au 2e feuillet avec quelques lettres suppléées à la main.
6 000 - 8 000
75 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
1 000 - 1 500
1 000 - 1 500
5 000 - 6 000
183
SADE Donatien Alphonse François, marquis de (1740 - 1814).
Les 120 Journées de Sodome ou L’École du Libertinage. Par le Marquis de Sade. Publié pour la première fois d’après le manuscrit original, avec des annotations scientifiques par le Dr Eugène Dühren. (Paris, Club des Bibliophiles, 1904) ; fort in-8 (26,5 x 17,7 cm). Reliure hongroise de l’époque veau vert amande, dos à nerfs orné, plats richement décorés d’une plaque de rinceaux dorés à larges écoinçons, doublure de veau saumon abondamment ornée de fers floraux, large roulette florale, gardes de soie grège (dos un peu passé).
Édition originale. Tirage limité à 200 exemplaires numérotés, celui-ci 1/5 sur Japon (n° 4). Cette édition fut publiée à Berlin en 1904 par Max Harrwitz. Eugène Dürhen est le pseudonyme d’un psychiatre berlinois, Iwan Bloch. Texte dans un encadrement vert bronze orné aux coins, fac-similé hors texte d’une page manuscrite de Sade à la fin du volume.
On a relié en tête de volume le prospectus.
Rare exemplaire sur japon de l’ouvrage capital de Sade
184 SAINT-EXUPÉRY Antoine de (1900 - 1944).
MANUSCRIT autographe pour Terre des hommes, [1931] ; 1 page et quart in-4 sur papier jaune. Brouillon très raturé et corrigé pour un chapitre de Terre des hommes
Ce brouillon est une version primitive, très travaillée, avec des reprises, de la conclusion de la première partie du chapitre VIII, Les Hommes
« Tout au long de ce livre j’ai parlé de ceux-là qui avaient obéi semble-t-il à une vocation souveraine, et avaient choisi le désert ou la ligne, comme d’autres eussent choisi le monastère, mais j’ai trahi mon but si j’ai paru vous engager à admirer d’abord des hommes »… Etc.
185
SAINT-EXUPÉRY Antoine de (1900 - 1944).
DESSIN original avec légende autographe, Roger Beaucaire. Mine de plomb sur papier, 17 x 15 cm.
Le personnage est identifié par un titre sous le dessin. Représenté en pied entre deux fleurettes stylisées, Roger Beaucaire a ses traits grossis, son nez et ses lèvres proéminents.
À côté d’une série de portraits de ses amis dans une veine très réaliste (dans un carnet intitulé Les Copains, cf. Dessins, Gallimard, 2006, p. 58-75), Saint-Exupéry excellait aussi dans la caricature ( idem, p. 132 - 146 et p. 166 - 167). Ce dessin de Roger Beaucaire est inédit. Plusieurs de ses traits sont à rapprocher d’autres croquis : les fleurs de part et d’autre du personnage sont identiques à celles qui flanquent un autre personnage, également croqué au crayon noir (idem, n° 211). Le pantalon bouffant, resserré aux chevilles, est aussi reconnaissable ailleurs (notamment n° 226).
Passionné par les problèmes de physique, Saint-Exupéry a échangé avec son ami Roger BEAUCAIRE une correspondance argumentative, notamment sur un problème de tonneau « immergé dans un fluide » (voir Pléiade, II, 1025 - 1027).
186 SAINT-SIMON Louis Rouvroy, duc de (1675 - 1755).
L.A.S. « Le Duc de S t Simon », Paris 10 janvier 1728, au Garde des Sceaux (Germain-Louis CHAUVELIN) ; 1 page in-4 (portrait gravé joint).
La lettre accompagne un mémoire de trois pages : « vous verrés s’il vous plaist par la 4 e que j’ay ajoutée si j’ay bien eclairci ce que vous avés jugé qui meritoit de l’estre ». Il a joint la copie de sa lettre au cardinal de FLEURY et Chauvelin jugera « si j’ay bien executé ce que vous m’avés fait la grace de me conseiller […] J’envoye l’un et l’autre à M. de MAUREPAS pour les rendre à M. le C[ardina]l a propos d’avoir le tems de les luy faire lire. Je n’ay osé luy mander que je vous en eusse parlé et neantmoins je voudrois bien que vous pussiés scavoir quand il aura veu M. le C la dessus pour vous mettre en estat de faire en sorte que le C vous en parlast et vous donner ainsy occasion a ce que j’attendray toujours en toutte confiance de l’honneur de vostre amitié »…
Ancienne collection Alfred BOVET (1887, n° 711).
Les Siècles et les jours, n° 237.
1 200 - 1500
1 500 - 2 000
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 76
1 500 - 2 000
1 500 - 2000
187 SAINTE-BEUVE Charles-Augustin (1804 - 1869).
22 L.S. avec corrections et additions autographes (minutes, 2 non signées), 1866 - 1868 ; 44 pages in-8 ou in-12. Lettres dictées à son secrétaire Jules TROUBAT, puis abondamment corrigées par Sainte-Beuve, à Ernest BERSOT (réponse à un article sur la Galerie des Académiciens de Vattier), P. Bernay (sur une caricature de Sainte-Beuve), Pierre LAROUSSE (« auteur du Grand Dictionnaire, à propos de l’article Causeries du Lundi communiqué en épreuves »), Camille GUINHUT (rédacteur de L’ Étendard, à propos de la question romaine), COLINCAMP (sur son article consacré aux Lundis), Benoît JOUVIN (belle lettre sur la pérennité de la littérature), Louis COMBES (« petite querelle » sur Louis XVI), Jules CLARETIE (au sujet de Victor Jacquemont), Dussieux (sur le scandale d’une édition tronquée des Mémoires du grand Frédéric), Paul MEYER (hommage de Port-Royal, « le moins imparfait de mes écrits »), de GONET (« juge d’instruction, pour recommander le jeune Alfred Verlière, auteur de Déisme & Péril social, détenu sous l’inculpation de société secrète »), Henri BRISSON (réponse à un article sur les délits de presse), BARUTEL (à propos des prix de l’Académie), C. RITTER (sur une intervention au Sénat), Louis ULBACH (réponse à La Cocarde blanche), Émile EGGER (remerciant pour le « précieux cadeau » de son savant confrère), Ernest RENAN (sur David Strauss), Félix AUVILLAIN (critique de ses vers, par « un ancien élégiaque »), etc.
188 SAND George (1804 - 1876).
MANUSCRIT autographe signé « G. Sand », Rêveries et souvenirs, fragments de journal ; 44 pages in-8. Manuscrit de travail, avec ratures et corrections, d’un article politique sur 1848 et l’Empire, Napoléon III et Eugénie
Cet article a été publié dans le journal Le Temps du 5 septembre 1871, sans le sous-titre « fragments de journal » ; il a été recueilli en 1873 dans Impressions et souvenirs (Michel Lévy, 1873, p. 17-36).
Présenté comme un fragment de journal en date de mars 1860, le texte commence par une évocation de son état d’âme (rédigée au masculin, comme à son habitude) : « Ces bons vieux amis me demandent en quel état est mon âme. S’ils y pouvaient lire à toute heure, ils trouveraient peut-être qu’elle est en état de grâce, comme disent les catholiques ; moi je dis qu’elle n’a plus guère d’état particulier, elle est entrée depuis longtems dans le chemin où les accidents et les périls ne font pas retourner en arrière. – On me trouve trop indulgent pour les choses et pour les gens de ce tems ci. Je ne suis pas si indulgent que l’on croit. J’ai acquis de la patience en proportion de ce qu’il en faut, voilà tout. Ayant traversé beaucoup de choses jugées, je n’ai pas le goût de supplicier ce que je condamne, j’aime mieux l’oublier »….
Elle évoque sévèrement la naissance du second Empire : « L’avenir est noir. Ce coup d’état qui, dans les mains d’un homme vraiment logique, eût pu nous imprimer un mouvement de soumission ou de révolte dans le sens du progrès, ne nous a conduits qu’à un affaissement tumultueux à la surface, pourri en dessous »…. Le peuple est « dans un courant funeste, 48 a été pour lui une ivresse et une déception. […] La bourgeoisie avait fait fortune, elle n’aimait plus les révolutions ; son rôle de 1830 était terminé, elle n’avait plus de principes de gouvernement, elle n’avait plus de philosophie à elle, plus d’esprit de caste, elle ne se tenait plus ; à force de vouloir tenir à tout elle ne tenait plus à rien Elle n’était plus voltairienne, elle ne comprenait plus 89 dont elle parlait sans cesse. Enrichie par cette première révolution, elle était devenue aristocrate […] Cette vanité maladive est devenue maladie mortelle sous l’empire. La bourgeoisie, qui devrait être flattée d’avoir sur le trône un parvenu, – l’empereur lui-même s’intitule ainsi malicieusement, – ne veut plus être parvenue. Elle se cherche des aïeux, elle se donne des titres, ou tout au moins des particules. […] Quoique parvenu, l’empereur fait publier es généalogies qui font remonter jusqu’au Cid d’Andalousie la noblesse de la jeune comtesse de Teba. Il n’a pas suffi à Mlle Montijo d’être belle et charmante, il faut qu’elle ait des ancêtres pour ce monarque qui se vante de n’en point avoir et qui se déjuge comme la bourgeoisie ».Puis elle brosse un portrait de la « jeune impératrice », avant de constater : « Il n’y a donc plus de bourgeoisie. Cette morte a été rejoindre sa sœur aînée, la noblesse, sur le registre des mortalités historiques. Il n’y a plus que deux classes, celle qui consomme et celle qui produit ; classe riche ou aisée, classe pauvre ou misérable »…. Et elle tente de comprendre où en est le peuple, et se montre pessimiste : « L’empire, en se fondant sur un plébiscite, a inauguré le règne de l’ignorance, sauf à la gouverner par la force quand elle le gênerait. Le peuple s’est cru roi, mais si son illusion dure encore, elle cessera bientôt, et gare au désenchantement ! Il sera terrible. La majorité est en ce moment pour l’empire, elle opprime, elle persécute, elle insulte ceux qui protestent, et, ce qu’il y a de triste, c’est que ceux qui protestent procèdent mal, avec rage ou folie, Le paysan est satisfait, il perd de plus en plus l’esprit de solidarité avec l’ouvrier des villes. L’ouvrier, en revanche, s’isole du laboureur, le méprise et ne cherche plus à l’initier à des notions plus étendues. Le fils de l’ouvrier aspire à devenir un bourgeois »… Etc. Elle croit cependant au « triomphe de la civilisation sur la barbarie »…
1 800 - 2 000
77 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
1 000 - 1 200
189
SARTRE Jean-Paul (1905 - 1980).
MANUSCRIT autographe, [1946] ; 1 page et demie in-4 (quelques légères mouillures). Réflexions sur le Juif, pour ses Réflexions sur la question juive (1946).
« Que choisira-t-il ? Rien ne permet de le prédire puisqu’il est libre. Toutefois la situation le réduit à cette alternative : il faut choisir de nier sa situation ou de la revendiquer. Et c’est bien en effet l’un ou l’autre de ces partis qu’il prendra : mais il y a mille et mille manières de refuser, mille et mille manières d’assumer. Aussi y a-t-il des milliers de “caractères” juifs – à vrai dire on peut en concevoir une infinité. Car un Juif n’est rien d’autre que ce “projet” pour dépasser une situation intolérable. Ni race, ni religion : mais un homme libre et qui cerné par la haine ou l’injuste mépris se jette, au-delà ce mépris et cette haine, vers ses buts propres. Et s’il choisit de fuir, qui donc oserait le blâmer ? Cette fuite n’est pas une lâcheté, ni une désertion : c’est un essai pour vivre sa vie comme si le problème juif n’existait pas, un effort de toute la personne, qui se manifeste dans le travail comme dans les jeux, dans la solitude et dans la vie sociale, pour supprimer symboliquement en l’homme et hors de l’homme la réalité du problème juif. Cette fuite est un martyre, au sens propre du mot, car le Juif qui fuit tente de prouver avec sa chair que la race juive n’existe pas. Ainsi est-il hanté sans répit par ce fantôme qu’il veut anéantir et, bien entendu, c’est cette tentative d’évasion qui le constitue comme Juif, car c’est le Juif seul qui peut vouloir s’évader de la situation juive »… Etc.
190 SARTRE Jean-Paul (1905 - 1980).
MANUSCRIT autographe sur le Communisme, [vers 1950] ; 4 pages in-4 sur papier quadrillé. Intéressantes réflexions sur le Communisme, l’URSS et la France, la masse et les élites, la diplomatie et la paix « Ici il faut passer en revue les objections […] je sais pourquoi on nous déteste : nous ne pouvons prendre que des compagnons de route. […] Mais si vous ouvrez les yeux : qui n’a aujourd’hui ne tâche infinie. Qui donc veut se borner à restaurer la démocratie. […] C’est que nous ne sommes pas communistes. Cela veut dire 1) recul par rapport à l’URSS. 2) Nous avons à nous forger nos méthodes […] 3) Nous ne représentons pas les masses mais le petit bourgeois, l’élite du prolétariat etc. Cela suppose un héritage bourgeois. Sauver des valeurs. Il ne s’agit pas d’un accord opportuniste mais pour une situation qui peut durer longtemps d’une entente qui ne doit pas se rompre. Et après ? Eh bien nous changerons et la situation changera. Si nous prenions le pouvoir ? Mais c’est que la situation aurait changé. Si les Comm. le prennent seuls ? […] C’est que nous aurons été battus, nous nous serons laissés faire. La politique à suivre est claire. Résurrection de l’activité politique en France. Retour à la souveraineté. […] Paix en Indochine. Politique de production de richesses. La paix. Il faut trouver une majorité pour la faire. Qui la fait aujourd’hui ? Le Parti Communiste. […] On dit c’est pour l’URSS. Mais c’est d’abord pour la France. Alors ?
[…] Ne pas s’opposer aux Comm. en ayant le même programme »… Etc.
191 SAUGUET Henri (1901 - 1989).
MANUSCRIT MUSICAL autographe signé « Henri Sauguet », La Rencontre (1948) ; 87 pages in-fol., en un volume broché.
Partition d’orchestre du ballet La Rencontre Sauguet a composé dans l’été 1948 la musique de son ballet La Rencontre ou Œdipe et le Sphinx, en un acte, sur un livret de Boris KOCHNO, qui venait de prendre, après la démission de Roland Petit, la direction des Ballets des Champs-Élysées. Transposant l’épisode de la rencontre d’Œdipe avec le Sphinx dans l’ambiance d’un cirque de plein air : sur la piste, tel des acrobates, les deux protagonistes s’affrontaient ; à la fin, tandis que le Sphinx, vaincu, se balançait tristement sur son trapèze, Œdipe s’éloignait vers son destin. La création eut lieu au Théâtre des Champs-Élysées, le 8 novembre 1948, dans un merveilleux décor et des costumes de Christian BÉRARD (dont ce fut la dernière création), et une chorégraphie de David LICHINE, avec Jean BABILÉE et la jeune Leslie CARON, sous la direction musicale d’André Girard. La partition, d’une durée de 22 minutes, fut publiée chez Heugel, et dédiée « à Boris Kochno et Christian Bérard ». Henri Sauguet l’a enregistrée avec l’Orchestre d’État de l’URSS. « Le Sphinx, c’était la toute jeune Leslie Caron – dont ce fut la révélation – collant blanc, silhouette serpentine ; Œdipe – le bondissant Babilée, visage grave, corps de fauve. La chorégraphie évoquait le jeu des questions et des réponses par un enchaînement de poses essentiellement plastiques. […] La musique évoque, par certains aspects répétitifs, la marche d’Œdipe vers son destin à la manière d’une “force en mouvement”, comme une machine quasi-infernale ; l’alternance des questions et des réponses oppose aux courbes sinueuses, interrogatives du violon la masse triomphante de l’orchestre. À la fin, celui-ci se met à vibrer, pour évoquer les tressaillements du Sphinx, tandis que la flûte marque la marche d’Œdipe, délivré. L’ensemble constitue peut-être le chef-d’œuvre de la musique de ballet de Sauguet » (André Hofmann).
« La partition de M. Henri Sauguet est une de ses meilleures partitions. Expressive et bien rythmée, colorée d’une orchestration qui met les thèmes en valeur, elle transmet dans le domaine des sons le décor de Christian Bérard et la chorégraphie de Lichine, et s’accorde à souhait avec eux pour former un spectacle harmonieux » (René Dumesnil).
Roland-Manuel jugeait la partition comme l’une des « meilleures, des mieux conçues, des mieux écrites, des plus clairement agencées et des plus poétiquement allusives que nous devions à ce musicien qui a le goût et le sens du ballet. Sauguet excelle à dégager le signe musical représentatif de l’image et de l’idée chorégraphiques ».
Le manuscrit est à l’encre noire sur papier à 32 lignes ; il est signé et daté en fin « Coutras, 12 oct. 1948 » ; il a servi de conducteur et porte de nombreuses annotations au crayon rouge ou bleu. L’orchestre comprend : flûte (et piccolo), hautbois (et cor anglais), clarinette, basson, cor, trompette, tuba, timbales, percussion, harpe, piano, et les cordes.
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 78
1 500
- 2 000
1 000 - 1 500
000 - 1 200
1
192 SCHLEGEL August Wilhem von (1767 - 1845).
POÈME autographe signé « A.G. Schlegel », Bonn 1821, à Philipp Franz von WALTHER ; 1 page in-4, adresse au verso avec cachet de cire rouge aux armes (manque de papier sans affecter le texte).
Poème de 10 vers latins en l’honneur de son collègue à l’Université de Bonn, le chirurgien et ophtalmologiste
Philipp Franz von WALTHER (1782 - 1849).
« Viro Paeonis et Apollinari
Ph. Fr. a Walther s.p.d. A. G. Schlegel. Te vates medicum poscit collyria lippus. Phoebus amat vates, at genuit medicos »…
193 SCHOPENHAUER Adèle (1797 - 1849) femme de lettres allemande, sœur du philosophe.
ALBUM de papiers découpés originaux avec manuscrit autographe, signé « A. Schopenhauer », 1826 ; titre et 7 doubles pages oblong in-12 (10,8 x 14,5 cm) ; reliure de l’époque maroquin rouge, cadre de filets dorés et motifs à froid, éventails dorés en écoinçons.
Joli album de papiers découpés
Suite de 7 papiers découpés pour illustrer le poème Frühlings Einzug de Wilhelm MÜLLER, datée du 19 janvier 1826.
Wilhelm MÜLLER (1794 - 1827) est un poète allemand, dont Schubert a mis en musique de nombreux poèmes, notamment pour ses deux cycles de lieder, Die schöne Müllerin et le Winterreise
Adele Schopenhauer a copié elle-même le poème de Müller sur les pages de droite, et l’a illustré sur les pages de gauche de ses délicats papiers découpés à la manière des silhouettes.
Les compositions ou silhouettes de papier noir brillant, finement travaillées, sont montées sur papier rose. Après la page de titre, la représentation de l’hiver qui s’en va sous la forme d’un homme sauvage avec un traîneau illustre la première strophe ; plus le printemps, sous la forme d’un garçon ailé qui pousse l’hiver hors de la porte, illustre la deuxième strophe ; pour la 3 e strophe, une maison aux fenêtres ouvertes, avec une cigogne sur le toit, dans un décor campagnard où vivent de petites bêtes ; suit le printemps, marchant sur les nuages et soufflant du cor, au-dessus d’une scène champêtre ; puis une représentation du soleil en jeune guerrier tenant des lances ; enfin, un couple amoureux dans un décor champêtre entouré d’un arc de rayons pour la dernière strophe. En fin de volume, la signature « A. Schopenhauer » en lettres minuscules. Goethe avait introduit l’art du découpage du papier chez les Schopenhauer, comme Johanna Schopenhauer l’écrivait à son fils le 3 décembre 1806. Il avait amené une silhouette de Runge. Cela a inspiré Johanna à créer ses propres silhouettes, que Goethe a particulièrement appréciées. Déjà jeune fille, Adèle a acquis un talent très admiré dans cet art, que Goethe a célébré dans un poème comme « des formations tendres et ombragées ». Adele Schopenhauer a offert ce petit livre à son amie Julia Kleefeld de Dantzig. Une note de la main de Julia Kleefeld est jointe, dans laquelle elle lègue le livret au conseiller privé C. S. Abegg.
194 STENDHAL Henri Beyle, dit (1783 - 1842).
L.A.S. « De Beyle », Paris 12 mai 1812, « au Chef de Division de la Conscription » ; 1 page in-4 à en-tête du Conseil d’État
Lettre inédite
Comme « Aud[iteu]r att[ach]é à la S[ecti]on de la Guerre », il renvoie à son correspondant « les deux Décrets et la copie de rapport que vous avez eu la bonté de me confier, et que je n’ai pu vous adresser plutôt, parce que cette affaire n’a été mise à l’ordre qu’aujourd’huy »…
195 SUARÈS André (1868 - 1948).
MANUSCRIT autographe, [Dernières notes, vers 1948] ; carnet oblong in-8 (14 x 21 cm), 56 pages irrégulièrement remplies d’une petite écriture.
Précieux carnet inédit, recueil de pensées et réflexions intimes, à la fin de sa vie
Le titre « Dernières notes » a été ajouté d’une autre main sur la couverture.
Sur la première page, Suarès a envisagé pour ces notes, un titre et en a exposé le thème : « Titre : SECRETS. Sous ce titre, ponter, dans les Cahiers, mes hypothèses, pour moi seul, touchant le plein du fait, ou erreurs, ou prenant le pas sur la preuve. – Deux asymptotes dirigées l’une vers l’autre, sans pouvoir ses rencontrer par définition. Si des vecteurs interviennent, les figures varient. Les vecteurs ne fixent pas tous la position du point d’une courbe définie »… Etc.
Et plus loin : « On détruit l’ordre en le forçant. On détruit l’art si on le force, – et le droit et le reste. La nature fuit la contrainte. Comprendre la leçon de la liberté »…
Il est aussi question de la mort qui vient : « Tu aimes trop la vie ; qui te l’a permis ? Tu as volé ta part : paie comptant »…
À la fin du carnet, Suarès évoque Israël : « Israël, à la bonne heure. Et pourquoi pas ? Et d’ailleurs, c’est une rêverie ».
Puis il cite les écrivains russes et Pouchkine, avant de conclure : « Homme de tous les hommes. Un monde qui va de Lhassa à Mexico et aux Andes. Cosmopolite n’a pas de sens : la politique n’entre pas ici. Toute la place est à l’esprit et aux sentiments. […] La culture de l’éternel est celle de l’intuition ».
1 500 - 2 000
79 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
600 - 800
1 000 - 1 500
1 000 - 1 200
196 SWINBURNE Algernon Charles (1837 - 1909).
L.A.S., The Pines [Putney, Londres] 4 mai 1891, à une dame [Louise CHANDLER MOULTON ?] ; 1 page in-8 ; en anglais.
Au sujet de son ami mort, le poète Philip Marston
[Louise Chandler MOULTON (1835 - 1908) cherchait un éditeur pour publier les œuvres du poète anglais Philip Bourke MARSTON (1850 - 1887) ; elle publiera à Boston en 1892 The Collected Poems de Marston.]
Il serait heureux de lui recommander un éditeur, s’il savait à qui la recommander. Mais comme son propre éditeur lui a catégoriquement refusé un petit livre – toujours inédit – dédié à la mémoire de leur pauvre ami Philip Marston, et qui comporte, outre des sonnets et autres poèmes élégiaques écrits par Swinburne immédiatement après la mort de Marston, l’hommage de Mr Watts, publié dans l’Athenæum, elle comprendra que l’influence de Swinburne dans le monde éditorial est moins que rien…
« I should be happy to recommend a publisher to you if I knew of one to recommend. But as my own publisher flatly refused a little book – still unpublished – of my own, inscribed to the memory of our poor friend Philip Marston, & which would have contained besides my sonnets & other elegiac poems written immediately after his death, Mr. Wats’s memorial tribute reprinted from the Athenaeum, you will understand that my influence in the publishing world is rather less than nothing »…
197 TOULOUSE-LAUTREC Henri de (1864 - 1901).
L.A.S. « H. », Arcachon 7 août [1891], à sa mère, la comtesse Adèle de TOULOUSE-LAUTREC ; 1 page in-8.
« Tout va bien. Je suis toujours en bateau, et ai reçu une longue lettre de Papa qui semble désirer que je m’occupe directement de Ricardelle au cas ou Jalabert [gérant du vignoble familial de Ricardelle] viendrait à mourir. Le sujet est gros et demande à être traité de vous à moi. Je vous ferai voir la lettre, et nous verrons ce qu’il y a à faire ». Il viendra mardi ou mercredi à Malromé.
198 TROTSKI Léon (1879 - 1940) théoricien révolutionnaire et homme politique russe.
P.S. « Л Троцки » comme président du Soviet révolutionnaire militaire de la République, 9 janvier 1920 ; 1 page in-4 dactylographiée signée au crayon bleu, ; en russe. Ordre du Soviet révolutionnaire militaire de la République : nomination.
199 TURGOT Anne-Robert-Jacques (1727 - 1781).
L.A.S. « Turgot », Paris 11 février 1776, à M. DU PUY ; 2 pages in-4. Il est passé chez son correspondant : « mon dessein étoit de vous parler des vues que m’a fait naître la place que laisse vacante à l’Académie des belles lettres feu M r le Duc de S t Aignan mon beau-frère. Indépendamment de mon goût pour les lettres, j’ai peut-être quelques titres auprès de cette Academie. Mon père avoit l’honneur d’en être. J’avois désiré dès lors d’y entrer en qualité d’associé. Dans l’occasion qui se présente je serois très flatté du suffrage des savans qui composent l’Académie. Je vous serai très obligé, Monsieur, de vouloir bien prévenir de mon vœu ceux de ces messieurs que vous aurés occasion de voir et de m’indiquer les démarches que je dois faire auprès d’eux »…
200 VALÉRY Paul (1871 - 1945).
CARNET autographe, 1903 ; carnet in-12 (13 x 8 cm) de 18 ff., soit env. 29 pages au crayon, cartonnage moire verte. Précieux carnet de notes diverses, notamment sur la littérature À côté de schémas géométriques et de problèmes mathématiques, de comptes et situations bancaires, d’adresses (J.K. [Huysmans], Houssaye...), Valéry a noté de nombreuses pensées et réflexions : « j’ai remarqué que l’acquisition de toute connaissance consiste dans l’adoption de restrictions à la marche ou à la nappe imaginative »… ; « Les monologues d’Hamlet durent, dans le vrai, une seconde » ; « Toute entité n’est qu’une abréviation, une désignation d’expériences possibles »… ; « G. appartient à cette race d’écrivains qui sont agréables à lire et qui parfois attachent. Mais si on ferme son livre, il ne ressuscite pas de lui-même » ; « Le théâtre est le miroir des masses »… ; « Les beaux vers constituent et détruisent la poésie » ; « NIETZSCHE est un écrivain – un écrivain = un homme dont les fureurs font rire, doivent faire rire » ; « La stupidité des groupes. Les idiots se sentent les coudes »… Notes pour son testament destinées à Maître JOSSET : « Je désire qu’après mon décès nos enfants soient égaux en droits »… Etc. On relève deux croquis d’un plan d’appartement. Provenance : François VALÉRY, fils du poète (13 décembre 2007, n° 155).
800 - 1 200
1 000 - 1 200
800 - 1 000
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 80
150 - 200
1 200 - 1 500
201 VERLAINE Paul (1844 - 1896).
POÈME autographe signé « Paul Verlaine », Littérature, [1891] ; 1 page in-8, montée sur onglets sur papier fort en un volume in-8, reliure demi-maroquin rouge.
Publié dans La Revue Blanche de novembre 1891, ce poème sera recueilli en 1896 dans Invectives (L. Vanier, 1896) ; Verlaine a noté dans le coin supérieur gauche de notre manuscrit Invectives ; à gauche du titre Littérature, il a inscrit « (Epitre) ».
Le poème, en octosyllabes, est composé de 5 quintains. On relève une rature et quelques variantes.
Verlaine s’y plaint de ses « confrères mal frères », et de leur silence à son égard.
« Bons camarades de la Presse Comme aussi de la Poésie, Fleurs de mufflisme et de bassesse »…
On a joint une longue L.S. de Roger Lhombreaud, Oxford 10 juillet 1951, au sujet de Romances sans paroles
202
VOLTAIRE (1694 - 1778).
L.S. « Voltaire », au château de Ferney 27 août 1768, [à Antoine LE BAULT, conseiller au Parlement de Bourgogne] ; 1 page et demie in-4.
« Je me flatte que vous aurez d’excellent vin cette année, et que vous voudrez bien que j’en boive cent bouteilles. Mr. le Président de BROSSES me fait boire la lie du vin de la terre de Tourney ; si vous vendiez votre vin aussi cher qu’il vend le sien, vous feriez une fortune immense. S’il veut vous prendre pour arbitre, vous êtes un gourmet en fait de procédés, j’en passerai par ce que vous ordonnerez. Au reste, si Mr. de Brosses ne veut pas me rendre justice, j’aime mieux souffrir que plaider ; et quoique j’aie beaucoup perdu avec lui dans cette affaire, j’aime mieux mon rôle que le sien »…
On joint la copie par le même secrétaire d’une lettre de Voltaire au Président de BROSSES, 19 août 1768 (3 pages et demie in-4).
203 ZOLA Émile (1840 - 1902).
L.A.S. « Emile Zola », Paris 1er septembre 1864, [à Prosper FAUGÈRE] ; 1 page in-8 sur papier bleu à en-tête Libraire de L. Hachette et C ie, Boulevard Saint-Germain, 77 [Zola, âgé de 24 ans, est alors chef de service de la publicité chez l’éditeur Hachette, qui vient de publier l’édition par Prosper Faugère des Mémoires de Mme Roland, provoquant une polémique avec l’historien Charles Dauban, alors que le journaliste Philippe Dauriac doit leur consacrer un article, dans Le Monde illustré.]
« En l’absence de M. Templier, j’ai l’honneur de vous faire passer une lettre que nous venons de recevoir et à laquelle nous vous serions obligés de vouloir bien répondre quelques mots. Nous ferons remettre à M. Dauriac une liste des principales inexactitudes que vous avez relevées dans l’édition de M. Dauban. Mais il serait bon, ce nous semble, que vous fournissiez de votre côté quelques renseignements à ce journaliste qui pourrait ainsi édifier le public en connaissance de cause »…
On joint 2 feuillets de dessins à la plume et aquarellés par DESCAVES en 1915 et 1916 (probablement Victor DESCAVES, 1899 - 1959, fils aîné de Lucien Descaves) : – 5 portraits de poilus ; – soldat mort, avec citation du poème de Victor Hugo : « Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie »…
1 500 - 2 000
1 000 - 1 500
81 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
400 - 500
204 ZOLA Émile (1840 - 1902).
RECUEIL de lettres, pièces et notes autographes, dont plusieurs signées, et quelques documents d’une autre main, [Notes sur François Zola], 1868 - 1899 ; 85 pages autographes de formats divers, et 17 pages non autographes, le tout monté sur onglets et relié en un volume petit in-4 demi-maroquin violet (H. Jacquet-Riffieux).
Très bel ensemble de documents sur François Zola, ingénieur mort en 1847, dont Zola tiendra à réhabiliter la mémoire
François ZOLA (Venise 1795-Marseille 1847) s’était engagé dans la Légion étrangère en 1830, mais avait dû en démissionner en 1832, ayant été mêlé à une affaire de détournement de fonds, qui se solda par un non-lieu. Devenu ingénieur civil à Marseille, il conçut plusieurs projets d’envergure, dont celui de barrages et d’un canal d’adduction d’eau pour la ville d’Aix-en-Provence, où il s’établit avec sa famille en 1843. Il mourut brusquement, laissant sa famille couverte de dettes. Son fils écrira : « Mon père passe comme une ombre dans les souvenirs de ma petite enfance »…Pendant l’Affaire Dreyfus, Zola prendra la défense de son père, dont la mémoire avait été calomniée.
A. À propos d’une campagne à Aix-en-Provence, 1868 . 5 brouillons de lettres autographes ; et 4 lettres adressées à Zola. (Nous suivons ici l’ordre chronologique des lettres, et non celui de la reliure.)
[3 août], à REMONDET-AUBIN, directeur du Mémorial d’Aix (4 p. in-4). Zola proteste contre le refus du Mémorial d’insérer sa réponse à un entrefilet dirigé contre lui-même. « En effet, j’ai subi chez vous une barbarie : j’y ai vu mon père mourir à l’œuvre et y être ensuite lapidé jusque dans sa mémoire »… Il blâme vigoureusement le rédacteur, puis adopte un ton ironique pour reconnaître que Le Mémorial « n’a pas encore essayé d’effacer mon nom de la couverture de mes livres, comme il l’a souvent effacé en parlant du canal Zola »…
[3 août], à Léopold ARNAUD, directeur du Messager de Provence (1 p.). Il le prie d’insérer le texte de sa lettre au Mémorial, où on l’a attaqué « avec grossièreté ».
[12 août], à REMONDET-AUBIN (8 p.). Il relève dans le Mémorial une phrase injurieuse : « “M. Zola fils abuse un peu trop de M. Zola père.” Comment ! vous avez déjà assez de mes réclamations ! Mais je commence à peine. Vous n’avez donc compris que si j’ai gardé le silence pendant de longues années, c’est que j’attendais d’être fort ; je lutte depuis dix ans, j’ai grandi dans le travail et le courage, j’ai conquis ma position en me battant chaque jour contre la misère et le désespoir. Et vous voudriez aujourd’hui m’imposer silence […] Ah ! vous dites que j’abuse du nom de mon père, le jour où pour la première fois je vous reproche sévèrement votre oubli. Vous manquez de tact, vous manquez de cœur »…
[14 septembre], au Maire et aux membres du Conseil municipal de la ville d’Aix. « Mon père, M. François Zola, a doté d’un canal la ville que vous représentez. Je ne vous rappellerai pas ses longues démarches auprès du gouvernement, les luttes qu’il eut à soutenir dès le début, les succès qu’il avait obtenus lorsque la mort vint le saisir, au moment où il allait réaliser son projet déclaré d’utilité publique »… Pour que le créateur du canal qui alimente Aix en eau ne soit pas oublié, son fils demande quelque hommage à sa mémoire…
[Après le 19 décembre], au Maire et aux membres du Conseil municipal de la ville d’Aix. Il a reçu copie de leurs délibérations et du décret par lequel ils ont donné au boulevard du Chemin Neuf le nom de François Zola. « Je savais que je ne rappellerais pas les travaux de mon père, sans que votre générosité ne s’émût des retards mis à récompenser la mémoire d’un homme qui s’est dévoué aux intérêts des citoyens que vous représentez. […] Veuillez croire à ma reconnaissance profonde. Si je ne suis pas un fils de votre ville, j’ai grandi à Aix et je me considère un peu comme son enfant d’adoption. Aujourd’hui, un nouveau lien m’attache fortement à elle »…
Lettres adressées à Zola sur le même sujet par REMONDET-AUBIN (31 juillet 1868), L. MARGUERY (Aix, 1er août 1868 et Dimanche), et Pascal ROUX, maire d’Aix (6 novembre 1868, annonçant la décision du Conseil municipal de nommer le Boulevard Zola).
B. Lettres au général de Galliffet et à M. Waldeck-Rousseau, décembre 1899. MANUSCRIT en partie autographe et signé (18 p. in-4, dont 10 de la main de Madame Zola, qui a recopié les deux lettres à Galliffet, au bas desquelles Zola a apposé sa signature, ainsi que la réponse du ministre).
Cet échange de lettres entre Zola et le ministre de la Guerre le général de GALLIFFET et le ministre de l’Intérieur WALDECK-ROUSSEAU, a été publié dans L’Aurore du 19 décembre 1899 (le manuscrit a été découpé pour l’impression et remonté).
9 décembre, au général de GALLIFFET. « Un rédacteur du Petit Journal, M. Ernest Judet, au moment où je devais comparaître devant le jury de Versailles, a publié deux articles diffamatoires contre la mémoire de mon père, dans lesquels il a cité de prétendues lettres du colonel Combe, où mon père, lieutenant à la Légion étrangère, et se trouvant en Algérie (1832), était violemment accusé d’avoir détourné une somme, faisant partie de la caisse du régiment »... Le 3 août 1898, Zola a dénoncé Judet pour faux et usage de faux ; depuis, une ordonnance de non-lieu a provoqué une plainte de Judet contre Zola, pour dénonciation calomnieuse. L’écrivain, s’estimant victime d’une lâcheté politique, demande à voir le dossier de son père : « Il serait vraiment monstrueux qu’on l’ait ouvert pour un adversaire sans scrupule, et qu’on le referme pour moi, qu’on en refuse la communication au fils de l’homme […] dont on a violé la sépulture »… 14 décembre, Galliffet répond que toute communication de dossier est interdite. 16 décembre. Galliffet informe Zola, après enquête, que la seconde des lettres de Combe existe bien dans le dossier, et que ce dossier avait été remis à un officier du ministère en 1897, décédé depuis…
LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€) 82
5 000 - 8 000
16 décembre. Zola soumet à WALDECK-ROUSSEAU sa correspondance avec le ministre de la Guerre. « Nous sommes ici dans l’exception, et dans une exception cruelle, où j’espère avoir pour moi tous les honnêtes gens. Sans doute, je ne demanderais pas à connaître un dossier secret […]. Mais je demande à connaître le dossier de mon père, qu’un crime prévu par la loi a rendu public »… Il le prie de porter cette question devant le Conseil des Ministres qu’il préside, et fait remarquer que l’officier que le général ne nomme pas n’est autre que « le colonel Henry »…
C. L’enquête sur François Zola après les attaques d’Ernest Judet, 1899 - 1900. Brouillon de lettre autographe et signé, et notes autographes.
Paris 4 janvier 1900, au général de GALLIFFET, Ministre de la Guerre (12 p. in-4). Zola, accompagné de M e LABORI et de M. Jacques Dhur, a pris connaissance du dossier de son père et s’est entretenu avec les archivistes de la Guerre. L’absence quasi totale de traces écrites, et les souvenirs de l’un des archivistes de l’aspect qu’avait alors le dossier confidentiel, amènent Zola à soupçonner des vols de documents. Il prie le ministre d’ordonner de nouvelles recherches, en particulier pour savoir s’il existe des traces judiciaires de l’affaire dont on accuse son père. « Si mon père a été emprisonné, il a subi certainement un interrogatoire. S’il a fait des aveux, où sont-ils ? Il a dû expliquer sa conduite, où est donc sa défense ? »… Il demande en outre à retrouver un projet de fortifications de son père (1831 - 1840), et à permettre une expertise contradictoire de pièces dans le dossier de son père. « La lettre Combe, particulièrement, est pleine de telles irrégularités, de telles violations des règlements militaires en vigueur en 1832, de tels anachronismes et de tels enfantillages, qu’il me semble impossible qu’elle soit authentique »… Il commente son aspect matériel, fort suspect, et propose, en outre, une analyse chimique de l’encre, « pour bien fixer la date »…
NOTES autographes, à l’encre ou au crayon (24 p. in-4, et 30 p. in-12). Liste et résumé du contenu de lettres et mémoires de son père concernant des travaux à Marseille (agrandissement du port, projet de dock et de canal maritime), et à Aix-en-Provence (Canal Zola). Notes sur Galliffet et le Canal Zola, sous la monarchie de Juillet (Galliffet avait alors soutenu le projet). Copies de lettres de François Zola à Thiers et à Louis-Philippe, et d’un rapport au sujet des projets de fortifications. Notes sur des machines à terrasser et à transporter des terres. Références bibliographiques aux publications de son père. Notes au crayon, probablement prises sur le vif, sur le dossier administratif de son père, l’aspect de la lettre Combe, et les pistes à suivre. Notes sur les services militaires du colonel Combe, mort au siège de Constantine. Chronologie d’articles de presse, procès et démarches pour défendre la mémoire de son père, etc.
Exposition Zola, Bibliothèque nationale de France, 2002, n° 5.
Provenance : collection ÉMILE-ZOLA (vente Artcurial 23 mai 2005, lot A).
205 HALLER Alberto, Iconum Anatomicarum quibus aliquae partes corporis humani, Göttingen, 1781. In folio avec planches d’anatomie gravées. Ex
206 PÉRAU Gabriel Louis. Description historique de l’hôtel Royal des Invalides. Planches gravées. In - folio Manque la page de titre.
207 VANDER AA (Pierre).
Les royaumes d’Espagne et de Portugal représentées en tailles douces très-exactes, dessinées sur les lieux-mêmes, qui comprennent les principales villes, forteresses, montagnes, églises, monastères, maisons Royales, Palais, places publiques, fontaines, habits, ordres des chevaliers, fêtes, mausolées et autres choses digne de remarque, etc. Avec les cartes géographiques tant générales que particulières de ces deux royaumes.
Leide Vander AA s.d. (circa 1720)
in-4 oblong relié plein veau dos à nerfs à caissons fleuris Titre-frontispice, 165 vues gravées & 1 dépliante. Reliure usagée, mouillures marginales
83 Lettres, manuscrits, autographes, livres & photographies 10 octobre 2023 LOT DESCRIPTIF ESTIMATION (€)
libris (accidents) 200 - 300
200 - 300
3 000 - 5 000