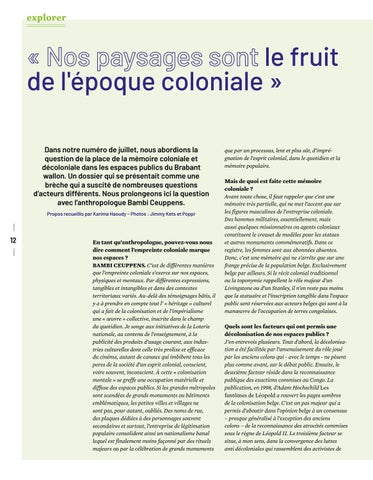explorer
« Nos paysages sont le fruit de l'époque coloniale » Dans notre numéro de juillet, nous abordions la question de la place de la mémoire coloniale et décoloniale dans les espaces publics du Brabant wallon. Un dossier qui se présentait comme une brèche qui a suscité de nombreuses questions d’acteurs différents. Nous prolongeons ici la question avec l’anthropologue Bambi Ceuppens. Propos recueillis par Karima Haoudy – Photos : Jimmy Kets et Poppr
12
En tant qu’anthropologue, pouvez-vous nous dire comment l’empreinte coloniale marque nos espaces ? BAMBI CEUPPENS. C’est de différentes manières que l’empreinte coloniale s’exerce sur nos espaces, physiques et mentaux. Par différentes expressions, tangibles et intangibles et dans des contextes territoriaux variés. Au-delà des témoignages bâtis, il y a à prendre en compte tout l’ « héritage » culturel qui a fait de la colonisation et de l’impérialisme une « œuvre » collective, inscrite dans le champ du quotidien. Je songe aux initiatives de la Loterie nationale, au contenu de l’enseignement, à la publicité des produits d’usage courant, aux industries culturelles dont celle très prolixe et efficace du cinéma, autant de canaux qui imbibent tous les pores de la société d’un esprit colonial, conscient, voire souvent, inconscient. À cette « colonisation mentale » se greffe une occupation matérielle et diffuse des espaces publics. Si les grandes métropoles sont scandées de grands monuments ou bâtiments emblématiques, les petites villes et villages ne sont pas, pour autant, oubliés. Des noms de rue, des plaques dédiées à des personnages souvent secondaires et surtout, l’entreprise de légitimation populaire consolident ainsi un nationalisme banal lequel est finalement moins façonné par des rituels majeurs ou par la célébration de grands monuments
que par un processus, lent et plus sûr, d’imprégnation de l’esprit colonial, dans le quotidien et la mémoire populaire.
Mais de quoi est faite cette mémoire coloniale ? Avant toute chose, il faut rappeler que c’est une mémoire très partielle, qui ne met l’accent que sur les figures masculines de l’entreprise coloniale. Des hommes militaires, essentiellement, mais aussi quelques missionnaires ou agents coloniaux constituent le creuset de modèles pour les statues et autres monuments commémoratifs. Dans ce registre, les femmes sont aux abonnées absentes. Donc, c’est une mémoire qui ne s’arrête que sur une frange précise de la population belge. Exclusivement belge par ailleurs. Si le récit colonial traditionnel ou la toponymie rappellent le rôle majeur d’un Livingstone ou d’un Stanley, il n’en reste pas moins que la statuaire et l’inscription tangible dans l’espace public sont réservées aux acteurs belges qui sont à la manœuvre de l’occupation de terres congolaises. Quels sont les facteurs qui ont permis une décolonisation de nos espaces publics ? J’en entrevois plusieurs. Tout d’abord, la décolonisation a été facilitée par l’amenuisement du rôle joué par les anciens colons qui - avec le temps - ne pèsent plus comme avant, sur le débat public. Ensuite, le deuxième facteur réside dans la reconnaissance publique des exactions commises au Congo. La publication, en 1998, d’Adam Hochschild Les fantômes de Léopold a rouvert les pages sombres de la colonisation belge. C’est un pas majeur qui a permis d’aboutir dans l’opinion belge à un consensus – presque généralisé à l’exception des anciens colons – de la reconnaissance des atrocités commises sous le règne de Léopold II. Le troisième facteur se situe, à mon sens, dans la convergence des luttes anti décoloniales qui rassemblent des activistes de