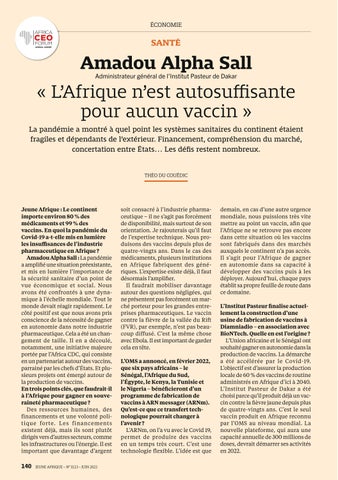ÉCONOMIE
SANTÉ
Amadou Alpha Sall Administrateur général de l’Institut Pasteur de Dakar
« L’Afrique n’est autosuffisante pour aucun vaccin » La pandémie a montré à quel point les systèmes sanitaires du continent étaient fragiles et dépendants de l’extérieur. Financement, compréhension du marché, concertation entre États… Les défis restent nombreux. THÉO DU COUËDIC
Jeune Afrique : Le continent importe environ 80 % des médicaments et 99 % des vaccins. En quoi la pandémie du Covid-19 a-t-elle mis en lumière les insuffisances de l’industrie pharmaceutique en Afrique ? Amadou Alpha Sall : La pandémie a amplifié une situation préexistante, et mis en lumière l’importance de la sécurité sanitaire d’un point de vue économique et social. Nous avons été confrontés à une dynamique à l’échelle mondiale. Tout le monde devait réagir rapidement. Le côté positif est que nous avons pris conscience de la nécessité de gagner en autonomie dans notre industrie pharmaceutique. Cela a été un changement de taille. Il en a découlé, notamment, une initiative majeure portée par l’Africa CDC, qui consiste en un partenariat autour des vaccins, parrainé par les chefs d’États. Et plusieurs projets ont émergé autour de la production de vaccins. En trois points clés, que faudrait-il à l’Afrique pour gagner en souveraineté pharmaceutique ? Des ressources humaines, des financements et une volonté politique forte. Les financements existent déjà, mais ils sont plutôt dirigés vers d’autres secteurs, comme les infrastructures ou l’énergie. Il est important que davantage d’argent
140
JEUNE AFRIQUE – N° 3113 – JUIN 2022
soit consacré à l’industrie pharmaceutique – il ne s’agit pas forcément de disponibilité, mais surtout de son orientation. Je rajouterais qu’il faut de l’expertise technique. Nous produisons des vaccins depuis plus de quatre-vingts ans. Dans le cas des médicaments, plusieurs institutions en Afrique fabriquent des génériques. L’expertise existe déjà, il faut désormais l’amplifier. Il faudrait mobiliser davantage autour des questions négligées, qui ne présentent pas forcément un marché porteur pour les grandes entreprises pharmaceutiques. Le vaccin contre la fièvre de la vallée du Rift (FVR), par exemple, n’est pas beaucoup diffusé. C’est la même chose avec Ebola. Il est important de garder cela en tête. L’OMS a annoncé, en février 2022, que six pays africains – le Sénégal, l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Kenya, la Tunisie et le Nigeria – bénéficieront d’un programme de fabrication de vaccins à ARN messager (ARNm). Qu’est-ce que ce transfert technologique pourrait changer à l’avenir ? L’ARNm, on l’a vu avec le Covid 19, permet de produire des vaccins en un temps très court. C’est une technologie flexible. L’idée est que
demain, en cas d’une autre urgence mondiale, nous puissions très vite mettre au point un vaccin, afin que l’Afrique ne se retrouve pas encore dans cette situation où les vaccins sont fabriqués dans des marchés auxquels le continent n’a pas accès. Il s’agit pour l’Afrique de gagner en autonomie dans sa capacité à développer des vaccins puis à les déployer. Aujourd’hui, chaque pays établit sa propre feuille de route dans ce domaine. L’Institut Pasteur finalise actuellement la construction d’une usine de fabrication de vaccins à Diamniadio – en association avec BioNTech. Quelle en est l’origine ? L’Union africaine et le Sénégal ont souhaité gagner en autonomie dans la production de vaccins. La démarche a été accélérée par le Covid-19. L’objectif est d’assurer la production locale de 60 % des vaccins de routine administrés en Afrique d’ici à 2040. L’Institut Pasteur de Dakar a été choisi parce qu’il produit déjà un vaccin contre la fièvre jaune depuis plus de quatre-vingts ans. C’est le seul vaccin produit en Afrique reconnu par l’OMS au niveau mondial. La nouvelle plateforme, qui aura une capacité annuelle de 300 millions de doses, devrait démarrer ses activités en 2022.